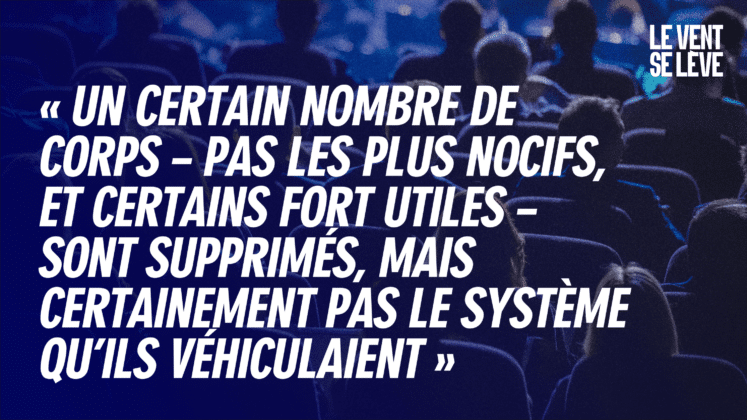L’annonce récente de la privatisation d’ADP et de la Française des Jeux a fait resurgir la question des privatisations au cœur du débat national. Si ces privatisations ont fait l’objet de vives critiques, leur adoption est désormais pratiquement actée, sauf si le référendum d’initiative partagée devait aboutir pour ADP. Par-delà la mutation économique de premier ordre que constitue ce geste, on peut aussi se demander ce que cela dit du rôle de l’État en France, de plus en plus désengagé et minoré. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de supprimer l’ENA et les grands corps ; la conception du service de l’État à la française semble donc réduite de toutes parts. Afin de mieux cerner l’idéologie à l’œuvre dans ces réformes, nous nous sommes entretenus avec François-Xavier Dudouet, sociologue chercheur au CNRS et à l’Université Paris-Dauphine, co-auteur de Les grands patrons en France : du capitalisme d’État à la financiarisation (Lignes de repères, 2010).
LVSL – Les voix réfractaires aux privatisations de la loi Pacte ont été très vives, avec plusieurs recours déposés devant le Conseil constitutionnel et le déclenchement par plusieurs groupes parlementaires du Référendum d’initiative partagée – RIP – contre ce projet. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette proposition de privatisation fait l’objet de tant d’objections ? Quelles seraient les conséquences concrètes de l’adoption de la loi Pacte ?
François-Xavier Dudouet – Cette levée de boucliers est en soi un événement. Sur le plan parlementaire, je pense que c’est la première fois que la gauche et la droite s’unissent contre un projet de privatisation. Auparavant, la gauche était plutôt contre les privatisations, tandis que la droite y était plutôt favorable. C’est très étrange de les voir réunies, là en 2019, contre ce qui reste à privatiser, en l’occurrence les aéroports de Paris et la Française des Jeux. C’est aussi une surprise parce que il y a un large consensus populaire contre la privatisation. Un sondage indique que 48 % des Français sont opposés à la privatisation d’ADP, contre seulement 20 % qui seraient pour. Et ça aussi, c’est assez nouveau, cette mobilisation contre les privatisations. En tant que sociologue qui travaille depuis un certain nombre d’années sur le sujet, j’interprète cette mobilisation de la part des Français comme une demande d’État. Je pense qu’à travers ADP, les Français veulent plus d’État. Et ils ont bien vu qu’avec les privatisations, c’est toujours moins d’État qui est proposé. Face aux inquiétudes actuelles, diffuses, qui sont globales, qui donnent l’impression d’un monde incertain, ils se retournent vers un État, dont le rôle historique en France est d’être protecteur. Ce que les Français recherchent à travers l’État, c’est une protection : face à la mondialisation, face aux extrêmes, mais aussi face aux migrations, face à tout un tas de choses complètement diffuses, qui ont tendance à se mélanger, et qui se cristallisent à mon sens dans la demande de plus d’État. C’est pour cela que l’on peut avoir des partis extrêmement opposés qui se retrouvent malgré tout sur cette idée commune.
LVSL – La France n’est pourtant pas novice en termes de privatisations. C’est un mouvement que l’on a vu s’engager depuis les années 1980 : l’État s’est progressivement désengagé de son monopole économique, pour privatiser de grandes entreprises nationales comme Saint-Gobain, Paribas, France Télécom ou encore les sociétés d’autoroutes. Quel est donc l’intérêt que représente la cession de biens collectifs à des groupes privés ? Est-ce que les privatisations tiennent vraisemblablement leur promesse de solution miracle pour redresser l’économie ?
François-Xavier Dudouet – Avant de porter un jugement sur les privatisations, il faut essayer de se souvenir du contexte dans lequel elles ont été engagées. Elles prennent naissance au début des années 1980 un peu partout dans les pays occidentaux, pour pallier une crise économique qui est apparue dans les années 1970, à une époque où l’État était assez présent, notamment au Royaume-Uni, en France ainsi que dans d’autres pays européens. L’idée était que la régulation keynésienne de l’économie axée sur la consommation était arrivée à bout de souffle. Est-ce que c’était le bon diagnostic ? Je n’en suis pas sûr, il n’empêche que c’est celui-là qui a triomphé. Donc pour redynamiser l’économie des pays industrialisés, il fallait privatiser, faire entrer la concurrence et réduire la place de l’État qui protège les monopoles et les statuts. C’était la solution proposée pour enclencher un nouveau cycle de prospérité et sortir de la crise, du chômage de masse, afin de relancer l’industrie. Cette relance de la prospérité par l’accroissement de la concurrence n’a jamais été démontrée théoriquement. Mais les gens y ont cru. On y croyait d’autant plus qu’on était dans un contexte de Guerre froide, que le contre-modèle était vivant, c’était le communisme soviétique, qui lui était en pleine décomposition. Donc, avant de condamner nos parents, il faut rappeler ce contexte de Guerre froide, et de remise en cause des paradigmes économiques du moment. Idéologiquement, cela peut se défendre. Mais en retour je pense qu’il n’y a pas d’autres raisons qu’idéologiques aux privatisations.
En effet, la plupart des promesses qui étaient associées aux privatisations n’ont pas été tenues. Tout d’abord, l’idée de redynamiser l’économie pour réduire le chômage de masse ne s’est pas vérifiée. Même aujourd’hui ceux qui disent que le chômage a pu être réduit n’invoquent pas les privatisations, mais la dérégulation du travail, comme en Allemagne avec les lois Hartz. Donc ce n’est pas les privatisations qui ont permis de réduire le chômage, qui reste d’ailleurs très élevé. Ensuite, ce que l’on sait aussi grâce à plusieurs rapports, c’est que les entreprises qui ont été privatisées n’ont pas créé d’emplois. Au contraire, elles en détruisent, comme toutes les grandes entreprises, quand elles n’ont pas tout simplement disparues (AGF, Péchiney, Alcatel). Une grande entreprise ne crée pas d’emplois, une grande entreprise détruit des emplois. Je parle en équivalent temps plein, ce qui peut aussi signifier une augmentation du travail précaire, notamment chez les sous-traitants. Donc l’idée que les privatisations sont un facteur d’amélioration des conditions d’emploi est un leurre.
LVSL – Quelles sont alors les conséquences à terme de cette évolution radicale de l’économie française ? Sur la question des inégalités, de l’accès aux services, du coût et de la gestion de ceux-ci ?
François-Xavier Dudouet – L’autre argument était que les privatisations offriraient un meilleur service aux usagers. Là aussi, il n’y a aucune étude qui a permis de le démontrer. Au contraire, ce que l’on sait, par exemple du Royaume-Uni, c’est que le service ferroviaire a été tellement dégradé que l’État a dû renationaliser le réseau. Donc ce n’est pas vrai que les entreprises privatisées offrent nécessairement un meilleur service. Par exemple, dans le parc aérien européen, c’est vrai que les billets coûtent moins cher, mais le service est bien plus mauvais qu’avant. Pour les sociétés d’autoroutes, on se demande où est la plus-value du service apporté. Il y a moins de personnel, de plus en plus de services automatisés, mais pas plus d’investissements. Donc l’idée que la compétitivité apporterait nécessairement un meilleur service est aussi une idéologie que l’on trouve dans la littérature libérale, mais qui n’a jamais été prouvée par les faits. L’autre argument avancé en faveur des privatisations est celui selon lequel l’État n’était plus en mesure de financer les entreprises, et donc qu’il fallait passer par les marchés financiers pour financer les groupes publics. Or, la bourse ne finance pas les grandes entreprises. En 2017 et en 2018, les entreprises du CAC 40 n’ont fait aucune émission publique d’actions. Il n’y a donc pas eu de rentrée d’argent via la bourse. Par contre, elles ont versé des dividendes records, à des gens qui ne leur ont jamais apporté le moindre centime. Ce n’est pas parce que vous êtes actionnaire que vous investissez. Quand une action est échangée sur les marchés financiers, le prix de la transaction va dans la poche du vendeur, non dans celle de la firme. Les seuls moments où les entreprises touchent de l’argent des actionnaires, c’est quand elles émettent des actions. Or, cela fait bien longtemps que les grandes entreprises ne font plus de programmes massifs d’émission. De plus, quand l’État vend ses actions, il ne donne pas le prix de la vente à l’entreprise. Il garde l’argent pour lui. Donc, ce n’est pas parce que vous privatisez une entreprise que vous améliorez son financement.
En privatisant, l’État ne permet pas aux entreprises privatisées d’avoir de nouvelles sources de financement, mais au contraire, il les assujettis à d’autres ayants droits que lui.
En privatisant, l’État ne permet pas aux entreprises privatisées d’avoir de nouvelles sources de financement, mais au contraire, il les assujettis à d’autres ayants droits que lui ; ce sont les actionnaires, qui somment les entreprises de verser des dividendes de plus en plus importants chaque année, sans pour autant les financer, puisqu’une action, c’est un droit, et non un devoir. Ce n’est pas parce que vous avez une action que vous devez financer l’entreprise. En revanche, vous êtes toujours en droit de toucher des dividendes. Il y a donc deux sources de financement qui viennent combler ce manque. D’une part, l’auto- financement, et d’autre part, les banques. Mais c’est de plus en plus l’auto-financement, qui est réalisé par deux moyens, par l’actionnariat salarié, mais surtout par la réduction des coûts. C’est-à-dire qu’on augmente les ventes, on augmente la productivité, on diminue les coûts, on diminue le nombre d’employés. Il faut cependant noter que les grandes entreprises ne fonctionnent pas sur un modèle libéral, mais sur un modèle monopolistique. C’est pour ça qu’il y a une ambiguïté à dire que les grandes entreprises sont néo-libérales. Qui dit libéral dit libre concurrence. Or les grandes entreprises ne favorisent pas la compétition économique au contraire, elles fonctionnent de manière très monopolistique. Elles sont, d’ailleurs, régulièrement condamnées pour ententes illicites par les instances européennes. L’idéologie est libérale, mais le fonctionnement des grandes entreprises est tout sauf libéral.
LVSL – En quoi selon vous la privatisation des entreprises publiques fragilise-t-elle la définition même de l’État ? Quelle transformation radicale des champs du pouvoir et du contrôle de la puissance est-ce que cela implique ? Pensez-vous que nous assistons à un délitement de l’État moderne ?
François-Xavier Dudouet – C’est effectivement le cœur de mes travaux : les privatisations ne sont pas un geste anodin. C’est-à-dire que si on laisse de côté l’aspect idéologique, elles ont pour effet pratique et concret d’affaiblir l’État. Parce que l’État, en tout cas en France, s’est construit grâce à des monopoles, sur la fiscalité, sur la violence physique et sur une certaine emprise sur l’économie. Il en tire sa puissance économique, mais aussi sa capacité à apporter une protection sociale, et à réguler la société. A partir du moment où vous retirez à l’État son bras économique, non seulement vous l’appauvrissez, mais en plus, vous diminuez sa puissance et sa capacité d’intervention. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé avec les privatisations, et en particulier avec la privatisation de la monnaie. À savoir, l’indépendance de la Banque de France d’un côté, et la privatisation des banques de l’autre côté. Un ancien inspecteur des finances, membre du cabinet d’Édouard Balladur dans les années 1980, donc au moment des privatisations, m’a même avoué lors d’un entretien « On a peut-être été trop loin. Il aurait mieux valu garder une banque publique forte ». En effet, derrière les banques, c’est la création de la monnaie qui est en jeu donc le financement de l’économie. En rendant la Banque de France indépendante pour qu’elle puisse rentrer dans la zone euro, l’État a effectivement perdu sa souveraineté sur la monnaie, et donc sa capacité d’agir et d’orienter la vie économique du pays. C’est certainement une dépossession de l’État et de ses moyens d’action. À travers les privatisations, c’est un modèle d’organisation de la société qui n’est pas du tout français qui voit le jour. L’État français a toujours été un État centralisé, mais jamais complètement : il y avait des relations de collusions, que l’on pouvait critiquer entre le grand capital et l’État. Cela était incarné, par exemple, par la mobilité des hauts fonctionnaires, qui partaient pantoufler dans le privé, allant prendre des positions de direction. Mais cette mobilité était aussi une courroie de transmission : c’était le signe d’une certaine régulation ou cogestion de l’économie au plan national. À partir du moment où l’on a dit qu’il fallait rompre cette relation très forte entre les grandes entreprises et l’État, et bien en fait on a non seulement réduit le rôle de l’État, mais on a aussi affaibli la puissance et la souveraineté de la France.
A partir du moment où vous retirez à l’État son bras économique, non seulement vous l’appauvrissez, mais en plus, vous diminuez sa puissance et sa capacité d’intervention.
Historiquement, le capitalisme français est un capitalisme d’État, et ce même au XIXème siècle, avec le lancement des grandes banques et des compagnies ferroviaires : l’État intervenait alors directement pour fixer les prix. C’est-à-dire que, l’activité économique en France n’a jamais été absolument libre, contrairement aux États-Unis, par exemple. L’État a toujours été présent de manière très forte, d’où aussi la critique marxiste selon laquelle l’État est l’agent du capitalisme. C’est une symbiose entre l’autorité publique, souveraine, et l’activité économique. Le projet des privatisations était de couper ce lien. Toutefois, on a brisé un modèle non seulement économique, mais aussi, dans une certaine mesure, ce qui faisait l’État français. La France est un pays qui s’est constitué par l’État. Le remettre en cause, c’est remettre en cause la France elle-même. Toute l’historiographie française est construite autour de la construction de l’État. L’histoire de France se confond avec celle de ses rois, autrement dit avec celle de l’État moderne occidental, dont la France reste un modèle mondial. Il est là le mythe fondateur de la France. C’est l’État qui a fait la nation française. Le Français est Français parce l’État préexiste à la nation. Donc la rupture qui se joue avec les privatisations, c’est de dire que l’État n’est plus là pour guider et bâtir la nation, l’État doit laisser place à d’autres acteurs. Il s’agit d’une rupture historique fondamentale. Pour reprendre le mot de De Gaulle, c’est « une certaine idée de la France » qui s’effondre. Je pense que les sociétés existent à travers leurs mythes. Si vous retirez ses mythes à une société, elle cesse d’exister. C’est donc bien plus qu’une mutation économique, c’est une mutation des mentalités, des comportements qui est à l’œuvre. Et pour revenir au début de notre entretien, c’est en raison de cet effacement étatique que les gens sont vent debout, contre les privatisations et de manière générale contre Emmanuel Macron, parce qu’ils sentent bien qu’il mène une politique qui contribue à affaiblir encore un peu plus l’État. Et l’affaiblissement de l’État, c’est non seulement l’affaiblissement de leurs niveaux de vies, mais aussi une remise en cause profonde de leur identité.
LVSL – Vous expliquez dans une vidéo réalisée par DataGueule que « Nous sommes dirigés par des gens qui sont convaincus de l’inutilité de l’institution qui les a faits ». Pensez-vous que la récente annonce d’Emmanuel Macron à propos de la suppression de l’ENA et des grands corps est un exemple supplémentaire de ce phénomène ? Que va impliquer concrètement cette mutation dans le recrutement des fonctionnaires ?
François-Xavier Dudouet – Absolument. Le problème de l’ENA, ce n’est pas qu’il y ait une grande école qui produise des hauts fonctionnaires au service de la République et de l’État. Le problème de l’ENA, c’est qu’elle produit des gens qui sont convaincus qu’il faut détruire l’État et que leur carrière, pour être réussie, doit nécessairement aboutir en dehors de l’État. Aujourd’hui, vous avez plus de la moitié des inspecteurs des finances qui sont dans l’entreprise, qui ne servent pas l’État. Donc le problème de l’ENA, c’est qu’elle sert une idéologie qui n’est plus l’idéologie de l’État mais celle du marché. Quand Emmanuel Macron dit qu’il faut supprimer l’ENA, effectivement, il travaille à la décomposition de l’État français. L’une des forces de l’État français, que d’autres pays peuvent nous envier par ailleurs, c’est une logique du concours qui est très forte, et un système scolaire qui est tout entier tourné vers le service de l’État. Vous prenez les trois plus grandes écoles du système scolaire français : les Écoles normales supérieures, Polytechnique et l’ENA, ce sont des écoles qui sont destinées au service public. Or, aujourd’hui, les fonctionnaires qui sont issus de ces écoles sont persuadés que la vérité est ailleurs que dans les institutions qui les ont faits, et ce vers quoi elles les destinent a priori. Pourquoi a-t-on progressivement éduqué nos élites à servir une idéologie et un modèle qui n’était pas celui du service public à la française ? Pourquoi avoir introduit des modes de pensées anglo-saxons, non pas comme des savoirs parmi d’autres, mais comme des vérités incontestables ? C’est à mon sens la grande question civilisationnelle de notre époque. Dans quelle mesure nous ne sommes pas entrés dans un nouvel empire. Si jamais nos élites ne travaillent plus à la promotion et à la sauvegarde de l’État français, alors pour qui travaillent-elles ? Visiblement elles travaillent pour un modèle prétendument libéral qui est le modèle américain. Le pire est que souvent elles ne s’en rendent même pas compte. Elles sont souvent convaincues que l’État est trop puissant, trop présent, trop gros, mais sans savoir d’où vient cette idéologie, et ce qu’elle porte en terme de projet civilisationnel. Elles se rendent malgré elles complices d’une inféodation de la France à une puissance étrangère.
Concernant le recrutement des fonctionnaires, dans le cas où l’ENA, ou son équivalente, serait vraiment supprimée, un système dit des dépouilles pourrait apparaître. C’est le modèle encore pratiqué aux États-Unis. Chaque nouveau président renvoie et nomme une partie importante des hauts fonctionnaires, donnant libre cours à un système de clientélisme particulièrement développé. Est-ce cela qui est envisagé par la suppression de l’ENA ? Si vous n’avez plus la procédure anonyme du concours, qui est relativement fiable, même s’il y a des biais certains, quelle autre procédure mettre en place ? Le système du concours permet une certaine égalité de traitement et offre quand même à des gens qui ne sont pas issus des cercles du pouvoir d’y accéder. Une étude récente a montré que 70% des énarques étaient issus des classes supérieurs, mais il faut compter dans ce chiffre les fils de professeurs certifiés et agrégés, ainsi que les enfants d’artistes. En fait les énarques fils d’énarques ou de hauts fonctionnaires sont moins de 5%. Il existe donc une proportion non négligeable d’énarques qui ne sont pas issus de ce que l’on entend communément comme la classe dirigeante. Le système dit des dépouilles ou de la cooptation directe, ne garantit absolument pas un recrutement plus diversifié ! Il ne suffit pas de faire appel à la société civile pour promouvoir l’égalité des chances. De plus, ce n’est pas parce que vous diversifiez les origines sociales que vous améliorez le gouvernement. Il y a là aussi une illusion à croire que, parce que vous avez des gouvernants à l’image de la société, alors vous aurez de meilleurs dirigeants. C’est une croyance qui n’est absolument pas démontrée. D’ailleurs, toutes les études sur la mobilité sociale montrent l’inverse. Les individus en phases d’ascension, notamment si celle-ci est forte, ont tendance a épouser les valeurs et représentations du groupe d’accueil et à prendre de la distance avec leur milieu d’origine. Donc la croyance qui veut que, plus le gouvernement est diversifié, meilleur il soit, n’est pas fondée. La meilleure manière de garantir une impartialité, c’est finalement de convaincre les apprentis gouvernants d’un certain ethos, de certains principes professionnels. C’est de les former à une certaine idée du service public et de l’État. Si on part du principe que, parce qu’on est fils d’ouvrier, alors on sera meilleur dirigeant qu’un fils de grand bourgeois, c’est complètement naïf. C’est une nouvelle manière de jeter de la poudre aux yeux, et de déresponsabiliser l’exercice du pouvoir. Donc supprimer l’ENA au nom de la diversité sociale, c’est quelque chose qui n’a pas été réfléchi, et n’aura pas les conséquences attendues.