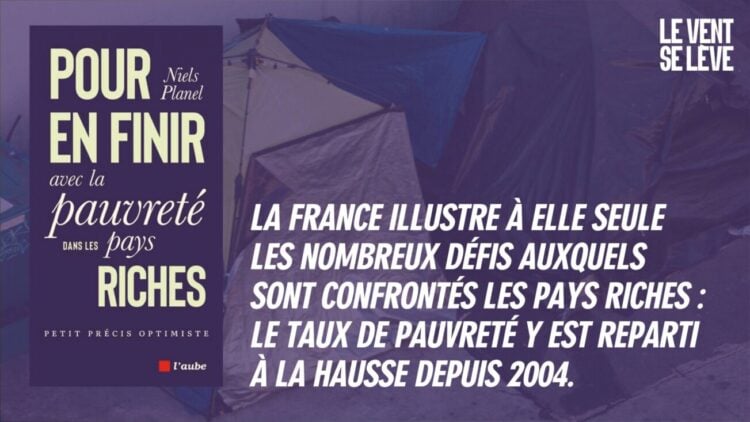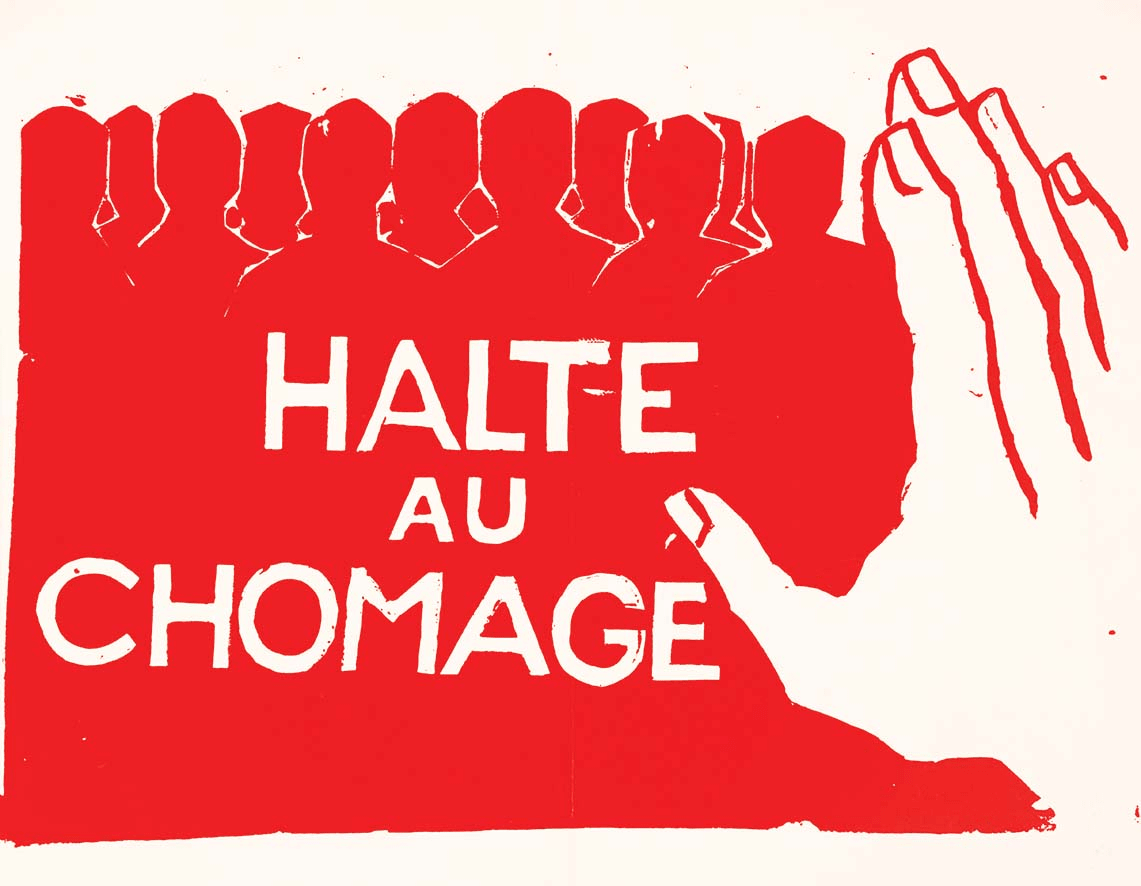Comment peut-on accepter que nos sociétés, plus riches que jamais, voient de nouveau se développer une pauvreté qu’elles avaient cru pouvoir éradiquer au siècle dernier ? Le sous-titre du dernier ouvrage de Niels Planel constitue alors un pied de nez à tous les discours pessimistes qui associent la pauvreté à une fatalité : ce « petit précis optimiste » cherche en effet à « en finir avec la pauvreté dans les pays riches » (Éditions de l’Aube, 2025). L’auteur, qui conseille des organisations internationales, des entreprises et des municipalités sur les enjeux de croissance inclusive et d’innovation sociale, montre ainsi comment on pourrait, dès demain, changer la vie de millions de personnes défavorisées, du berceau à la retraite. La clé, selon lui : combiner trois mesures concrètes, peu coûteuses et déjà expérimentées ici ou là, dont l’articulation garantirait à chacune et à chacun les moyens de développer pleinement ses possibilités. Extraits.
Et si l’on pouvait s’attaquer en profondeur au défi de la pauvreté qui habite encore nos sociétés malgré leur richesse sans précédent ? Et s’il existait des solutions nouvelles, mais éprouvées, testées grandeur nature à une échelle raisonnable, et riches en leçons, que l’on pourrait relier entre elles pour qu’à chaque étape clé de la vie, il existe un filet de sécurité universel pour prévenir la bascule dans la pauvreté ?
Justement : ce petit précis narre les obstacles que les plus fragiles rencontrent aujourd’hui aux divers âges de la vie, et les prouesses que certains ont réalisées pour y apporter des solutions aussi efficaces et ingénieuses que peu coûteuses. Mieux : le présent ouvrage noue ces prouesses ensemble pour proposer un projet de société inédit.
Les pages qui suivent vont mener leurs lecteurs d’un quartier de New York à la France rurale, de la Californie ensoleillée à la Finlande enneigée, du Royaume-Uni à l’Autriche, dans une école unique jusqu’aux portes d’entreprises pas tout à fait comme les autres. Parce que notre lutte contre les aspects les plus sombres de la pauvreté a été pavée de victoires significatives et parce que des innovations contemporaines en repoussent encore les limites, ces pages sont rédigées sur un ton optimiste. Elles combattent certaines idées reçues à l’égard de l’indigence tout en retraçant son histoire du Moyen Âge à nos jours, et offrent un nouvel horizon, atteignable, pour nos sociétés.
Faire tenir passé, présent et devenir possible d’un malheur qui a pesé sur tant de femmes et d’hommes en un petit précis est certainement une gageure. Mais si elles le méritent, rien n’honorerait plus ces pages que de faire l’objet de débats passionnés et passionnants, de susciter des idées, des critiques ou des alternatives de part et d’autre.
Car ce petit précis optimiste toucherait également à son but s’il contribuait à remettre à l’ordre du jour un impératif trop oublié, celui d’honorer la « dette inviolable et sacrée » que nous avons à l’égard de celles et ceux, encore si nombreux, encore trop nombreux, qui traversent l’existence comme une bien sombre succession de champs de bataille. En somme, de faire de l’éradication de la pauvreté une ambition nouvelle chez les prochaines générations.
Les pays riches face au retour de la pauvreté
Pour qui veut bien tendre l’oreille, les deux cents dernières années nous racontent une jolie histoire, celle d’un progrès majeur. Sous des couches d’atrocités, de guerres, de crises, de maladies et de malheurs, on peut voir une courbe s’incliner obstinément. Celle de l’extrême pauvreté, de cette misère absolue et indicible qui lacère et accable encore plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde aujourd’hui.
Vers 1820, la vaste majorité de la planète en souffre. En 2025, elle a virtuellement disparu de bien des recoins du globe, à commencer par l’Occident, dès les années 1960. Sur ces quarante-cinq dernières années, c’est-à-dire en un temps record à l’échelle de l’humanité, c’est la Chine qui extrait des centaines de millions de personnes de l’indigence la plus dure. L’Inde, à son tour, semble obtenir des résultats réels. Pour autant, c’est dans ses régions les plus rurales, ainsi qu’en Afrique (notamment des pays à larges populations, comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, etc.) que se joue la suite de cette incroyable et belle aventure, qui vise à soulager les plus précaires d’un fardeau aussi lourd qu’injuste.
Nous nous intéresserons dans ces pages à une autre affaire, celle de la pauvreté en Occident. Pour simplifier, vivre dans l’extrême pauvreté au niveau mondial signifie disposer de moins de 2,15 dollars par jour. Toutefois, certains économistes estiment que le seuil dans les pays à hauts revenus, comme la France, est de moins de 4 dollars en raison des besoins supplémentaires spécifiques à ces pays. Cette situation reflète un état de privations matérielles particulièrement sévères. En revanche, la pauvreté relative dans les pays riches se mesure par rapport à la distribution des revenus dans le pays. En Europe, cela signifie souvent avoir accès à plus de services qu’en situation d’extrême pauvreté, mais les conditions de vie restent très difficiles. Par exemple, en France, le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. En 2021, cela correspondait à un revenu disponible de 1 158 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 432 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, selon l’Insee.
Nous verrons rapidement qu’il y a d’autres manières d’appréhender ces questions que sous le seul angle monétaire. Me revient d’ailleurs immédiatement à l’esprit l’anecdote de ce voyageur qui se rendait naguère souvent en Afghanistan, l’un des pays les plus pauvres de la Terre, et expliquait que si l’on avait dit à des paysans qui avaient de quoi faire de bons repas au quotidien et se faire tailler des costumes sur-mesure qu’ils étaient pauvres, ceux-ci auraient souri.
Pourquoi s’intéresser dans ce livre aux pays les plus riches ? Peut-être d’abord parce que leurs avancées sociales inspirent aussi d’autres régions du globe, comme me le rappellent parfois mes amis des pays en voie de développement. Ensuite, parce que depuis plusieurs décennies, et sous la pression de la mondialisation et des technologies, l’Occident n’a su protéger les plus fragiles de profonds chocs sociaux qui ont fait émerger de nouvelles formes de précarité. Parmi ces défis, on peut citer en vrac l’émergence et la persistance des malheurs des travailleurs pauvres et des chômeurs de longue durée, l’insécurité de l’emploi pour les jeunes non qualifiés, une classe moyenne fragilisée, la vulnérabilité des mères célibataires et de leurs enfants ainsi que l’arrivée de migrants et de réfugiés parfois pris au piège de la précarité, de l’anxiété et de la dépression une fois installés dans nos sociétés.
Voire, dans certains pays, des phénomènes plus troublants : épidémie de solitude, crise des opioïdes et hausse des morts de désespoir. Le Nobel d’économie britannico-américain Angus Deaton estime ainsi que, sans se fermer au reste du monde pour autant, nous avons évidemment l’obligation de nous occuper des plus fragiles dans nos sociétés. L’ensemble des défis auxquels ils sont confrontés est exacerbé par les inégalités, à une époque où la richesse s’accumule de plus en plus par l’héritage plutôt que par l’entrepreneuriat, une tendance qui s’amplifiera bientôt lorsque certains baby-boomers laisseront des dizaines de milliers de milliards à leurs héritiers tandis que d’autres, si ce n’est la plupart, ne recevront presque rien.
On regroupe en général ces pays au sein d’un club, celui de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Là encore, leur trouver une définition commune n’est pas toujours intuitif : car quoi de commun, disons, entre le Danemark, qui a l’un des taux de pauvreté les plus bas au monde, et les États-Unis, où des poches de misère profonde subsistent et se creusent ? Et comment faire quand les méthodes de mesure de la pauvreté ne sont pas exactement les mêmes ? Nous appellerons à défaut « Occident » cet ensemble qui recouvre grosso modo l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
La France illustre à elle seule les nombreux défis auxquels ils sont confrontés : le taux de pauvreté y est reparti à la hausse depuis 2004, et si l’on ne peut parler d’explosion, il est toutefois raisonnable de parler d’un retournement inquiétant de tendance. Qu’on en juge : l’une des dix premières puissances économiques mondiales compte plus 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, plus de 2 millions de chômeurs de longue durée, près d’1 million de travailleurs pauvres, des Gilets jaunes alertant sur les fins de mois difficiles, un tiers des mères seules vivant sous le seuil de pauvreté, un précaire sur deux ayant moins de 30 ans, et près de 300 000 personnes vivant sans logement, le tout, alors que, selon le journal Financial Times, 80 % des milliardaires français ont hérité leur fortune.
Il est vrai que les deux cents dernières années envoient un signal formidable quant à ce que nous sommes capables de faire. Ainsi donc, l’Occident a, sans doute le premier, les moyens de triompher de la pauvreté et, ce faisant, de tracer un chemin.
Dans ce contexte global, certains restent pourtant optimistes au regard de ce qui a été accompli dans les deux derniers siècles et annoncent même que « l’histoire de la fin de la pauvreté a tout juste commencé » [référence à un ouvrage de Max Roser, paru en 2022, NDLR], même si ce combat prendra du temps. Il est vrai que les deux cents dernières années envoient un signal formidable quant à ce que nous sommes capables de faire. Ainsi donc, l’Occident a, sans doute le premier, les moyens de triompher de la pauvreté et, ce faisant, de tracer un chemin. Le présent essai se propose de dessiner une trajectoire de vie, du berceau à la retraite, reposant sur trois idées simples, qui doivent permettre de tendre vers cet horizon d’une société sans pauvreté. […]
Mettre l’État au service de l’emploi
Doté d’une éducation de qualité et d’un capital pour démarrer la vie d’adulte sur des fondations solides, vous finissez néanmoins par vous retrouver au chômage : votre usine a été délocalisée, votre start-up a payé un tribut mortel à une crise économique ou à une pandémie, un divorce ou la perte tragique d’un enfant vous a laissé incapable de rebondir. Vos compétences ne sont plus à jour, et à votre âge, il n’est pas toujours facile de se former à nouveau. Ou des problèmes de santé ou de handicap vous empêchent de saisir les opportunités autour de vous, l’achat et l’entretien d’une voiture et le plein d’essence sont de plus en plus chers, les transports en commun sont limités dans votre coin. Ou encore, vous vous occupez d’un proche malade, ou la naissance d’un enfant et l’absence de garderie autour de chez vous sont difficilement compatibles avec les exigences et les horaires des emplois. Votre compte en banque est à plat, vous êtes à sec le 15 du mois et vivotez après, vous n’avez plus assez pour rebondir. Vous voulez une seconde chance, vous voulez un emploi, vous croyez en la dignité du travail. Une « entreprise à but d’emploi » vous ouvre alors ses portes et vous offre un contrat à durée indéterminée.
On l’a vu dans le premier chapitre : la pauvreté repart à la hausse depuis plusieurs décennies, et le modèle classique de l’État providence, pourtant si précieux à nos sociétés, peine à renverser la tendance. En parallèle, le piège du chômage de longue durée condamne les plus fragiles à la précarité. Or, dès le milieu des années 1990, Robert Castel [1995] observe :
« Ce que l’incertitude des temps paraît exiger, ce n’est pas moins d’État [..]. Ce n’est pas plus d’État […]. Le recours, c’est un État stratège qui redéployerait ses interventions pour accompagner ce processus d’individualisation, désamorcer ses points de tension, éviter ses cassures et rapatrier ceux qui ont basculé en deçà de la ligne de flottaison. […] Mais cet État devrait ajuster au plus près ses interventions en suivant les nervures du processus d’individualisation. »
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, William Julius Wilson affirme que la disparition de l’emploi et ses conséquences sur la vie sociale et culturelle constituent les problèmes centraux dans les quartiers, où sévit un chômage beaucoup plus fort que la moyenne américaine. Ainsi, accompagnée d’un phénomène de retrait de l’État, de délitement des collectifs et de hausse de l’individualisme, cette privation d’emploi a des effets majeurs sur l’évolution de la pauvreté dans les économies avancées.
Et de fait, malgré 40 milliards d’euros annuels de coûts directs et indirects du chômage, l’on peine aujourd’hui à juguler le chômage de longue durée en France, sans doute sa forme la plus grave, qui affectait plus de 2 millions de Français en 2024.
L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »
L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) est précisément née de la ténacité d’acteurs associatifs, comme Patrick Valentin d’ATD Quart Monde, ou politiques, comme l’ancien député Laurent Grandguillaume, qui ont voulu contrer ce fatalisme, et qui, dans un contexte de chômage de masse, en ont fait l’une des plus grandes innovations sociales de ce quart de siècle en France.
Dès le début des années 1990, Patrick Valentin avait la conviction que ça marcherait, puisque des programmes similaires avaient été mis en place pour le retour à l’emploi à l’issue de la Première Guerre mondiale, dans les ateliers protégés, ou après la Seconde Guerre, dans les centres d’aide par le travail [abrégé en CAT par la suite, NDLR]. Il confirme plus tard : « Le tournant, c’est la guerre de 14-18 ». Dans son sillage, la société juge inacceptable que les blessés de guerre désireux de travailler malgré leurs handicaps ne le puissent pas. Émerge alors selon lui un modèle d’emploi cofinancé par la collectivité pour compenser une plus faible productivité. « C’est à partir de cette reconnaissance qu’apparaît ce système, et on traverse le XXe siècle avec », ajoute-t-il en référence à plusieurs épisodes similaires, comme une loi d’orientation en 1975 en faveur des personnes handicapées leur donnant un droit à l’emploi.
Plus tard, l’insertion par l’activité économique utilise le même modèle, c’est-à-dire l’emploi cofinancé par la collectivité. Par contre, à l’inverse des initiatives précédentes, comme les ateliers protégés et les CAT, l’insertion ne garantit pas l’emploi à long terme. C’est pourquoi Patrick Valentin propose de développer le modèle des entreprises à but d’emploi. Pour lui, l’élément clé favorisant la reconnaissance contemporaine de ce droit à l’emploi, et qui sera d’ailleurs inscrit dans une législation en 2020, c’est la notion de « privation d’emploi » et l’idée que ceux qui en souffrent ne sont pas des coupables, lestés de ce préjugé qui les hante depuis le Moyen Âge, mais bien des victimes d’un phénomène contemporain majeur entremêlant mondialisation, désindustrialisation et retrait de la puissance publique, plus communément appelé le chômage de longue durée.
Quant à Laurent Grandguillaume, longtemps élu à Dijon, une personne croisée dans la capitale des ducs de Bourgogne en 2023 me confia que celui-ci était connu pour se creuser les méninges dès les années 2000 pour trouver une solution au chômage. Député, il finira par porter la loi votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en 2016 pour initier cette expérimentation. Il se bat depuis comme un lion pour faire vivre cette expérimentation unique par bien des aspects.
Grâce à eux et à tant d’autres, avec TZCLD, la France s’est dotée d’un outil particulièrement audacieux pour s’attaquer à ce défi. En son cœur, l’idée est simple : il s’agit pour de petits territoires, jusqu’à 10 000 habitants, de mener un travail granulaire pour recenser celles et ceux éloignés du marché du travail depuis un an ou plus, analyser leurs compétences et aspirations, croiser ces dernières avec les besoins des communes et proposer des activités adéquates, non concurrentes avec l’existant et logées dans une « entreprise à but d’emploi » (EBE) commuant l’argent du chômage et du revenu de solidarité active (RSA) en salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Un contrat à durée indéterminée (CDI) est proposé d’entrée de jeu à des personnes qui, en moyenne, sont au chômage depuis près de cinq ans.
Avec le recul, on connaît également mieux le profil des bénéficiaires : 55 % de femmes pour 45 % d’hommes ; plus de la moitié âgée de 42 ans ou plus, et un cinquième, 52 ans ou plus ; ils sont souvent sans diplôme ; plus du cinquième des employés d’EBE ont un handicap ; et près de la moitié estime qu’ils n’auraient jamais pu trouver un emploi en dehors du projet.
Il peut s’agir par exemple d’améliorer la sécurité alimentaire par l’horticulture et le maraîchage, permettre la lutte contre la dégradation environnementale via le recyclage ou le surcyclage, développer les services de proximité, proposer des alternatives aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, « relocaliser » des activités industrielles à forte valeur ajoutée.
Et c’est un point clé : l’emploi est systématiquement adapté aux profils et aux compétences de chacun et les horaires de travail relèvent du « temps choisi », soit une flexibilité salutaire pour les familles monoparentales et les personnes qui ont des proches malades à charge. C’est d’ailleurs là la force d’un projet mis en place à l’échelle « micro » : on identifie rapidement l’ensemble des personnes privées durablement d’emploi, on les interpelle activement et facilement (« l’aller vers », dans le jargon, qui évite qu’on oublie les personnes les plus éloignées de la société), on connaît leurs histoires personnelles, et il est plus facile de leur proposer des activités sur-mesure pour qu’elles retrouvent le chemin du travail. Le CDI, le Saint Graal pour évoluer dans la société française, permet également aux employés de planifier leur vie et d’obtenir des prêts pour l’achat d’une voiture ou d’une maison.
Les services fournis par ces entreprises de la seconde chance sont désignés sous le nom de « travaux utiles » et répondent à des enjeux clés dans la vie de la commune : accélérer la transition écologique (pour un tiers des activités), contribuer au développement local (pour un quart environ) et à la cohésion sociale (un autre petit quart), et un cinquième dans les activités de support. Il peut s’agir par exemple d’améliorer la sécurité alimentaire par l’horticulture et le maraîchage, permettre la lutte contre la dégradation environnementale via le recyclage ou le surcyclage, développer les services de proximité, proposer des alternatives aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, « relocaliser » des activités industrielles à forte valeur ajoutée.
Le Comité local de l’emploi, une précieuse tour de contrôle dans le territoire
En sus, la création d’un « comité local de l’emploi » (CLE) réunissant des représentants de l’État, du Département, de France Travail, de la mairie, du tissu économique et de l’insertion, permet de faire un travail d’orfèvre qui n’aurait pas déplu à Robert Castel ou William Julius Wilson : constitution de la candidature de la commune, identification des personnes privées durablement d’emploi, cartographie précise du territoire et de ses besoins, échange de bonnes pratiques entre employeurs, organismes publics et acteurs du social, circulation d’offres d’emploi classiques ou de formations intéressant les chômeurs comme les entreprises, etc. Le CLE innove en faisant se parler des acteurs travaillant souvent en silos afin qu’ils œuvrent ensemble à l’éradication du chômage. Il peut fonctionner sans budget propre, à partir du moment où ses membres acceptent de donner de leur temps pour poursuivre un dialogue technique qui relève souvent de leurs missions respectives.
Dans l’ensemble, l’expérimentation fluidifie le fonctionnement des marchés du travail locaux. De fait, au-delà même du lancement de l’EBE, cette expérimentation permet aux communes d’acquérir une connaissance très fine de la situation du chômage (statistiques, durée, obstacles, localisation des chômeurs, etc.), au point que même les agents de France Travail en retirent des leçons.
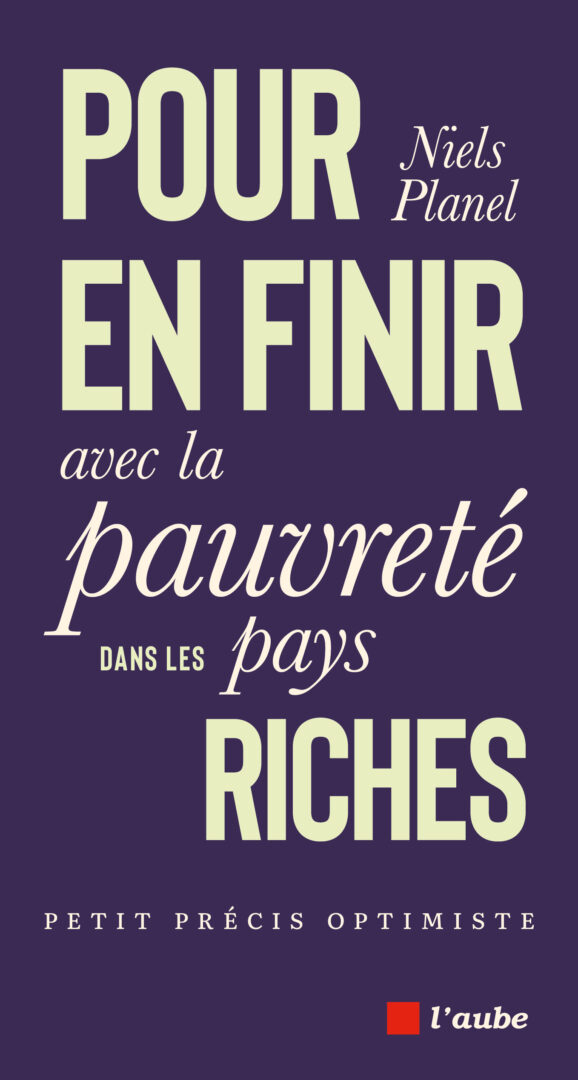
Surtout, le CLE et l’EBE présentent une force indéniable pour s’attaquer à « l’effet de voisinage » discuté dans le premier chapitre, puisque, par définition, les deux procèdent à un travail granulaire pour comprendre tous les atouts et toutes les faiblesses du territoire pour formuler des solutions sur-mesure au sort des personnes privées d’emploi, sans· entrer en concurrence avec les activités économiques préexistantes. Du reste, il ne s’agit pas d’une expérimentation « pour » les gens, mais construite « avec » eux : les personnes privées d’emploi durablement participent pleinement à l’élaboration du projet dans leur ville, aux côtés des autres acteurs locaux, comme les habitants, les entreprises et les élus, et elles sont également représentées au CLE.
Niels Planel, Pour en finir avec la pauvreté dans les pays riches. Petit précis d’optimisme, Éditions de l’Aube, 2025, 15€.