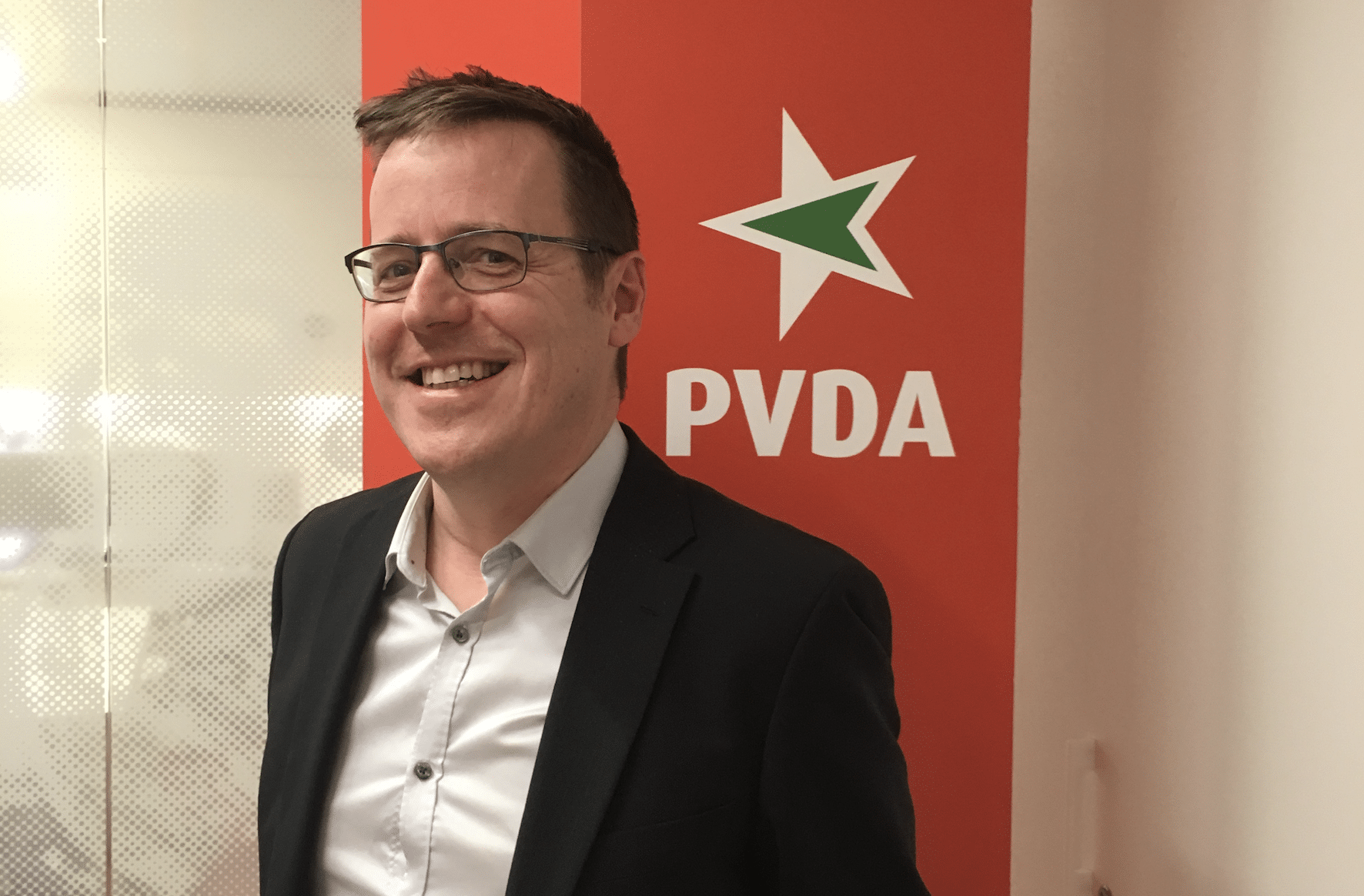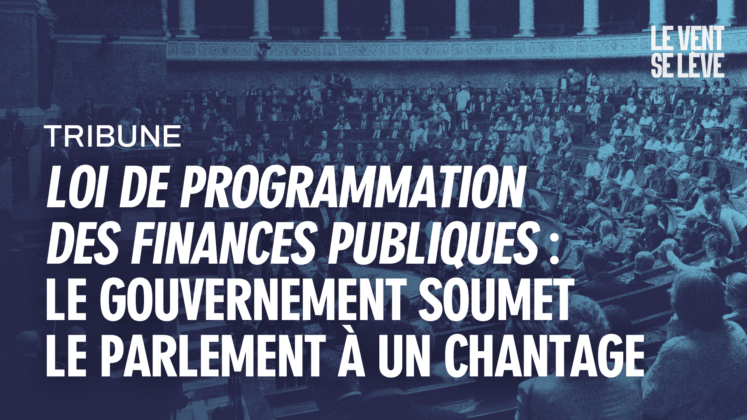Depuis quelques mois déjà, la scène politique belge semble en ébullition face à l’émergence du Parti du Travail de Belgique. Annoncé entre 15 et 19% par les sondages en Wallonie, le PTB serait en passe de dépasser le Parti socialiste longtemps hégémonique dans la région. Dans un système politique complexe de coalition et à l’approche des élections communales et fédérales en 2018 et 2019, le PTB inquiète les partis traditionnels en bouleversant de vieux équilibres. Nous avons pu nous entretenir avec David Pestieau, vice-président du parti, à son siège central à Bruxelles.
LVSL – Le PTB a émergé plutôt récemment comme force politique majeure en Belgique. Cependant, cette émergence repose sur un travail de longue haleine véritablement amorcé en 2008, où le PTB adopte une forme de rupture stratégique. Vous ne parlez alors plus directement de classe ouvrière mais des « gens », avec le slogan « Les gens d’abord, pas le profit ». Il est souvent reproché aux partis populistes en Europe d’abandonner l’analyse de classe pour construire ce que l’on appelle de « nouvelles latéralités ». Comment envisagez-vous l’articulation entre la reconfiguration de votre discours et le maintien d’un schème intellectuel de lutte des classes ?
David Pestieau – Nous n’avons en effet pas abandonné l’analyse de classes : lorsque vous lisez les documents de notre Congrès du Renouveau en 2008 et du Congrès de la Solidarité en 2015, la classe des travailleurs est au centre de la réflexion. La classe des travailleurs est pour nous la classe de tous les gens qui vendent leur force de travail pour pouvoir vivre : en Belgique, il y a 4 millions de personnes salariées. Bien sûr la situation n’est pas la même qu’il y a 50 ans. Cependant, d’une certaine manière, qui peut-être surprenante pour certains, la classe des travailleurs est même plus grande qu’avant, plus diversifiée et éparpillée. Nous ne sommes plus uniquement face aux grandes entreprises d’autrefois. Aujourd’hui ce sont de grandes chaînes de production avec des sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants, donc plus d’interdépendance entre les entreprises et un plus gros éclatement des collectifs de travail. Fondamentalement, la contradiction entre capital et travail est toujours là, mais moins visible, moins concentrée. De ce point de vue-là, nous nous définissons comme un parti marxiste et dans une analyse de classe. La question et le travail de la gauche radicale sont de savoir comment donner à nouveau une conscience de classe aux travailleurs, qui sont éparpillés et précarisés. C’est un grand travail.
Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que les classes disparaîtraient dans un ensemble nommé « le peuple ». En revanche, nous sommes d’accord avec le fait que la classe des travailleurs n’est pas consciente qu’elle est une classe ou qu’elle est capable de changer la société. Il s’agit donc de reconquérir, de faire un travail de conscientisation, de mobilisation, d’organisation de cette classe de travailleurs. Il faut alors venir avec des mots qui ramènent à cette contradiction. Lorsque nous avons choisi le slogan « Les gens d’abord, pas le profit », nous avons mis au centre les “gens”, mais nous avons surtout mis en avant la contradiction avec le profit.
“Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que les classes disparaîtraient dans un ensemble nommé « le peuple ». En revanche, nous sommes d’accord avec le fait que la classe des travailleurs n’est pas consciente qu’elle est une classe ou qu’elle est capable de changer la société. Il s’agit donc de reconquérir, de faire un travail de conscientisation, de cette classe de travailleurs.”
Notre travail depuis quelques années est d’une part d’allier une communication qui permette d’accrocher tout le monde, donc ne pas être dans un langage d’initiés, d’être compréhensibles, et d’autre part de ne pas se limiter à l’accroche : nous voulons amener les gens à réfléchir, à aller plus loin. Nous sommes dans la démarche d’un parti marxiste moderne, qui essaye de voir comment aujourd’hui, au 21ème siècle, dans une période où les forces de gauche sont sur la défensive, il est possible de reprendre le combat pour conquérir à nouveau l’hégémonie culturelle sur un certain nombre de concepts, de mots, de consciences.
LVSL – Comment parvenez-vous à gérer la contradiction entre la remise au goût du jour de concepts marxistes qui ont pu être délaissés et de l’affirmation d’une modernité politique ?
Je ne sais pas si cette méthode est spécifique, mais il s’agit tout du moins d’une méthode développée à partir de notre propre pratique. Nous avons constaté que nous n’étions pas assez audibles, et ce malgré le fait que nous présentions une analyse sérieuse et profonde de la crise du système capitaliste. Nous avons initié une réflexion sur ce sujet en 2008. Nous avons notamment étudié la façon de mener des actions sociales capables d’impliquer des milliers de gens, et sur la manière avec laquelle porter notre message. Auparavant, nous apportions un ensemble d’idées, de concepts, que nous déversions sur les gens, au lieu de chercher à présenter ces idées au rythme auquel elles peuvent être digérées.
Nous avons un message, nous avons un fond, nous avons une analyse globale ; et à chaque étape, à chaque période, nous essayons de voir ce que nous pouvons mettre à l’agenda politique, quels sont les thèmes qui vont faire avancer le débat dans un contexte particulier. Prenons par exemple la question de la fiscalité des entreprises, et le fait que les multinationales payent peu d’impôts. Nous cherchons à rendre le thème concret au lieu de le généraliser ou de faire de grands concepts. Nous avons dénoncé lors d’une fermeture d’usine à Liège d’Arcelor-Mittal le fait que cette firme n’avait payé que 476 euros d’impôts l’année précédente. Il y a alors une confrontation entre l’injustice des licenciements de masse et le fait que les grandes multinationales payent moins d’impôts que les travailleurs de cette multinationale qui sont licenciés. L’idée n’est pas de faire un cours d’économie marxiste au tableau en troisième doctorat d’économie, mais de déclencher une réflexion chez des dizaines de milliers de travailleurs : « Tiens, il y a quand même un problème dans cette société entre la faiblesse de la fiscalité des grandes entreprises et la manière dont nous payons nos impôts. ».
” Notre idée du militantisme est que si l’on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Si vous êtes dans une situation où vous gagnez 6000 ou 10 000 euros par mois, ce qui est le salaire d’un député ou d’un ministre, vous perdez votre lien avec la réalité.
Nous prenons également beaucoup de temps pour consulter les gens, pour savoir ce qui les préoccupent. Si vous parlez de choses sur lesquelles ils n’accrochent pas, vous pourrez parler autant que vous le voulez, cela ne marchera pas. Il faut partir des choses qui les préoccupent, puis élargir votre propos.
LVSL : Vous avez mis en place un système de reversement des indemnités des élus du PTB, qui sont payés au niveau du salaire moyen belge. La moralisation et le renouveau politique sont souvent utilisés, notamment en France, pour faire passer la couleuvre du néolibéralisme. Quel statut a pour vous ce système ? Est-ce un ressort de stratégie politique ?
David Pestieau – Il s’agit avant tout de notre vision de la société et de notre idéologie. Notre idée du militantisme est que si l’on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Si vous êtes dans une situation où vous gagnez 6000 ou 10 000 euros par mois, ce qui est le salaire d’un député ou d’un ministre, vous perdez votre lien avec la réalité. Vous devez demander à votre chauffeur quel est le prix du pain avant d’entrer en studio. Et si vous l’avez oublié, vous faites une gaffe ; comme Copé avec ses pains au chocolat. Cette rupture entre l’establishment politique et la population est très grande.
Pour avoir la prétention de représenter les travailleurs, les gens, il faut continuer de vivre comme tout le monde. Il faut vivre dans les quartiers populaires, avoir les mêmes salaires, et pouvoir ressentir les mêmes choses. Lorsque l’on a débattu de l’augmentation de la TVA de 6 à 21 % sur l’énergie, nous étions les seuls représentants politiques qui pouvaient voir que cela faisait une différence à la fin du mois. Une augmentation de 6 à 21%, pour quelqu’un qui touche 6000 euros par mois, ça ne se ressent pas dans son quotidien, c’est une abstraction, c’est quelque chose qu’il ne peut pas comprendre.
Tous nos responsables vivent avec un salaire moyen de travailleur, ce qui permet aussi au parti d’avoir une certaine indépendance financière puisque le surplus est reversé aux caisses du parti. Nous ne voulons pas être entièrement dépendants des dotations publiques que nous recevons depuis maintenant 3 ans. Pour ma part, je ne suis pas un élu mais un cadre du PTB. Le même principe s’applique : je touche un salaire moyen de travailleur et je vis dans un quartier populaire.
LVSL : Votre figure de proue, Raoul Hedebouw (avec qui nous avions réalisé un entretien en décembre 2016) n’est pas le président du parti mais « seulement » l’un de ses porte-paroles. Qu’est-ce que cela révèle de votre analyse de la problématique du césarisme en politique ?
David Pestieau – Un choix a effectivement été fait. Du fait de notre tradition très collective, nous avons été confrontés à un problème : l’espace médiatique, politique, est occupé par des personnalités, par des gens qui sont mis en avant. Nous tentions de mettre régulièrement en avant le collectif du PTB. Nous savons maintenant que cela ne fonctionne pas si l’on ne mise pas sur des figures que l’on va populariser. En 2005, nous avons décidé de populariser deux personnes : le président du parti Peter Mertens principalement du côté néerlandophone, et le porte-parole national du parti Raoul Hedebouw principalement côté francophone. C’est ça qui explique qu’on a décidé de « jouer le jeu » et de concentrer la communication, en tout cas au début, vers ces personnes. Mais toujours avec l’idée que ces personnes représentent la parole d’un collectif. Donc les grandes orientations qui passent dans les médias par la voix de nos porte-paroles sont des discussions collectives. Ils ne décident pas de notre projet parce qu’un jour ils se sont rasés le matin, ce n’est pas comme ça que ça se passe et donc on est absolument en désaccord avec un quelconque césarisme ou l’idée de l’homme providentiel. D’ autant plus que c’est quelque chose d’étranger à ce que nous défendons comme vision politique, comme marxistes nous sommes des gens qui croient au collectif.
LVSL : Nous souhaitions revenir sur la façon dont vous vous impliquez dans les luttes sociales, sur le terrain, sur la construction d’initiatives alternatives, nous pensons à la Manifiesta, à vos nombreuses organisations de jeunesse, aux nouvelles revues. Est-ce que tout ça s’inscrit sur une stratégie de construction d’une forme de contre-société ?
David Pestieau – D’un coté, il y a les luttes sociales. Ce premier aspect de la question des luttes sociales est bien évidemment l’ADN de notre parti, c’est-à-dire que nous pensons que si on veut des changements majeurs dans la société; il faut développer un rapport de forces important. Ce sont les gens, ce sont les masses qui font l’histoire, disait déjà Marx. C’est par des mouvements sociaux importants que l’on peut amener des changements profonds et des bouleversements dans l’histoire. Donc il est logique que nous investissions dans le travail social, que ce soit au niveau syndical, au niveau des associations, des quartiers etc…
On pense que les travailleurs, les jeunes, les différents acteurs du milieu populaire, doivent s’emparer de la chose publique, de la chose politique ; ils doivent être des acteurs de la politique et pas des consommateurs de la politique. C’est une vision très différente de la vision traditionnelle de la représentation qui se limite à des élections tous les 4, 5 ou 6 ans suivant les pays sans autre forme de participation démocratique; où on délègue son pouvoir à des représentants professionnels qui alors se l’accaparent et défendent en réalité souvent d’autres aspirations que celles du peuple ou de ceux qui l’ont élu.
“Pour nos 11 maisons médicales, c’est à peu près 25 000 patients qui sont soignés par des médecins qui sont pour une grande partie membres du PTB et qui ont décidé de servir la population et d’offrir un accès à la santé.”
Le deuxième élément c’est que l’on pense que le développement de cette lutte sociale se fait aussi en conjonction avec la lutte des idées. On investit dans Manifiesta qui est une fête qu’on a mise sur pied. On ne va pas se le cacher, celle-ci a d’autres inspirations comme les fêtes mises sur pied par d’autres partis communistes dans le monde comme la fête de l’Humanité en France ou la fête de l’Avante au Portugal et qui ont réussi à faire des fêtes populaires la conjonction entre culture populaire et débat politique. L’objectif est de créer peut-être pas une contre-société mais dans tous les cas une contre-hégémonie culturelle. De concentrer en un lieu différents aspects, que ce soit la lutte contre l’injustice sociale, mais aussi contre le racisme, pour la paix, pour le climat, pour les droits démocratiques, les différents thèmes sur lesquels nous essayons de travailler, on essaye de les apporter à travers cette fête qui est organisée conjointement par notre journal Solidaire et notre organisation Médecine pour le peuple.
LVSL : Médecine pour le peuple aussi c’est assez singulier justement, vous pouvez nous en parler ?
David Pestieau – Ce sont des maisons médicales qui sont nées de la constatation du fait qu’en Belgique, nous étions confrontés à une médecine libérale, une médecine de prestation, c’est-à-dire que les gens allaient chez leur médecin, payaient souvent pas mal d’argent et n’étaient pas toujours bien soignés parce plus ce genre de médecins voyaient de patients, plus ils recevaient de l’argent. On a essayé de lancer un autre modèle en pratique en ayant des médecins, qu’on a appelé les médecins du peuple. La première maison médicale a été lancée en 1971 par le PTB. Maintenant il y a 11 maisons médicales localisées à chaque fois dans des quartiers populaires. Ce sont des médecins qui ont décidé de faire une médecine sociale et une médecine gratuite. D’autres maisons médicales ont vu le jour aussi avec d’autres gens qui ne sont pas au PTB, qui ont aussi un certain nombre de principes similaires. Aujourd’hui, il y a un système qu’on appelle le système au forfait qui concerne maintenant 250 000 patients en Belgique, où les gens peuvent se soigner gratuitement en étant inscrits dans une maison médicale de quartier. Pour nos 11 maisons médicales, c’est à peu près 25 000 patients qui sont soignés par des médecins qui sont pour une grande partie membres du PTB et qui ont décidé de servir la population et d’offrir un accès à la santé.
LVSL : Pour revenir un peu à la politique plus générale en Belgique, vous jouissez en ce moment de bons sondages, au moins dans la partie francophone. Certains médias belges tentent de dessiner un scénario à la portugaise d’ici les prochaines élections en 2019. Raoul Hedebouw avait affirmé à la RTBF « nous ne serons pas au pouvoir avant 10 ou 15 ans ». Vous évacuez toujours la question d’une prise de pouvoir. Quelle vision vous avez vis-à-vis de ce scénario-là ?
David Pestieau – Je répondrais par une petite boutade de Mitterrand qui disait en substance « gouverner, ce n’est pas le pouvoir ». Il le disait pour justifier son incapacité à agir sur une série de décisions politiques. Je vais prendre cette citation par l’autre bout, parce que je pense qu’elle est correcte, je pense que le gouvernement ne reflète pas le pouvoir réel dans la société capitaliste aujourd’hui. Le pouvoir d’Etat est un ensemble où il y a le gouvernement, mais il y a aussi la masse extrêmement grande des lobbies des multinationales qui sont quasiment présents directement ou indirectement dans les cabinets ministériels. On le voit en France et je pense que c’est assez remarquable parce que là, on a plusieurs représentants directs du patronat qui sont ministres aujourd’hui et qui élaborent des lois quasiment directement. En Belgique on voit l’ingérence du pouvoir financier par Alexia Bertrand, la cheffe de cabinet du ministère des affaires étrangères qui est la fille d’une des plus grandes fortunes de Belgique ; on a des représentants de la filiale GDF-Suez en Belgique qui siègent dans le cabinet de la ministre de l’énergie. Donc il y a des liens très profonds entre les multinationales et le pouvoir politique.
“La gauche radicale en Europe a vécu cette expérience avec la Grèce. […] Ils avaient le gouvernement mais pas le pouvoir. Dès les premiers jours de ce gouvernement, toutes les décisions étaient connues du gouvernement d’Angela Merkel et de la Commission européenne, parce que les hauts-fonctionnaires grecs travaillaient pour l’establishment européen.”
L’autre aspect c’est qu’il y a un certain nombre de très hauts fonctionnaires qui représentent les intérêts de l’establishment traditionnel, et puis on a toute une série de services secrets, de hauts officiers de police, de l’armée qui défendent aussi les intérêts de l’establishment. Nous disons que le jeu électoral actuel nous amène dans des situations où nous pouvons être au gouvernement mais où nous ne pourrions pas exercer un réel pouvoir. C’est très important parce que ça détermine notre stratégie comme force de gauche. Si vous voulez changer profondément la société, si vous voulez même ne fut-ce qu’une autre répartition des richesses, et que vous n’avez pas une compréhension de cette réalité, vous allez vous tromper de stratégie.
La gauche radicale en Europe a vécu cette expérience avec la Grèce. Nous avons eu un gouvernement, qui a été élu avec quasiment une majorité absolue en sièges, Syriza, avec un programme anti-austérité relativement radical, mais qu’il n’a pas pu mettre en place. On peut discuter du programme, mais on ne peut pas dire qu’il ne rentrait pas en confrontation avec les dogmes néo-libéraux. Le résultat pratique est qu’ils avaient le gouvernement mais pas le pouvoir. On a vu, et ça a été notamment l’expérience qui a été relatée dans le livre de Yanis Varoufakis, que dès les premiers jours de ce gouvernement, toutes les décisions étaient connues du gouvernement d’Angela Merkel et de la Commission européenne, parce que les hauts-fonctionnaires grecs travaillaient pour l’establishment européen; on a vu que l’establishment grec et européen ont fait pression sur le gouvernement d’Alexis Tsipras par un étranglement économique en particulier juste avant le référendum anti-austérité de juillet 2015, donc on a coupé l’oxygène financier à la Grèce ; on a vu des pressions plus ou moins directes à travers l’appareil policier et militaire grec…
La stratégie appliquée en Grèce était de gouverner sans réellement toucher au pouvoir réel. Cela les a amenés à être finalement contraints à un moment donné, soit à quitter l’UE soit à accepter les diktats d’Angela Merkel et plier, ce qu’ils ont fait. Et ils ont dû appliquer le programme qui est le contraire du programme sur lequel ils ont été élus, c’est-à-dire le programme de l’Union Européenne. C’est pas une histoire d’il y a un siècle mais une histoire de maintenant, de 2015…
On ne peut que constater que si nous voulons avoir une stratégie qui aborde les questions de notre temps, c’est-à-dire la crise majeure du capitalisme, une crise politique, une crise climatique, une crise démocratique, une crise des relations internationales ; il va falloir remettre en cause le pouvoir dans son ensemble. Et nous disons simplement que si nous voulons être capables d’ébranler un tant soit peu ce pouvoir, il faut qu’il y ait un contre-pouvoir suffisamment fort. Et ce contre-pouvoir, ce n’est pas simplement avoir un bon résultat aux élections, c’est aussi avoir un mouvement dans la société et une organisation, une capacité à influencer une certaine hégémonie idéologique afin d’avoir des positions suffisamment fortes, en amenant à descendre dans la rue s’il y a un chantage économique, pouvoir avoir des médias alternatifs qui peuvent faire entendre un autre son de cloche que des grands médias privés détenus par des milliardaires, avoir des gens qui peuvent aussi porter le combat au sein des institutions par exemple…
“Nous disons, et d’une manière honnête vis-à-vis de tout le monde, que si nous ne sommes pas capables de construire un minimum ce contre-pouvoir et d’avoir les conditions pour pouvoir imposer un certain nombre de nos politiques, alors nous risquons d’avoir un scénario à la Syriza.”
Donc ne nous braquons pas sur des sondages. Même dans le cas où on aurait le succès électoral que nous annoncent ces sondages, nous devons être capables de mettre en place une politique réellement différente. Nous disons, et d’une manière honnête vis-à-vis de tout le monde, que si nous ne sommes pas capables de construire un minimum ce contre-pouvoir et d’avoir les conditions pour pouvoir imposer un certain nombre de nos politiques, alors nous risquons d’avoir un scénario à la Syriza. C’est-à-dire être élus avec une grande espérance parmi les gens et de devoir faire au gouvernement le contraire de la politique pour laquelle nous avons été élus. Nous n’avons, d’un côté, pas beaucoup de temps pour changer les choses parce que la situation sociale des gens recule fortement, mais, de l’autre côté, nous devons prendre le temps suffisant pour pouvoir faire quelque chose de fondamentalement différent que la politique actuelle qu’on connaît dans toute l’Europe. Ce n’est pas une question de période, ce n’est pas une question de 10-15 ans, il y a beaucoup de crises en ce moment en Europe, donc les choses peuvent évoluer vite, mais il faut qu’un certain nombre de conditions soient remplies.
Et pour l’instant on ne les voit pas parce que nous-mêmes nous estimons que nous devons encore grandir comme force, non seulement électorale mais comme force dans la société. Deuxièmement, nous sommes en Belgique dans un système de coalition gouvernementale. Et là nous ne voyons pas de changements dans les autres forces qui se disent de gauche pour le moment. Nous avons un parti social-démocrate qui a dominé la scène politique depuis des décennies et nous avons un parti écologiste. Or, ces deux partis restent encore aujourd’hui globalement dans le carcan qu’ils ont suivi depuis 30 ans.
LVSL : Justement le Parti Socialiste, lors de son dernier Congrès qui vient d’avoir lieu, a affiché une forme de « gauchisation ». D’un côté il y a cet affichage, et de l’autre tout l’épisode sur le CETA par exemple qui pose la question de la réelle motivation du PS. Ce Congrès illustre-t-il un réel virage idéologique ou c’est simplement pour vous faire barrage ?
David Pestieau – Je pense qu’il faut d’abord cadrer le problème du parti socialiste belge francophone. Car il y a deux partis socialistes en Belgique, un parti néerlandophone et un autre francophone. Le parti francophone était particulier jusqu’à maintenant car il est encore assez influent. Aux dernières élections, il a réalisé 32% des voix au sud du pays, mais il est confronté comme l’ensemble des sociaux-démocrates de toute l’Europe à une chute de cette influence. C’est lié au fait que la social-démocratie a fait son succès sur la conjonction depuis 1945 de deux phénomènes, un mouvement ouvrier très important qui a pu arracher des acquis sociaux, et le fait que la bourgeoisie européenne était confrontée à une réalité : un autre système en face, le socialisme à l’Est. Quel que soit le jugement qu’on peut porter sur ce système, la bourgeoisie a dû faire ici des concessions pour éviter que le monde ouvrier se tourne vers cet autre système.
Enzo Traverso a dit que, d’une certaine manière, la social-démocratie est un sous-produit de la révolution d’octobre. Je n’irais pas jusque là mais en tous cas le succès qu’elle a eu est lié à un moment très spécifique du capitalisme, qui n’est pas du tout sa face réelle et habituelle. Si vous regardez, le capitalisme depuis le XIXe siècle a connu plus de périodes de crises que de stabilité. Ces fameux 30-35 ans entre 1945 et 1980 qui ont été les heures de gloire de la social-démocratie européenne sont liés à une période très particulière de reconstruction d’un mouvement ouvrier fort et de l’existence d’un système concurrent.
révolution d’octobre. Je n’irais pas jusque là mais en tous cas le succès qu’elle a eu est lié à un moment très spécifique du capitalisme, qui n’est pas du tout sa face réelle et habituelle. Si vous regardez, le capitalisme depuis le XIXe siècle a connu plus de périodes de crises que de stabilité. Ces fameux 30-35 ans entre 1945 et 1980 qui ont été les heures de gloire de la social-démocratie européenne sont liés à une période très particulière de reconstruction d’un mouvement ouvrier fort et de l’existence d’un système concurrent.
Dans les années 1990, le tournant vers le social-libéralisme a permis de donner du change un certain temps aux partis sociaux-démocrates, avec la politique dite « du moindre mal » (« sans nous, ce serait pire »). Puis avec la crise de 2008, on a vu que les gens ont cherché leur salut au début dans les partis traditionnels (en France Sarkozy puis Hollande) qui n’ont pas sorti les classes populaires de la crise et on voit aujourd’hui depuis quelques temps une crise politique majeure de ces forces politiques traditionnelles. Donc il était logique que ce phénomène touche aussi la Belgique.
La particularité de la Belgique francophone est que cette chute de la social-démocratie ne s’est pas faite au profit de l’extrême droite, mais s’est aussi orientée vers des forces de gauche radicale. La crise de la social-démocratie est un phénomène profond. Peut-elle se renouveler ou est-elle arrivée à ses limites ?
Concernant ce congrès, le PS réagit clairement à la présence du PTB. Il n’a jamais été concurrencé sérieusement sur sa gauche. Il a toujours eu un socle électoral de 25 à 40% des voix. Aujourd’hui, une partie de ce socle s’oriente vers le PTB. Le PS reprend voire copie certaines idées du PTB, mais fondamentalement il n’a pas changé son orientation d’adaptation au système actuel. On le voit très bien déjà dans les premières déclarations : « c’est un programme à long terme » ; « nous verrons quand on aura des coalitions ». Il y a donc pas mal d’effets d’annonce. Vous avec connu cela avec François Hollande « je vais faire la guerre à la finance » « je vais revoir les traités européens » et puis finalement on a vu ce que ça a été. En plus, les personnalités au PS belge qui incarnent ce changement ne sont même pas des figures nouvelles et ont porté des politiques social-libérales souvent pendant 20-30 ans. Elio Di Rupo est au sommet de ce parti depuis plus de 20 ans !
Quand on pose la question « allez-vous lutter contre les politiques de l’Union Européenne de manière sérieuse ? » autrement dit « allez-vous faire de la désobéissance aux traités européens ? »… ils disent en fait non. Je vais prendre l’exemple très concret de la libéralisation du transport ferroviaire de passagers prévue pour 2023, c’est-à-dire demain. Alors on leur pose la question « Allez-vous vous y opposer et garder le monopole public en Belgique et désobéir à la directive européenne? » Et leur réponse est non. Idem pour le marché européen des gaz-à-effet-de-serre des grandes entreprises (ETS) qui fait qu’on ne fait rien de sérieux contre le réchauffement climatique et qu’on laisse les multinationales continuer à polluer, et on peut donner beaucoup d’autres exemples de ce type-là…
On demande des actes concrets sur des dossiers concrets et là on se rend compte que c’est directement « non » pour les sociaux-démocrates. Après 30 ans de néolibéralisme, il faut commencer par dire de quelle manière on bouleverse le cadre d’austérité et de libéralisation. Car on sait que le cadre est là pour vous ramener à mener toujours la même politique. Je ne vois pas comment le parti socialiste belge qui annonce déjà qu’il va rester dans ce cadre serait plus à gauche qu’a fait Syriza.
LVSL : Vos députés prêtent serment dans les trois langues officielles de la Belgique pour montrer leur attachement à l’unité du pays. Il est important de souligner que vous êtes le seul parti national en Belgique. Pourtant, si la contestation de l’austérité et de l’UE se porte sur le PTB en Wallonie, en Flandre, c’est le Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA qui semble tenir la corde. Comment l’expliquez-vous ? Est-ce le signe d’une opposition indépassable au sein de la nation belge ?
David Pestieau – Je répondrais au lecteur français qu’indépendamment de la langue, il y a en France des régions historiquement plus à gauche ou plus à droite. Je crois qu’il ne viendrait à l’idée à personne en France de dire que vous allez séparer les régions pour cela. En Belgique, nous avons une particularité avec trois langues, la Flandre où on parle Néerlandais, la Wallonie principalement francophone avec une petite partie où on parle Allemand et Bruxelles où on parle Français et Néerlandais. Il y a la même situation dans un autre pays en Europe, c’est la Suisse. La différence c’est que là-bas tous les partis sont restés nationaux. En Belgique on a séparé les partis avant de séparer les gens. Pour des raisons d’opportunisme politique on a décidé de séparer les partis en deux. Nous sommes restés un parti national. On voit difficilement comment on peut défendre une vision internationaliste, et même européenne si on est pas capable en Belgique d’être un seul parti et de s’entendre entre marxistes parlant simplement une langue différente ! On a fait le pari et on le fait tous les jours, d’être un parti national. La division linguistique en Belgique sert les intérêts des classes possédantes. Bill Gates est prêt à parler n’importe quelle langue si nécessaire pour conquérir des parts de marché. Et on le voit en Belgique aussi, tous les grands maîtres d’industrie parlent toutes les langues, mais ça les intéresse évidement d’appliquer le « diviser pour mieux régner » quand il s’adresse aux classes populaires.
“Ce rejet de la social-démocratie s’est traduit vers l’extrême droite, donc c’est un combat plus difficile en Flandre pour nous. Le contexte est plus à droite, le vote anti-establishment et la contestation des élites est capté en Flandre par le Vlaams Belang et depuis quelques années aussi par la N-VA. Il y a donc une bataille pour reconquérir le vote populaire contre des partis très à droite. “
En Flandre, la social-démocratie s’est développée dans un contexte où la droite était plus forte et il y a eu un mouvement nationaliste qui s’est développé, et qui politiquement s’est traduit à droite, voire à l’extrême droite. Le mouvement nationaliste a grandi au fil des années et s’est développé en deux partis : un mouvement « traditionnel » et un mouvement nationaliste d’extrême-droite. A partir des années 1980, ce mouvement nationaliste d’extrême droite, le Vlaams Belang a été un des précurseurs, peut-être avec le FN en France, d’un phénomène qu’on a vu ailleurs en Europe, c’est-à-dire qu’une partie du vote populaire s’est détourné des partis sociaux-démocrates pour aller vers des partis d’extrême droite. Ce rejet de la social-démocratie s’est traduit vers l’extrême droite, donc c’est un combat plus difficile en Flandre pour nous. Le contexte est plus à droite, le vote anti-establishment et la contestation des élites est capté en Flandre par le Vlaams Belang et depuis quelques années aussi par la N-VA. Il y a donc une bataille pour reconquérir le vote populaire contre des partis très à droite. En Wallonie, il est plus facile de travailler car le champ est plus libre car l’extrême-droite y est plus fiable et divisée.
La particularité de la Belgique qui complique encore les choses est qu’on a maintenant un parti d’extrême droite fasciste, le Vlaams Belang, et l’émergence à travers le mouvement traditionnel flamand d’une force qui est devenu une droite-extrême « civilisée » on va dire, une nouvelle droite, la NV-A. On a donc un des partis fascistes les plus organisés d’Europe qui vit à côté d’un autre parti de nouvelle droite nationaliste qui capte de manière très particulière un sentiment anti-establishment en étant lui même dedans. C’est une équation difficile que nous avons au nord du pays. Cette situation fait qu’on ne connaît pas en Flandre les mêmes scores qu’en Wallonie, mais dans une ville comme Anvers, la plus grande ville industrielle du pays, on fait 9% des voix ce qui est, vu ce contexte, un très bon score par rapport à pas mal de partis de gauche radicale d’Europe. Mais la bataille est plus difficile. Nous ne pensons pas que les Wallons sont intrinsèquement plus à gauche que les Flamands comme je ne pense pas que les gens du midi sont intrinsèquement plus à droite que ceux d’autres régions de France. On pense que c’est lié à des contextes politiques particuliers et qu’il faut mener le combat partout où il doit se mener avec l’idée qu’on doit unir les travailleurs. Notre équation c’est cela. Manifiesta c’est avec l’équipe nationale de foot belge un des seuls endroits où francophones et néerlandophones se côtoient par exemple.
LVSL : Ces derniers temps une véritable peur du rouge semble s’être emparée des grands médias belges. Comment gérez-vous le fait qu’une partie de la presse tente de vous renvoyer constamment à l’image du communiste au couteau entre les dents ? Ne craignez-vous pas le risque d’apparaître comme un repoussoir ?
David Pestieau – Il faut d’abord analyser le phénomène de la peur du rouge. Il y en a deux qui se superposent. Il y a d’abord celui traditionnel de la presse de droite, d’exagérer de manière à caricaturer pour le combat politique. Vous l’avez vu en France avec la caricature faite contre Mélenchon lors de la présidentielle. On a plus ou moins sorti tous les crimes possibles et imaginables du socialisme à 10 000 kilomètre à la ronde et 100 ans de différences…
LVSL : Pourtant la France Insoumise prend beaucoup plus de pincettes que vous et met de coté un certain nombre de référentiels. On peut penser à l’abandon de la couleur rouge ou de l’Internationale…
David Pestieau – Oui bien sûr mais ce que je veux dire c’est que c’est inévitable : si vous menez un combat où vous remettez en cause un certain nombre de dogmes néolibéraux vous allez être attaqué. Et vous pouvez avoir les couleurs que vous voulez si votre message est un tant soit peu contestataire par rapport au néolibéralisme, on vous traitera de tout. J’ai vu un jour un discours de Berlusconi qui traitait Romano Prodi de communiste ! On a tout vu. C’est la peur du rouge fantasmée utilisée comme argument politique pour gagner à court terme des élections. Mais c’est inévitable ! Vous pouvez danser sur votre tête… mais si on ne vous attaque pas de la sorte ça veut surtout dire que vous n’êtes pas occupé à contester le système. Tous les dirigeants de grève et de mouvements sociaux sont à un moment vilipendés et caricaturés.
“Je pense qu’aujourd’hui, il y a une méfiance profonde des milieux populaire pour le message des médias dominants. On l’a vu avec le référendum en France en 2005. L’influence politico-médiatique n’a pas été suffisante pour imposer le récit de l’establishment. Donc là aussi quand on parle de construire une contre-société, ça implique d’avoir un réseau d’informations et de discussions.”
Je pense qu’une peur réelle du PTB est aujourd’hui en train de se manifester au-delà de la caricature habituelle. On le voit quand on lit les déclarations des patrons. On a eu celle du patron des patrons wallon qui a dit qu’il fallait absolument que le PTB ne gouverne pas ou n’influe pas les décisions politiques. Donc depuis quelques temps, on sent que ce phénomène qui servait surtout dans un match politique est devenu une crainte réelle car le PTB monte et pourrait influencer d’autres partis politiques. Le patronat s’agite et demande de qualifier le PTB de parti non fréquentable.
Comment fait-on pour éviter d’avoir une étiquette ? Il faut commencer à défendre ses propres idées et les expliquer. Trouver tous les moyens de communication pour pouvoir le faire et ne pas être uniquement dépendant des canaux d’information traditionnels. Il faut aussi ne pas prêter le flanc à la caricature. Mais vous avez deux possibilités quand vous êtes attaqué de cette façon : vous changez votre message ou vous faites face. Je pense que d’une certaine manière il y a une crise politique profonde et un message anti-communiste ou anti-rouge, qui il y a 20 ans passait bien plus facilement qu’aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui, il y a une méfiance profonde des milieux populaire pour le message des médias dominants. On l’a vu avec le référendum en France en 2005. L’influence politico-médiatique n’a pas été suffisante pour imposer le récit de l’establishment. Donc là aussi quand on parle de construire une contre-société, ça implique d’avoir un réseau d’informations et de discussions. Et là je suis plus optimiste que par le passé quand je vois le développement des médias alternatifs et des nouvelles technologies.
Quand vous diabolisez quelqu’un, ça n’implique pas forcément un phénomène repoussoir mais peut-être qu’au contraire les gens vont s’intéresser. C’est un phénomène dangereux car il y a des gens qu’il faut repousser, l’extrême droite par exemple.
LVSL : C’est tout le débat de la dé-diabolisation du FN en France…
Absolument, mais vous ne pouvez pas diaboliser d’un côté l’extrême-droite si c’est pour défendre de l’autre les politiques austéritaires de l’Union européenne. Si vous dites que l’extrême droite et le racisme c’est mauvais, mais que ce qu’on propose à la place c’est Macron, on renforce l’extrême-droite. Donc on ne résout aucun problème. C’est le principal enjeu actuel à l’échelle européenne, soit on continue avec la politique Macron-Merkel et compagnie, l’Union Européenne de plus en plus autoritaire et austéritaire, soit on aura le repli nationaliste, soit on aura une option anticapitaliste, c’est une course contre la montre. C’est le défi que l’on souhaite modestement relever en Belgique mais c’est le défi partout en Europe.
Entretien réalisé avec l’aide d’Amandine Fouillard