Pourquoi, en 1914, les socialistes allemands ont-ils voté les crédits de guerre ? Pourquoi les ouvriers français n’ont-ils pas décrété la grève générale ? Lorsqu’éclate la guerre, les socialistes sont paralysés et l’internationalisme est oublié. La nation a triomphé des classes et toute idée de révolution mondiale paraît condamnée. Les origines du drame sont peut-être à chercher dans le rapport qu’entretiennent les socialistes avec l’idée nationale avant-guerre. Ce travail d’exploration, l’historien Jean-Numa Ducange l’entreprend dans son livre Quand la Gauche pensait la Nation : Nationalités et socialismes à la Belle-Époque. Avec lui, on voyage de Berlin à Vienne, en passant par la Pologne et la France, dans une enquête qui remonte aux sources de la conception socialiste de la nation. Grande oubliée des premiers débats doctrinaux, la nation s’impose finalement à tous, et il faut remonter aux origines du mouvement ouvrier pour comprendre pourquoi.
De l’internationalisme, on connaît la formule « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » tirée de la conclusion du Manifeste du parti communiste, on se souvient aussi de l’engagement pacifiste de Jean Jaurès ou du spectre de la révolution mondiale qui a inquiété les polices des différents États. Mais passer du slogan au concept est plus délicat. De la même manière, proposer une définition définitive de la nation dans la grammaire socialiste représente un véritable défi. Pour le dire simplement, s’il est possible de définir les notions de lutte des classes ou de plus-value, la grille de lecture marxiste semble inopérante quand on la confronte à l’idée de nation.
En cause ? Un relatif désintérêt pour la question nationale. Toutes les nations finiront par disparaître et il n’est pas nécessaire de s’attarder là-dessus. À mesure que passent les années, pourtant, le sujet gagne en importance. Si la France révolutionnaire a hissé l’idée de nation au plus haut dès 1789, l’Italie ou l’Allemagne ne sont unifiées qu’un siècle plus tard et, partout en Europe, les empires demeurent. Toutefois, dans l’Autriche-Hongrie du second XIXe siècle, comme dans l’empire tsariste ou dans les colonies, les minorités nationales s’agitent et la question des nationalités s’introduit dans le débat. L’étude des archives révèle l’importance des discussions soulevées par cet enjeu.
Si l’historiographie oppose généralement le moment internationaliste de la seconde moitié du XIXe à une phase de nationalisation des partis ouvriers dans les décennies qui suivent, l’analyse attentive des sources permet de révéler une plus grande complexité. Par l’étude des revues, journaux, archives de congrès, mais aussi des trajectoires individuelles des différents acteurs et de leurs publications ou des évolutions de leurs prises de position, Jean-Numa Ducange propose ainsi une histoire à la fois intellectuelle, politique et sociale, intéressée tant par les personnages politiques que par les théoriciens et les masses populaires.
La nation aux lendemains de 1848
L’industrialisation rapide de l’espace germanophone le porte aux avant-postes du développement du mouvement ouvrier. Au XIXe siècle, le soulèvement des tisserands silésiens célébrés par Heinrich Heine, la révolution de 1848 et la croissance rapide d’un prolétariat urbain conscientisé prépare la création des premiers partis ouvriers. Ferdinand Lassalle crée l’ADAV (Association générale des travailleurs allemands) en 1863 cependant que Marx et Engels poursuivent leurs travaux depuis l’Angleterre et que l’Association internationale des travailleurs est créée en 1864.
On ne saurait trop insister sur la centralité de l’espace germanophone à ce moment de l’histoire du mouvement ouvrier. Héritier de l’ADAV, le SPD – unifié en 1875 sous le nom de SAP – exerce une influence majeure sur tous les partis socialistes d’Europe, son organisation et ses figures intellectuelles sont respectées par-delà les frontières. En ce temps-là, l’allemand est la langue du socialisme, l’essentiel du travail sur la doctrine marxiste se fait en allemand, la compréhension des principaux ouvrages théoriques implique sa maîtrise et ce n’est pas un hasard si le Komintern créé en 1919 lui accorde le statut de langue officielle aux côtés du russe.
Si l’espace germanophone s’affirme comme le cœur du socialisme mondial, il s’inscrit néanmoins dans un vaste réseau de circulation des idées et des militants, lequel trouve son origine dans l’événement fondateur de 1848. Au mois de février, le peuple parisien inaugure ce qui va devenir le printemps des peuples. Le 13 mars, Vienne se soulève, suivie par Berlin cinq jours plus tard. Cette année-là, les députés réunis à Francfort votent en faveur de la solution « grande-allemande » unissant les États allemands et l’Autriche dans une même nation.
Cette tentative (avortée) de l’unification de tous les germanophones peut surprendre, J.-N. Ducange précise pourtant que « l’idée de la Grande Allemagne – soit en quelque sorte retrouver les frontières du Saint-Empire romain germanique mais avec une forme politique démocratique – s’impose comme un présupposé essentiel du mouvement ouvrier germanophone dès ses premiers pas. Le “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” n’avait alors absolument rien d’évident. » Il est vrai que le Saint-Empire, quasi-millénaire, a disparu à peine quarante ans auparavant sous les assauts des guerres napoléoniennes, que le Zollverein a permis d’accroître les échanges commerciaux dans cette zone et que l’idée d’unir les peuples de langue allemande n’est alors entravée que par le jeu complexe des pouvoirs institués.
Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, les nationalités ne revêtent pas le même caractère d’évidence qu’aujourd’hui. Ce vaste espace est divisé par les stratégies d’influence de l’Autriche et de la Prusse et on se définit essentiellement par la langue ou par les allégeances prêtées à telle ou telle puissance. En Autriche-Hongrie, Allemands d’Autriche, Tchèques, Juifs, Ruthènes, Hongrois, cohabitent dans un ensemble instable qui est loin de correspondre à l’idée homogène que l’on se fait de la nation. Le déclin de l’idéal grand-allemand hérité de la génération glorieuse de 1848 et la mise en exergue de la question des nationalités prennent ainsi racine dans le double mouvement de l’éclatement progressif de l’Empire d’Autriche-Hongrie et de l’unification bismarckienne de l’Allemagne.
Minorités et nations « peu viables »
Au départ, la nation n’a rien d’une question primordiale. Les travaux de Marx et Engels n’en font que très peu état et ce sont encore leurs correspondances qui évoquent le plus le sujet des nationalités. Pour les premiers marxistes, la nation n’est pas un héritage à cultiver et elle n’a rien d’un horizon indépassable. Le capitalisme, par l’extension sans cesse continuée des marchés, doit réaliser le dépassement des entités nationales ; comme le rappelle Ducange : « La langue et le territoire fondent la nation. Mais dans bien des cas les “petits” peuples sont fatalement amenés à se dissoudre avec le capitalisme. À quoi bon défendre des revendications archaïques ? » Le terme d’Aufhebung dans son double sens de dépassement et d’abolition traduit bien la vision marxiste selon laquelle les nations sont vouées à se dissoudre dans de grands ensembles, eux-mêmes intégrés dans une internationale des peuples. Dans la perspective de la révolution prolétarienne à venir, le soutien aux revendications particulières peut sembler procéder d’une certaine logique réactionnaire allant contre le sens de l’histoire. Le soutien apporté par Marx et Engels aux indépendances irlandaise et polonaise ne procède ainsi pas d’une sensibilité marquée à l’égard des luttes de libération nationales, mais s’inscrit bien plutôt dans une vision stratégique destinée à affaiblir les empires britannique et russe.
« Le dilemme de l’articulation du national avec la question sociale est au cœur du problème. Il le restera au moins jusqu’aux lendemains de la Première guerre mondiale. »
Volontiers partisans de la solution quarante-huitarde d’une grande République une et indivisible entre germanophones, ils sont favorables à l’assimilation des peuples minoritaires afin de ne pas multiplier les frontières. Pour Engels, la germanisation et la « dénationalisation » des minorités constitue même un objectif à atteindre. Ainsi, Marx et Engels se satisfont de l’unification territoriale réalisée par la Prusse de Bismarck, de même que Lassalle, là où Wilhelm Liebknecht, autre grande figure du socialisme allemand, demeure fidèle à l’idée d’une grande Allemagne englobant l’Autriche.
En 1866, à la bataille de Sadowa, la Prusse l’emporte sur son voisin du Sud. Cinq ans plus tard, après sa victoire sur Napoléon III lors de la guerre de 1870, Guillaume Ier proclame le Reich allemand (Deutsches Kaiserreich) dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Le rêve grand allemand est enterré et les socialistes vont devoir penser à nouveaux frais la question nationale. Dès lors, comme le note Jean-Numa Ducange : « Le dilemme de l’articulation du national avec la question sociale est au cœur du problème. Il le restera au moins jusqu’aux lendemains de la Première guerre mondiale ».
Échanges et solidarités transnationales : l’internationalisme concret
L’espace germanophone d’alors est le témoin de la circulation des idées et des hommes. L’effervescence intellectuelle de la seconde moitié du XIXe siècle se traduit par la multiplication des ouvrages, des journaux, des revues. Rappelant l’analyse des publications et des mises en réseau au sein du mouvement ouvrier français réalisée par Emmanuel Jousse dans son livre Les hommes révoltés : Les origines du réformisme en France, Jean-Numa Ducange propose l’histoire des échanges et des transferts culturels entre les villes et les organisations. Les militants lisent et écrivent, ils lancent le quotidien Vorwärts à Berlin en 1876, la Neue Zeit à Stuttgart en 1883 qui achèvera de consacrer Karl Kautsky « pape du marxisme » et publient tracts et brochures dans toutes les villes industrielles des deux empires.
Pourtant, les socialistes allemands affrontent bientôt le pouvoir. Pour contrer la progression des courants révolutionnaires dans le Reich, Bismarck promulgue en 1878 les lois dites « antisocialistes », qui ne seront abrogées qu’en 1890, permettant le retour d’exil des principaux responsables politiques du parti. Face à la répression, les socialistes d’Autriche-Hongrie portent assistance à leurs camarades allemands. Une « poste rouge » est mise en place et « Zurich sert de base arrière pour permettre la publication d’un nouvel hebdomadaire, Der Sozialdemokrat, qui, de 1880 à 1890, est le principal organe de presse du mouvement. » Plongeant dans les rapports de police, Ducange exhume les adresses de la police allemande à ses homologues autrichiens exhortant ces derniers à durcir les mesures contre les militants et déplorant la « contrebande d’écrits socialistes » et le fait que « Pest [aujourd’hui Budapest, NDLR] constitue un véritable port franc pour la distribution d’imprimés ». Cette solidarité entre socialistes européens renforce le sentiment internationaliste ; la classe prime la nation, pour quelques temps encore.
La question nationale ne se réglera pas d’elle-même
Le tournant des années 1870 marque une rupture. L’Autriche défaite par la Prusse en 1866 renonce à toute ambition sur les territoires septentrionaux, la France est battue et le Reich est fondé. Quelques décennies après la « bataille des nations » de Leipzig où les peuples d’Europe ont uni leur destin à l’idée nationale face à Napoléon, celle-ci s’affirme avec plus de vigueur encore. Après la proclamation du Reich à Versailles, « les mouvements ouvriers germanophones, à contrecœur, doivent se structurer séparément. L’État allemand n’est plus perçu comme une entité provisoire, une solution temporaire, mais “est accepté comme une réalité politique légitime”. » De là une éclipse des projets « mitteleuropéens » entre 1871 et 1914 et un centre de gravité du mouvement socialiste qui bascule vers l’Empire allemand.
On conserve généralement du mouvement ouvrier du XIXe siècle l’image d’Épinal d’un internationalisme fervent, indifférent aux frontières et aux langues. Avec le recul, cette perspective paraît néanmoins largement surdéterminée par le triomphe ultérieur des bolcheviks et la postérité de l’aile gauche des socialistes allemands – spartakistes en tête. Si l’historiographie communiste des premières décennies du XXe siècle a valorisé les figures qui, à l’instar de Rosa Luxembourg, renvoyaient nation et nationalisme dos à dos, l’étude approfondie des débats de l’époque ouvre d’autres horizons.
Contrainte d’accorder davantage de reconnaissance aux Hongrois, l’Autriche-Hongrie affaiblie est également confrontée aux revendications tchèques avec lesquels est engagée une tentative de trialisme. Côté socialiste, un parti tchécoslave est même fondé en 1878. Sur fond de montée en puissance des demandes des minorités nationales et quoique demeurés fidèles à l’idéal grand-allemand pour certains d’entre eux, les principaux chefs de l’opposition se rendent à l’évidence : « L’assimilation pure et simple de ces “petits” peuples, un temps souhaitée, ne se produit pas. La gauche socialiste ne peut plus les ignorer. »
L’idée du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes apparaît pour la première fois en 1874 dans un programme politique socialiste. En 1896, le congrès de l’Internationale se prononce en faveur de l’indépendance de la Pologne, les ordonnances Badeni de 1897 imposent le bilinguisme pour les fonctionnaires de l’Empire postés en Bohême et le parti hongrois se montre particulièrement déterminé à mener une politique de magyarisation active. Force est de constater que la question nationale ne se résoudra pas d’elle-même. Pour les socialistes « le réveil est brutal. Le conflit interne en est d’autant plus violent. »
Pour les marxistes, la nation est d’abord considérée comme un champ d’intervention. Engels indique ainsi dans une lettre à Kautsky : « Pour pouvoir lutter, il faut d’abord avoir une terre, de l’air, de la lumière et de l’espace pour se mouvoir. » Il poursuit : « Je suis donc d’avis que deux nations en Europe ont non seulement le droit mais le devoir d’être nationales avant d’être internationales : les Irlandais et les Polonais. » L’un et l’autre sont convaincus par la nécessité de constituer ou maintenir de grands ensembles, et par le caractère absolument contre-productif de la multiplication des États.
« Il revient à la lutte de classe prolétarienne de transformer la patrie (Vaterland) et sa culture, de monopole d’une petite minorité qu’elles sont aujourd’hui en foyer (Heimat) et propriété de tous. »
Mais la nouvelle génération des penseurs autrichiens remet en cause ce principe. Parmi eux, Karl Renner, juriste de formation et futur chancelier, publie État et nation en 1899. Prenant acte de la formidable complexité de l’ensemble austro-hongrois et de l’impressionnante imbrication de populations et groupes ethniques, il considère que le « principe du territoire » crée trop de problèmes dans l’Empire. En conséquence, Renner s’oppose au droit des nations à disposer d’elles-mêmes – compte tenu, notamment, des transferts de population que l’application d’un tel concept supposerait – et lui préfère la mise en place de droits spéciaux en fonction des différents groupes. Kautsky, devenu la principale autorité morale du socialisme allemand, refuse cette proposition. Il souligne au contraire la pertinence historique de la nation comme cadre de développement du capitalisme, mais insiste sur la multiplication des communications et des échanges, précurseurs d’une « mondialisation » susceptible de produire de grands ensembles dans lesquels l’œuvre de transformation socialiste se trouverait facilitée. De plus, comme le note Ducange, il « doute largement du “réveil des peuples sans histoire”, mais le fait qu’il écrive autant à ce propos trahit en quelque sorte les craintes qu’il pressent pour l’avenir du mouvement socialiste. »
En 1907, un autre intellectuel autrichien, Otto Bauer, probablement le plus important du courant austromarxiste, lance une revue théorique baptisée Der Kampf. La même année, il publie La social-démocratie et la question des nationalités, sans doute l’ouvrage le plus abouti sur cet enjeu devenu primordial pour son camp. Prolongeant Renner, il affirme son refus clair de toute germanisation et tente de repenser la question nationale dans un empire où les antagonismes nationaux ont tendance à recouper les clivages sociaux.
Face à eux, l’aile gauche ne ménage pas ses efforts. Si elle peine à formuler un horizon théorique capable de rivaliser avec les idées nouvelles venues de Vienne, elle s’oppose catégoriquement à toute valorisation de l’identité nationale. Rosa Luxembourg, quoique polonaise, refuse par exemple l’indépendance de son pays d’origine au motif que « favoriser le développement des États-nations lui paraît être un retour en arrière à combattre. » Plus radical encore, et soutenu par le Néerlandais Anton Pannekoek qui deviendra l’une des figures du conseillisme, Josef Strasser écrit : « Nous, sociaux-démocrates, nous refusons non seulement de maintenir les caractères nationaux actuels mais nous travaillons justement à leur destruction. » Plus modérée, Clara Zetkin formule l’idée d’un « patriotisme prolétarien ». Elle déclare, avec les accents jaurésiens que pourrait être tenté de déceler un lecteur français : « Il revient à la lutte de classe prolétarienne de transformer la patrie (Vaterland) et sa culture, de monopole d’une petite minorité qu’elles sont aujourd’hui en foyer (Heimat) et propriété de tous. »
Dans ces années d’intense débat intellectuel, Lénine invite Staline – son « merveilleux Géorgien » – à se rendre à Vienne. Lors des cinq semaines qu’il passe dans la capitale autrichienne en 1913, il écrit une série d’articles sur l’idée de nationalité. Boukharine, également présent à Vienne à ce moment, sert de traducteur à Staline qui ne parle pas l’allemand et tente d’opérer une synthèse des principaux écrits théoriques des sociaux-démocrates européens. Dans son livre Le marxisme et la question nationale, Staline définit ainsi la nation selon une série de critères. Pour lui, une nation c’est une langue, une entité économique, un territoire, un certain « psychisme » et une relative stabilité historique. Il déduit de cette définition plusieurs solutions à appliquer aux revendications nationales : l’autonomie régionale, la séparation dans certains cas spécifiques, ou l’assimilation pure et simple des nations jugées « peu viables », arguant du fait que « les nations et les peuples attardés doivent être entraînés dans la voie générale d’une culture supérieure ».
Une gauche nationaliste ?
Un autre courant tend à se développer dans les premières années du XXe siècle. La « gauche nationaliste » dépeinte par J.-N. Ducange s’inscrit pleinement dans le socialisme allemand mais diverge de l’aile gauche sur plusieurs points, celui de la nation bien sûr, mais aussi et surtout sur la question du réformisme. On l’oublierait presque, mais la nation n’est pas le principal enjeu des débats théoriques socialistes : en 1899 éclate la querelle réformiste (Reformismusstreit). Le révisionnisme d’Eduard Bernstein remet en cause l’idée d’une révolution nécessaire et – faisant le constat de la puissance du SPD dans l’Empire allemand – promeut la mise en place de réformes sociales approfondies pour réaliser le socialisme par étapes.
Quoiqu’en apparence déconnectés de l’immense controverse suscitée par les thèses bernsteiniennes, les débats sur la nation doivent être appréhendés à l’aune de ce contexte tendu au sein du monde socialiste. Dès les années 1870-1880, Georg von Vollmar pose la question de la réalisation du socialisme dans un État isolé et ses réflexions seront plus tard prolongées par plusieurs publications. Parmi elles, la revue Deutsche Worte dirigée par Engelbert Pernerstorfer (1850-1918), est certes marquée par une fascination pour les révolutions de 1848, mais aussi par une certaine imprégnation pangermaniste et par un attrait non-négligeable pour l’héritage celtique, Wagner, Nietzsche… Pour Pernerstorfer, socialisme et nation sont inséparables, il écrit : « Tous les partis bourgeois se déguisent extérieurement en représentants de l’idée nationale, cela constitue simplement leur intérêt de classe, même s’ils n’en sont pas toujours conscients. […] Les partis bourgeois ne sont que trop heureux de trahir les intérêts nationaux. » Les Deutsche Worte sont complétés par les Sozialistische Monatshefte, « restés dans l’histoire comme la revue “révisionniste” par excellence » selon Ducange. Dirigés par Joseph Bloch, ils sont – d’après Lénine – caractéristiques de l’opportunisme d’une partie importante du SPD et accueillent les contributions d’auteurs étrangers comme Jean Jaurès ou Georges Sorel.
D’autres intellectuels, tels que Schitlowsky, opposent quant à eux l’internationalisme tant au nationalisme qu’au cosmopolitisme et refusent les revendications particularistes montantes. D’autres encore, comme Karl Reuthner, vont plus loin et défendent notamment le fait de définir une nouvelle « Weltpolitik » (politique mondiale), soit un impérialisme grand-allemand social-démocrate seul capable de résoudre les problèmes du continent européen.
Figure centrale dans le parti, Kautsky – fidèle en cela à sa perspective de dépassement des identités confessionnelles ou nationales – se prononce par ailleurs en faveur de l’autodissolution du judaïsme et s’oppose au sionisme. Si les socialistes juifs sont dans leur majorité assimilationnistes (c’est par exemple le cas de Bernstein) ou farouchement opposés aux conceptions nationales (à l’instar de Rosa Luxembourg), Joseph Bloch et Pernerstorfer, à l’inverse, considèrent avec sympathie le projet sioniste cependant qu’ils défendent la Kultur allemande envers et contre tous.
Les lignes de clivage ne parviennent pas à séparer deux camps distincts, les trajectoires individuelles et les parcours intellectuels imposent d’introduire de la nuance dans les débats qui animent le camp socialiste dans ces années décisives. Néanmoins, il faut reconnaître avec Ducange que « le mythe d’une gauche et d’un socialisme imperméable à tout nationalisme […] à la fin du XIXe siècle ne tient pas. » Les discussions théoriques ne peuvent être dissociées d’un climat intellectuel général imprégné tant par le protectionnisme de l’économiste Friedrich List (l’idée de recréer un Zollverein demeure longtemps), que par l’idée d’une « voie particulière » allemande (le Sonderweg) ou plus généralement par le pangermanisme.
Investir la nation ?
Peu à peu, émerge l’idée de l’utilité tactique de revendiquer le signifiant national. Contre l’histoire officielle, les socialistes entreprennent de jeter les bases d’une histoire populaire destinée à fédérer la classe ouvrière contre le récit dominant. Le premier événement qui vient à l’esprit des acteurs de l’époque, celui qui constitue sans doute l’acte de baptême du mouvement qui est le leur, c’est bien sûr 1848. Ainsi, « célébrer 1848 est une manière de souder les rangs et de souligner le rôle des luttes de classes dans l’histoire tout en s’inscrivant dans un cadre national. » Mais au-delà de la mythologie socialiste qui se met en place, celle-là qui célèbre les luttes et les dirigeants illustres (on songe aux funérailles grandioses réservées à Liebknecht le 7 août 1900), la question de savoir ce qui doit advenir de la culture bourgeoise et nationale demeure entière. Ducange insiste à cet égard sur le cas Schiller : poète bourgeois ou partisan de l’émancipation ? Sa célébration par le mouvement ouvrier suscite en tout cas des débats nombreux dans les rangs du SPD.
Or, selon Kautsky, la social-démocratie devait se considérer « autant nationale que démocratique », ce qui fait dire à Jean-Numa Ducange qu’il n’est pas exagéré de « voir dans la démarche des acteurs des années 1880-1890 du “national-populaire” avant la lettre. » Ainsi la contre-histoire promue par les socialistes allemands vise-t-elle à se hisser à la hauteur de celle de leurs voisins français, laquelle, selon Gramsci « est pour ainsi dire intrinsèquement une histoire populaire, une histoire du peuple français ».
Mais l’aspect stratégique n’est pas tout. Une mutation s’opère : en devenant un mouvement de masse, le socialisme ambitionne de s’identifier au pays lui-même. Sa participation au pouvoir et sa bureaucratisation parachèvent son intégration à la nation : « la social-démocratie étant plus intégrée, elle se nationalise, y compris dans ses références historiques. » C’est là, sans doute, l’une des plus grandes réussites de la politique bismarckienne.
L’Orient et la question coloniale
À la belle époque, les Allemands dominent le socialisme mondial, mais d’autres partis naissent et les représentants venus d’autres continents que l’Europe s’assoient bientôt sur les bancs des congrès de l’Internationale. À Amsterdam, « la prise en compte du monde extra-européen s’affiche » et, pour dénoncer les tensions entre la Russie et le Japon, les deux vice-présidents du congrès sont Georges Plekhanov et Sen Katayama. Tandis que le mouvement socialiste gagne les nations colonisées et que cette même colonisation subit une accélération rapide après le congrès de Berlin de 1884, la question coloniale s’invite à l’ordre du jour des réunions. À Stuttgart, en 1907, où 27 pays sont représentés, trois journées du congrès sont consacrées au colonialisme.
« L’Orient apparaît bien désormais comme un des horizons possibles du socialisme. »
Là encore, les socialistes divergent. En 1904, Van Kol évoque à Amsterdam la possibilité de mener une « politique coloniale socialiste », laquelle apporterait de grands bénéfices aux ouvriers de métropole. Si cette proposition provoque un malaise relatif dans l’assistance, elle est reprise par le Français Lucien Deslinières qui formule, en 1912, un projet colonial pour le « Maroc socialiste » dans un livre éponyme. S’il obtient le soutien de Jules Guesde, il se heurte néanmoins à l’opposition de Jaurès.
Les positions allemandes s’inscrivent quant à elles dans une situation nationale particulière. Le Reich, en retard par rapport aux principales puissances coloniales, désire se faire une « place au soleil », et la nouvelle génération de Gustav Noske ou Friedrich Ebert qui arrive aux commandes du parti assume sans complexe le fait de mener une politique de colonisation.
Mais l’Orient, ce n’est pas que la question coloniale. C’est surtout un séisme immense. En 1905, le Tsar recule devant le peuple. L’immense empire russe, qui paraissait jusqu’alors endormi aux yeux de socialistes misant prioritairement sur le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière allemande, suscite un espoir considérable. Si l’engouement russophile et slavophile ne dure pas, 1905 n’en marque pas moins une rupture. Déjà, dans les intuitions du dernier Marx, on perçoit l’intérêt pour la Russie et l’Orient et, en 1911, Bauer pressent que de l’Est émergera ce « nouveau monde » qu’il appelle de ses vœux. Comme le résume Ducange, en ce début de XXe siècle, « l’Orient apparaît bien désormais comme un des horizons possibles du socialisme. »
Post-scriptum : 1914
En 1870, le refus des crédits de guerre par August Bebel lui avait valu un procès pour haute trahison. Un peu plus de quarante ans après, seule une fraction des députés socialistes allemands refuse la guerre. Deux ans plus tôt, le SPD était devenu le premier parti au Reichstag, il n’est plus un parti minoritaire, farouchement internationaliste et réprimé, il est pleinement intégré à la vie politique allemande. Au même moment, en Autriche, Victor Adler écrit dans la presse : « Si le prolétariat allemand avait un intérêt différent de celui du peuple allemand, alors nous serions jugés, alors nous devrions reconnaître que notre vision est fausse et l’édifice de notre pensée s’effondrerait. » Jean-Numa Ducange explique à ce propos que « le sentiment qui se dégage dans les sources des premiers jours d’août montre que, notamment pour des personnalités comme Adler, le conflit peut être une nouvelle occasion historique de rapprocher Autrichiens et Allemands. Un même peuple pour un même ensemble “allemand” devient à nouveau un horizon envisageable. Le vieux rêve de 1848 a assurément pesé. »
L’intégration « négative » du SPD au Reich, l’extrême diversité ethnique de l’Autriche-Hongrie qui préparait l’éclatement de 1918 et le républicanisme des socialistes français pouvaient, à tout prendre, difficilement s’accorder.
En France, où le mouvement socialiste s’est plus facilement identifié à l’idée de nation que dans les pays voisins, Jaurès est assassiné et Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT, déclare à ses funérailles le 4 août 1914 : « Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l’envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de civilisation et d’idéologie généreuse que nous a légué l’histoire. Nous ne voulons pas que sombrent les quelques libertés si péniblement arrachées aux forces mauvaises. […] C’est en harmonie avec cette volonté que nous répondons “présent” à l’ordre de mobilisation. » Et le vieux rêve internationaliste s’estompe en même temps que tombent les premiers soldats sur la Marne.
Quelques années plus tard, la radicalisation de l’aile gauche mènera aux conférences de Zimmerwald et Kiental, à la promotion du défaitisme révolutionnaire et les pays vaincus seront secoués par les répliques du tremblement de terre bolchevik.
Il apparaît que les socialistes de la Belle époque n’ont pas su proposer de grammaire commune sur la question nationale. L’intégration « négative » du SPD au Reich, l’extrême diversité ethnique de l’Autriche-Hongrie qui préparait l’éclatement de 1918 et le républicanisme des socialistes français pouvaient, à tout prendre, difficilement s’accorder. Cette longue période des premières décennies du socialisme fut le théâtre de débats passionnés d’une qualité intellectuelle rare qui n’auront pas su, pourtant, empêcher le dénouement tragique qui a ouvert le siècle.
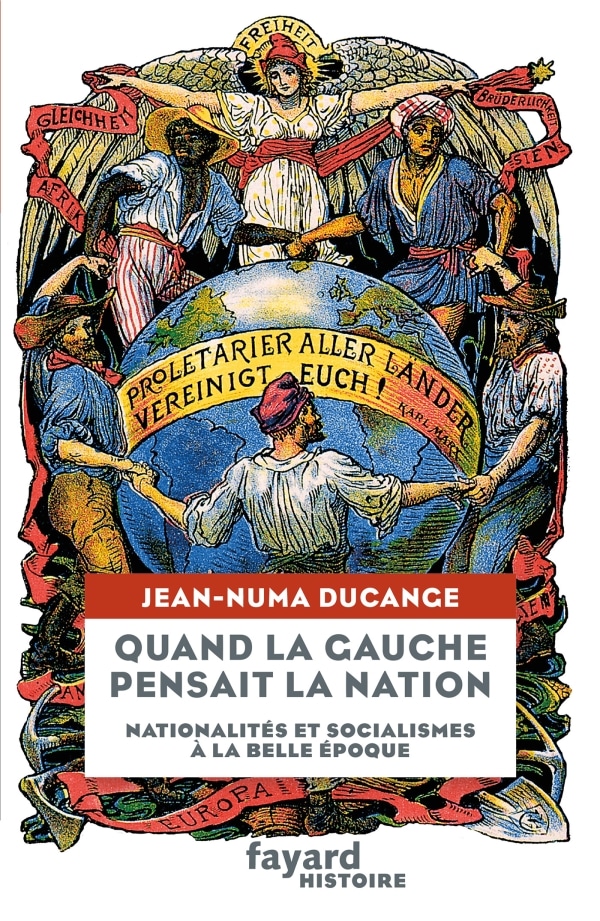
Quand la Gauche pensait la Nation. Nationalités et socialismes à la Belle-Époque
Jean-Numa Ducange
Fayard, 2021. 23,00 €










