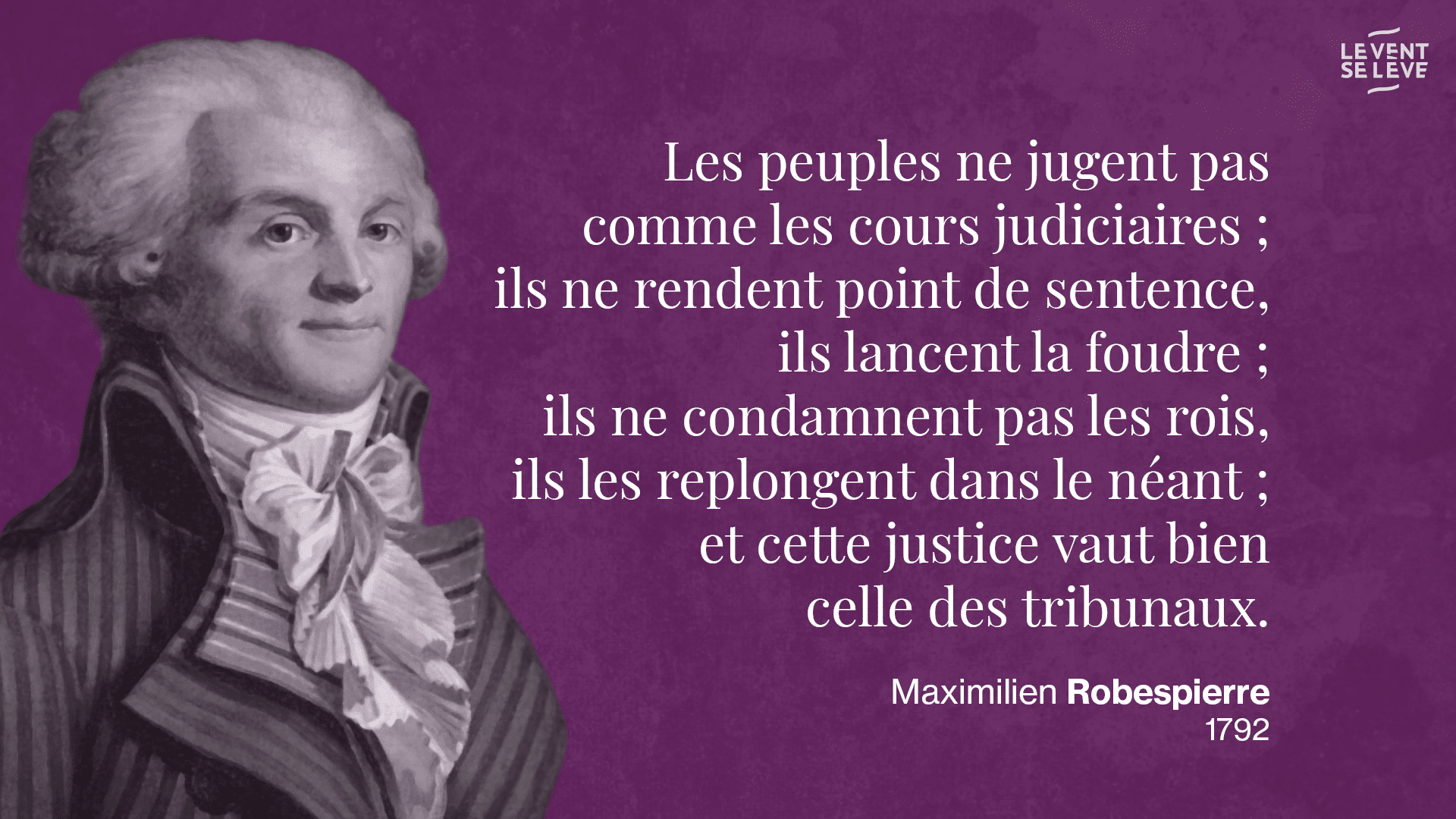Le 3 décembre 1792, Maximilien Robespierre prononce à la Convention un discours intitulé « Sur le parti à prendre à l’égard de Louis XVI ». La famille royale est alors retenue à la prison du Temple et les débats s’enlisent. Ce 3 décembre, la Convention adopte finalement un décret stipulant que le roi déchu pouvait être jugé et qu’il le serait par elle-même. La dernière charge de Robespierre, que nous reproduisons ici pour notre dossier « Les grands textes », aura eu raison de l’indécision des représentants du peuple. La découverte de l’armoire de fer au palais des Tuileries et l’examen des preuves de la trahison de Louis XVI fit prendre du retard au jugement. Finalement condamné, il fut guillotiné le 21 janvier 1793.
L’Assemblée a été entraînée, à son insu, loin de la véritable question. Il n’y a point ici de procès à faire. Louis n’est point un accusé ; vous n’êtes point des juges ; vous n’êtes, vous ne pouvez être que des hommes d’État et les représentants de la nation. Vous n’avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme : mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Un roi détrôné, dans la république, n’est bon qu’à deux usages, ou à troubler la tranquillité de l’État, et à ébranler la liberté ; ou à affermir l’une et l’autre. Or, je soutiens que le caractère qu’a pris jusqu’ici votre délibération va directement contre ce but.
En effet, quel est le parti que la saine politique prescrit pour cimenter la république naissante ? C’est de graver profondément dans les cœurs le mépris de la royauté, et de frapper de stupeur tous les partisans du roi. Donc, présenter à l’univers son crime comme un problème ; sa cause comme l’objet de la discussion la plus imposante, la plus religieuse, la plus difficile qui puisse occuper les représentants du peuple français, mettre une distance incommensurable entre le seul souvenir de ce qu’il fut, et la dignité d’un citoyen ; c’est précisément avoir trouvé le secret de le rendre encore dangereux à la liberté.
Louis fut roi, et la république est fondée ; la question fameuse qui vous occupe est décidée par ces seuls mots. Louis a été détrôné par ses crimes ; Louis dénonçait le peuple français comme rebelle ; il a appelé, pour le châtier, les armes des tyrans, ses confrères ; la victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle : Louis ne peut donc être jugé ; il est déjà jugé. Il est condamné, ou la république n’est point absoute. Proposer de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c’est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel ; c’est une idée contre-révolutionnaire ; car c’est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l’objet d’un procès, Louis peut être absous ; il peut être innocent. Que dis-je ? Il est présumé l’être jusqu’à ce qu’il soit jugé. Mais si Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la révolution ? Si Louis est innocent, tous les défenseurs de la liberté deviennent des calomniateurs. Tous les rebelles étaient les amis de la vérité et les défenseurs de l’innocence opprimée ; tous les manifestes des cours étrangères ne sont que des réclamations légitimes contre une faction dominatrice. La détention même que Louis a subie jusqu’à ce moment est une vexation injuste ; les fédérés, le peuple de Paris, tous les patriotes de l’empire français sont coupables ; et ce grand procès pendant au tribunal de la nature entre le crime et la vertu, entre la liberté et la tyrannie, est enfin décidé en faveur du crime et de la tyrannie. Citoyens, prenez-y garde ; vous êtes ici trompés par de fausses notions ; vous confondez les règles du droit civil et positif avec les principes du droit des gens ; vous confondez les relations des citoyens entre eux avec les rapports des nations à un ennemi qui conspire contre elle ; vous confondez encore la situation d’un peuple en révolution avec celle d’un peuple dont le gouvernement est affermi ; vous confondez une nation qui punit un fonctionnaire public, en conservant la forme du gouvernement, et celle qui détruit le gouvernement lui-même. Nous rapportons à des idées qui nous sont familières un cas extraordinaire qui dépend des principes que nous n’avons jamais appliqués. Ainsi, parce que nous sommes accoutumés à voir les délits dont nous sommes les témoins, jugés selon des règles uniformes, nous sommes naturellement portés à croire que, dans aucune circonstance, les nations ne peuvent avec équité, sévir autrement contre un homme qui a violé leurs droits, et où nous ne voyons point un juré, un tribunal, une procédure, nous ne trouvons point la justice. Ces termes mêmes que nous appliquons à des idées différentes de celles qu’ils expriment dans l’usage, achèvent de nous tromper. Tel est l’empire naturel de l’habitude, que nous regardons les plus arbitraires, quelquefois même les institutions les plus défectueuses, comme la règle la plus absolue du vrai ou du faux, du juste ou de l’injuste. Nous ne songeons pas même que la plupart tiennent encore nécessairement aux préjugés dont le despotisme nous a nourris ; nous avons été si longtemps courbés sous son joug, que nous nous relevons difficilement jusqu’aux principes éternels de la raison ; que tout ce qui remonte à la source sacrée de toutes les lois semble prendre à nos yeux un caractère illégal, et que l’ordre même de la nature nous paraît un désordre. Les mouvements majestueux d’un grand peuple, les sublimes élans de la vertu se présentent souvent à nos yeux timides comme les éruptions d’un volcan ou le renversement de la société politique ; et certes ce n’est pas la moindre cause des troubles qui nous agitent, que cette contradiction éternelle entre la faiblesse de nos mœurs, la dépravation de nos esprits, et la pureté des principes, l’énergie des caractères que suppose le gouvernement libre auquel nous osons prétendre.
Lorsqu’une nation a été forcée de recourir au droit de l’insurrection, elle rentre dans l’état de la nature à l’égard du tyran. Comment celui-ci pourrait-il invoquer le pacte social ? Il l’a anéanti. La nation peut le conserver encore, si elle le juge à propos, pour ce qui concerne les rapports des citoyens entre eux : mais l’effet de la tyrannie et de l’insurrection, c’est de le rompre entièrement par rapport au tyran ; c’est de les constituer réciproquement en état de guerre ; les tribunaux, les procédures judiciaires sont faites pour les membres de la cité. C’est une contradiction grossière de supposer que la constitution puisse présider à ce nouvel état de choses ; ce serait supposer qu’elle survit elle-même. Quelles sont les lois qui la remplacent ? Celles de la nature, celle qui est la base de la société même ; le salut du peuple. Le droit de punir le tyran et celui de le détrôner, c’est la même chose. L’un ne comporte pas d’autres formes que l’autre ; le procès du tyran, c’est l’insurrection ; son jugement c’est la chute de sa puissance ; sa peine celle qu’exige la liberté du peuple.
Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires ; ils ne rendent point de sentence, ils lancent la foudre ; ils ne condamnent pas les rois, ils les replongent dans le néant ; et cette justice vaut bien celle des tribunaux. Si c’est pour leur salut qu’ils s’arment contre leurs oppresseurs, comment seraient-ils tenus d’adopter un mode de les punir, qui serait pour eux un nouveau danger ?
Nous nous sommes laissé induire en erreur par des exemples étrangers qui n’ont rien de commun avec nous. Que Cromwell ait fait juger Charles Ier par un tribunal dont il disposait ; qu’Élisabeth ait fait condamner Marie d’Écosse de la même manière, il est naturel que des tyrans qui immolent leurs pareils, non au peuple, mais à leur ambition, cherchent à tromper l’opinion du vulgaire par des formes illusoires. Il n’est question là ni de principes, ni de liberté, mais de fourberie et d’intrigues : mais le peuple ! quelle autre loi peut-il suivre, que la justice et la raison appuyées de sa toute-puissance ?
Dans quelle république la nécessité de punir le tyran fut-elle litigieuse ? Tarquin fut-il appelé en jugement ? Qu’aurait-on dit à Rome, si des Romains avaient osé se déclarer ses défenseurs ? Que faisons-nous ? Nous appelons de toute part des avocats pour plaider la cause de Louis XVI.
Nous consacrons comme des actes légitimes ce qui chez tout peuple libre eût été regardé comme le plus grand des crimes. Nous invitons nous-mêmes les citoyens à la bassesse et à la corruption. Nous pourrons bien un jour décerner aux défenseurs de Louis des couronnes civiques ; car s’ils défendent sa cause, ils peuvent espérer de la faire triompher ; autrement, vous ne donneriez à l’univers qu’une ridicule comédie. Et nous osons parler de république ! Nous invoquons des formes, parce que nous n’avons pas de principes ; nous nous piquons de délicatesse, parce que nous manquons d’énergie ; nous étalons une fausse humanité, parce que le sentiment de la véritable humanité nous est étranger ; nous révérons l’ombre d’un roi, parce que nous sommes sans entrailles pour les opprimés.
Le procès à Louis XVI ! Mais qu’est-ce que ce procès, si ce n’est l’appel de l’insurrection à un tribunal ou à une assemblée quelconque ? Quand un roi a été anéanti par le peuple, qui a le droit de le ressusciter pour en faire un nouveau prétexte de trouble et de rébellion ? Et quels autres effets peut produire ce système ? En ouvrant une arène aux champions de Louis XVI, vous ressuscitez toutes les querelles du despotisme contre la liberté ; vous consacrez le droit de blasphémer contre la république et contre le peuple, car le droit de défendre l’ancien despote emporte le droit de dire tout ce qui tient à sa cause. Vous réveillez toutes les factions ; vous ranimez, vous encouragez le royalisme assoupi. On pourra librement prendre parti pour ou contre. Quoi de plus légitime, quoi de plus naturel que de répéter partout les maximes que ses défenseurs pourront professer hautement à votre barre et dans votre tribune même ? Quelle république que celle dont les fondateurs lui suscitent de toutes parts des adversaires pour l’attaquer dans son berceau !
C’est une grande cause, a-t-on dit, qu’il faut juger avec une sage et lente circonspection. C’est vous qui en faites une grande cause. Que dis-je ? C’est vous qui en faites une cause ? Que trouvez-vous là de grand ? Est-ce la difficulté ? Non. Est-ce le personnage ? Aux yeux de la liberté, il n’en est pas de plus vil ; aux yeux de l’humanité, il n’en est pas de plus coupable. Il ne peut en imposer encore qu’à ceux qui sont plus lâches que lui. Est-ce l’utilité du résultat ? C’est une raison de plus de le hâter. Une grande cause, c’est un projet de loi populaire ; une grande cause, c’est celle d’un malheureux opprimé par le despotisme. Quel est le motif de ces délais éternels que vous nous recommandez ? Craignez-vous de blesser l’opinion du peuple ? Comme si le peuple lui-même craignait autre chose que la faiblesse ou l’ambition de ses mandataires ! Comme si le peuple était un vil troupeau d’esclaves stupidement attaché au stupide tyran qu’il a proscrit, voulant, à quelque prix que ce soit, se vautrer dans la bassesse et dans la servitude ! Vous parlez de l’opinion ; n’est-ce point à vous de la diriger, de la fortifier ? Si elle s’égare, si elle se déprave, à qui faudrait-il s’en prendre, si ce n’est à vous-mêmes ? Craignez-vous de mécontenter les rois étrangers ligués contre nous ? Oh ! sans doute, le moyen de les vaincre, c’est de paraître les craindre ? Le moyen de confondre la criminelle conspiration des despotes de l’Europe, c’est de respecter leur complice. Craignez-vous les peuples étrangers ? Vous croyez donc encore à l’amour inné de la tyrannie ? Pourquoi donc aspirez-vous à la gloire d’affranchir le genre humain ? Par quelle contradiction supposez-vous que les nations qui n’ont point été étonnées de la proclamation des droits de l’humanité seront épouvantées du châtiment de l’un de ses plus cruels oppresseurs ? Enfin, vous redoutez, dit-on, les regards de la postérité. Oui, la postérité s’étonnera en effet de votre inconséquence et de votre faiblesse ; et nos descendants riront à la fois de la présomption et des préjugés de leurs pères. On a dit qu’il fallait du génie pour approfondir cette question ; je soutiens qu’il ne faut que de la bonne foi : il s’agit bien moins de s’éclairer que de ne point s’aveugler volontairement. Pourquoi ce qui nous paraît clair dans un temps, nous semble-t-il obscur dans un autre ? Pourquoi ce que le bon sens du peuple décide aisément se change-t-il, pour ses délégués, en problème presque insoluble ? Avons-nous le droit d’avoir une volonté générale et une sagesse différente de la raison universelle ?
J’ai entendu les défenseurs de l’inviolabilité avancer un principe hardi, que j’aurais presque hésité à énoncer moi-même. Ils ont dit que ceux qui, le 10 août, auraient immolé Louis XVI auraient fait une action vertueuse. Mais la seule base de cette opinion ne peut être que les crimes de Louis XVI et les droits du peuple. Or trois mois d’intervalle ont-ils changé ses crimes ou les droits du peuple ? Si alors on l’arracha à l’indignation publique, ce fut sans doute uniquement pour que sa punition, ordonnée solennellement par la Convention nationale, au nom de la nation, en devint plus imposante pour les ennemis de l’humanité ; mais remettre en question s’il est coupable ou s’il peut être puni, c’est trahir la foi donnée au peuple français. Il est peut-être des gens qui, soit pour empêcher que l’assemblée ne prenne un caractère digne d’elle ; soit pour ravir aux nations un exemple qui élèverait les âmes à la hauteur des principes républicains ; soit par des motifs encore plus honteux, ne seraient pas fâchés qu’une main privée remplit les fonctions de la justice nationale. Citoyens, défiez-vous de ce piège ; quiconque oserait donner un tel conseil, ne servirait que les ennemis du peuple. Quoi qu’il arrive, la punition de Louis n’est bonne désormais qu’autant qu’elle portera le caractère solennel d’une vengeance publique.
Qu’importe au peuple le méprisable individu du dernier des rois ? Représentants, ce qui lui importe, ce qui vous importe à vous-mêmes, c’est que vous remplissiez les devoirs que sa confiance vous a imposé. Vous avez proclamé la république, mais nous l’avez-vous donnée ? Nous n’avons point encore fait une seule loi qui justifie ce nom ; nous n’avons pas encore réformé un seul abus du despotisme. Ôtez les noms, nous avons encore la tyrannie tout entière, et de plus, des factions plus viles et des charlatans plus immoraux, avec de nouveaux ferments de troubles et de guerre civile. La république ! Et Louis vit encore ! Et vous placez encore la personne du roi entre nous et la liberté ! À force de scrupules, craignons de nous rendre criminels ; craignons qu’en montrant trop d’indulgence pour le coupable, nous ne nous mettions nous-mêmes à sa place.
Nouvelle difficulté. À quelle peine condamnerons-nous Louis ? La peine de mort est trop cruelle. Non, dit un autre, la vie est plus cruelle encore. Je demande qu’il vive. Avocats du roi, est-ce par pitié ou par cruauté que vous voulez le soustraire à la peine de ses crimes ! Pour moi, j’abhorre la peine de mort prodiguée par vos lois, et je n’ai pour Louis ni amour, ni haine : je ne hais que ses forfaits. J’ai demandé l’abolition de la peine de mort à l’Assemblée que vous nommez encore constituante, et ce n’est pas ma faute, si les premiers principes de la raison lui ont paru des hérésies morales et politiques. Mais si vous ne vous avisâtes jamais de les réclamer en faveur de tant de malheureux dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les criminels ? Vous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer ? Oui, la peine de mort en général est un crime, et par cette raison seule que, d’après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social. Or, jamais la sûreté publique ne la provoque contre les délits ordinaires, parce que la société peut toujours les prévenir par d’autres moyens, et mettre le coupable dans l’impuissance de lui nuire. Mais un roi détrôné au sein d’une révolution qui n’est rien moins que cimentée par les lois, un roi dont le nom seul attire le fléau de la guerre sur la nation agitée, ni la prison, ni l’exil ne peut rendre son existence indifférente au bonheur public ; et cette cruelle exception aux lois ordinaires que la justice avoue, ne peut être imputée qu’à la nature de ses crimes. Je prononce à regret cette fatale vérité… Mais Louis doit mourir, parce qu’il faut que la patrie vive. Chez un peuple paisible, libre et respecté au dedans comme au dehors, on pourrait écouter les conseils qu’on vous donne d’être généreux. Mais un peuple à qui l’on dispute encore sa liberté, après tant de sacrifices et de combats ; un peuple chez qui les lois ne sont encore inexorables que pour les malheureux ; un peuple chez qui les crimes de la tyrannie sont des sujets de dispute, doit désirer qu’on le venge ; et la générosité dont on nous flatte ressemblerait trop à celle d’une société de brigands qui se partagent des dépouilles.
Je vous propose de statuer dès ce moment sur le sort de Louis. Quant à sa femme, vous la renverrez aux tribunaux, ainsi que toutes les personnes prévenues des mêmes attentats. Son fils sera gardé au Temple, jusqu’à ce que la paix et la liberté publique soient affermies. Pour lui, je demande que la Convention le déclare dès ce moment, traître à la nation française, criminel envers l’humanité ; je demande qu’il donne un grand exemple au monde, dans le lieu même où sont morts, le 10 août, les généreux martyrs de la liberté. Je demande que cet événement mémorable soit consacré par un monument destiné à nourrir dans le cœur des peuples le sentiment de leurs droits et l’horreur des tyrans ; et dans l’âme des tyrans, la terreur salutaire de la justice du peuple.
Source : Wikisource.