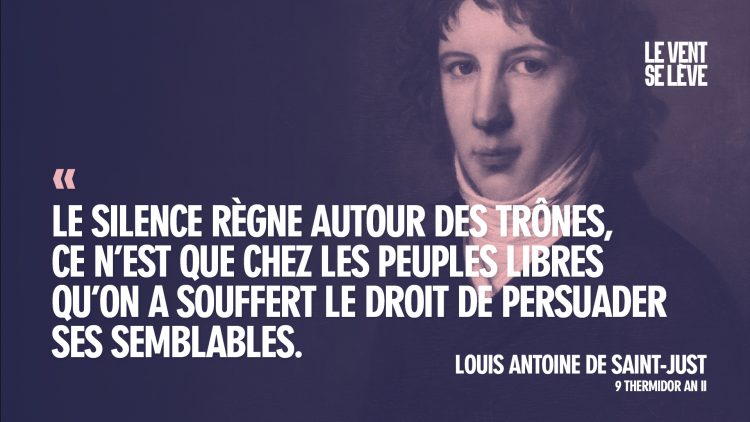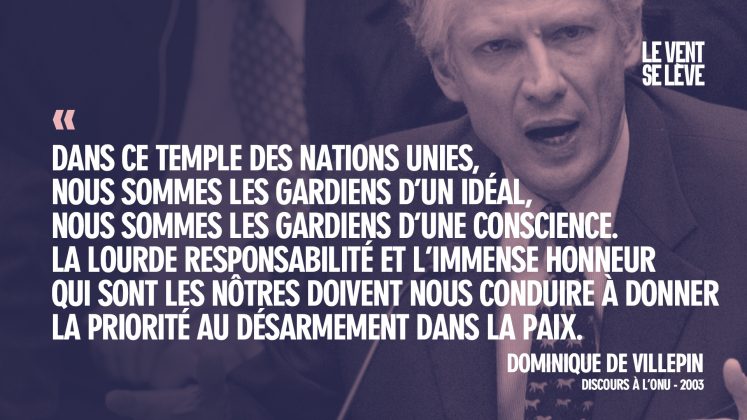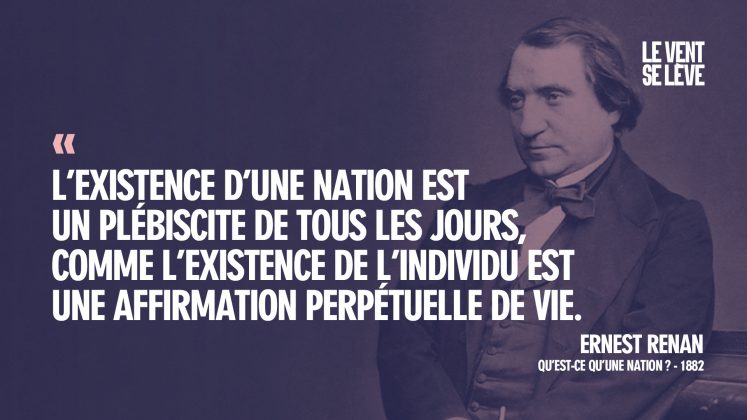Le 9 thermidor An II, Saint-Just prononce son dernier discours à la Convention. La veille, Robespierre a lancé une charge contre certains membres du Comité de Salut Public qu’il se refuse à nommer. Tallien, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois sont – entre autres – tenus responsables des excès de la Terreur. Saint-Just leur fit parvenir un billet porteur de ces mots : « Vous avez flétri mon cœur ; je vais l’ouvrir à la Convention. » Alors qu’il commençait à lire le discours écrit dans la nuit pour la défense de Robespierre, il est interrompu par Tallien, bientôt rallié par d’autres conventionnels. Robespierre tente d’intervenir, il en est empêché. Dans la confusion qui s’ensuit, ses adversaires lui interdisent l’accès de la tribune aux cris de « À bas le tyran ! ». Saint-Just se mure dans le silence, calme et immobile. Avec Robespierre, il est décrété d’arrestation. Libérés dans la soirée à la faveur d’une insurrection de la Commune et réfugiés à l’Hôtel de ville, ils sont finalement appréhendés et guillotinés le lendemain, place de la Révolution.
Je ne suis d’aucune faction ; je les combattrai toutes. Elles ne s’éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l’autorité et feront plonger sans retour l’orgueil humain sous le joug de la liberté publique.
Le cours des choses a voulu que cette tribune aux harangues fût peut-être la Roche Tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J’ai cru que la vérité vous était due, offerte avec prudence, et qu’on ne pouvait rompre avec pudeur l’engagement pris avec sa conscience de tout oser pour le salut de la patrie. Quel langage vais-je vous parler ? Comment vous peindre des erreurs dont vous n’avez aucune idée ? et comment rendre sensible le mal qu’un mot décèle, qu’un mot corrige ?
Vos Comités de sûreté générale et de salut public m’avaient chargé de vous faire un rapport sur les causes de la commotion sensible qu’avait éprouvée l’opinion publique dans ces derniers temps.
La confiance des deux comités m’honorait, mais quelqu’un cette nuit a flétri mon cœur, et je ne veux parler qu’à vous.
J’en appelle à vous de l’obligation que quelques-uns semblaient m’imposer de m’exprimer contre ma pensée.
On a voulu répandre que le gouvernement était divisé : il ne l’est pas, une altération politique, que je vais vous rendre, a seulement eu lieu.
[Arrivé à ce moment du discours, Saint-Just est interrompu par les conventionnels complices de ceux-là même qu’il s’apprête à dénoncer. Peu de temps après, il est décrété d’arrestation. Ce qui suit ne fut jamais prononcé par lui à la tribune.]
Ils ne sont point passés, tous les jours de gloire ! et je préviens l’Europe de la nullité de ses projets contre la vigueur du gouvernement.
Je vais parler de quelques hommes que la jalousie me paraît avoir portés à accroître leur influence et à concentrer dans leurs mains l’autorité par l’abaissement ou la dispersion de ce qui gênait leurs desseins, en outre en mettant à leur disposition la milice citoyenne de Paris, en supprimant ses magistrats pour s’attribuer leurs fonctions; qu’ils me paraissent avoir projeté de neutraliser le gouvernement révolutionnaire et tramé la perte des meilleurs gens de bien, pour dominer plus tranquillement.
Ces membres avaient concouru à me charger du rapport. Tous yeux ne m’ont point paru dessillés sur eux, je ne pouvais les accuser en leur propre nom, il eût fallu discuter longtemps dans l’intérieur le problème de leur entreprise, ils croyaient que, chargés par eux de vous parler, j’étais contraint par respect humain de tout concilier, ou d’épouser leurs vues et de parler leur langue.
J’ai profité d’un moment de loisir que m’a laissé leur espérance, pour me préparer à leur faire mesurer devant vous toute la profondeur de l’abîme où ils se sont précipités. C’est donc au nom de la patrie que je vous parle, j’ai cru servir mon pays et lui éviter des orages en n’ouvrant mes lèvres sincères qu’en votre présence.
C’est au nom de vous-mêmes que je vous entretiens, puisque je vous dois compte de l’influence que vous m’avez donnée dans les affaires.
Je suis donc résolu de fouler aux pieds toutes considérations lâches, et de vider en un moment à votre tribunal une affaire qui eût causé des violences dans l’obscurité du gouvernement. La circonstance où je me trouve eût paru délicate et difficile à quiconque aurait eu quelque chose à se reprocher, on aurait craint le triomphe des factions, qui donne la mort. Mais, certes, ce serait quitter peu de chose qu’une vie dans laquelle il faudrait être ou le complice ou le témoin muet du mal.
J’ai prié les membres dont j’ai à vous entretenir de venir m’entendre. Ils sont prévenus à mes yeux de fâcheux desseins contre la patrie, je ne me sens rien sur le cœur qui m’ait fait craindre qu’ils récriminassent, je leur dirai tout ce que je sens d’eux sans pitié.
J’ai parlé du dessein de détruire le gouvernement révolutionnaire. Un complice de cet attentat est arrêté et détenu à la Conciergerie. Il s’appelle Legray, il avait été receveur des rentes, il était membre du Comité révolutionnaire de la section du Muséum. Il s’ouvrit de son projet à quelques personnes qu’il crut attirer dans son crime.
Le gouvernement révolutionnaire était, à son gré, trop rigoureux, il fallait le détruire. Il manifesta qu’on s’en occupait.
Legray ajoute que des discours étaient préparés dans les sections, contre la Convention nationale, il se plaignit de l’expulsion des nobles, que ç’avait été un moyen de les reconnaître pour les assassiner, que la mémoire de Danton allait être réhabilitée et qu’on ferait repentir Paris des jugements exécutés sous ses yeux.
Dans le même temps, le bruit dans toute l’Europe se répandait que la royauté, en France, était rétablie, la Convention nationale égorgée et l’arbre de la liberté et les instruments du supplice des traîtres brûlés au pied du trône. Il s’y répandait que le gouvernement était divisé… On se trompe ! les membres du gouvernement étaient dispersés.
Dieu ! vous avez voulu qu’on tentât d’altérer l’harmonie d’un gouvernement qui eut quelque grandeur, dont les membres ont sagement régi, mais n’ont point voulu toujours en partager la gloire ! Vous avez voulu qu’on méditât la perte des bons citoyens ! Je déclare avoir fait mon possible pour ramener tous les esprits à la justice et avoir reconnu que la résolution évidente de quelques membres y était opposée.
Je déclare qu’on a tenté de mécontenter et d’aigrir les esprits pour les conduire à des démarches funestes, et l’on n’a point espéré de moi, sans doute, que je prêterais mes mains pures à l’iniquité. Ne croyez pas au moins qu’il ait pu sortir de mon cœur l’idée de flatter un homme ! Je le défends parce qu’il m’a paru irréprochable, et je l’accuserais lui-même, s’il devenait criminel.
Quel plan d’indulgence grand Dieu, que celui de vouloir la perte d’hommes innocents ! Le Comité de sûreté générale a été environné de prestiges pour être amené à ce but. Sa bonne foi n’a point compris la langue que lui parlait un dessein si funeste. On le flattait, on lui insinuait qu’on visait à le dépouiller de son autorité, les moindres prétextes sont saisis pour grossir l’orage. Trois ouvriers de la poudrière, habitants d’Arcueil et mêlés à 10 ou 12 pensionnaires de Bicêtre, qui s’étaient enivrés ensemble, sont présentés aux deux Comités par Billaud Varenne comme des patrouilles de conjurés… À ce sujet, il faut arrêter ou chasser le maire de Paris et l’état-major, et s’emparer de tout… Cette nuit encore on se disait sous le couteau, on annonçait qu’on serait mort sous 24 heures, qu’il y aurait une révolte aujourd’hui… J’adjure ici les consciences. N’est-il point vrai que dans le même temps on inspirait à beaucoup de membres des terreurs telles qu’ils ne couchaient plus chez eux ? On leur insinuait que certains membres du Comité faisaient à leur sujet de sanglantes propositions. On préparait ainsi les cœurs à la vengeance et à l’injustice.
J’atteste que Robespierre s’est déclaré le ferme appui de la Convention, et n’a jamais parlé dans le Comité, qu’avec ménagement, de porter atteinte à aucun de ses membres.
Collot et Billaud prennent peu de part, depuis quelque temps, aux délibérations, et paraissent livrés à des intérêts et à des vues plus particulières. Billaud assiste à toutes les séances sans parler, à moins que ce ne soit dans le sens de ses passions, ou contre Paris, contre le tribunal révolutionnaire, contre les hommes dont il paraît souhaiter la perte. Je me plains que, lorsqu’on délibère, il ferme les yeux et feint de dormir, comme si son attention avait d’autres objets. À sa conduite taciturne a succédé l’inquiétude depuis quelques jours. À ce sujet, je veux essayer de crayonner la politique avec laquelle tout se conduit, et vous dire des choses qu’il faut que vous sachiez et que vous eussiez ignorées.
Il m’a paru que l’on cherchait à renouveler l’époque où Valazé, Fabre d’Eglantine, Deffieux tentèrent d’exciter du trouble dans Paris pour justifier la révolte de Dumouriez. Voici comment on a suivi cette idée.
Billaud répète souvent ces paroles avec un feint effroi : nous marchons sur un volcan. Je le pense aussi, mais le volcan sur lequel nous marchons est sa dissimulation et son amour de dominer.
Le bruit court dans l’étranger que la Convention a été forcée de tirer 60 000 hommes de la Belgique pour les appeler vers Paris. Je ne pense pas que personne ait pensé à réaliser ce bruit, mais je trouve très déplorable que Paris se trouve précisément troublé dans ce moment, que ce soit dans ce moment même que des idées de jalousie et des desseins d’innovation se manifestent et que la liberté d’émouvoir les troupes soit concentrée dans très peu de mains avec un secret impénétrable, de manière que toutes les armées auraient changé de place et que très peu de personnes en seraient instruites.
Puisqu’on a dit qu’une loi permettait de ne laisser dans Paris que 24 compagnies de canonniers, je ne nie point qu’on ait eu le droit d’en tirer, mais je n’en connais pas le besoin. On ne le fit point sans de grands dangers, l’ennemi fuit et nous abandonne ses forteresses.
Je reviendrai sur les affaires militaires, je veux achever de parler de l’intérieur.
Tout fut rattaché à un plan de terreur. Afin de pouvoir tout justifier et tout oser, il m’a paru qu’on préparait les comités à recevoir et à goûter l’impression des calomnies. Billaud annonçait son dessein par des paroles entrecoupées, tantôt c’était le mot de Pisistrate qu’il prononçait et tantôt celui de danger. Il devenait hardi dans les moments où, ayant excité les passions, on paraissait écouter ses conseils. Mais son dernier mot expira toujours sur ses lèvres, il hésitait, il s’irritait, il corrigeait ensuite ce qu’il avait dit hier, il appelait tel homme absent Pisistrate, aujourd’hui présent, il était son ami. Il était silencieux, pâle, l’œil fixe, arrangeant ses traits altérés. La vérité n’a point ce caractère, ni cette politique.
Mais si l’on examine ce qui pouvait avoir donné lieu à la discorde, il est impossible de le justifier par le moindre prétexte d’intérêt public. Aucune délibération du gouvernement n’avait partagé les esprits, non point que toutes les mesures absolument eussent été sages, mais parce que ce qu’il y avait de plus important et surtout dans la guerre, était résolu et exécuté en secret.
Un membre s’était chargé, trompé peut-être, d’outrager sans raison celui qu’on voulait perdre, pour le porter apparemment à des mesures inconsidérées, à se plaindre publiquement, à s’isoler, à se défendre hautement, pour l’accuser ensuite des troubles dont on ne conviendra pas que l’on est la première cause. Ce plan a réussi, à ce qu’il me paraît, et la conduite rapportée plus haut a tout aigri.
C’est dans l’absence de ce membre qu’une expédition militaire, qu’on jugera plus tard parce qu’on ne peut pas la faire connaître encore, mais que je tiens pour insensée dans la circonstance où elle prévalut fut imaginée. On avait ordonné de tirer, sans m’avertir ni mes collègues, de l’armée de Sambre-et-Meuse, 18 000 hommes pour cette expédition. On ne m’en prévint pas, pourquoi ? Si cet ordre, donné le 1er messidor, s’était exécuté, l’armée de Sambre-et-Meuse était forcée de quitter Charleroi, de se replier peut-être sous Philippeville et Givet, et d’abandonner Avesnes et Maubeuge. Ajouterai-je que cette armée était devenue la plus importante ?
L’ennemi avait conduit devant elle toutes ses forces, on la laissait sans poudre, sans canons, sans pain. Des soldats y sont morts de faim en baisant leur fusil. Un agent, que mes collègues et moi envoyâmes au Comité pour demander des munitions ne fut point reçu comme j’aurai été sensiblement flatté qu’il le fût, et je dois cet éloge à Prieur, qu’il parut sensible à nos besoins. Il fallait vaincre, on a vaincu.
La journée de Fleurus a contribué à ouvrir la Belgique. Je désire qu’on rende justice à tout le monde, et qu’on honore des victoires, mais non point de manière à honorer davantage le gouvernement que les armées, car il n’y a que ceux qui sont dans les batailles qui les gagnent, et il n’y a que ceux qui sont puissants qui en profitent. Il faut donc louer les victoires et s’oublier soi-même.
Si tout le monde avait été modeste et n’avait point été jaloux qu’on parlât plus d’un autre que de soi, nous serions fort paisibles, on n’aurait point fait violence à la raison pour amener des hommes généreux au point de se défendre pour leur en faire un crime.
L’orgueil enfante les factions. C’est par les factions que les gouvernements voisins d’un peuple libre attaquent sa prospérité. Les factions sont le poison le plus terrible de l’ordre social, elles mettent la vie des bons citoyens en péril par la puissance de la calomnie, lorsqu’elles règnent dans un État, personne n’est certain de son avenir, et l’empire qu’elles tourmentent est un cercueil. Elles mettent en problème le mensonge et la vérité, le vice et la vertu, le juste et l’injuste : c’est la force qui fait la loi. Si la vertu ne se montrait parfois, le tonnerre à la main, pour rappeler tous les vices à l’ordre, la raison de la force serait toujours la meilleure. Ce n’est qu’après un siècle que la postérité plaintive verse des pleurs sur la tombe des Gracques et sur la roue de Sidney. Les factions en divisant un peuple, mettent la fureur de parti à la place de la liberté, le glaive des lois et les poignards des assassins s’entrechoquent, on n’ose plus parler ni se taire, les audacieux, qui se placent à la tête des partis, forcent les citoyens à se prononcer entre le crime et le crime. Ainsi, sous le règne d’Hébert et de Danton, tout le monde était furieux et farouche par peur.
C’est pourquoi le vœu le plus tendre pour sa patrie que puisse faire un bon citoyen et le bienfait le plus doux qui puisse descendre des mains de la Providence sur un peuple libre, le fruit le plus précieux que puisse recueillir une nation généreuse de sa vertu, c’est la ruine, c’est la chute des factions. Quoi ? l’amitié s’est-elle envolée de la terre ? la jalousie présidera-t-elle aux mouvements du corps social ? et, par le prestige de la calomnie, perdra-t-on ses frères, parce qu’ils sont plus sages et plus magnanimes que nous ?
La renommée est un vain bruit. Prêtons l’oreille sur les siècles écoulés. Nous n’entendrons plus rien, ceux qui, dans d’autres temps, se promèneront parmi nos urnes, n’en entendront pas davantage. Le bien, voilà ce qu’il faut faire, à quelque prix que ce soit, en préférant le titre de héros mort à celui de lâche vivant !
Il ne faut point souffrir que le crime triomphe, ni que l’intensité de la morale publique diminue de sa force contre les méchants. La puissance des lois et de la raison arrive à la suite, et tout le monde tremble sans distinction, il n’y a plus que des esclaves épouvantés.
Si vous voulez que les factions s’éteignent et que personne n’entreprenne de s’élever sur les débris de la liberté publique par les lieux communs de Machiavel, rendez la politique impuissante en réduisant tout à la règle froide de la justice, gardez pour vous la suprême influence : dictez des lois impérieuses à tous les partis, les lois n’ont point de passions qui les divisent et qui les fassent dissimuler. Les lois sont sévères, et les hommes ne le sont pas toujours, un masque impénétrable peut les couvrir longtemps. Si les lois protègent l’innocence, l’étranger ne peut les corrompre. Mais si l’innocence est le jouet des viles intrigues, il n’y a plus de garantie dans la cité. Il faut s’enfuir dans les déserts pour y trouver l’indépendance et des amis parmi des animaux sauvages. Il faut laisser un monde où l’on n’a plus l’énergie ni du crime ni de la vertu, et où il n’est resté que l’épouvante et le mépris !
C’est pourquoi je demande quelques jours encore à la Providence pour appeler sur les institutions les méditations du peuple français et de tous ses législateurs. Tout ce qui arrive aujourd’hui dans le gouvernement n’aurait point eu lieu sous leur empire ; ils seraient vertueux, et n’auraient point pensé au mal, ceux dont j’accuse ici les prétentions orgueilleuses ! Il n’y a pas longtemps peut-être qu’ils ont laissé la route frayée par la vertu.
Quand je revins pour la dernière fois de l’armée, je ne reconnus plus quelques visages, les membres du gouvernement étaient épars sur les frontières et dans les bureaux ; les délibérations étaient livrées à deux ou trois hommes avec le même pouvoir et la même influence que le comité même, qui se trouvait presque entièrement dispersé, soit par des missions, soit par maladie, soit par les procès intentés aux autres pour les éloigner. Le gouvernement à mes yeux a véritablement été envahi par deux ou trois hommes. C’est pendant cette solitude qu’ils me semblent avoir conçu l’idée très dangereuse d’innover dans le gouvernement et de s’attirer beaucoup d’influence.
À mon retour, comme je l’ai dit, tout était changé, le gouvernement n’était point divisé, mais il était épars, et abandonné à un petit nombre, qui, jouissant d’un absolu pouvoir, accusa les autres d’y prétendre, pour le conserver.
C’est dans ces circonstances qu’on a conçu la procédure d’hommes innocents, qu’on a tenté d’armer contre eux de très injustes préventions. Je n’ai point à m’en plaindre, on m’a laissé paisible comme un citoyen sans prétentions et qui marchait seul et c’est par erreur que, par le suffrage de quelques-uns, on m’avait chargé du rapport pour me lier à des idées qui ne sont point faites, ce me semble, pour moi.
Je ne puis épouser le mal. Je m’en suis expliqué en présence des comités, je rapporterai mes propres paroles devant eux, lorsqu’il me parut qu’on les avait assemblés pour les égarer :
Citoyens, leur dis-je, j’éprouve de sinistres présages, tout se déguise devant mes yeux, mais j’étudierai tout ce qui se passe, je me dirai tout ce que la probité conseille pour le bien de la patrie, je me tracerai l’image de l’honnête homme et ce que la vertu lui prescrit en ce moment, et tout ce qui ne ressemblera pas au pur amour du peuple et de la liberté aura ma haine.
Le lendemain, nous nous assemblâmes encore, tout le monde gardait un profond silence, les uns et les autres étaient présents. Je me levai, et je dis :
Vous me paraissez affligés, il faut que tout le monde ici s’explique avec franchise, et je commencerai, si on le permet.
Citoyens, ajoutai-je, je vous ai déjà dit qu’un officier suisse, fait prisonnier devant Maubeuge, et interrogé par Guvton, Laurent et moi, nous donna la première idée de ce qui se tramait. Cet officier nous dit que la police redoutable survenue dans Cambrai, avait déconcerté le plan des alliés, qu’ils avaient changé de vues, mais qu’on ne se plaçait en Autriche dans aucune hypothèse d’accommodement avec la France, qu’on attendait tout d’un parti qui renverserait la forme terrible du gouvernement, que l’on comptait sur des intelligences, sur des principes sévères. Je vous invitai de surveiller avec plus de soin tout ce qui tendait à altérer la forme salutaire de la justice présente : bientôt vous vîtes vous-mêmes percer ce plan dans les libelles étrangers. Les ambassadeurs vous ont prévenus de tentatives prochaines contre le gouvernement révolutionnaire : aujourd’hui que se passe-t-il ? On réalise les bruits étrangers ; on dit même que si l’on réussit, on fera contraster l’indulgence avec votre rigueur contre les traîtres.
Je dis ensuite que, la République manquant de ces institutions d’où résultaient les garanties, on tendait à dénaturer l’influence des hommes qui donnaient de sages conseils, pour les constituer en état de tyrannie, que c’était sur ce plan que marchait l’étranger, d’après les notes mêmes qui étaient sur le tapis, que je ne connaissais point de dominateur qui ne se fût emparé d’un grand crédit militaire, des finances et du gouvernement et que ces choses n’étaient point dans les mains de ceux contre lesquels on insinuait des soupçons.
David se rangea de mon avis avec sa franchise ordinaire. Billaud Varenne dit à Robespierre : Nous sommes tes amis ; nous avons marché toujours ensemble. Ce déguisement fit tressaillir mon cœur.
La veille, il le traitait de Pisistrate et avait tracé son acte d’accusation.
Il est des hommes que Lycurgue eût chassés de Lacédémone sur le sinistre caractère et la pâleur de leur front, et je regrette de n’avoir plus vu la franchise ni la vérité céleste sur le visage de ceux dont je parle.
Quand les deux Comités m’honorèrent de leur confiance et me chargèrent du rapport, j’annonçai que je ne m’en chargeais qu’à condition qu’il serait respectueux pour la Convention et pour ses membres. J’annonçai que j’irai à la source, que je développerais le plan ourdi pour saper le gouvernement révolutionnaire, que je m’efforcerais d’accroître l’énergie de la morale publique. Billaud-Varenne et Collot d’Herbois insinuèrent qu’il ne fallait point parler de l’être suprême, de l’immortalité de l’âme, de la sagesse, on revint sur ces idées, on les trouva indiscrètes et l’on rougit de la divinité.
C’était au même instant que la pétition de Magenthies parut, tendant à caractériser comme blasphème et à punir de mort des paroles souvent entendues dans la bouche du peuple. Ah ! ce ne sont point là des blasphèmes, un blasphème est l’idée de faire marcher devant Dieu les faisceaux de Sylla, un blasphème, c’est d’épouvanter les membres par des listes de proscription et d’en accuser l’innocence.
Ainsi, l’on m’avait condamné à ne vous point parler de la Providence, seul espoir de l’homme isolé, qui, environné de sophismes, demande au ciel et le courage et la sagesse nécessaires pour faire triompher la vérité.
Si l’on réfléchit attentivement sur ce qui s’est passé dans votre dernière séance on trouve application de tout ce que j’ai dit. L’homme éloigné du comité par les plus amers traitements, lorsqu’il n’était plus composé, en effet, que de 2 ou 3 membres présents, cet homme se justifie devant vous, il ne s’explique point, à la vérité, assez clairement, mais son éloignement et l’amertume de son âme peuvent excuser quelque chose : il ne sait point l’histoire de sa persécution, il ne connaît que son malheur. On le constitue en tyran de l’opinion. Il faut que je m’explique là-dessus, et que je porte la flamme sur un sophisme qui tendrait à faire proscrire le mérite. Et quel droit exclusif avez-vous sur l’opinion, vous qui trouvez un crime dans l’art de toucher les âmes ? Trouvez-vous mauvais que l’on soit sensible ? Êtes-vous donc de la cour de Philippe, vous qui faites la guerre à l’éloquence ? Un tyran de l’opinion ? Qui vous empêche de disputer l’estime de la patrie, vous qui trouvez mauvais qu’on la captive ? Il n’est point de despote au monde, si ce n’est Richelieu, qui se soit offensé de la célébrité d’un écrivain. Est-il un triomphe plus désintéressé ? Caton aurait chassé de Rome le mauvais citoyen qui eût appelé l’éloquence, dans la tribune aux harangues, le tyran de l’opinion. Personne n’a le droit de stipuler pour elle, elle se donne à la raison et son empire n’est pas le pouvoir des gouvernements.
La conscience publique est la cité, elle est la sauvegarde du citoyen. Ceux qui ont su toucher l’opinion ont tous été les ennemis des oppresseurs. Démosthène était-il tyran ? Sous ce rapport, sa tyrannie sauva pendant longtemps la liberté de toute la Grèce. Ainsi, la médiocrité jalouse voudrait conduire le génie à l’échafaud ! Eh bien, comme le talent d’orateur, que vous exercez ici est un talent de tyrannie, on vous accusera bientôt comme des despotes de l’opinion. Le droit d’intéresser l’opinion publique est un droit naturel, imprescriptible, inaliénable et ne voit d’usurpateur que parmi ceux qui tendraient à opprimer ce droit.
Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois ? Non. Le silence règne autour des trônes, ce n’est que chez les peuples libres qu’on a souffert le droit de persuader ses semblables. N’est-ce point une arène ouverte à tous les citoyens. Que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l’art de bien dire et vous verrez rouler un torrent de lumières qui sera le garant de notre liberté, pourvu que l’orgueil soit banni de notre République.
Immolez ceux qui sont les plus éloquents et bientôt on arrivera à celui qui les enviait et qui l’était le plus après eux. Un censeur royal se serait contenté de dire : Vous avez écrit contre la cour et contre monseigneur l’archevêque. Mais qu’avons-nous donc fait de notre raison ? On dit aujourd’hui à un membre du souverain Vous n’avez pas le droit d’être persuasif.
Le membre qui a parlé longtemps hier à cette tribune ne paraît point avoir assez nettement distingué ceux qu’il inculpait. Il n’a point à se plaindre et ne s’est pas plaint non plus des comités, car les comités me semblent toujours dignes de votre estime et les malheurs dont j’ai tracé l’histoire sont nés de l’isolement et de l’autorité extrême de quelques membres restés seuls.
Il devait arriver que le gouvernement s’altérerait en se dépouillant de ses membres. Couthon est sans cesse absent, Prieur de la Marne est absent depuis huit mois, Saint-André est au Port la Montagne, Lindet est enseveli dans ses bureaux, Prieur de la Côte-d’Or dans les siens, moi j’étais à l’armée, et le reste, qui exerçait l’autorité de tous, me paraît avoir essayé de profiter de leur absence.
Je regarderais comme un principe salutaire et conservateur de la liberté publique, que le tapis du Comité fût environné de tous ses membres. Vous aviez confié le gouvernement à 12 personnes, il s’est trouvé en effet, le dernier mois, entre les mains de 2 ou 3. Avec cette imprudence, on s’expose à inspirer aux hommes le goût de l’indépendance et de l’autorité.
Imaginez que cette altération eût continué, que Paris eût été sans état-major et sans magistrats, que le Tribunal révolutionnaire eût été supprimé ou rempli des créatures de 2 ou 3 membres gouvernant absolument, votre autorité en eût été anéantie.
Une seule chose aurait encore gêné ces membres, c’étaient les Jacobins, qu’ils appellent la tyrannie de l’opinion, il fallait donc sacrifier les hommes les plus influents de cette société.
Car, en même temps que Billaud-Varenne et Collot d’Herbois ont conduit ce plan, ils ont manifesté depuis quelque temps leur haine contre les Jacobins, ils ont cessé de les fréquenter et d’y parler.
S’ils avaient réussi, tandis que la majorité du Comité était plongée dans les détails, quelques hommes régnaient, ils n’avaient plus à craindre les orateurs incommodes et jouissaient de la réputation et de l’autorité exclusives.
Il a donc existé un plan d’usurper le pouvoir en immolant une partie des membres du Comité et en dispersant les autres dans la République, en détruisant le Tribunal révolutionnaire, en privant Paris de ses magistrats. Billaud-Varenne et Collot d’Herbois sont les auteurs de cette trame.
Les deux Comités n’ont donc rien dû perdre de l’estime publique, et ceux-là seuls sont indignes d’eux qui ont eu de l’ambition sous le masque du désintéressement et qui ont pensé concentrer dans eux l’initiative des accusations contre vos membres.
Je pense que vous devez à la justice et à la patrie d’examiner ma dénonciation. Vous devez regarder comme un acte de tyrannie toute délibération du Comité qui ne sera point signée de six membres, vous devez examiner aussi s’il est sage que les membres fassent le métier de ministres, qu’ils s’ensevelissent dans des bureaux, qu’ils s’éloignent de vous et altèrent ainsi l’esprit et les principes de leur compagnie.
Les affaires publiques ne souffriront point de cet orage, la liberté n’en sera pas alarmée et le gouvernement reprendra son cours par votre sagesse.
Il me reste à vous convaincre que je n’ai pu prendre d’autre parti que celui de vous dire la vérité. Si j’annonçais mon intention dans les comités, on n’avait plus de mesures à garder et tout pouvait entraîner des démarches funestes. Dans ce cas, leur point d’influence acquérait de nouvelles forces : ils rendaient d’autres membres solidaires avec eux, s’ils fussent parvenus à les tromper. J’ai cru éviter des désordres et dispenser les comités d’une querelle difficile, puisque l’on eût tout employé pour brouiller les esprits.
Les membres que j’accuse ont commis peu de fautes dans leurs fonctions, ils n’ont donc point à se justifier par les opérations, si ce n’est celle des 18 000 hommes qu’on a voulu enlever de l’armée de Sambre et Meuse. Je les accuse d’avoir tiré parti de la réputation du Comité, pour l’appliquer à leur ambition. Sylla était un fort bon général, un grand politique, il savait administrer, mais il appliqua ce mérite à sa fortune. J’aime beaucoup qu’on nous assure des victoires, mais je ne veux pas qu’elles deviennent des prétextes de vanité. On annonça la journée de Fleurus, et d’autres, qui n’en ont rien dit, y étaient présents. On a parlé de sièges et d’autres, qui n’en ont rien dit, étaient dans la tranchée. J’affirme que tout le mal est venu de ce que, sans que personne s’en doutât, toute l’autorité était tombée dans quelques mains qui ont voulu la conserver et l’augmenter par la ruine de tout ce qui pouvait réprimer la puissance arbitraire.
Je ne conclus pas contre ceux que j’ai nommés : je désire qu’ils se justifient et que nous devenions plus sages.
Je propose le décret suivant :
La Convention nationale décrète que les institutions qui seront incessamment rédigées présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre de son ressort révolutionnaire, ne puisse tendre à l’arbitraire, favoriser l’ambition, et opprimer ou usurper la représentation nationale.