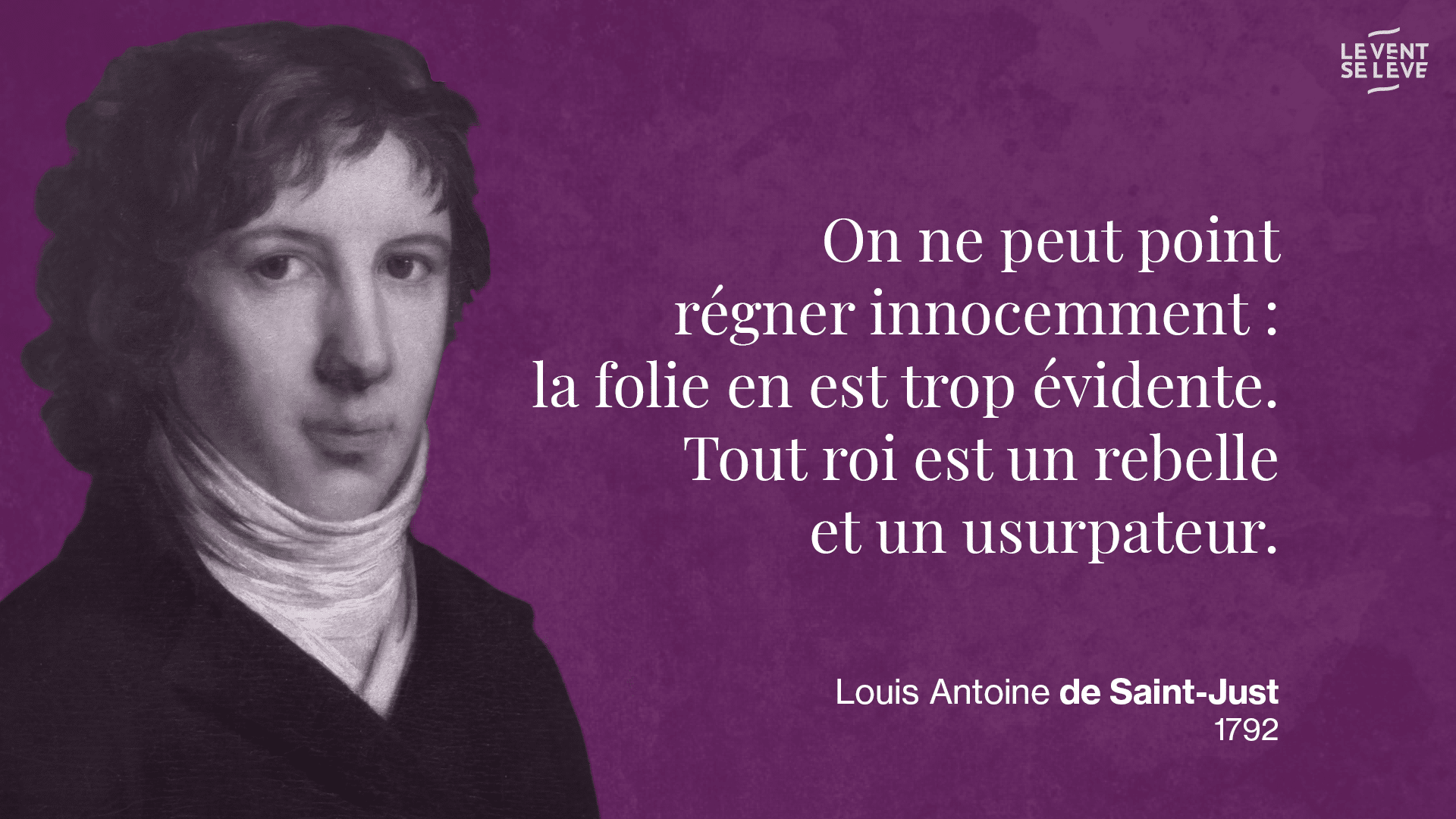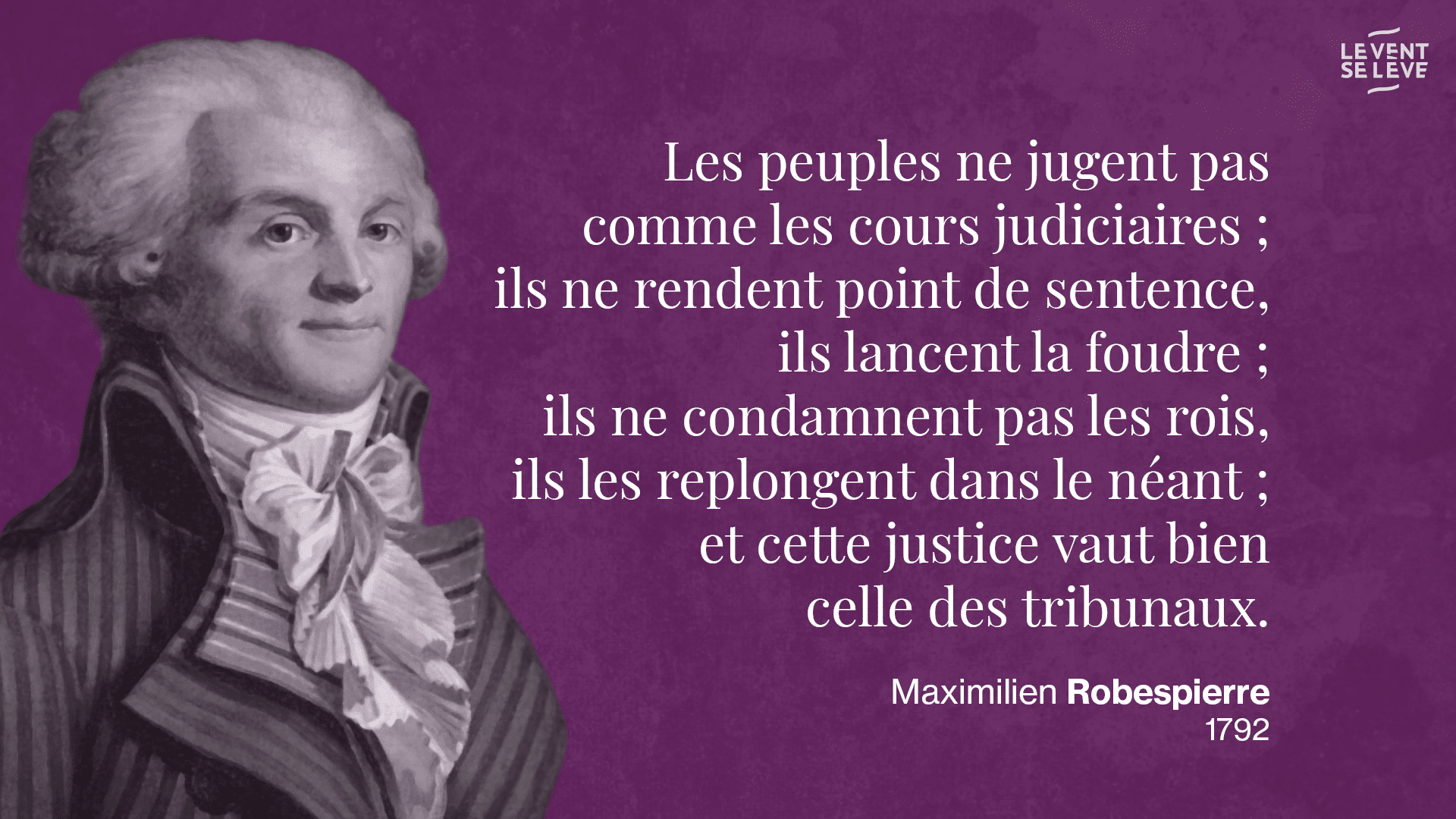Élu député au mois de septembre 1792, Louis Antoine de Saint-Just est seulement âgé de 25 ans lorsqu’il prononce son premier discours à la tribune de la Convention. Le sujet de ce discours, c’est le jugement du roi. Après la prise des Tuileries le 10 août, la victoire de Valmy et la proclamation de la République le 21 septembre, les conventionnels doivent encore décider ce qu’il adviendra de la famille royale. Le jeune député de l’Aisne pose les termes du débat. Michelet note à son propos : « Ce glaive de la Montagne, il fut porté par Saint-Just. Il fallait un homme tout neuf (…). Jeune ou non, exagéré ou non, il avait eu cette puissance de donner le ton pour tout le procès. Il détermina le diapason ; on continua de chanter au ton de Saint-Just. » Moins de deux ans après ce discours emblématique, prononcé le 13 novembre 1792 et réédité par LVSL pour sa collection « Les grands textes », celui qu’on a baptisé « l’archange de la Terreur » fut guillotiné avec Robespierre sur la place de la Révolution, le 10 thermidor an II.
J’entreprends, Citoyens, de prouver que le roi peut être jugé ; que l’opinion de Morisson, qui conserve l’inviolabilité, et celle du comité, qui veut qu’on le juge en citoyen, sont également fausses, et que le roi doit être jugé dans des principes qui ne tiennent ni de l’une ni de l’autre. Le comité de législation, qui vous a parlé très sainement de la vaine inviolabilité du roi et des maximes de la justice éternelle ne vous a point, ce me semble, développé toutes les conséquences de ces principes ; en sorte que le projet de décret qu’il vous a présenté n’en dérive point, et perd, pour ainsi dire, leur sève.
L’unique but du comité fut de vous persuader que le roi devait être jugé en aimable citoyen ; et moi, je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu’à le combattre, et que, n’étant plus rien dans le contrat qui unit les Français, les formes de la procédure ne sont point dans la loi civile, mais dans la loi du droit des gens.
Faute de ces distinctions, on est tombé dans des formes sans principes, qui conduiraient le roi à l’impunité, fixeraient trop longtemps les yeux sur lui, ou qui laisseraient sur son jugement une tache de sévérité injuste ou excessive. Je me suis souvent aperçu que de fausses mesures de prudence, les lenteurs, le recueillement, étaient ici de véritables imprudences ; et après celle qui recule le moment de nous donner des lois, la plus funeste serait celle qui nous ferait temporiser avec le roi. Un jour, peut-être, les hommes, aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales, s’étonneront de la barbarie d’un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un tyran, où le peuple qui eut un tyran à juger l’éleva au rang de citoyen avant d’examiner ses crimes, songea plutôt à ce qu’on dirait de lui qu’à ce qu’il avait à faire, et, d’un coupable de la dernière classe de l’humanité, je veux dire celle des oppresseurs, fit, pour ainsi dire, un martyr de son orgueil.
On s’étonnera un jour qu’au dix-huitième siècle on ait été moins avancé que du temps de César – là le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autres formalités que vingt-trois coups de poignard et sans autre loi que la liberté de Rome. Et aujourd’hui l’on fait avec respect le procès d’un homme assassin d’un peuple, pris en flagrant délit, la main dans le sang, la main dans le crime !
Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une République à fonder : ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d’un roi ne fonderont jamais une République. Parmi nous, la finesse des esprits et des caractères est un grand obstacle à la liberté ; on embellit toutes les erreurs, et, le plus souvent, la vérité n’est que la séduction de notre goût.
Votre comité de législation vous en donne un exemple dans le rapport qui vous a été lu. Morisson vous en donne un plus frappant : à ses yeux, la liberté, la souveraineté des nations sont une chose de fait. On a posé des principes ; on a négligé leurs plus naturelles conséquences. Une certaine incertitude s’est montrée depuis le rapport. Chacun rapproche le procès du roi de ses vues particulières ; les uns semblent craindre de porter plus tard la peine de leur courage ; les autres n’ont point renoncé à la monarchie ; ceux-ci craignent un exemple de vertu qui serait un lien d’esprit public et d’unité dans la République ; ceux-là n’ont point d’énergie. Les querelles, les perfidies, la malice, la colère, qui se déploient tour à tour, ou sont un frein ingénieux à l’essor de la vigueur combinée dont nous avons besoin, ou sont la marque de l’impuissance de l’esprit humain. Nous devons donc avancer courageusement à notre but, et, si nous voulons une République, y marcher très sérieusement. Nous nous jugeons tous avec sévérité, je dirai même avec fureur ; nous ne songeons qu’à modifier l’énergie du peuple et de la liberté, tandis qu’on accuse à peine l’ennemi commun et que tout le monde, ou rempli de faiblesse ou engagé dans le crime, se regarde avant de frapper le premier coup. Nous cherchons la liberté, et nous nous rendons esclaves l’un de l’autre ! Nous cherchons la nature, et nous vivons armés comme des sauvages furieux ! Nous voulons la République, l’indépendance et l’unité, et nous nous divisons et nous ménageons un tyran !
Citoyens, si le peuple romain, après six cents ans de vertu et de haine contre les rois ; si la Grande-Bretagne, après Cromwell mort, vit renaître les rois, malgré son énergie, que ne doivent pas craindre parmi nous les bons citoyens amis de la liberté, en voyant la hache trembler dans nos mains, et un peuple, dès le premier jour de sa liberté, respecter le souvenir de ses fers ! Quelle République voulez-vous établir au milieu de nos combats particuliers et de nos faiblesses communes ?
On semble chercher une loi qui permette de punir le roi : mais dans la forme de gouvernement dont nous sortons, s’il y avait un homme inviolable, il l’était, en partant de ce sens, pour chaque citoyen ; mais de peuple à roi, je ne connais plus de rapport naturel. Il se peut qu’une nation, stipulant les clauses du pacte social, environne ses magistrats d’un caractère capable de faire respecter tous les droits et d’obliger chacun ; mais ce caractère étant au profit du peuple, et sans garantie contre le peuple, l’on ne peut jamais s’armer contre lui d’un caractère qu’il donne et retire à son gré. Les citoyens se lient par contrat ; le souverain ne se lie pas ; ou le prince n’aurait point de juge et serait un tyran. Ainsi l’inviolabilité de Louis ne s’est point étendue au-delà de son crime et de l’insurrection ; ou, si on le jugeait inviolable après, si même on le mettait en question, il en résulterait, Citoyen, qu’il n’aurait pu être déchu, et qu’il aurait eu la faculté de nous opprimer sous la responsabilité du peuple.
Le pacte est un contrat entre les citoyens, et non point avec le gouvernement : on n’est pour rien dans un contrat où l’on ne s’est point obligé. Conséquemment, Louis, qui ne s’était pas obligé, ne peut pas être jugé civilement. Ce contrat était tellement oppressif, qu’il obligeait les citoyens, et non le roi : un tel contrat était nécessairement nul, car rien n’est légitime de ce qui manque de sanction dans la morale et dans la nature.
Outre ces motifs, qui tous vous portent à ne pas juger Louis comme citoyen, mais à le juger comme rebelle, de quel droit réclamerait-il, pour être jugé civilement, l’engagement que nous avons pris avec lui, lorsqu’il est clair qu’il a violé le seul qu’il avait pris envers nous, celui de nous conserver ? Quel serait cet acte dernier de la tyrannie que de prétendre être jugé par des lois qu’il a détruites ? Et, Citoyens, si nous lui accordions de le juger civilement, c’est-à-dire suivant les lois, c’est-à-dire en citoyen, à ce titre il nous jugerait, il jugerait le peuple même. Pour moi, je ne vois point de milieu : cet homme doit régner ou mourir. Il vous prouvera que tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour soutenir le dépôt qui lui était confié ; car, en engageant avec lui cette discussion, vous ne lui pouvez demander compte de sa malignité cachée ; il vous perdra dans le cercle vicieux que vous tracez vous-mêmes pour l’accuser.
Citoyens, ainsi les peuples opprimés au nom de leur volonté s’enchaînent indissolublement par le respect de leur propre orgueil, tandis que la morale et l’utilité devraient être l’unique règle des lois. Ainsi, par le prix qu’on met à ses erreurs, on s’amuse à les combattre, au lieu de marcher droit à la vérité.
Quelle procédure, quelle information voulez-vous faire des entreprises et des pernicieux desseins du roi ? D’abord, après avoir reconnu qu’il n’était point inviolable pour le souverain, et ensuite lorsque ses crimes sont partout écrits avec le sang du peuple, lorsque le sang de vos défenseurs a ruisselé, pour ainsi dire, jusqu’à vos pieds, et jusque sur cette image de Brutus, qu’on ne respecte pas le roi. Il opprima une nation libre ; il se déclara son ennemi ; il abusa des lois : il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu’il était dans ses vues d’accabler le peuple pour assurer le sien. Ne passa-t-il pas, avant le combat, les troupes en revue ? Ne prit-il pas la fuite au lieu de les empêcher de tirer ? Que fit-il pour arrêter la fureur de ses soldats ? L’on vous propose de le juger civilement, tandis que vous reconnaissez qu’il n’était pas citoyen, et qu’au lieu de conserver le peuple il ne fit que sacrifier le peuple à lui-même.
Je dirai plus : c’est qu’une Constitution acceptée par un roi n’obligerait pas les citoyens ; ils avaient, même avant son crime, le droit de le proscrire et de le chasser. Juger un roi comme un citoyen ! Ce mot étonnera la postérité froide. Juger, c’est appliquer la loi. Une loi est un rapport de justice : quel rapport de justice y a-t-il donc entre l’humanité et les rois ? Qu’y a-t-il de commun entre Louis et le peuple français, pour le ménager après sa trahison ? Il est telle âme généreuse qui dirait, dans un autre temps, que le procès doit être fait à un roi, non point pour les crimes de son administration, mais pour celui d’avoir été roi, car rien au monde ne peut légitimer cette usurpation ; et de quelque illusion, de quelques conventions que la royauté s’enveloppe, elle est un crime éternel, contre lequel tout homme a le droit de s’élever et de s’armer ; elle est un de ces attentats que l’aveuglement même de tout un peuple ne saurait justifier. Ce peuple est criminel envers la nature par l’exemple qu’il a donné, et tous les hommes tiennent d’elle la mission secrète d’exterminer la domination en tout pays.
On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois mêmes traitaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité ? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell ? Et, certes, Cromwell n’était pas plus usurpateur que Charles Ier ; car lorsqu’un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n’est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l’un que sur celle de l’autre.
Voilà les considérations qu’un peuple généreux et républicain ne doit pas oublier dans le jugement d’un roi.
On nous dit que le roi doit être jugé par un tribunal comme les autres citoyens… Mais les tribunaux ne sont établis que pour les membres de la cité ; et je ne conçois point par quel oubli des principes des institutions sociales un tribunal serait juge entre un roi et le souverain ; comment un tribunal aurait la faculté de rendre un maître à la patrie, et de l’absoudre, et comment la volonté générale serait citée devant un tribunal.
On vous dira que le jugement sera ratifié par le peuple. Mais si le peuple ratifie le jugement, pourquoi ne jugerait-il pas ? Si nous ne sentions point tout le faible de ces idées, quelque forme de gouvernement que nous adoptassions, nous serions esclaves ; le souverain n’y serait jamais à sa place, ni le magistrat à la sienne, et le peuple serait sans garantie contre l’oppression.
Citoyens, le tribunal qui doit juger Louis n’est point un tribunal judiciaire : c’est un conseil, c’est le peuple, c’est vous : et les lois que nous avons à suivre sont celles du droit des gens.
C’est vous qui devez juger Louis ; mais vous ne pouvez être à son égard une cour judiciaire, un juré, un accusateur ; cette forme civile de jugement le rendrait injuste ; et le roi, regardé comme citoyen, ne pourrait être jugé par le citoyen avant son crime ; il ne pouvait voter ; il ne pouvait porter les armes ; il l’est encore moins depuis son crime. Et par quel abus de la justice même en feriez-vous un citoyen, pour le condamner ? Aussitôt qu’un homme est coupable, il sort de la cité ; et, point du tout, Louis y entrerait par son crime. Je vous dirai plus : c’est que si vous déclariez le roi simple citoyen, vous ne pourriez plus l’atteindre. De quel engagement de sa part lui parleriez-vous dans le présent ordre des choses ?
Citoyens, si vous êtes jaloux que l’Europe admire la justice de votre jugement, tels sont les principes qui le doivent déterminer ; et ceux que le comité de législation vous propose seraient précisément un monument d’injustice. Les formes, dans le procès, sont de l’hypocrisie ; on vous jugera selon vos principes.
Je ne perdrai jamais de vue que l’esprit avec lequel on jugera le roi sera le même que celui avec lequel on établira la République. La théorie de votre jugement sera celle de vos magistratures. Et la mesure de votre philosophie, dans ce jugement, sera aussi la mesure de votre liberté dans la Constitution.
Je le répète, on ne peut point juger un roi selon les lois du pays, ou plutôt les lois de cité. Le rapporteur vous l’a bien dit ; mais son idée est morte trop tôt dans son âme ; il en a perdu le fruit. Il n’y avait rien dans les lois de Numa pour juger Tarquin, rien dans les lois d’Angleterre pour juger Charles Ier : on les jugea selon le droit des gens ; on repoussa la force par la force, on repoussa un étranger, un ennemi. Voilà ce qui légitima ces expéditions, et non point de vaines formalités, qui n’ont pour principe que le consentement du citoyen, par le contrat.
On ne me verra jamais opposer ma volonté particulière à la volonté de tous. Je voudrai ce que le peuple français, ou la majorité de ses représentants voudra, mais comme ma volonté particulière est une portion de la loi qui n’est point encore faite, je m’explique ici ouvertement.
Il ne suffit pas de dire qu’il est dans l’ordre de la justice éternelle que la souveraineté soit indépendante de la forme actuelle de gouvernement, et d’en tirer cette conséquence, que le roi doit être jugé ; il faut encore étendre la justice naturelle et le principe de la souveraineté jusqu’à l’esprit même dans lequel il convient de le juger. Nous n’aurons point de République sans ces distinctions qui mettent toutes les parties de l’ordre social : dans leur mouvement naturel, comme la nature crée la vie de la combinaison des éléments.
Tout ce que j’ai dit tend donc à vous prouver que Louis XVI doit être jugé comme un ennemi étranger. J’ajoute qu’il n’est pas nécessaire que son jugement à mort soit soumis à la sanction du peuple ; car le peuple peut bien imposer des lois par sa volonté parce que ces lois importent à son bonheur ; mais le peuple même ne pouvant effacer le crime de la tyrannie, le droit des hommes contre la tyrannie est personnel ; et il n’est pas d’acte de la souveraineté qui puisse obliger véritablement un seul citoyen à lui pardonner.
C’est donc à vous de décider si Louis est l’ennemi du peuple français, s’il est étranger, si votre majorité venait à l’absoudre, ce serait alors que ce jugement devrait être sanctionné par le peuple ; car si un seul citoyen ne pouvait être légitimement contraint par un acte de la souveraineté à pardonner au roi, à plus forte raison un acte de magistrature ne serait point obligatoire pour le souverain.
Mais hâtez-vous de juger le roi car il n’est pas de citoyen qui n’ait sur lui le droit que Brutus avait sur César ; vous ne pourriez pas plutôt punir cette action envers cet étranger que vous n’avez blâmé la mort de Léopold et de Gustave.
Louis était un autre Catilina ; le meurtrier, comme le consul de Rome, jugerait qu’il a sauvé la patrie. Louis a combattu le peuple : il est vaincu. C’est un barbare, c’est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides ; vous avez vu son armée ; le traître n’était pas le roi des Français, mais le roi de quelques conjurés. Il faisait des levées secrètes de troupes, avait des magistrats particuliers ; il regardait les citoyens comme ses esclaves ; il avait proscrit secrètement tous gens de bien et de courage. Il est le meurtrier de la Bastille, Nancy, du Champ-de-Mars, de Tournay, des Tuileries : quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal ? Il doit être jugé promptement : c’est le conseil de la sagesse et de la saine politique : c’est une espèce d’otage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié ; on achètera bientôt des larmes ; on fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance, et tu pourras nous accuser de perfidie.
Source : Wikisource
Le second discours de Saint-Just sur la mort du roi est disponible ici.