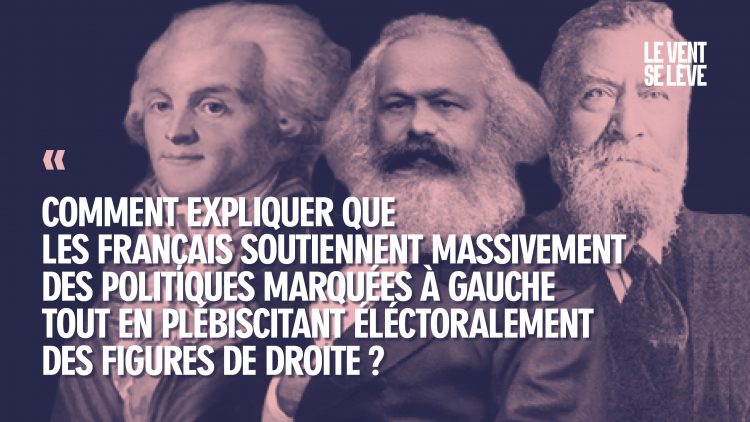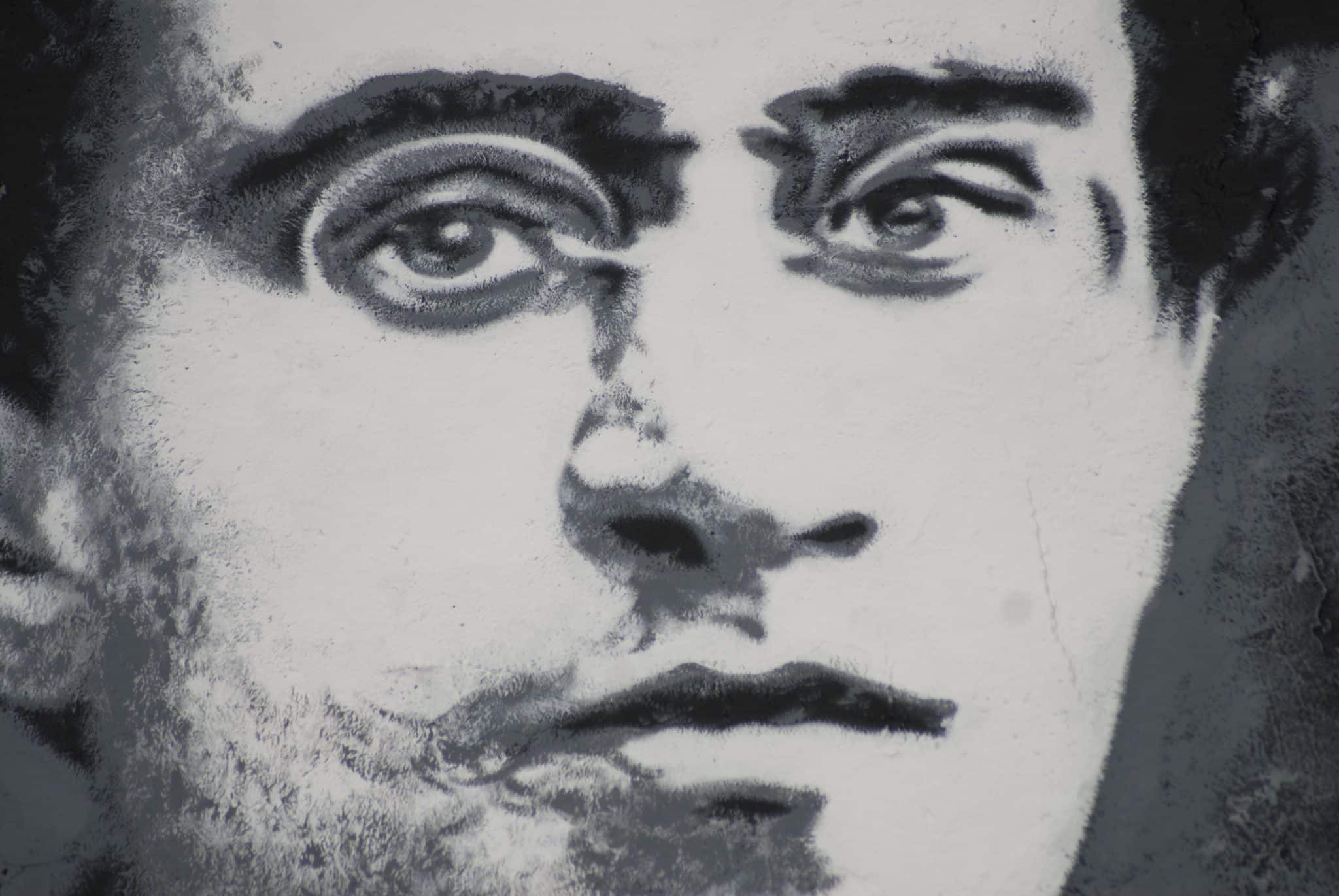Stéphane Rozès est conseiller pour les entreprises, territoires et États en matière de stratégie d’opinion. Au cours de sa longue expérience de sondeur et politologue, il a travaillé et conseillé confidentiellement seize candidats lors de quatre présidentielles, puis trois présidents : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors que les partis politiques et candidats s’organisent progressivement en vue de 2022, nous avons souhaité l’interroger sur les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Entretien retranscrit par Manon Milcent.
LVSL – La situation politique française semble exceptionnelle à bien des égards. Le champ politique n’a jamais été aussi morcelé et les conditions sanitaires actuelles rendent toute proposition politique inaudible. Pourtant, les partis se mettent progressivement en ordre de marche pour préparer le rite républicain-monarchique de l’élection présidentielle. Que signifie cette élection dans le système institutionnel français ?
Stéphane Rozès – La présidentielle est le moment qui cristallise ce qui nous tient ensemble. Nous devons faire un détour historique pour en rendre raison et envisager 2022.
On peut effectivement partir de la notion de « système institutionnel ». Institution au sens de ce qui est institué. D’un processus immanent. Alors que la plupart du temps, surtout en France, l’institution est considérée comme extérieure, comme s’imposant du haut à la société.
Chaque peuple, pays, nation ou empire se façonne des institutions de sorte de faire tenir ensemble sa complexité, ses diversités d’origines, de croyances, d’intérêts, de statuts et de classes sociales pour faire face ensemble aux adversités collectives de la vie. Un système institutionnel est un ensemble de mécanismes élaborés qui permettent religieusement ou politiquement de résoudre des contradictions internes en vue de maîtriser un destin collectif au travers de pouvoirs hétéronomes au-dessus des groupes sociaux et individus.
Aujourd’hui, partout, prévaut la lutte contre un risque sanitaire minime mais contingent sur le risque d’un effondrement économique et social généralisé. On devrait consentir à voir rogner nos libertés individuelles par des libertés collectives dont les institutions étatiques ont le monopole nonobstant leurs limites objectives et incuries politiques.
Les institutions sont symboliques et effectives, incarnées et de représentation. Elles varient dans le temps, mais procèdent d’une structure pérenne qui leur préexiste qui est la façon d’être et de faire d’un peuple. C’est ce que j’appelle son « imaginaire », sa façon de s’approprier un réel sans cesse changeant.
Cet imaginaire puise sa singularité dans la façon dont un peuple s’est assemblé. La centralité du politique, chez nous, vient de ce que, contrairement aux autres pays, nous n’avons pas d’origine, qui puisse fonder ce que nous sommes. « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » disait René Char. C’est que dès le départ dans le territoire de ce qui deviendra la France, il y a des celtes, des latins et des germains.
Ce sont des disputes théologico-politiques, puis démocratiques communes qui vont dénaturaliser ces origines pour nous permettre de nous relier, de fonder au travers de l’État autour duquel s’est constituée la France au travers des siècles et qui a précédé la nation.
Ce qui fonde une société, la France, contrairement à ce que pensent la plupart à gauche, est le besoin de commun politique avant même la dispute sociale. Contrairement à ce que pensent la plupart à droite, il n’y a pas une « origine chrétienne » à la France mais à l’inverse une pluralité d’origines qui fait de notre dispute commune, du « plébiscite de tous les jours » pour reprendre Renan, qui nous assemble.
Après la monarchie absolue, notre imaginaire se perpétue au travers de l’idée républicaine, de ses institutions et réalisations. Péguy disait : « La République une et indivisible : notre Royaume de France ».
Mais pour nous faire tenir ensemble, la République a besoin de nous projeter dans l’espace, le temps, une vision et une incarnation politique. Cette projection est aujourd’hui en panne.
Ce retour sur ce que nous avons institué permet d’approcher la nature d’une présidentielle. Elle ne vise pas tant à élire un président que de réactiver notre imaginaire, pour refonder un nouveau contrat politique au travers d’un même rite, dont les candidats seront les acteurs, plus ou moins conscients.
Voilà ce qui agite notre nation, alors que le Paris politico-médiatique pense à l’inverse. Les politiques, journalistes et politologues pensent, pour la plupart, que les candidats, les partis font la présidentielle, que la carte partisane fait le territoire national, que le haut fait le bas alors que c’est l’inverse.
Le rite de la présidentielle est encadré par les institutions de la Vème. Sa longévité provient de ce que sa procédure de scrutin uninominal majoritaire à deux tours est le plus adapté à notre dispute politique commune qui est le moteur de notre imaginaire. Ce rite dégagera un président tenant ensemble les citoyens au travers des dimensions spirituelles et temporelles de sa fonction.
Ce rite est immuable. Durant la pré-campagne, les états-majors, candidats et analystes, y compris lors des primaires, se déploient sans être sous la prise immanente de la nation qui fera ensuite la campagne et l’élection.
D’où durant cette pré-campagne, nombre de tâtonnements, décalages et illusions d’optiques entre les visions du Paris politico-médiatique et ce que seront les enjeux du pays et la dynamique de la campagne que seuls des signaux faibles ou études permettent déjà de repérer.
En tout état de cause, l’emportera celui, celle, qui construira une cohérence entre ces enjeux et son incarnation, sa vision et son projet avant même en plus que son programme et les positionnements politiques sur lesquels se polarisent les analystes politiques.
Le premier tour procède du déploiement de la dispute. Celle-ci distingue qui devra déjà intégrer le commun, dans lequel elle devra ensuite s’encastrer pour le second tour et la victoire.
Même les candidats les plus rétifs psychologiquement, culturellement et politiquement, pourvu qu’ils veuillent l’emporter, et non témoigner, ont dû ployer devant ce rite pour se faire élire par la nation et s’inscrire dans la réactivation de notre imaginaire qui fonctionne comme un « reset » du pays.
La déconnexion chez nous entre la centralité du politique et la politique, sa vie, ses acteurs, explique les forts taux de participation, nonobstant le jugement sévère à l’égard de chacun des candidats. Cela relativise les gloses sur la faiblesse des scores de premier tour de scrutin.
En France, contrairement aux pays anglo-saxons les citoyens ont un rapport absolu et non relatif au politique. L’analyse comparée de l’abstention en France et aux États-Unis par exemple le rappelle. Chez nous son fondement est politique. Il est socio-culturel aux États-Unis.
Au total, la centralité du politique chez nous est telle que même si les deux tiers des électeurs Français ne souhaitent pas un second tour Macron/Le Pen, s’il devait se profiler, ils se rueraient aux urnes en procession qui nous relient.
La question centrale est ensuite celle du consentement politique de la nation au verdict de la présidentielle et de l’action menée de l’Élysée dont la durée est indexée sur la cohérence avec la nature du nouveau contrat politique noué entre elle et le Président.
En tout état de cause, que dire aujourd’hui pour anticiper ce qui va advenir ? Comme notre imaginaire est transcendant et universaliste, il a engendré un Descartes et le fait que nous voyons la réalité procéder du haut alors que c’est le peuple qui fait la présidentielle à partir des candidats qui s’offrent à lui. Hobbes déjà le disait « le souverain interprète le spectacle du peuple ».
C’est à lui et lui seul, à ses fondamentaux qu’il faut revenir. Ce qui a bougé ; c’est la prévalence actuelle du commun sur la dispute à contenu social qui fonde le clivage gauche/droite.
Le néolibéralisme empêchant de se projeter dans un commun meilleur et donc la question sociale ne peut se déployer. Tous les candidats qui pèsent ; Macron, Le Pen, et même d’un certain point de vue, Mélenchon, s’extraient de l’axe gauche/droite pour redéfinir d’abord le commun de nature politique.
Dans le moment actuel la dimension d’incarnation présidentielle est donc décisive. L’individu ballotté par le cours des choses néolibérales, ne coupera pas le cordon ombilical qui le relie aux autres au travers de la dimension symbolique de la fonction présidentielle indexé à son rite laïc et de l’élection du Président au suffrage universel qui relie chacun des citoyens entre eux.
LVSL – Vous insistez beaucoup sur le poids des imaginaires culturels nationaux. Selon vous, le modèle français est un modèle de projection, qui produit de la dépression depuis l’approfondissement de l’intégration européenne. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
S.R. – Oui. « Chaque nation a une âme » disait le candidat Hollande au Bourget. Il rajoutait « la France n’est pas le problème mais la solution ». Chaque peuple, chaque nation a une façon singulière d’être et de faire pour s’approprier le réel. Cette façon encastre sa manière de ressentir, créer, penser, s’instituer, travailler, guerroyer, innover, concevoir la bonne économie et organiser ses rapports sociaux. Selon moi les questions culturelles, l’imaginaire, encastrent les questions religieuses, politiques, économiques, sociales, technologiques et rapports internationaux.
Le réel change sans cesse et les formes des sociétés avec elles mais toujours de la même façon.
Dans ma grille d’analyse, les imaginaires des peuples sont des contenants, des matrices, des structures pérennes au travers des âges, dont les contenus de représentations, institutions, et rapports sociaux évoluent sans cesse.
Ce qui est pérenne chez nous, c’est que pour dénaturaliser nos diversités d’origines, d’intérêts de statuts sociaux et de classes, nous devons nous projeter dans l’espace, le temps, une vision politique ou incarnation politique. Il nous faut « embrasser le monde » comme disait Malraux. Notre façon d’être et de faire, c’est sans cesse de pouvoir représenter les choses par écart au réel, de nous dégager au travers de l’ironie, du libre examen, de la raison, des nombres des pesanteurs des origines, statuts, situations sociales et expériences personnelles.
Ainsi, pour remonter à Rabelais, suite aux attentats islamistes contre Charlie Hebdo, la caricature, c’est sans cesse de faire bouger les représentations, les images, avant même de changer la réalité. La caricature, l’humour envers chacun, de toute façon et à tout moment, sont des procédés de dénaturalisation des statuts, situations, de telle sorte qu’on puisse imaginer que tout est possible qui est notre marque et de multiples combinaisons de socialité. Ainsi, chez Marivaux, dans « Les jeux d’amour et du hasard », le procédé d’échange des rôles entre la comtesse qui joue la servante et la servante qui joue la comtesse pour des affaires de badinage. Eh bien, la comtesse est très bien en servante et inversement. Par la suite, chacun reprend son statut, mais au fond, l’essentiel a été fait.
Il y a une égalité des conditions possibles pour s’assembler, qui fait qu’une comtesse pourrait être une servante, et une servante pourrait être une comtesse. C’est également une modalité singulière de notre imaginaire que d’être universaliste et projectif dans l’espace et le temps pour tenir ensemble nos diversités.
Le premier trait de notre imaginaire est notre universalisme, nous voyons le monde par écart au réel. Tel est le statut central chez nous de la raison comme fondant le vrai et le beau chez Descartes, Rameau, Boileau, notre peinture, musique, nos avant-gardes, rapport au luxe, école de mathématiques… Le vrai, le réel réside dans un écart aux expériences avec leurs singularités et menaces centrifuges pour nous. Chez nous l’esprit, le cogito serait séparé et devrait prévaloir sur le corps et ses gargouillis.
Cet universalisme procède de notre monde intérieur qui a permis de nous assembler pour dépasser nos origines de sorte que nous voyons les autres comme notre prolongement, ce qui justifierait que nous établissions une Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, ou que nous pensions que nous avons quelque chose à faire au Mali.
Nous voyons les autres comme une déclinaison exotique de ce que nous sommes, d’où l’arrogance et la légèreté qui nous sont prêtés par nos amis étrangers.
Nous mésestimons complètement ces questions de différences culturelles entre les peuples. C’est une erreur que ne font pas les allemands, italiens et même espagnols qui dans un premier temps ont été impressionnés par la Révolution française et Napoléon, jusqu’à ce qu’ils aient à subir ce que nous sommes, une fois que nos armées s’installaient chez eux. D’ailleurs, Thomas Mann, que ses amis interrogeaient sur son admiration pour la Révolution, et sur le fait qu’il aille combattre contre la France en 1914, répondait que malgré son admiration pour la France, les Français ne reconnaissent pas les différences entre peuples.
Notre universalisme a deux leviers de projections : l’un dans l’espace et l’autre dans le temps. Projection dans l’espace, avec les croisades, les guerres napoléoniennes, les colonies ou l’Europe, il y a une continuité dans notre façon de nous projeter dans une « France en grand » pour tenir ensemble ce qui nous assemble à l’intérieur.
Ainsi, Kissinger, dans son dernier ouvrage, en parlant du traité de Leipzig, observe que Napoléon, qui aurait eu militairement tout intérêt à se rendre aux conditions des adversaires de la France pour faire la paix était tenu par des raisons internes pour asseoir son « pouvoir dépendant de l’imagination des Français », pour reprendre l’expression de l’Empereur.
En cela, il rejoint Marx, qui, dans « le 18 Brumaire », veut expliquer pourquoi la Grande armée va par dizaine de milliers de soldats aller à Moscou avec l’Empereur puis être décimée. Il convient que c’est trop court de dire qu’il s’agissait seulement d’étendre les acquis de la Révolution française à tous les serfs européens en matière de droit de propriété. Il constate que ce dernier issue de la Révolution française égalitaire, en abolissant le droit d’aînesse, fait que les “paysans parcellaires” en économie autarcique ne sont pas reliés entre eux au travers de marchés notamment, mais en autarcie de sorte que la paysannerie n’est pas une « classe pour soi », mais seulement une « classe en soi », ce qui fait que les “paysans parcellaires”, qui constituent l’armée de l’an II, puis la Grande armée, sont « des patates dans un sac de patates, dont l’empereur tient la anse ».
Notre rapport à l’espace, dépend donc de la configuration singulière de l’articulation chez nous entre la question nationale et la question sociale. Marx repère la singularité de notre rapport à la politique lors de ses deux séjours à Paris. La plupart au sein d’une gauche devenue économiciste oublieront cette leçon que Marx avait apprise et que savait Jaurès comme historien et socialiste français. Chez nous la question nationale préempte la question sociale, car la France s’est constituée autour de l’État et ce dernier a précédé la nation.
Projection dans le temps. Cette dernière est ce que nous sommes depuis toujours dans le processus même de la pensée française, avant même le rapport au progrès qu’apporteront les Lumières.
L’imaginaire français a engendré des cartes mentales qui voudraient que l’esprit se détache du corps et que le réel réside dans la raison à construire pour que « l’Homme devienne maître et possesseur de la nature », dans son évolution même.
Pour Tocqueville les révolutionnaires de 1789 et auteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sont « des élèves de Descartes descendus dans la rue ». Ils sont tout autant des lecteurs des Encyclopédistes et surtout spectateurs de Molière, Corneille, Marivaux, Beaumarchais …
C’est ce qui intéressait d’ailleurs Kant et Hegel dans la Révolution française, bien qu’ils en donnassent leur propre lecture qui insistait plus sur le processus que sur la finalité. Car dans l’imaginaire allemand, c’est l’expérience qui fait le réel, et non la raison. D’ailleurs, quand l’Allemagne envahit la France par les Ardennes, Heidegger déclarera « Descartes est battu ». La raison nous permet de nous fonder et de nous déployer dans le régime d’historicité de la modernité ou c’est le futur qui fait le présent.
C’est que nous pensons qu’au travers de la raison et le progrès le genre humain, au travers de luttes, pensées et droits conquiert l’avenir en passant par-dessus les us et coutumes des peuples.
Le progrès est le moteur de la modernité, au cœur de la Révolution française qui découle de la raison et qui tient ensemble la maîtrise du temps dans ses dimensions scientifiques, intellectuelles, morales, économiques et sociales pour construire politiquement l’avenir de la nation, des nations.
Seul le peuple américain est comme nous universaliste mais pour des raisons inverses au notre. Hormis les descendants d’indiens et d’esclaves, ils ont, eux ou leurs ancêtres, voulu établir une terre promise alors que nous devons au contraire sans cesse refaire le contrat politique qui nous relie.
Lors de notre présidentielle chaque citoyen et candidat doit partir de l’idée qu’il se fait d’intérêt général dont chacun donnera sa propre définition en fonction de sa propre situation socio-politique. Chez nous le commun précède la singularité. Au contraire, aux USA on part de la singularité des citoyens pour aller ensuite au patriotisme commun. Cette différence est décisive en ce que les techniques de communication politique ou outils internet, réseaux sociaux, ou utilisation des datas qui nous viennent d’outre-Atlantique doivent être compris et adaptés à cette différence culturelle fondamentale.
Chez nous la projection dans l’espace et le temps est guidée, portée par une volonté, vision et incarnation politique qui part du commun.
LVSL – Pourquoi parler de dépression française dans le moment actuel ?
S.R. – Car aujourd’hui les trois moteurs de notre imaginaire que sont la projection dans l’espace, la projection dans le temps, et la vision politique sont en panne.
Notre rapport au temps est déstabilisé par le fait que le néolibéralisme et le cours du capitalisme financier empêchent de tenir ensemble le progrès économique, le progrès social et le progrès technologique et de nous projeter dans un avenir meilleur.
À partir du début des années 90, les Français pensent que demain sera pire qu’aujourd’hui. Le passage du capitalisme managérial au capitalisme patrimonial nous retire la promesse de penser que l’avenir de nos enfants sera meilleur. Nous tentons dans un nouveau régime d’historicité, post-moderne. L’avenir devient contingent. Nous devenons alors les plus pessimistes au monde.
Quant à la question de la projection dans l’espace, à partir du référendum de 2005, même si la question était déjà nettement en débat lors de Maastricht, les Français ne voient plus les institutions européennes comme l’organe politique légitime de l’Europe attendue comme « la France en grand ». La phrase de Mitterrand « La France est notre patrie et l’Europe est notre avenir » devient caduque, du fait de ce que sont devenues les gouvernances et politiques européennes.
Les Français voulaient que l’Europe soit notre prolongement, une puissance économique, politique et sociale pesant dans la globalisation et consentirent alors à des abandons de souverainetés monétaires, budgétaires, économiques et financiers avec leurs effets sociaux.
Mais le Président Mitterrand pour éviter que l’Allemagne réunifiée se détourne de l’Europe a consenti à Berlin que les gouvernances et politiques bruxelloises soient adaptées à l’imaginaire et intérêts allemands : procédurales au plan économique et adaptées à l’ordolibéralisme allemand.
Cependant, avec la directive Bolkestein durant la campagne référendaire sur le traité constitutionnel européen en 2005, il est apparu que l’Europe élargie n’était plus perçue comme l’Europe puissance dans la mondialisation, mais au contraire comme un relais de la globalisation néolibérale chez nous remettant en cause notre souveraineté et nos acquis sociaux. À partir de ce moment-là, dans les abstentionnistes sous tension entre Europe idéale et institutions européennes, basculent brutalement dans « Non » au TCE comme j’avais pu l’établir et l’énoncer au printemps 2005, car on pouvait en rendre raison à partir de cette désillusion sur ce qu’était devenue l’Europe, non la France en grand mais le cheval de Troie de la mondialisation que nous devrions intérioriser.
Pour ce qui concerne le troisième moteur de notre imaginaire, le projet et l’incarnation politique, il est devenu insalissable. Le néolibéralisme n’est pas seulement et essentiellement le vecteur de l’ultra-libéralisme qui remet en cause les rapports sociaux, capital/travail au sein de la nation ; c’est l’idée que le gouvernement des Hommes doit céder la place à l’administration des choses, les marchés doivent se substituer à la politique, les gouvernances européennes doivent se substituer aux nations souveraines, les procédures technocratiques doivent remplacer les disputes communes républicaines, la technostructure se substitue aux politiques.
Ainsi la crise du politique, de sa vision et de son incarnation vient de la contradiction depuis trois décennies entre la nation et l’État.
La nation du fait de son imaginaire pour s’assembler et s’approprier le réel demeure projective et politique alors qu’au contraire le sommet de l’État lui demande d’intérioriser des procédures et normes économiques indexées sur Bercy, Bruxelles et l’imaginaire allemand. De cette contradiction entre nation et l’État résulte notre dépression morale, nos régressions politiques et nos reculs économiques.
Cette contradiction fonde la crise de notre système politique et non l’inverse comme l’affirmait à tort le candidat Macron en 2017, en témoigne le retour de la crise de notre système politique à partir de l’été 2008.
C’est là où se répète, depuis 1995, la contradiction au cœur de notre vie et système politique entre le rite présidentiel, qui oblige le futur président à s’indexer sur notre imaginaire national pour l’emporter, et ses premiers pas à l’Élysée au sommet d’un État sous emprise néolibérale.
Dans l’espace d’une année, chaque nouveau président sitôt à l’Élysée opère un tête à queue, souvent silencieux, avec le contrat initial qui le liait à la nation et qui faisait le consentement de la nation, nonobstant l’injustice sociale de son action pourvu de restaurer la maîtrise politique de notre destin. Le mouvement social de 1995 ou la jacquerie des gilets jaunes en furent les réactions les plus spectaculaires.
Cette dépression ne veut pas dire absence de vitalité du pays, mais que son énergie est contrariée par le mouvement inverse du sommet de l’État, de la technostructure et de ses élites dans leurs visions, intérêts immédiats et politiques menées.
LVSL – Emmanuel Macron semble tel un caméléon. Après le disrupteur libéral de 2017, nous avons eu : le parti de l’ordre, la réinvention radicale, puis la posture républicaine de centre droit. Comment qualifier le macronisme ? Le candidat de 2022 aura-t-il la même identité politique que celui de 2017 ?
S.R. – Comment définir le macronisme ? Il y a des disputes intellectuelles et politologiques sur ce qu’est sa nature dès l’origine. Selon moi, mais mon analyse est singulière, pour les raisons indiquées plus haut sur ce qu’est chez nous le politique, la politique, le moment présidentiel ; Emmanuel Macron inconnu trois ans auparavant l’a emporté, car il a compris les ressorts essentiels de notre imaginaire, les causes de notre dépression et énoncé un chemin politique pour résoudre la contradiction entre ce que nous sommes et le monde extérieur, pour nous remettre « en marche ».
Il a fait de la crise du système politique, du clivage gauche/droite de l’ « ancien monde », la cause de notre malheur, alors que c’est pour moi l’inverse ; l’effet de la contradiction entre notre imaginaire national et le néolibéralisme du sommet de l’État.
Mais cette posture néo-bonapartiste, contre le personnel politique, lui a néanmoins permis de constituer un front politique entre la bourgeoisie, voyant dans le système politique un obstacle au déploiement de ses intérêts auquel s’est adjointe, et la petite bourgeoisie, qui a vu dans le propos macroniste une promesse de pérennité sociale, nonobstant à son programme d’adaptation néolibérale, au nom de son projet qui était de « restaurer la souveraineté de la nation ». Il avait dit devant le Congrès que c’était « le premier mandat que m’ont confié les Français ».
C’est cette même promesse durant la première année qui a fait également le consentement à ses réformes des classes populaires, fort critique à l’égard du contenu jugé injuste de sa politique économique. Ainsi, elles ne se rallieront pas les cheminots et ne feront pas majoritairement « grève par procuration » en les soutenant dans les sondages lors de la grève à la SNCF en 2017.
Emmanuel Macron, avait compris que nous étions dans un moment où la symbolique politique et la question nationale préemptaient la question sociale.
Dès son élection, dans mon interview par Marcel Gauchet dans la revue Le Débat, j’avais utilisé le terme de néo-bonapartisme ou de bonapartisme à l’heure néo-libérale. Quand les analystes mettaient en avant le caractère accidentel de la campagne, ce qui est toujours le cas sauf en 2012, ou l’étroitesse de son score de premier tour et l’évidence du résultat du second, ou l’argument du soutien de la finance et des grands médias et ses prétendus effets électoraux, ou un supposé « dégagisme » ; je mettais au contraire en avant les éléments dynamiques.
Emmanuel Macron était le seul à dire que notre destin ne dépendait, ni de la soumission à la mondialisation, ni à sa résistance, mais de nous remettre en marche à partir de ce que nous sommes à la condition de changer notre classe politique.
François Fillon, de son côté, disait qu’il fallait changer notre modèle économique et sociale, de nous soumettre à la mondialisation de sorte de ne pas périr, tout en restaurant, en contrepartie, nos valeurs traditionnelles.
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, avec des contenus différents, partent de l’idée de la résistance à la mondialisation. La première de dénoncer le cosmopolitisme, et le second le capitalisme ultra-libéral.
Au fond, dans son adresse au pays Emmanuel Macron aura été un mélange entre Michelet et Ricoeur. Michelet considérait la France comme une personne. Ricoeur, comme protestant français, insiste sur le fait que chaque personne recèle un talent et que la vocation du politique, c’est l’émancipation individuelle par la possibilité de le voir rayonner. Lors d’une présidentielle tel était ce qu’attendait le pays.
Néanmoins, quand à partir du seul principe ricoeurien, il suggère à un individu de se prendre en main pour trouver un emploi traversant la rue, cette approche du salut individuel apparaît comme une offense à notre imaginaire collectif national de tradition catholique. Chez nous le salut individuel passe d’abord par le salut commun.
Macron avait dit aux Français : vous êtes fantastiques, vous n’êtes pas responsables de notre malheur, c’est le personnel politique dans sa globalité d’où la sérénité et l’aspect optimiste de son adresse au pays dans un pays déprimé et vieillissant et le mystère apparent de son élection qui ne peut être réduit à des circonstances ou machinations.
Le propos macroniste, son projet politique se rompt quand Angela Merkel en avril 2018, prive le président français du deuxième étage de sa dynamique, d’une relance européenne.
Il a pensé, que, comme ses prédécesseurs, que pour convaincre la chancelière allemande, il fallait lui donner des gages. À Aix-la-Chapelle, il déclare à son entourage vouloir la convaincre au travers d’un discours. Il n’y a que les Français qui pensent qu’on peut convaincre les Allemands au travers de discours. Il a été surpris et étonné que la chancelière allemande reste inflexible sur le fait qu’elle ne bougerait pas sur les politiques européennes nonobstant les premiers gages qu’il avait donné.
Il avait pourtant alerté la chancelière allemande à Bucarest, les journalistes n’ont d’ailleurs pas compris quand il disait que “les Français étant des Gaulois n’aiment pas qu’on leur impose des réformes de l’extérieur, et la France est universaliste et on a besoin de profondeur de champ pour réformer”. Il s’agissait déjà de faire bouger Angela Merkel.
De la même façon, pour son interview au Financial Times, au début de la pandémie, il s’adresse à Angela Merkel lorsqu’il déclare que face à la pandémie, le risque est grave, qu’il faut faire bouger les lignes en Europe sous peine de périr collectivement. Il argue que le nazisme est la conséquence du traité de Versailles, de l’idée que « l’Allemagne paiera » et qu’il serait paradoxal de faire un traité de Versailles à l’envers, contre les pays du Sud, et que l’on ne mette pas les moyens de mettre en œuvre des politiques de relance européenne par l’investissement et par la demande. Cette fois il fut entendu, face à la crise de la Covid en jouant du ressort allemand de la culpabilité : en allemand schult significativement le même terme que pour dire dette. Dans le même temps la bourgeoisie allemande comprenait que la demande dans les pays du Sud devenait vitale pour la croissance allemande.
Au total depuis Maastricht, tous nos présidents ont été coincés entre la nation dont ils dépendent politiquement et l’environnement des institutions et politiques bruxelloises, conformes à l’imaginaire allemand auquel le sommet de l’État, Bercy et Matignon, comptable de la règle annuelle des 3% ont pensé discipliner l’État et la nation.
Mais la légitimité de l’adresse de l’État à la nation est que les règles économiques devraient l’emporter sur les finalités et visions alors que notre imaginaire national procède à l’inverse.
Quand la chancelière allemande dira explicitement qu’elle ne fera pas bouger l’Europe, cela a pour conséquence que la politique menée par le gouvernement d’Édouard Philippe, qui est une politique orléaniste, d’adaptation aux contraintes extérieures et aux grandes normes budgétaires, prévaut dans les faits et maintenant les paroles et postures initiales néo-bonapartistes du président qui va s’estomper et ne plus contrebalancer dans la communication présidentielle la politique menée par Matignon et Bercy.
Tout se dérègle alors dans le rapport du président à la nation. L’impact considérable de l’affaire Benalla vient de ce que ce personnage semble être un écran mis par le Président dans sa relation verticale entre lui et les Français.
Il en résultera les mouvements centrifuges et crises au sein de sa majorité présidentielle et le gouvernement avec les démissions notamment d’Hulot, Collomb et le MoDem.
La réponse du pays sera sans équivoque, ce sera la jacquerie au travers des gilets jaunes. Tout peut se synthétiser dans une pancarte dans un carrefour qui disait « Macron nourrit ton peuple ».
La jacquerie mêle la question sociale et la question fiscale à la question de la souveraineté, comme dans l’Ancien Régime. Le peuple dit au seigneur ou souverain : tu as des devoirs, une charge, un contrat politique qui te lient à nous, tu as été élu par nous, tu dois nous défendre, représenter, donc tu dois mener des politiques qui correspondent à ce que nous sommes.
Derrière les éléments circonstanciels il y a un inconscient collectif du pays qui explique le soutien de deux tiers des Français aux gilets jaunes sans discontinuer nonobstant les violences. Mais une jacquerie n’est ni un mouvement social comme un autre, ni une révolution, c’est une adresse directe au souverain.
L’abandon de la restauration de la souveraineté nationale ne rendait plus justifiable les injustices fiscales et sociales.
À partir de ce moment précis, le lien est rompu avec un président qui commit la faute de mettre un temps entre lui et le pays en écran le Premier ministre, ce qui radicalisera le pays. Il se contenta alors de représenter le parti de l’Ordre. Il passera en quelques mois du néo-bonapartisme, à l’orléanisme, de Guizot à Thiers.
Le lien ne sera que partiellement rétablit avec « Le Grand débat ». Ce lien sera à nouveau rompu avec la réforme des retraites dont le contenu paramétrique fut de nature orléaniste, sous pression de Bruxelles, et imposé par Matignon et Bercy.
La crise sanitaire vient à nouveau reconstituer le lien vertical entre le pays et le Président, nonobstant les retards, incuries du système de santé, de l’État et mensonges notamment à propos des masques. La pandémie non maîtrisée et frappant de façon contingente les individus, le pays se ressoude dans un besoin d’égalité des conditions face au péril sanitaire commun aux effets humains relativement limités.
Cela explique l’acceptabilité du confinement, la préférence de la maîtrise collective de nos destins sur le risque d’effondrement économique et social et le consentement à ce que les libertés individuelles cèdent la place devant les libertés collectives.
Ce choc sanitaire oblige le président Macron, dans ses premiers discours, à revenir aux fondamentaux français comme la souveraineté de la nation ou les services publics. Le départ du juppéiste Philippe, avatar actuel de l’orléanisme et son remplacement par un néo-radical Castex semblait signer un retour de la prévalence de l’Élysée.
La reprise de la Covid et du confinement ont à nouveau déstabilisé la politique et la communication de l’exécutif réduit à une gestion de court terme des crises sanitaire, économique et sociale où « on ne compte pas les seaux » sans remettre en cause les périmètres d’actions de l’État et la nature fondamentale de ses interventions.
Pour l’exécutif chaque jour semble suffire sa peine et on peine à apercevoir une stratégie de l’État.
La reprise du terrorisme islamiste s’en prenant notamment à un serviteur de l’Ecole républicaine, Samuel Paty, et la prise de conscience de la plupart des dangers que représente l’islamisme pour la laïcité, la République et la démocratie a entraîné dans l’opinion un effet de ressaisissement dont le Président a su dans ses postures et annonces épouser le mouvement.
Avec la seconde vague de la Covid-19, le pays est rentré dans une crise systémique, durable et semblant contingente dans ses dimensions sanitaire, économique, sociale, financière, séparatiste et écologique, crise qui entraîne sidération et inquiétude tel que le lien entre le pays et le Président est renforcé non tant par sa qualité que par son exclusivité.
Le Président Macron a dorénavant compris, comme beaucoup, que lors de la présidentielle de 2022 se jouera la reprise en main de notre destin, sur la souveraineté nationale et que se rejouera la pièce de ce qui la contrecarre : la gouvernance et les politiques européennes néolibérales et ultra-libérales. Ces dernières ont momentanément bougé, avec le plan de relance, du fait des effets terribles économiques et sociaux de la crise pandémique.
Mais plus que jamais les politiques européennes demeurent néolibérales sous hégémonies culturelles et objectives allemandes tant la chancelière allemande est sortie renforcée de l’épreuve sanitaire actuelle.
Si la crise sanitaire a à nouveau illustré l’interdépendance sanitaire générée par la globalisation néolibérale, chaque peuple a mené sa guerre à sa façon selon ses singularités culturelles.
L’Allemagne a pu bénéficier de la plus grande cohérence entre son imaginaire, ses institutions, politiques de santé, rapports sociaux et environnements européens.
Face au repli des peuples, l’Union européenne doit être adaptée à son génie qui est de faire la diversité et complémentarité de ses peuples du commun et non fonctionner comme le Saint Empire romain germanique dont le centre était Aix-la-Chapelle prétendant mener des politiques uniques.
Face au risque représenté par les nationalismes, il faut réparer les imaginaires et modèles nationaux.
LVSL – L’espace de la « gauche » est aujourd’hui morcelé entre trois forces qui se neutralisent : EELV, le PS et la France insoumise. Comment analysez-vous l’état des gauches ? Les écologistes, qui sont en dynamique, sont-ils capables à vos yeux d’épouser l’imaginaire français de l’élection présidentielle ?
S.R. – C’est parce que la gauche est éloignée des fondamentaux qui étaient les siens : la nation, la République, l’articulation entre la question nationale et sociale, entre l’égalité des conditions et l’égalité réelle, qu’elle se marginalise et fragmente.
En un mot elle disparaît car elle est divisée. Elle est divisée car elle s’est éloignée du peuple français et de son imaginaire.
Si on fait un rapide état des lieux de son paysage décomposé, la conjoncture politique immédiate est marquée par une progression d’EELV dans certaines grandes villes et métropoles, qui dans la configuration particulière de ces municipales, aux deux tours saucissonnés, ce qui a occasionné une très forte abstention, ont conduit à la victoire de maires écologistes dans des grandes métropoles.
Il y a deux raisons essentielles à ce phénomène. La première bien sûr est la centralité de la question écologiste dont la crise pandémique et le confinement ont accéléré une prise de conscience vertueuse par l’arrêt sur image qu’elle a imposé dans la course à l’adaptation permanente à un cours des choses néolibérales destructeur de l’humain et des ressources de la planète en matière climatique et de biodiversité.
Le vote EELV s’en est trouvé à nouveau légitimité nonobstant la qualité de ses dirigeants et militants.
Ensuite dans les grandes métropoles, les sujets des classes moyennes et de la petite bourgeoisie sont la question de leur pérennité dans les années qui viennent face au renchérissement de l’accès au logement, du coût de la vie et de la dégradation du quotidien.
Le vote EELV apparaît comme un signal de volonté d’arrêter un développement métropolitain qui se retournerait contre ses habitants. Ce vote apparaît alors pour des raisons nobles comme une défense d’un entre-soi social pour une reprise en main du développement urbain, ce qui ne va pas sans ambiguïtés dans un certain nombre de domaines comme la densité urbaine nécessaire dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais pour la présidentielle, ce qu’est EELV est contradictoire pour des raisons culturelles, idéologiques et politiques avec ce qu’est chez nous le politique, la réactivation de notre imaginaire, la verticalité politique, la centralité de l’incarnation et du projet politique.
Le plus conscient de ces singularités est sans doute Yannick Jadot, mais ce qu’est devenu EELV, ses militants et sympathisants issus de la petite bourgeoisie intellectuelle l’a rendue dans la dernière période très perméable aux approches anglo-saxonnes communautaristes, intersectionnelles, voire identitaristes, racialistes ou islamo-gauchistes aux antipodes de ce que nous sommes. Si ces courants sont dynamiques dans certains secteurs universitaires ou médiatiques ils sont absolument contradictoires avec la dimension universaliste de notre imaginaire qui nous relie.
Mélenchon est le seul qui émerge actuellement à gauche. Mais une majorité de sympathisants de gauche estiment qu’il représente plus un problème qu’un atout pour elle.
Il avait pourtant fait une belle fin de présidentielle sur des bases républicaines, jauressiennes et patriotes. Depuis il s’est éloigné de ces fondamentaux pour des raisons idéologiques et de clientélisme électoral dans certains types de quartiers. Il a éloigné les républicains de LFI pour conserver les communautaristes et islamo-gauchistes. Cela a brouillé et discrédité l’image de LFI, d’autant que son leader lors d’une perquisition de ses locaux ne s’était pas comporté en élu de la République.
L’assassinat de Samuel Paty a relancé les débats sur la complaisance de LFI et d’autres à la gauche de la gauche avec les islamistes notamment lors d’une participation à leur appel et sur leurs mots d’ordre contre « l’islamophobie » en novembre 2019.
Depuis son annonce de candidature, sa modalité de déclaration J.L. Mélenchon veut éviter une confrontation d’appareils avec les autres secteurs de gauche pour cultiver son lien direct avec les français, mais il semble se dégager de son entourage non sur les sujets du pays que sont la nation, la République, la laïcité, la question sociale mais vers une échappée vers « l’harmonie entre les êtres humains et la nature » dont il ne semble pas être précisément l’incarnation.
Le PS dans la dernière période s’est distingué du communautarisme d’une partie de la gauche mais sans définir une cohérence d’analyse et de projet à partir déjà de ce qu’est la France, le cours des choses néolibérales et ce qu’a été son exercice du pouvoir.
À ce propos, dans les angles morts de la gauche, outre la question de la France, de la République, de l’articulation entre la question nationale et sociale, il y a dans leurs prolongements la question du progrès. Dès le XVIIIème est posée la question de savoir s’il a sa dynamique propre, inexorable qui devait se déployer par-dessus les peuples comme le pensait Condorcet ou si le progrès devrait être indexé sur les us et coutumes des nations comme l’envisageait Montesquieu.
Ce débat est au fondement de nombre d’impasses actuelles et confusions entre libéralisme, ultralibéralisme et néolibéralisme. Ainsi la plupart à gauche au nom de la lutte contre l’ultralibéralisme étaient en fait des néolibéraux.
Ils y ont perdu en route le peuple, pour se replier ensuite dans la défense de minorités en France auto-proclamées et fantasmées.
En tout état de cause, le problème de la gauche politique actuelle est qu’elle pense qu’elle doit partir de ce qu’elle est, résoudre sa crise politiquement en s’unifiant pour s’adresser ensuite aux Français, alors qu’elle devrait au contraire partir du réel, revenir au peuple, à la France, les comprendre puis construire un projet à partir de ses idéaux. Alors, elle se rassemblera en s’indexant sur le réel pour ensuite trouver un chemin à partir de ses idéaux.
LVSL – Depuis la diffusion de la saison 3 de “Baron noir”, de nombreux observateurs spéculent sur l’émergence d’une candidature outsider. Que pensez-vous d’une telle hypothèse ?
S.R. – J’ai regardé la première saison de “Baron noir”, si je dois faire part d’une touche personnelle permise par le recul, cela m’a déprimé tellement, elle m’a rappelé une vie antérieure, où certains minoritaires et conspués, à partir de Maastricht notamment, ont tenté d’éviter les erreurs, renoncements, décisions, politiques nationales et européennes dont nous payons aujourd’hui le prix lourd.
Hormis Chevènement et Séguin, peu sortent grandis des dernières décennies et peuvent se prévaloir d’une quelconque légitimité intellectuelle et politique pour sortir la France et l’Europe de ses régressions politiques et reculs économiques et relever les défis immenses qui nous attendent.
Votre revue, et d’autres, des fondations, associations et mouvements représentent un espoir dans la mesure où libérés des erreurs du passé, ils peuvent partir de ce que nous sommes pour aller quelque part pour relever les défis actuels.
Le sujet de 2022, dans un contexte d’instabilité systémique, sera la question de la maîtrise de notre destin collectif, de la restauration de la souveraineté de la nation.
C’est la condition d’acceptabilité d’un avenir écologiste en reposant la question de l’arbitrage entre le bon, le juste et l’efficace, variable selon les pays pour construire un développement durable et responsable. Seul le politique et la souveraineté nationale peuvent y parvenir.
Le Président Macron a l’avantage d’être là, aux affaires, d’être connu dans ses qualités et défauts. Dans le moment d’instabilité généralisé c’est un atout considérable.
Marine Le Pen a fait muter le RN. Depuis les dernières européennes, elle est plus en phase avec le caractère projectif de notre imaginaire. On repère mieux sa cohérence entre la question nationale et la question sociale mais demeure un doute, la possibilité et la dangerosité de son projet pour la France, sur sa personne et son entourage.
Deux tiers des Français attendent une autre alternative que celle du second tour de la dernière présidentielle mais alors la crédibilité d’une autre personnalité réside dans la volonté et capacité de remettre l’État au service de la nation.
Le candidat, ou la candidate, attendu(e) doit comprendre et porter les attentes de la nation et connaître l’État et les lieux actuels de pouvoirs. Le succès d’opinion du général de Villiers est révélateur mais n’aura sans doute pas de traduction présidentielle. Xavier Bertrand se prépare et pourrait l’emporter en partant de la nation à partir de son expérience locale. Arnaud Montebourg a pour lui d’avoir en son temps tenté de peser au sommet de l’État pour le mettre au service de l’intérêt national en matière industrielle et économique. Demeure des précisions à apporter sur le régalien, les institutions et les questions républicaines.
Pour l’un, comme pour l’autre, la question de l’incarnation, de la confiance en soi et dans le peuple français est décisive. Dans les moments présidentiels, les Français psychologisent les questions politiques et politisent les questions psychologiques.
Un autre candidat ou candidate peut émerger. En tout état de cause, l’emportera celui qui reprendra le chemin de la promesse de restaurer la souveraineté de la nation avec une autorité personnelle, un chemin, une compétence et une confiance chevillée au corps dans le génie de notre peuple.
Le moment actuel de retrait du néolibéralisme le permet et l’exige. Avant la Covid, déjà les peuples se repliaient et, avec la pandémie, le politique revient aux postes de commande.
Seul le politique peut remettre l’État au service de la nation au travers d’arbitrages souverains entre le bon, le juste et l’efficace. C’est la condition de remise en mouvement de la République pour résoudre nos lourds défis collectifs.
Cela nécessite de revenir en parallèle de la présidentielle au génie européen qui est de faire de la diversité de ses peuples du commun, et non l’inverse comme aujourd’hui, d’où le fait que notre continent quitte l’Histoire et la géographie. Voilà comment je vois les enjeux de 2022.