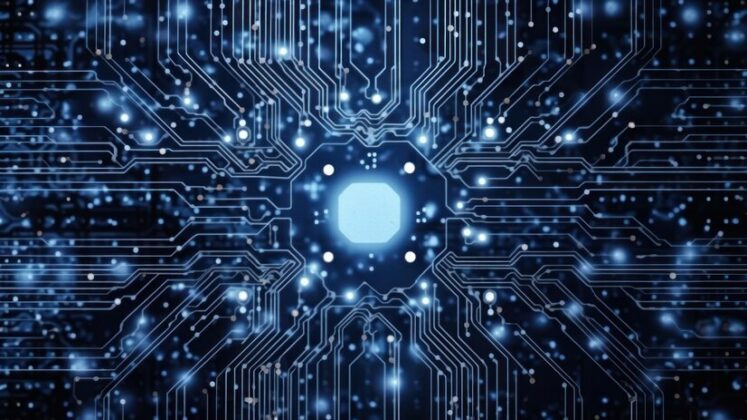Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye ordonnait la mise en place de « mesures conservatoires » contre la « plausibilité » d’un génocide à Gaza. Si la Cour ne s’est pas prononcée sur la pertinence du qualificatif de « génocide », sa décision constitue un revers pour la guerre menée par Israël. Elle oblige les États signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG) à agir pour protéger les Gazaouis, et permet d’envisager des poursuites contre les soutiens militaires d’Israël pour complicité potentielle de crime de génocide. Au nom de l’arrêt de la CIJ, la justice néerlandaise a ainsi interdit aux Pays-Bas l’exportation de pièces de bombardiers F-35 vers Israël. Mais hormis cette décision, le statu quo demeure. Tandis que les bombardements continuent de pleuvoir sur Rafah et qu’une « puissante » offensive sur la ville est annoncée par Benjamin Netanyahu, faisant craindre des milliers de victimes civiles supplémentaires, les États-Unis et l’Europe appellent pieusement à la désescalade, sans œuvrer à sa mise en œuvre. Au risque de morceler sans retour un ordre international déjà atone. Reportage à La Haye.
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, la requête de l’Afrique du Sud contre Israël n’a pas encore commencé qu’une poignée de personnes attend déjà devant les grilles du Palais de la Paix, qui abrite la Cour internationale de Justice. Venues de toute l’Europe et du Maghreb, mais aussi des États-Unis, de l’Inde ou du Liban, elles espèrent assister aux plaidoiries des deux parties. Depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, c’est en effet la première fois qu’Israël, en réponse à l’accusation de crime de génocide, présentera des arguments juridiques devant la communauté internationale.
Malgré le froid glacial de l’hiver néerlandais et l’incertitude quant au nombre de places restantes, l’ambiance est à la patience. En tête de file, trois Néerlandaises munies de couvertures de camping et de thermos font tourner des beignets et des baklavas. Vers cinq heures du matin, la foule grossit d’une vingtaine de nouveaux arrivants, parmi lesquels on reconnaît l’ancien président tunisien Moncef Marzouki, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et le député Arnaud le Gall, l’ancien ambassadeur britannique Craig Murray, ainsi que le député travailliste britannique Jeremy Corbyn – qui passera la nuit suivante devant le Palais pour être certain de pouvoir assister à la plaidoirie israélienne.
Bombardements non intentionnels de civils ? Afin de contrecarrer ce récit, les avocats sud-africains ont mis en exergue les appels à l’anéantissement de Gaza, le vocabulaire de déshumanisation de ses habitants, ainsi que la confusion rhétorique entre les membres du Hamas et la population palestinienne.
Ici, on vient pour « voir l’histoire en train de s’écrire ». On espère assister à la réalisation d’une vieille promesse : le triomphe du droit international sur la Realpolitik. « Il y a bien des façons émotionnelles de percevoir ce conflit », avance ainsi Shakki, un jeune indo-américain tout juste diplômé en sciences politiques qui fera partie des treize finalement admis. « J’ai le sentiment qu’avec la démarche initiée par l’Afrique du Sud, c’est la première fois dans l’histoire récente qu’il est possible de rassembler de façon rationalisée différentes perspectives et interprétations sur ce qu’il se passe dans cette région, quels que soient les intérêts particuliers des États », ajoute-t-il. Les représentants de la presse occidentale sont peu nombreux. Ce n’est que plus tard, quand le petit jour poindra sur La Haye, que les premiers journalistes arriveront. Vers 9 heures, nous entrons finalement sous les majestueux lustres du Palais de la Paix.
« Victimes collatérales » ? Contrecarrer le récit des dirigeants israéliens
Les avocats sud-africains ont débuté l’audience par une condamnation sans appel des « actions terroristes et de la prise d’otage du 7 octobre », précisant de surcroît qu’ils se refuseraient à projeter des images « explicites » des massacres à Gaza, afin de « ne pas transformer la Cour en théâtre ». Durant trois heures, mises en perspective historiques, analyses chirurgicales d’événements récents et points juridiques se sont succédés.
La singularité de la bande de Gaza a fait l’objet d’un long développement. Longue d’à peine quarante kilomètres, cette zone est l’une des plus densément peuplées au monde et la moitié de ses habitants sont des enfants, a-t-il été rappelé. Depuis 2007 elle fait l’objet d’un blocus illégal, à la fois terrestre, maritime et aérien. L’État israélien dispose du contrôle de la sphère électro-magnétique, de l’acheminement en eau et en électricité, ainsi qu’une mainmise de fait sur les infrastructures civiles et gouvernementales essentielles.
La requérante a rappelé que durant les trois premières semaines, 6000 bombes par semaine ont en moyenne ont été larguées sur Gaza. Parmi celles-ci, au moins 200 bombes d’environ une tonne au Sud de la bande, pourtant décrétée « zone de sécurité » par l’armée israélienne, vers laquelle elle enjoignait les Gazaouis à se réfugier. Preuve s’il en est, ont ajouté les avocats sud-africains, que ces massacres de civils ont été causés « de manière délibérée ».
La plaidoirie a tenu à rappeler que « tout acte de violence ne constitue pas un génocide ». Crimes de guerre, nettoyages ethniques, punitions collectives ou attaques d’hôpitaux sont autant de pratiques qui peuvent être commises sans intention génocidaire. Cependant, les modalités et l’intensité de la campagne de bombardements – l’une des plus massives du XXIe siècle – incitent l’Afrique du Sud à considérer qu’Israël « a violé et continue de violer les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur le génocide », et qu’il existe « un risque de préjudice irréparable » pour les Palestiniens.
Évoquant les chiffres officiels à jour du 9 janvier 2024, l’Afrique du Sud a rappelé que 1% de la population de Gaza avait été tuée, qu’une personne sur 40 avait été blessée et que, sur les 180 accouchements ayant lieu chaque jour, l’Organisation Mondiale de la Santé estimait à près de 15% les femmes risquant de souffrir de complications graves sans pouvoir bénéficier des soins médicaux. Mentionnant le risque d‘une famine aiguë et de la propagation d’épidémies, elle a fait appel à l’article II-c de la Convention pour la prévention du crime de génocide, qui fait entrer dans le champ d’application de la Convention la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».
Victimes collatérales ? Bombardements non intentionnels de civils ? Afin de contrecarrer ce récit israélien – qui plaide le caractère accidentel des tueries de civils, là où les actions du Hamas visent délibérément des cibles non militaires –, l’Afrique du Sud a longuement égrené des notes ministérielles, des déclarations officielles, des entretiens télévisés de dirigeants. Il s’agissait de souligner les appels décomplexés à l’anéantissement de la bande de Gaza, le vocabulaire de déshumanisation de ses habitants, ainsi que la stratégie rhétorique visant à confondre les membres du Hamas avec la population gazaouie dans son ensemble. Parmi les personnes concernées : le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le président israélien, plusieurs ministres, de hauts gradés de l’armée aussi bien que de simples soldats.
Ces « propos génocidaires ne sont donc pas l’exception, ils sont ancrés dans la politique de l’État d’Israël » a ainsi martelé le demanderesse. En outre, cette « intention de détruire » serait « bien comprise par les soldats sur le terrain », ce que la projection d’une vidéo devait appuyer. Dans la salle du tribunal a ainsi résonné, durant une minute, le vacarme d’un groupe de soldats, armes sous le bras, dansant, riant et chantant à tue-tête en récitant des extraits de la Bible : « Que brûlent leurs villages. Que Gaza soit effacée », « Tu effaceras la mémoire d’Amalek de dessous les cieux » – référence biblique à un peuple dont le Dieu de la Torah aurait demandé l’extermination.
Pour justifier sa démarche, l’Afrique du Sud a souhaité rappeler que la lutte contre le crime de génocide échappe à la « compétence exclusive d’un État » et oblige la communauté internationale dans son ensemble. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence de la CIJ dans l’affaire « Gambie contre Myanmar ». En 2019, la Cour internationale de justice avait en effet été saisie par la Gambie après le dépôt d’une plainte contre le Myanmar pour un éventuel génocide des Rohingyas, bien que ces deux pays se situent sur deux continents différents. Des « mesures conservatoires » avaient alors été exigées contre le Myanmar. À présent, l’Afrique du Sud en requérait de nouvelles à l’égard d’Israël, incluant notamment l’arrêt des opérations militaires à Gaza ainsi que l’interdiction de la destruction de preuves pouvant servir une enquête ultérieure.
La CIJ est habilitée à exiger des mesures conservatoires dans un bref délai, dès lors qu’il est établi que « des actes susceptibles de causer un préjudice irréparable » sont commis. Et ce, bien avant que « la Cour se prononce de manière définitive sur l’affaire », c’est-à-dire sur l’existence, ou non, d’intentions génocidaires réelles. Ce n’est qu’au bout d’un long travail d’enquête que la CIJ est habilitée à statuer sur ce dernier aspect.
Éradiquer le terrorisme : la défense israélienne
Le lendemain, la Cour devait entendre la plaidoirie de l’État inculpé durant trois heures. Changement de méthode avec la défense israélienne. Par contraste avec la précédente, des images d’otages détenus par le Hamas ont été affichées pendant plusieurs minutes.
« Israël connaît bien le contexte de création du concept de génocide dont il est accusé », a mentionné la défense, soulignant que le plus jamais ça était bien plus qu’un slogan pour le pays, mais son « obligation morale suprême ». À l’inverse, « s’il y a eu des actes que l’on pourrait qualifier de génocidaires, c’est contre Israël ». Et de citer des déclarations de dirigeants du Hamas prônant l’annihilation de l’État hébreu. Dans cette logique, celui-ci mènerait une « guerre défensive », où primerait le droit à prendre toutes les mesures pour défendre ses ressortissants et assurer la libération des otages. Un droit, a-t-il été ajouté, menacé par les demandes itérées de cessez-le-feu.
La résolution de la CIJ pourrait avoir de nombreuses conséquences indirectes pour les États continuant à soutenir Israël. À commencer par son premier pourvoyeur d’armes, les États-Unis.
Les avocats israéliens ont souhaité mettre en exergue une supposée naïveté dans la plaidoirie sud-africaine : « bien malheureusement, les souffrances civiles en temps de guerre ne sont pas le monopole de Gaza », ajoutant que ces pertes n’interviennent que « dans la poursuite légitime d’objectifs militaires ». « Ce qui au contraire est sans précédent », ont-ils poursuivi, c’est « l’enracinement du Hamas dans la population civile », évoquant la propension du groupe armé à utiliser (« de manière systématique ») des infrastructures civiles pour s’y cacher, allant jusqu’à affirmer que la population gazaouie serait « gouvernée par une organisation terroriste qui préfère anéantir ses voisins que protéger ses propres civils ».
Rejetant une quelconque intentionnalité dans les bombardements de Palestiniens non armés, les avocats ont allégué que l’armée israélienne agissait toujours « de manière proportionnée », cherchant à éviter les victimes en les prévenant d’actions militaires imminentes, par des appels téléphoniques ou l’envoi de feuillets depuis les hélicoptères. De même, la défense israélienne a mentionné une aide humanitaire « extraordinaire » qui aurait été offerte aux Gazaouis, avant d’ajouter qu’il n’y avait « aucune restriction d’eau à Gaza » et que des infrastructures avaient été réparées par les Israéliens eux-mêmes.
L’argumentation s’est ensuite voulue plus offensive. La partie israélienne n’a pas hésité à multiplier les attaques ad hominem contre les avocats sud-africains, qualifiant leurs accusations de « calomnies » qui viseraient « à bander les yeux des juges et de la Cour ». Ils ont ainsi affirmé que l’acceptation par la CIJ des mesures conservatoires demandées risquerait de transformer le droit international un « instrument agressif et non protecteur, qui saperait les droits plus qu’il ne les protégerait ». La Convention pour la prévention du crime de génocide serait ainsi tournée en une « charte de l’agresseur », punissant les États cherchant à se « protéger du terrorisme ».
Enfin, la défense israélienne a cherché à inscrire l’Afrique du Sud dans les pas du Hamas : ses représentants nieraient « l’histoire juive » et ses avocats partageraient « la même rhétorique et la même grille d’analyse » que l’organisation terroriste palestinienne.
Mesures conservatoires sans cessez-le-feu
Le 26 janvier 2024, après deux semaines de délibération, la Cour devait rendre une première décision : ayant reconnu sa compétence dans l’affaire, elle a indiqué plusieurs mesures conservatoires, dans l’attente du verdict final, portant sur la réalité des intentions génocidaires. Dans l’ordonnance publiée, elle affirme ainsi qu’il en va « du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide » et que « les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles ». Parmi ces « faits et circonstances mentionnés », ont notamment été pris en compte les modalités de l’opération militaire conduite à Gaza.
Surtout, la Cour a « [pris] note » de plusieurs déclarations tenues par les hauts responsables israéliens eux-mêmes. Parmi ces derniers, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant qui, le 10 octobre 2023, a déclaré dans une allocution aux troupes israéliennes à la frontière de Gaza : « Nous combattons des animaux humains […] Gaza ne reviendra pas à ce qu’elle était avant. Il n’y aura pas de Hamas. Nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines, voire des mois, aucun endroit ne nous échappera. »
La déclaration du président d’Israël, Isaac Herzog, tenue le 12 octobre 2023, a elle aussi été mise en avant : « C’est toute une nation qui est responsable. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et qui n’étaient pas impliqués, ça n’existe pas. » La Cour a ainsi ordonné à Israël de prévenir et de sanctionner toute incitation au génocide dans la bande de Gaza, et de se conformer aux obligations lui incombant en vertu de la Convention pour la prévention du crime de génocide afin de protéger le peuple palestinien d’ « un risque réel et imminent de préjudice irréparable ». De même, elle a enjoint l’État d’Israël à « prévenir la destruction […] des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application » de cette même Convention, afin de permettre à l’enquête de la Cour d’avoir lieu.
Cette décision a pu être jugée décevante par les partisans du cessez-le-feu, étant donné qu’aucun appel à la cessation des hostilités n’a été prononcé. Elle a coïncidé, ce même 26 janvier, dans les heures suivant la décision de la Cour, avec des accusations lancées contre l’UNRWA – l’agence onusienne chargée de répondre aux besoins essentiels des réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Après qu’Israël a présenté à l’ONU des informations selon lesquelles au moins douze membres de l’agence auraient été impliqués dans les attaques menées par le Hamas le 7 octobre, d’importants donateurs ont décidé de suspendre leurs financements, parmi lesquels les États-Unis (premier contributeur de l’agence), le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie ou encore les Pays-Bas. Un coup dévastateur porté aux deux millions de réfugiés de Gaza, qui dépendent directement de cette assistance humanitaire. La France, quant à elle, a décidé de ne pas effectuer de nouveau versement à l’UNRWA pour le premier semestre 2024 suite à ces « accusations d’une extrême gravité », et n’a pas communiqué de date pour une éventuelle reprise du financement. Quelques jours après la décision de la CIJ, celle-ci était-elle déjà frappée de nullité ?
Elle pourrait cependant avoir de nombreuses conséquences indirectes pour les États continuant à soutenir Israël. À commencer par son premier pourvoyeur d’armes, les États-Unis. Dans son ordonnance, la Cour a en effet très explicitement rappelé que la Convention pour la prévention du crime de génocide condamne également « la complicité dans le génocide » (article III, litt. e). Ainsi, si la CIJ n’a pas appelé à un cessez-le-feu, le non-respect des mesures conservatoires n’est pas sans implications juridiques.
Une lueur d’espoir malgré les bombardements sans trêve ?
Pour l’heure, l’arrêt de la CIJ ne semble nullement peser sur les dirigeants israéliens. Lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision états-unienne ABC News et diffusé le 11 février, le premier ministre Benjamin Netanyahu a ainsi annoncé une offensive imminente sur Rafah, déclarant : « La victoire est à portée de main. Nous allons le faire. Nous allons prendre les derniers bataillons terroristes du Hamas et Rafah, qui est le dernier bastion. » Une annonce qui n’a pas été sans alerter un grande nombre de dirigeants politiques et susciter de vives réactions, y compris parmi les proches soutiens d’Israël. Lors d’une rencontre le 12 février à la Maison-Blanche avec le roi de Jordanie Abdallah II, le président des États-Unis Joe Biden a ainsi affirmé la nécessité d’un plan « crédible et réalisable » pour protéger la population concentrée à Gaza – rejetant cependant dans le même temps l’idée d’un cessez-le-feu durable dans la région. Cette préoccupation n’a cependant pas empêché l’armée israélienne de bombarder Rafah.
Seul un arrêt de la justice néerlandaise, frappant d’interdiction l’exportation de pièces de bombardiers F-35 vers Israël, fait figure à ce jour de mesures contraignantes. Les plaignants avaient saisi les tribunaux des Pays-Bas, soulignant qu’une telle action pourrait rendre le pays coupable de complicité de crime de génocide, en vertu de la décision de la Cour de La Haye. Une décision surtout symbolique – les États-Unis pouvant fournir l’ensemble des pièces de F-35 en lieu et place des Pays-Bas – mais donc certains espèrent qu’elle fera tâche d’huile.
Une maigre consolation, à l’heure où malgré quelques déclarations inquiètes, les leaders du camp occidental ne se défont pas de leur soutien militaire à Israël. Alors que les bombes continuent de pleuvoir sur Rafah, la décision de la CIJ appartient-elle déjà au passé ? Si les prochaines semaines devaient signer son obsolescence, c’est une nouvelle brèche qui serait ouverte dans le droit international et l’ordre mondial actuel. Un gouffre béant qui se creuserait entre l’OTAN et les BRICS. Et une disgrâce durable qui frapperait les pays qui s’alignent sur un État qui proclame son mépris pour les Nations-Unies.