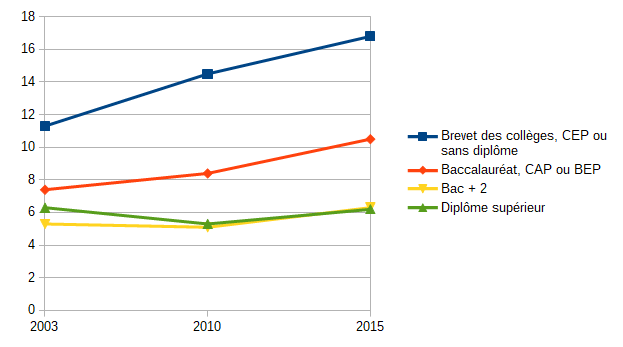L’ambiance politique en France semble souffrir d’un malaise que rien ne réussit à soigner. L’élection d’Emmanuel Macron avait pourtant permis d’envisager un soulagement des antagonismes du pays, par le biais d’un renouvellement du personnel politique réuni autour d’un projet libéral abolissant le clivage toujours plus réduit entre le PS et Les Républicains. Mais après un été qui a signé la fin de son état de grâce, le Président de la République lui-même avouait lors d’une interview qu’il “n’avait pas réussi à réconcilier le peuple Français avec ses dirigeants”. Trois jours plus tard, ce diagnostic lui était confirmé par l’irruption sur la scène politique des gilets jaunes.
Si les gilets jaunes ont été originellement mis en mouvement par l’annonce de la hausse des taxes sur les produits pétroliers, leurs témoignages convergent sur un point : cette hausse de taxe n’est pas tant l’objet de leur contestation qu’une goutte d’eau ayant fait déborder le vase. Le caractère diffus du mouvement fait que les gilets jaunes n’ont pas de mot d’ordre explicitement défini, néanmoins certains discours font nettement consensus. Il s’exprime d’un ras-le-bol d’ordre global à l’encontre d’un système politique qui s’attaque au portefeuille des classes moyennes et populaires sous couvert d’écologie, tout en privilégiant les grandes fortunes et intérêts industriels. Partout, la démission d’Emmanuel Macron est réclamée. Malgré ces revendications incontestablement politiques, les gilets jaunes se définissent comme apolitiques. C’est que le mot “apolitique” est utilisé pour désigner une autre réalité : celle d’un très fort rejet de la représentation politique.
“C’est que le mot “apolitique” est utilisé pour désigner une autre réalité : celle d’un très fort rejet de la représentation politique.”
Il s’agit d’une colère larvée qui, n’ayant pas été résolue précédemment par la démocratie représentative, se met à rejeter la démocratie représentative. On pourrait cyniquement dire qu’il ne s’agit pas tant d’une crise que d’un retour à la normale. La normale d’une Vème République essoufflée, caractérisée non-seulement par un pouvoir exécutif hypertrophié, mais aussi par une incapacité à résoudre les crises qui l’habitent par des voies institutionnelles. Après le désaveu subi par François Hollande, suivi par le “dégagisme” qui a structuré l’élection présidentielle de 2017, la pulsion destituante qui anime une part importante de la société française s’est réveillée avec fracas. Pour comprendre l’origine de l’impasse politique dans laquelle semble s’être enfoncée la France, il est nécessaire de retracer l’évolution de la Vème République jusqu’à nos jours.
UNE VÈME RÉPUBLIQUE EN ÉVOLUTION

Car l’agencement des institutions a significativement évolué depuis le référendum du 28 septembre 1958 qui a approuvé la Constitution écrite par Michel Debré. Dans l’esprit initial du texte, le Président devait jouer le rôle de “clé de voûte de notre régime parlementaire”, selon son auteur. Il s’agissait donc bien initialement d’un régime mené par ses parlements, ayant le Premier Ministre comme chef du gouvernement, celui-ci et ses ministres tirant leur légitimité de l’Assemblée nationale. Le Président, élu par un collège électoral restreint, était conçu comme un arbitre de la vie politique et le représentant de l’État pour les questions diplomatiques. N’ayant pas vocation à s’immiscer dans les affaires courantes, les pouvoirs que lui conférait la Constitution lui permettaient de solliciter d’autres pouvoirs : dissoudre l’Assemblée Nationale, décider d’un référendum, nommer le Premier ministre. Dans le contexte de l’époque, après une IVème République marquée par l’instabilité politique, l’ajout du rôle de Président dans l’organigramme institutionnel avait pour objectif de rationaliser et stabiliser le fonctionnement d’un régime axé autour du parlement.
“L’élection au suffrage universel fit passer le Président du statut de simple arbitre à celui de personnage incontournable de la vie politique.”
Or, la Vème République est aujourd’hui unanimement qualifiée de régime présidentiel, voire présidentialiste. Si le parlementarisme n’est plus d’actualité, c’est que le régime et l’équilibre de ses pouvoirs ont vite évolué. Charles De Gaulle lui-même, de par sa popularité importante, empiétait sur les prérogatives de ses premiers ministres. Si l’Histoire et son rôle dans la Seconde Guerre Mondiale lui donnaient la légitimité nécessaire pour concentrer autant de pouvoirs, il avait néanmoins conscience du caractère exceptionnel de sa situation. Cela le poussera à proposer en 1962, par un référendum, que le Président de la République soit élu au suffrage universel, afin que ses successeurs puissent jouir d’une légitimité équivalente. Cette modification constitutionnelle fit passer le Président du statut de simple arbitre à celui de personnage incontournable de la vie politique : le suffrage universel sur une circonscription nationale fait de lui le récipiendaire de la souveraineté du peuple, jusqu’ici détenue par l’Assemblée nationale.
La Constitution de la Vème République prévoit naturellement qu’au pouvoir exécutif s’oppose un contre-pouvoir. Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale et peut être renversé par cette dernière. Néanmoins, un phénomène a été observé tout au long de la Vème République, que l’on appelle le fait majoritaire. Toujours, les élections législatives ont fait émerger une majorité nette au sein de l’Assemblée nationale. Cet état des choses était consciemment voulu par les rédacteurs de la Constitution, qui cherchaient à rendre le pouvoir législatif plus stable, et ont pour ce faire décidé que les députés ne seraient pas élus à la proportionnelle mais via un système à deux tours qui incite à la formation d’alliances politiques. La stabilité qui en a découlé avait un prix : dans le cadre du fait majoritaire, il est invraisemblable que l’Assemblée nationale exerce son pouvoir de renversement du gouvernement du fait des liens d’allégeance politique qui lient le gouvernement et la majorité.
Le Président n’est pas pour autant tout puissant. Le pouvoir de l’exécutif sous la Vème République est important, mais l’asynchronicité des élections présidentielles et législatives donna lieu à des cohabitations forçant le couple Président/Premier ministre à trouver des compromis. La première advint en 1986, quand Jacques Chirac devint Premier ministre de François Mitterrand. Plus tard, ce sera Jacques Chirac qui devra cohabiter avec Lionel Jospin. En 2000, Jacques Chirac fit adopter par référendum le passage du septennat au quinquennat. Dés lors, c’est le scénario d’une cohabitation qui tombe dans le domaine de l’invraisemblable : les élections présidentielles et législatives n’étant à chaque fois séparées que de quelques mois, les dynamiques politiques permettent toujours au Président élu d’être soutenu par une majorité à l’Assemblée.
“La Vème République devient problématique du fait de son incapacité à digérer les crises politiques et à faire émerger des solutions positives par le jeu des pouvoirs et contre-pouvoirs.”
Depuis 1958, les mécanismes d’équilibre des pouvoirs de la Vème République ont donc significativement évolué vers un renforcement du rôle de l’exécutif, et un alignement de l’Assemblée nationale sur celui-ci. Emmanuel Macron a l’intention de contribuer à cette dynamique, à l’aide de son projet de révision constitutionnelle qui prévoit une réduction du nombre de parlementaires et de leurs marges de manœuvre, dont l’examen a été reporté à janvier 2019.
L’IMPASSE
L’évolution de la Vème République n’est pas un facteur de crise en lui-même. Les crises politiques rencontrées par la France trouvent leurs germes dans la désindustrialisation, le chômage de masse et le développement des inégalités, ainsi que dans l’incapacité des pouvoirs étatiques de s’en protéger du fait des traités internationaux, traités européens en tête, qui fixent comme un cadre indépassable le libre-échange, la libre circulation des capitaux, et la rigueur budgétaire.
La Vème République devient problématique du fait de son incapacité à digérer les crises politiques et à faire émerger des solutions positives par le jeu des pouvoirs et contre-pouvoirs. La victoire du “non” au référendum pour une Constitution européenne en 2005 peut, à ce titre, représenter le début de la spirale infernale. Après le coup de semonce qu’a constitué l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2002, un véritable divorce entre les dirigeants et une partie de la population qui rejette le projet d’intégration européenne et les conséquences de la mondialisation s’est amorcé.

Ce désaveu appelait une réponse institutionnelle. Face à l’inadéquation avérée entre le peuple et ses représentants, des institutions fonctionnelles auraient du être en mesure de soulager le malaise par des voies démocratiques. Le Président de la République est supposé jouer le rôle d’arbitre, et a les moyens de purger les crises, notamment par la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est ce que de Gaulle fit en 1968 après que les manifestations étudiantes et la signature des accords de Grenelle eurent ébranlé son pouvoir.
Cependant, à la différence de 1968, le Président de la République est devenu un acteur à part entière de la vie politique plutôt qu’un simple arbitre. Dissoudre l’Assemblée nationale ne serait plus tant l’exercice d’un contre-pouvoir qu’une balle que le Président se tirerait lui-même dans le pied. Or, l’enseignement de Montesquieu, lorsqu’il théorisa la séparation des pouvoirs, est qu’un pouvoir laissé à lui même est destiné à agir égoïstement, qu’il est vain d’attendre de lui qu’il s’auto-régule, et que pour éviter la tyrannie, il est nécessaire qu’à chaque pouvoir s’oppose un contre-pouvoir en mesure de le neutraliser.
“Entre deux élections présidentielles, aucun processus institutionnel ne peut se mettre en travers de l’action d’un Président qui irait à l’encontre de la volonté du peuple.”
Quels contre-pouvoirs rencontre aujourd’hui l’exécutif Français ? Si l’Assemblée a formellement le pouvoir de renverser le gouvernement, le fait majoritaire implique qu’il est invraisemblable que cela se produise. Le Président, quant à lui, ne peut être menacé que par l’Article 68 de la Constitution, qui nécessite une majorité absolue de la part des deux parlements, tout aussi invraisemblable. Entre deux élections présidentielles, aucun processus institutionnel ne peut se mettre en travers de l’action d’un Président qui irait à l’encontre de la volonté du peuple.
Cette absence de contre-pouvoir a ouvert la voie à la disparition d’un rapport agonistique entre les classes populaires et les classes dirigeantes. N’étant plus institutionnellement contraints pendant la durée de leurs mandats, les membres de l’exécutif sont formellement libres de mettre en place la politique de leur choix sans avoir à prendre en compte les revendications d’une certaine partie de la population qui n’a pas accès aux ficelles du pouvoir autrement que par leur bulletin de vote, et que les techniques modernes de communication et de création du consentement permettent de maîtriser. À ces phénomènes institutionnels s’ajoutent des déterminations sociales : depuis 1988, la part de députés issus des classes populaires n’a jamais dépassé 5%. La victoire du “Non” au référendum de 2005 n’a donc pas donné lieu à une remise en cause introspective des élites politiques sur la façon dont elles représentent le peuple, mais à une simple dénégation de la responsabilité politique des dirigeants envers ceux qu’ils représentent.
“Leur présence sur les ronds points n’est pas une interpellation du pouvoir comparable à celles qu’effectuent les syndicats lors de leurs manifestations. Il s’agit pour les gilets jaunes d’un procédé de dernier recours.”
En tenant compte du fait que les responsables politiques successifs se sont illustrés par leur compromission à des intérêts tiers (grandes entreprises, monarchies pétrolières) et l’application de politiques pour lesquelles ils n’ont pas été élus (Loi Travail, libéralisation de la SNCF, etc.), les classes populaires ne doivent pas seulement être vues comme les “perdants de la mondialisation”, mais aussi comme des laissés pour compte de la démocratie. Les implications sont majeures. Car les processus démocratiques institutionnels ont un objectif social : être les vecteurs des antagonismes qui parcourent la société, de sorte que la violence des rapports sociaux s’exprime verbalement, symboliquement en leur sein plutôt que physiquement entre individus.
C’est sous ce prisme qu’il faut analyser le mouvement des gilets jaunes. Ayant perdu confiance en tous les procédés de représentation au sein des instances politiques institutionnelles, qu’il s’agisse des partis ou des syndicats, la colère politique se donne à voir au grand jour. Une colère qui ne trouve plus sa canalisation symbolique, et qui n’a d’autre choix que de se manifester physiquement. Les témoignages de gilets jaunes font état de l’impasse, non seulement financière mais aussi politique, dans laquelle ils se trouvent. Nombreux sont les citoyens pour qui ce mouvement est la première manifestation politique à laquelle ils participent, ce qui indique que leur présence sur les ronds points n’est pas une interpellation du pouvoir comparable à celles qu’effectuent les syndicats lors de leurs manifestations. Il s’agit pour les gilets jaunes d’un procédé de dernier recours, d’un refus de la politique conventionnelle qui les a trop trahis, les poussant à prendre les choses en main eux-mêmes et à s’organiser hors des institutions existantes.
QUEL AVENIR POLITIQUE POUR LES GILETS JAUNES ?
À certains égards, les analyses de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, théoriciens du populisme de gauche, se voient confirmées : une dynamique destituante domine, par les appels à la démission d’Emmanuel Macron et la confiance brisée en tous les mécanismes de représentation politique. Une dynamique constituante, encore ténue, peut être aperçue. D’une part, les gilets jaunes utilisent des signifiants nationaux tels que le drapeau, la Marseillaise ou la Révolution de 1789, ce qui illustre que leurs revendications n’ont pas tant à voir avec des thématiques sectorielles comme le prix du carburant, qu’avec une conception de l’État-nation comme étant responsable devant ses citoyens. D’autre part, sur leurs groupes Facebook et lors des rassemblements, les gilets jaunes amorcent des réflexions autour de propositions pour sortir par le haut de la crise politique. Des référendums sont réclamés de manière un peu intransitives, sans qu’on observe un accord tranché sur les termes de la question qui serait posée. On va jusqu’à observer des propositions de nouvelle Constitution pour la France, là encore sous des termes flous. Car ce qui unit les gilets jaunes n’est sans doute pas tant un ensemble de revendications précises, mais un profond sentiment d’abandon et un virulent désir d’exercer une souveraineté politique. Il s’agit pour eux de réaffirmer la place du peuple comme acteur à part entière du processus politique institutionnel quotidien.
“Ce qui unit les gilets jaunes n’est sans doute pas tant un ensemble de revendications précises, mais un profond sentiment d’abandon et un virulent désir d’exercer une souveraineté politique.”
Le mouvement des gilets jaunes n’est pas fini, mais on peut déjà dire que le paysage politique français en sera transformé. De quelle manière ? Si les gilets jaunes ont démontré que leur colère pouvait les pousser à la violence, un scénario insurrectionnel où le gouvernement serait physiquement contraint d’abandonner le pouvoir demeure invraisemblable. Comme le faisait remarquer le démographe Emmanuel Todd, les révolutions ont lieu dans des pays jeunes, c’est-à-dire où l’âge médian de la population se situe aux alentours de 25 ans. Aujourd’hui, la moitié des Français a plus de 40 ans. De plus, la faible expérience des mouvements sociaux du gilet jaune moyen ne permet pas d’affirmer que le mouvement tiendrait bon face à des forces de l’ordre ouvertement hostiles.
Sans insurrection, il est probable que le mouvement trouve, à moyen terme, son prolongement dans les processus électoraux habituels. Dans la mesure où les gilets jaunes confirment le diagnostic du populisme de gauche, doit-on s’attendre à ce que la France Insoumise et ses représentants raflent la mise ? Rien n’est moins sûr tant l’hostilité aux représentants politiques déjà établis semble forte. L’image de la France Insoumise a souffert de la vague de perquisitions d’octobre dernier. Quoi que l’on pense du bien fondé de celles-ci, la séquence politique qui leur a correspondu a fait entrer dans l’opinion l’idée que la France Insoumise était un parti “comme les autres”, comme en atteste la chute de popularité de Jean-Luc Mélenchon qui a suivi.
Si les premiers signes de structuration autour d’une demande politique autorisent à espérer que le mouvement débouche sur des revendications progressistes, les tentatives de récupération par les différents mouvements de droite et d’extrême-droite se multiplient et trouvent leur relai dans les chaînes d’information en continu, de telle sorte que rien n’est garanti. Tout peut arriver avec les gilets jaunes, tant ce mouvement est encore en devenir, extrêmement volatil. Le scénario de l’échec de toute récupération politique n’est pas à exclure car le discours destituant est une composante essentielle de ce mouvement. Doit-on s’attendre à voir émerger, dans le sillage de ces évènements, une formation politique nouvelle caractérisée par une relative absence de structuration idéologique, analogue à certains égards au M5S italien ?
En l’absence d’un mécanisme institutionnel de contre-pouvoir à même de purger la crise, seule une abdication d’Emmanuel Macron pourrait soulager le pays. La volonté répétée de ce dernier de persévérer, ainsi que l’ampleur des intérêts économiques qui le soutiennent, laissent penser qu’une reddition n’arrivera pas. Seulement 18 mois après les dernières élections présidentielles, les divisions du pays se sont réveillées et s’expriment hors de tout cadre institutionnel propre à les canaliser. Les prochains mois et années se profilent sous un jour noir, tant la confiance entre citoyens et personnel politique s’effrite. Les prochaines élections européennes seront l’occasion de mesurer l’étendue de la reconfiguration politique provoquée par le mouvement des gilets jaunes, que celle-ci se traduise par la montée en popularité d’un parti ou un autre, ou par une abstention toujours plus abyssale. Elles ne seront toutefois que l’occasion de prendre la température. Car dans une Vème République où l’élection présidentielle est le seul mécanisme institutionnel qui peut agir sur un pouvoir exécutif surpuissant, il est difficile d’imaginer un scénario de sortie de crise avant 2022.