Après un été marqué par des événements climatiques extrêmes et un nouveau rapport du GIEC confirmant ses prévisions les plus inquiétantes, une grande partie de la planète est désormais traversée par une crise énergétique qui préfigure d’autres troubles économiques à venir. Cette conjoncture a enterré le rêve d’une transition harmonieuse vers un monde post-carbone, mettant au premier plan la question de la crise écologique du capitalisme. À la COP26, la tonalité dominante a été celle de l’impuissance, où les malheurs imminents ont laissé l’humanité coincée entre les exigences immédiates de la reproduction systémique et l’accélération des désordres climatiques. Texte de Cédric Durand, économiste et auteur de Technoféodalisme. Critique de l’économie numérique (Zones, 2020), initialement publié par la New Left Review, traduit par Giorgio Cassio et édité par William Bouchardon.
À première vue, on pourrait penser que des mesures sont prises pour faire face à ce cataclysme. Plus de 50 pays – plus l’ensemble de l’Union européenne – se sont engagés à atteindre des objectifs de « zéro émission nette » qui verraient les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie diminuer de 40% d’ici à 2050. Pourtant, une simple lecture des données scientifiques montre que la transition écologique est loin d’être sur la bonne voie. Si nous ne parvenons pas à atteindre l’objectif mondial de zéro émission nette, les températures continueront d’augmenter, dépassant largement les +2°C d’ici à 2100. Selon le PNUE (Emissions Gap Report 2021, 26 octobre 2021), les contributions décidées au niveau national avant la COP2 permettraient de réduire les émissions à échéance de 2030 de 7,5%. Or, une baisse de 30% est nécessaire pour limiter le réchauffement à +2°C, tandis qu’une baisse de 55% serait nécessaire pour +1,5°C.
Comme le soulignait un récent éditorial de Nature du 31 mars 2021, nombre de ces pays ont pris des engagements de « zéro émission nette » sans avoir de plan concret pour y parvenir. Quels gaz seront visés ? Dans quelle mesure cet objectif net repose-t-il sur une réduction effective plutôt que sur des systèmes de compensation ? Ces derniers sont devenus particulièrement attrayants pour les pays riches et les entreprises polluantes, car ils ne réduisent pas directement les émissions et impliquent le transfert de la charge de la réduction des émissions de carbone vers les pays à revenu faible et moyen (qui seront les plus durement touchés par le dérèglement climatique). Sur ces questions cruciales, on ne trouve nulle part d’informations fiables et des engagements transparents, ce qui compromet la possibilité d’un suivi scientifique international crédible. En résumé, sur la base des politiques climatiques mondiales actuelles – celles qui sont mises en œuvre et celles qui sont proposées – le monde est sur la voie d’une augmentation dévastatrice des émissions au cours de la prochaine décennie.
La crise de l’énergie a déjà commencé
Malgré cela, le capitalisme a déjà connu le premier choc économique majeur lié à la transition bas carbone. La flambée des prix de l’énergie est due à plusieurs facteurs, notamment une reprise désordonnée après la pandémie, des marchés de l’énergie mal conçus au Royaume-Uni et dans l’UE qui exacerbent la volatilité des prix, et la volonté de la Russie de sécuriser ses revenus énergétiques à long terme. Toutefois, à un niveau plus structurel, l’impact des premiers efforts déployés pour restreindre l’utilisation des combustibles fossiles ne peut être négligé. En raison des limites imposées par les gouvernements à la combustion du charbon et de la réticence croissante des actionnaires à s’engager dans des projets qui pourraient être largement obsolètes dans trente ans, les investissements sont en baisse dans les combustibles fossiles. Si cette contraction de l’offre n’est pas suffisante pour sauver le climat, elle s’avère néanmoins trop importante pour la croissance capitaliste.
Plusieurs événements récents nous offrent un avant-goût de ce qui nous attend. Dans la région du Pendjab, en Inde, de graves pénuries de charbon ont provoqué des pannes d’électricité imprévues. En Chine, plus de la moitié des administrations provinciales ont imposé des mesures strictes de rationnement de l’électricité. Plusieurs entreprises, dont des fournisseurs clés d’Apple, ont récemment été contraintes d’interrompre ou de réduire leurs activités dans la province de Jiangsu, après que les autorités locales aient restreint l’approvisionnement en électricité. Ces restrictions visaient à respecter les objectifs nationaux en matière d’émissions en limitant la production d’électricité à partir du charbon, qui représente encore environ deux tiers de l’électricité en Chine. Pour contenir les retombées de ces perturbations, les autorités chinoises ont mis un frein temporaire à leurs ambitions climatiques, en ordonnant à 72 mines de charbon d’augmenter leur approvisionnement et en relançant les importations de charbon australien, interrompues pendant des mois en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays.
Alors qu’une réduction de l’offre d’hydrocarbures est en cours, l’augmentation des sources d’énergie durables ne suffit pas à répondre à la demande croissante. Il en résulte une inadéquation énergétique qui pourrait faire dérailler la transition.
En Europe, c’est la flambée des prix du gaz qui a déclenché la crise actuelle. Hantés par le souvenir du soulèvement des Gilets jaunes contre la taxe carbone de Macron, les gouvernements sont intervenus avec des subventions énergétiques pour les classes populaires. Mais de manière plus inattendue, les hausses du prix du gaz ont précipité des réactions en chaîne dans le secteur manufacturier. Le cas des engrais est révélateur : un groupe américain, CF Industries (Deeefild, Illinois), a décidé d’arrêter la production de ses usines d’engrais au Royaume-Uni, devenues non rentables en raison de la hausse des prix. En tant que sous-produit de ses activités, l’entreprise fournissait auparavant 45% du CO2 de qualité alimentaire du Royaume-Uni – dont la perte a déclenché des semaines de chaos pour l’industrie, affectant divers secteurs, allant de la bière et des boissons non alcoolisées à l’emballage alimentaire et à la viande. Au niveau mondial, la flambée des prix du gaz affecte le secteur agricole par le biais de l’augmentation des prix des engrais. En Thaïlande, le coût des engrais est en passe de doubler depuis 2020, augmentant les coûts pour de nombreux producteurs de riz et mettant en péril la saison de la plantation. Si cette situation perdure, les gouvernements pourraient être amenés à intervenir pour garantir les approvisionnements alimentaires essentiels.
Les répercussions mondiales et généralisées des pénuries d’énergie et des hausses de prix soulignent les effets complexes qu’implique la transformation structurelle nécessaire à l’élimination des émissions de carbone. Alors qu’une réduction de l’offre d’hydrocarbures est en cours, l’augmentation des sources d’énergie durables ne suffit pas à répondre à la demande croissante. Il en résulte une inadéquation énergétique qui pourrait faire dérailler la transition. Dans ce contexte, les pays peuvent soit revenir à la source d’énergie la plus facilement disponible – le charbon –, soit provoquer un recul de l’économie en raison de la flambée des coûts et de ses effets sur la rentabilité, les prix à la consommation et la stabilité du système financier. A court terme, il s’agit donc d’un compromis entre les objectifs écologiques et la nécessité de favoriser la croissance. Mais ce dilemme énergétique est-il valable à moyen et long terme ? Un choix entre le climat et la croissance finira-t-il par s’imposer ?
Décroissance et investissement : les deux volets de la transition écologique
La réussite de la transition vers un monde décarbonné implique le déroulement harmonieux de deux processus complexes et interdépendants, aux niveaux matériel, économique et financier. Premièrement, un processus de démantèlement doit avoir lieu : les sources de carbone doivent être réduites de manière drastique, et avant tout l’extraction d’hydrocarbures, la production d’électricité à partir de charbon et de gaz, les systèmes de transport à base de carburant, le secteur de la construction (en raison du niveau élevé d’émissions liées à la production de ciment et d’acier) et l’industrie de la viande. Il s’agit ici de décroissance au sens le plus simple du terme : les équipements doivent être mis au rebut, les réserves de combustibles fossiles doivent rester dans le sol, l’élevage intensif doit être abandonné et toute une série de fonctions professionnelles relatives à ces secteurs doivent être supprimées.
Toutes choses égales par ailleurs, l’élimination des capacités de production implique une contraction de l’offre qui entraînerait une pression inflationniste généralisée. Ceci est d’autant plus probable que les secteurs les plus touchés occupent une position stratégique dans les économies modernes. Se répercutant sur les autres secteurs, la pression sur les coûts entamera les marges des entreprises, les profits mondiaux et/ou le pouvoir d’achat des consommateurs, déclenchant de violentes spirales de récession. En outre, la décroissance de l’économie carbonée est une perte nette du point de vue de la valorisation du capital financier : d’énormes quantités d’actifs perdus doivent être effacées puisque les bénéfices sous-jacents attendus sont abandonnés, ouvrant la voie à des ventes à la sauvette et ricochant sur la masse de capital fictif1. Ces dynamiques interdépendantes s’alimenteront mutuellement, les forces de la récession augmentant les défauts de paiement des dettes tandis que la crise financière gèle l’accès au crédit.
L’autre aspect de la transition est un effort d’investissement majeur pour faire face au choc de l’offre causé par la décroissance du secteur du carbone. Si le changement des habitudes de consommation pourrait jouer un rôle, notamment dans les pays riches, la création de nouvelles capacités de production décarbonées, l’amélioration de l’efficacité, l’électrification des transports, des systèmes industriels et de chauffage (ainsi que, dans certains cas, le déploiement de la capture du carbone) sont également nécessaires pour compenser l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre. D’un point de vue capitaliste, cela pourrait représenter de nouvelles opportunités de profit, tant que les coûts de production ne sont pas prohibitifs par rapport à la demande disponible. Attirée par cette valorisation, la finance verte pourrait intervenir et accélérer la transition, propulsant une nouvelle vague d’accumulation capable de soutenir l’emploi et le niveau de vie.
L’impasse du marché carbone
Cependant, il faut garder à l’esprit que le timing est primordial : réaliser de tels ajustements en cinquante ans est complètement différent que de devoir se désengager radicalement en une décennie. Or, au vu de la situation actuelle, les perspectives d’un passage en douceur et adéquat aux énergies vertes sont pour le moins minces. La réduction du secteur du carbone reste incertaine en raison de la contingence inhérente aux processus politiques et du manque persistant d’engagement des autorités nationales. Il est révélateur qu’un seul sénateur, Joe Manchin, élu de Virginie-Occidentale, parvienne à bloquer le programme des démocrates américains visant à faciliter le remplacement des centrales électriques au charbon et au gaz.
Au vu de la situation actuelle, les perspectives d’un passage en douceur et adéquat aux énergies vertes sont pour le moins minces.
Comme l’illustrent les perturbations actuelles, le manque d’alternatives facilement disponibles pourrait également entraver l’abandon progressif des combustibles fossiles. Selon l’AIE – Agence internationale de l’énergie : « Les dépenses liées à la transition […] restent bien en deçà de ce qui est nécessaire pour répondre à la demande croissante de services énergétiques de manière durable. Ce déficit est visible dans tous les secteurs et toutes les régions. » Dans son dernier rapport sur l’énergie, Bloomberg (New Energy Outlook 2021) estime qu’une économie mondiale en croissance nécessitera un niveau d’investissement dans l’approvisionnement et les infrastructures énergétiques compris entre 92 000 et 173 000 milliards de dollars au cours des trente prochaines années. L’investissement annuel devra plus que doubler, passant d’environ 1700 milliards de dollars par an aujourd’hui à une moyenne comprise entre 3100 et 5800 milliards de dollars par an. L’ampleur d’un tel ajustement macroéconomique serait sans précédent.
Du point de vue de la théorie économique dominante, qui ne jure que par le marché, cet ajustement passe par la détermination du bon prix. Dans un récent rapport commandé par le président français Emmanuel Macron, deux économistes de premier plan dans ce domaine, Christian Gollier et Mar Reguant, affirment que « la valeur du carbone doit servir de jauge pour toutes les dimensions de l’élaboration des politiques publiques ». Bien que les normes et les réglementations ne soient pas à exclure, une « tarification bien conçue du carbone », via une taxe sur le carbone ou un mécanisme de plafonnement et d’échange, doit jouer le rôle principal. Les mécanismes de marché sont censés internaliser les externalités négatives des émissions de gaz à effet de serre, permettant ainsi une transition ordonnée tant du côté de l’offre que de la demande. La tarification du carbone présente l’avantage de se concentrer sur l’efficacité en termes de coût par tonne de CO2, sans qu’il soit nécessaire d’identifier à l’avance les mesures qui fonctionneront. Reflétant la plasticité de l’ajustement du marché, « contrairement à des mesures plus prescriptives, un prix du carbone laisse le champ ouvert à des solutions innovantes ».
Cette perspective techno-optimiste et de libre marché garantit la conciliation entre la croissance capitaliste et la stabilisation du climat. Cependant, elle souffre de deux défauts principaux. Le premier est l’aveuglement de l’approche de la tarification du carbone face à la dynamique macroéconomique impliquée par l’effort de transition. Un récent rapport de Jean Pisani-Ferry (août 2021), rédigé pour le Peterson Institute for International Economics, minimise la possibilité d’un ajustement en douceur conduit par les prix du marché, tout en anéantissant les espoirs d’un Green New Deal qui bénéficierait à tous.
Puisque « la procrastination a réduit les chances d’organiser une transition ordonnée », le rapport note qu’il n’y a « aucune garantie que la transition vers la neutralité carbone soit bonne pour la croissance ». Le processus est assez simple : 1) comme la décarbonation implique une obsolescence accélérée d’une partie du stock de capital existant, l’offre sera réduite; 2) dans l’intervalle, il faudra investir davantage. La question qui se pose alors est la suivante: y a-t-il suffisamment de ressources dans l’économie pour permettre un accroissement des investissements parallèlement à une offre affaiblie ? La réponse dépend de la quantité de ressources inutilisées dans l’économie, c’est-à-dire de capacités de production inutilisées et du chômage. Mais compte tenu de l’ampleur de l’ajustement et de la brièveté du délai, cela ne peut être considéré comme acquis. Selon Jean Pisani-Ferry, « l’impact sur la croissance serait ambigu, l’impact sur la consommation devrait être négatif. L’action pour le climat est comme une montée en puissance militaire face à une menace : bonne pour le bien-être à long terme, mais mauvaise pour la satisfaction du consommateur. » Le transfert de ressources de la consommation vers l’investissement signifie que les consommateurs supporteront inévitablement le coût de l’effort.
En dépit de sa perspective néo-keynésienne, Pisani-Ferry ouvre une discussion éclairante sur les conditions politiques qui permettraient une réduction du niveau de vie et une lutte des classes verte menée en fonction des revenus. Pourtant, de par son attachement au mécanisme des prix, son argumentation, comme celle de l’ajustement du marché, repose de manière irrationnelle sur l’efficacité de la réduction des émissions de CO2. Le deuxième défaut de la contribution de Gollier et Reguant devient apparent lorsqu’ils appellent à « une combinaison d’actions climatiques dont le coût par tonne d’équivalent CO2 non émise soit le moins élevé́ possible ». En effet, comme les auteurs le reconnaissent eux-mêmes, la fixation du prix du carbone est très incertaine. Les évaluations peuvent aller de 45 à 14 300 dollars par tonne, selon l’horizon temporel et la réduction visée. Avec une telle variabilité, il est inutile d’essayer d’optimiser le coût de la réduction du carbone de manière intertemporelle. Ce qui importe n’est pas le coût de l’ajustement, mais plutôt la certitude que la stabilisation du climat aura lieu.
Pourquoi la planification est indispensable
Dans un travail sur les spécificités du modèle japonais d’Etat développeur (c’est-à-dire étant à l’origine du développement économique, ndlr), le politologue Chalmers Johnson fait une distinction qui pourrait également être appliquée au débat sur la transition écologique. Selon lui, « un Etat régulateur – ou rationnel par rapport au marché – se préoccupe de la forme et des procédures – les règles, si vous voulez – de la concurrence économique, mais il ne se préoccupe pas des questions de fond […] Au contraire, l’Etat développeur – rationnel par rapport au plan – a pour caractéristique dominante de fixer précisément de tels objectifs sociaux et économiques de fond. »
En d’autres termes, alors que la première vise l’efficience – en faisant l’usage le plus économique des ressources – la seconde s’intéresse à l’efficacité, c’est-à-dire à la capacité d’atteindre un objectif donné, qu’il s’agisse de la guerre ou de l’industrialisation. Etant donné la menace existentielle que représente le changement climatique et le fait qu’il existe une mesure simple et stable pour limiter notre exposition, nous devrions nous préoccuper de l’efficacité de la réduction des gaz à effet de serre plutôt que de l’efficience économique de l’effort. Au lieu d’utiliser le mécanisme des prix pour laisser le marché décider où l’effort doit porter, il est infiniment plus simple d’additionner les objectifs aux niveaux sectoriel et géographique, et de prévoir un plan de réduction cohérent pour garantir que l’objectif global sera atteint à temps.
Au lieu d’utiliser le mécanisme des prix pour laisser le marché décider où l’effort doit porter, il est infiniment plus simple d’additionner les objectifs aux niveaux sectoriel et géographique, et de prévoir un plan de réduction cohérent pour garantir que l’objectif global sera atteint à temps.
Ruchir Sharma, de Morgan Stanley, aborde cette question dans le Financial Times du 2 août 2021 et soulève un point qui plaide indirectement en faveur de la planification écologique. Il note que la poussée d’investissement nécessaire à la transition vers une économie bas carbone nous pose un problème matériel trivial : d’une part, les activités polluantes – en particulier dans les secteurs de l’exploitation minière ou de la production de métaux – ne sont plus rentables en raison de la réglementation accrue ou de la hausse des prix du carbone; d’autre part, l’investissement dans le verdissement des infrastructures nécessite de telles ressources pour accroître les capacités. La diminution de l’offre et l’augmentation de la demande sont donc la recette de ce qu’il appelle la « greenflation ». Ruchir Sharma affirme donc que « bloquer les nouvelles mines et les plates-formes pétrolières ne sera pas toujours la décision la plus responsable sur le plan environnemental et social ».
En tant que porte-parole d’une institution ayant un intérêt direct dans les matières premières polluantes, Sharma est loin d’être neutre. Mais le problème qu’il présente – comment fournir suffisamment de matières polluantes pour construire une économie à énergie propre ? – est réel et renvoie à un autre problème lié à une hypothétique transition axée sur le marché : la tarification du carbone ne permet pas à la société de faire la distinction entre les utilisations fallacieuses du carbone – comme envoyer des milliardaires dans l’espace – et les utilisations vitales comme la construction de l’infrastructure d’une économie bas carbone. Dans le cadre d’une transition réussie, le premier usage serait rendu impossible et le second serait aussi bon marché que possible. En tant que tel, un prix unique du carbone devient une voie évidente vers l’échec.
Contre le marché, le socialisme
Cela nous renvoie à un argument ancien mais toujours décisif : la reconstruction d’une économie – dans ce cas, une économie qui élimine progressivement les combustibles fossiles – nécessite la restructuration de la chaîne de relations entre ses divers segments, ce qui suggère que le sort de l’économie dans son ensemble dépend de son point de moindre résistance. Comme l’a noté Alexandre Bogdanov dans le contexte de la construction du jeune Etat soviétique, « en raison de ces relations interdépendantes, le processus d’expansion de l’économie est soumis dans son intégralité à la loi du point le plus faible ». Cette ligne de pensée a été développée plus tard par Wassily Leontief dans ses contributions à l’analyse des entrées-sorties (input-ouput). Il soutient que les ajustements du marché ne sont tout simplement pas à la hauteur de la transformation structurelle. Dans de telles situations, ce qu’il faut, c’est un mécanisme de planification prudent et adaptatif capable d’identifier et de traiter un paysage mouvant de goulets d’étranglement.
Avec sa préoccupation de longue date pour la planification et la consommation socialisée, le socialisme international est une piste évidente pour assumer cette tâche historique.
Lorsque l’on considère les défis économiques que représente la restructuration des économies pour maintenir les émissions de carbone en phase avec la stabilisation du climat, cette discussion prend une nouvelle tournure. L’efficacité doit primer sur l’efficience économique dans la réduction des émissions. Cela signifie qu’il faut abandonner le fétichisme du mécanisme des prix pour planifier la manière dont les ressources polluantes restantes seront utilisées au service d’infrastructures propres. Cette planification doit avoir une portée internationale, car les plus grandes possibilités de décarbonation de l’approvisionnement en énergie se trouvent dans le Sud. En outre, comme la transformation du côté de l’offre ne suffira pas, des transformations du côté de la demande seront également essentielles pour rester dans les limites planétaires. Les besoins en énergie pour assurer un niveau de vie décent à la population mondiale peuvent être réduits de manière drastique, mais outre l’utilisation des technologies disponibles les plus efficaces, cela implique une transformation radicale des modes de consommation, y compris des procédures politiques pour établir des priorités entre des demandes de consommation concurrentes.
Avec sa préoccupation de longue date pour la planification et la consommation socialisée, le socialisme international est une piste évidente pour assumer cette tâche historique. Bien que l’état médiocre des courants socialistes n’incite guère à l’optimisme, la conjoncture catastrophique dans laquelle nous entrons – ainsi que la volatilité des prix et les spasmes continus des crises capitalistes – pourrait accroître le caractère mouvant de la situation. Dans de telles circonstances, la gauche doit être suffisamment flexible pour saisir toute opportunité politique qui fera avancer la voie d’une transition écologique démocratique.
Note : ce texte a également été republié en français par le magazine Contretemps.


















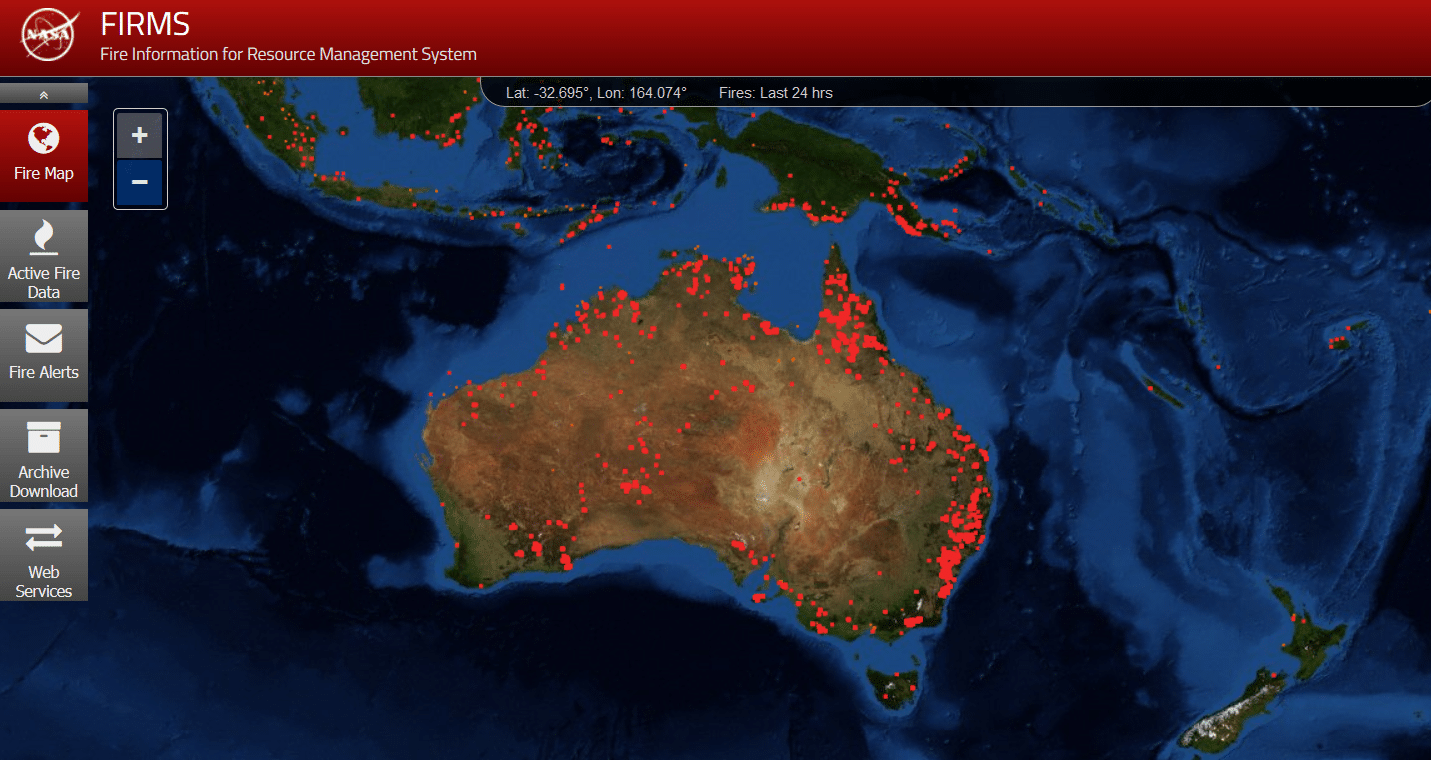
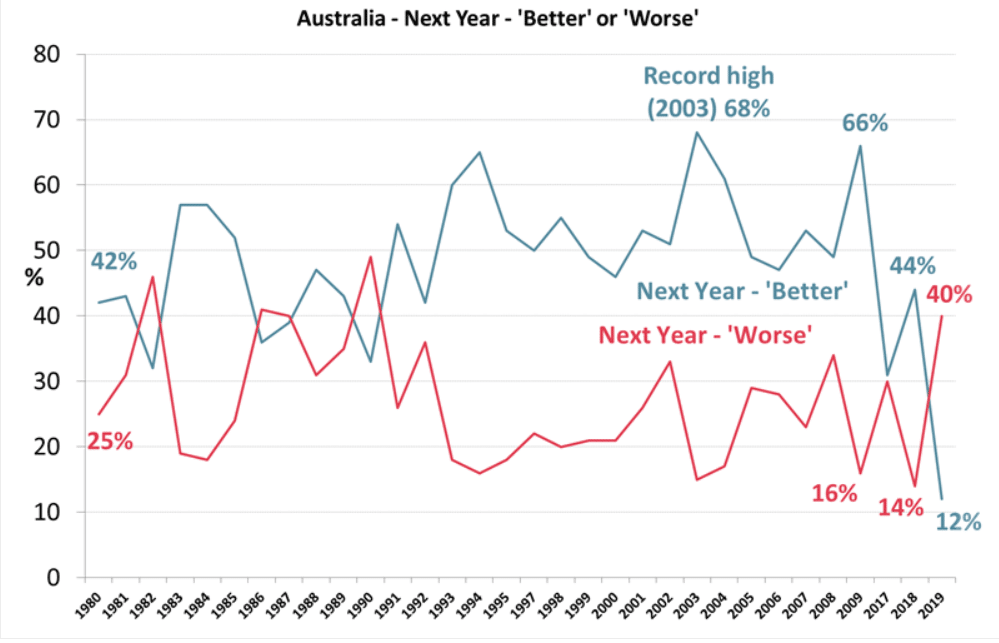








 ntiment envers l’arrivée des réfugiés lorsqu’ils ne sont pas placés dans des centres de rétention en Papouasie ou à Nauru, dans des conditions exécrables qui ont déjà valu à l’Australie de nombreuses condamnations par les ONG.
ntiment envers l’arrivée des réfugiés lorsqu’ils ne sont pas placés dans des centres de rétention en Papouasie ou à Nauru, dans des conditions exécrables qui ont déjà valu à l’Australie de nombreuses condamnations par les ONG.

