Dans leur dernier ouvrage, La dette, une solution face à la crise planétaire ? (Éditions de l’Aube – Fondation Jean-Jaurès), Michael Vincent et Dorian Simon reviennent sur certains grands mécanismes économiques (création monétaire, régulation bancaire, collatéralisation des dettes…) afin de comprendre les marges de manoeuvres dont disposent les États pour réorienter leurs politiques budgétaires. À l’inverse des ritournelles néolibérales, prêtes à refermer la parenthèse du « quoiqu’il en coûte » au nom de la rigueur, les auteurs démontrent combien les dettes publiques sont les rouages indispensables des marchés financiers, en quête d’actifs sûrs. De quoi relativiser les chiffres qui pleuvent par milliards dans les déclarations ministérielles et transformer les dépenses conjoncturelles en dépenses structurelles. C’est à ce prix que pourra se préparer un avenir écologique. Extraits.
Pourquoi prétendre à une politique monétaire neutre alors que les marchés ne le sont pas : ils consacrent la logique extractive, de domination, de compétition et de recherche du profit à court terme au détriment de la prospérité. Ce sont ces marchés qui soutiennent les hydrocarbures, faisant fi des limites du vivant et des ressources, faisant fi des inégalités, faisant fi des régimes politiques et des motivations, ou de l’usage de ces profits. La guerre lancée par Poutine début 2022 nous en offre une illustration macabre.
(…) Puisque la monnaie est un moyen, pas une fin, puisque c’est un outil, de plus en plus utilisé pour tenter de sortir des crises avec plus ou moins de succès par ailleurs, pourquoi ne pas orienter la politique monétaire, voire la monnaie elle-même, vers l’une des plus grosses crises qui nous menacent : la crise climatique ? La stabilité financière, ou celle des prix, l’économie en général ne sont que peu de chose face au défi climatique et aux risques imbriqués, qui vont évidemment peser lourdement. Surtout, si la monnaie peut faire beaucoup pour financer la transition écologique afin d’anticiper ces crises, elle ne pourra pas grand-chose pour jouer les pompiers lorsque la trajectoire climatique aura atteint le point irréversible du non-retour. Et si la monnaie doit réellement être « neutre », nous proposons qu’elle s’attelle à atteindre avant tout la neutralité carbone.
« Et si la monnaie doit réellement être « neutre », nous proposons qu’elle s’attelle à atteindre avant tout la neutralité carbone. »
La démocratisation de la politique monétaire est aussi une piste pertinente. Que diraient les citoyens s’ils étaient consultés? C’est notamment l’objectif d’une initiative menée par les ONGs en 2021 sous le nom de la Banque citoyenne européenne, une sorte de convention citoyenne de la politique monétaire organisée en phases de dialogues et d’ateliers avec des experts de tous bords, dont des institutionnels, puis de consultations et d’élaboration de propositions pour la monnaie. Sans détailler ici toutes les propositions auxquelles nous renvoyons à la sagacité du lecteur curieux d’en savoir plus, il est intéressant d’observer que les propositions émises par les citoyens ont toutes en commun les deux fils rouges suivants : la non-neutralité de la monnaie, qui est un outil qu’il faut mettre au profit d’une fin démocratiquement décidée ; et l’urgence climatique, alimentée par le business as usual, qui nécessite de financer la transition, en orientant les flux financiers ou en ajoutant au mandat de la BCE un principe de non-nuisance, par exemple par l’instauration d’une interdiction de financer toute activité polluante ou écocide.
Une nouvelle donne monétaire ?
Est-ce que la nouvelle donne monétaire est transitoire ou bien permanente ? La question se pose puisque la FED a déjà commencé ce que l’on appelle le « tapering », c’est-à-dire la fermeture du robinet du rachat de dettes. La BCE également, qui, si elle respecte ses annonces à l’heure où nous rédigeons ce livre, devrait stopper les rachats à l’heure où vous le lirez. Des signes montrent que la fenêtre d’opportunités pourrait se refermer face à l’inflation. C’est vrai, les taux montent et la France emprunte à des taux un peu moins farfelus que les taux négatifs, mais des taux pas inintéressants pour autant. Et comme souvent en finance, il faut regarder les choses de manière relative : le taux réel, c’est-à-dire la différence entre les taux d’emprunt et l’inflation, est par la force des choses très compétitif, encore plus que lorsque l’inflation était basse ! Cette normalisation des taux n’est pas forcément négative : elle va aussi dégonfler un peu la bulle des marchés puisqu’il existe une dualité entre le prix des actifs et le marché du travail, et forcer le capital à s’investir plutôt qu’à se placer est indispensable pour améliorer les conditions des travailleurs.
Cela ne doit pas empêcher de regarder le problème inflationniste pour ce qu’il est : il est avant tout dû aux pressions géopolitiques et énergétiques. La montée des prix est expliquée en majeure partie par le coût de l’énergie carbonée. Autant de raisons de penser économie circulaire et locale, et transition énergétique, pour la contenir comme il se doit. Pour se prémunir de la montée des prix, il faut enclencher une transition écologique et de justice sociale, avec en tête une politique énergétique ambitieuse et renouvelable ainsi qu’un investissement massif dans la recherche et l’innovation, et ce avant que ces coûts primaires ne s’étendent durablement cela a déjà démarré à l’alimentation, aux biens et aux services, tous tributaires de la montée des prix de l’énergie et des tensions géopolitiques.
Si la remontée des taux se matérialise au point de ne plus être tenable, il faudra enfin regarder en face les effets des dépenses de rattrapage des dernières années, et du côté de celles et ceux qui en ont profité. Les chiffres de l’augmentation des patrimoines des plus riches, des records de dividendes, des salaires des grands patrons et des bénéfices du CAC 40 donnent de bons indices, et appellent à la mise en place d’une justice fiscale. Dans le cas contraire, le coût de cette dette reviendrait, une fois encore, à permettre aux plus riches et aux plus puissants de s’enrichir, tout en socialisant les pertes. À l’aune également du défi climatique et de la corrélation directe entre niveau de revenu et empreinte carbone, il n’est pas seulement question de justice fiscale et sociale, mais aussi de justice climatique.
« Pour se prémunir de la montée des prix, il faut enclencher une transition écologique et de justice sociale, avec en tête une politique énergétique ambitieuse. »
Il reste encore aujourd’hui une opportunité importante aux États de la zone euro notamment, et pour la France en particulier, pour emprunter et anticiper l’avenir. Le besoin structurel de safe assets [ndlr : « actifs sûrs », parmi lesquels figurent les titres de dette publique]pour le marché reste bien réel. Cette opportunité a déjà été partiellement exploitée pour financer la politique du « quoi qu’il en coûte », mais elle ne doit pas nous empêcher de penser à la qualité des dépenses sous-jacentes. Si elle a permis de compenser les pertes liées à la conjoncture sanitaire, ou les hausses de prix du pétrole, elle n’a en rien aidé à préparer l’avenir face aux défis, notamment climatiques et sociaux, au risque de les amplifier plus tard puisqu’en se plaçant en porte-à-faux avec les limites planétaires et climatiques. Il faut dépasser la réaction et entrer dans l’anticipation, pour ne pas gâcher cette opportunité budgétaire unique.
Définanciariser la monnaie
Il est enfin nécessaire de repenser la monnaie pour sortir de ce cercle risqué, sinon vicieux, de manière structurelle, et aussi pour pouvoir mieux réglementer le shadow banking et l’intermédiation pour définanciariser la monnaie. Il est évident que, si nous ne le faisons pas, la finance, comme la nature, ayant horreur du vide, l’industrie regardera d’elle-même les alternatives au safe asset pour l’intermédiation via la blockchain, risquant alors de priver les États des marges qu’ils ont aujourd’hui. Mais un tel démantèlement ne se fera pas en un jour, il n’y a d’ailleurs malheureusement que peu d’appétit apparent pour sortir de ce statu quo néolibéral ; mais s’il doit s’enclencher c’est bien dans cet ordre-là. Si nous ne sommes pas fondamentalement contre l’idée d’une annulation partielle de la dette, ou contre l’idée d’une monnaie libre de dette, nous alertons en revanche sur les risques de ces « options » tant que la monnaie reste autant financiarisée, et tant que la tuyauterie de la finance, de l’intermédiation, du shadow banking, de l’eurodollar, de la collatéralisation, fonctionnera ainsi. En effet, dans le système actuel, ces options vont conduire à chahuter la stabilité financière, et nous savons très bien qu’aux mêmes maux seront opposées les mêmes solutions : c’est-à-dire le « quoi qu’il en coûte » du pompier, qui va une fois encore nous enfermer dans la spirale que nous ne connaissons que trop bien depuis plusieurs décennies : des crises qui augmentent en fréquence et en intensité, et des dépenses de rattrapages plutôt que structurelles, qui font le lit de la prochaine.
Nous encourageons donc plutôt les gouvernements à profiter au maximum des marges de manœuvre budgétaires offertes par la conjonction de la suspension des règles budgétaires et de la dette attractive, pour pouvoir ensuite enclencher cette définanciarisation, cette nécessaire relocalisation de nos économies, de la prise en compte des limites planétaires, y compris dans la monnaie. Reconnaître que la neutralité de la monnaie n’existe pas, puisque la politique monétaire a été utilisée à escient pour maintenir les marchés et le statu quo. À l’occasion de la pandémie, beaucoup, certains même avant, se sont demandés si leur métier avait du sens. Si leurs entreprises créent des solutions pour répondre à des problèmes, ou si elles créent des solutions parce qu’il y a des entreprises à faire tourner ? Pour la monnaie, c’est la même chose : il faut y remettre du sens.
« Une refondation de notre système monétaire ne passera que par une refondation de notre modèle de société. »
La pénurie de safe assets n’est que le symptôme d’une défaillance globale des institutions. Notre crise est une crise de confiance. La confiance en la monnaie n’est que le côté pile de la confiance envers la politique. Une refondation de notre système monétaire ne passera que par une refondation de notre modèle de société. Mais après tout, peut-être que la solution est à l’intérieur du problème. La financiarisation de la monnaie est peut-être l’opportunité de démocratiser la création monétaire, autrefois monopole des États, puis des banques, maintenant accessible à des non-banks. La tâche qui nous incombe est de repenser notre architecture monétaire, afin de financer les activités non rentables, mais socialement utiles et responsables face aux limites de la Terre et du vivant. Sortir à terme du « tout finance » car il y a des investissements indispensables pour notre survie et une trajectoire climatique soutenable qui ne seront jamais « rentables » au sens de l’Ancien Monde. La plomberie financière actuelle nous en offre la possibilité, il ne nous reste qu’à en redéfinir les contours en fonction des contraintes de notre époque.



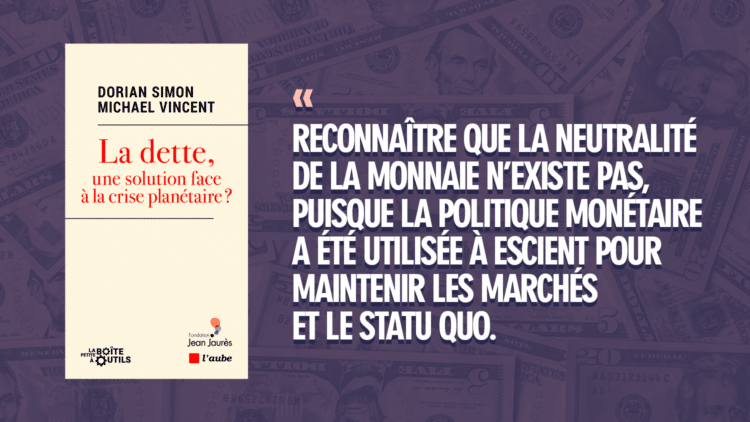

















 Benjamin Lemoine est un sociologue qui s’intéresse aux questions d’économie et notamment de dette publique. Dans son livre L’ordre de la dette, il s’attache à faire une socio-histoire de la mise en marché de la dette publique française.
Benjamin Lemoine est un sociologue qui s’intéresse aux questions d’économie et notamment de dette publique. Dans son livre L’ordre de la dette, il s’attache à faire une socio-histoire de la mise en marché de la dette publique française.

