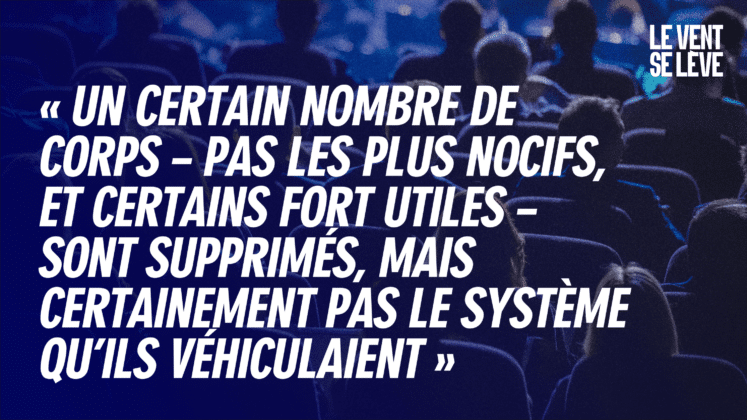La polémique autour du limogeage de la préfète d’Indre-et-Loire n’est que la face émergée de l’iceberg. Depuis le début du deuxième mandat Macron, les préfets, garants de la continuité de l’Etat, sont de plus en plus nommés selon des critères politiques. Rotation massive, notation, sélection de profils plus politiques, fin du concours : différents signaux témoignent d’une reprise en main de la fonction préfectorale. Au risque de menacer l’immuable neutralité de l’État.
Une préfète doit-elle choisir entre le respect de l’Etat de droit et la volonté des élus locaux ? C’est le dilemme qui a coûté sa place à Marie Lajus. La préfère d’Indre-et-Loire a en effet été relevée de ses fonctions et non uniquement mutée comme cela est traditionnellement le cas. Selon le Canard enchaîné, cette décision est la conséquence directe de l’insatisfaction d’élus locaux de droite, mécontents de plusieurs décisions de la préfète. Fait inédit dans la Ve République, cette dernière a fait l’objet d’une pétition de soutien d’élus, y compris de son précédent département. Comment interpréter une telle décision ?
La préfète semble avoir payé principalement son refus de céder aux exigences du maire de Reugny – près de Tours – et de l’entrepreneur Xavier Aubry. Ces derniers souhaitaient construire un bâtiment futuriste hébergeant un incubateur de start-ups en rasant partiellement un bois sur le domaine d’un site classé. Atteinte à l’environnement, menace d’un bâtiment historique : tous les ingrédients étaient réunis pour un tel refus. Las, la pression des élus locaux classés à droite a eu raison de son affectation. Outre l’appétence des macronistes pour la start-up nation, la volonté de Renaissance d’attirer des élus issus de la droite traditionnelle pour renforcer ses assises locales a sans doute également joué. Enfin, bien qu’il affirme qu’il ne s’agit pas d’une décision politique, le ministre de l’Intérieur apparaît comme l’un des candidats à la succession d’Emmanuel Macron en 2027, et est donc soucieux de s’attirer les faveurs et les précieuses signatures des élus locaux.
Le relèvement de la préfète d’Indre-et-Loire est symptomatique d’une reprise en main politique du corps préfectoral, un symbole de notre histoire administrative.
Cet épisode est symptomatique d’un mouvement plus large dans l’administration préfectorale. Observé sur l’ensemble du territoire, il traduit une reprise en main politique de cette fonction qui, depuis sa création par Napoléon en 1800, relève tout à la fois d’une dimension administrative et politique. À l’époque, le préfet dispose de pouvoirs étendus de sorte à accompagne le déploiement du nouveau régime sur tout le territoire. Depuis, en représentant de l’État dans chaque département, le préfet est à la fois la courroie de transmission de l’action gouvernementale et le garant du bon fonctionnement de l’administration. Aussi, il s’agit du seul fonctionnaire dont les missions sont définies dans la Constitution.
La fin de la spécificité de la préfectorale
Rompant avec cette longue tradition, le pouvoir actuel a décidé de mettre fin à la spécificité de la fonction préfectorale. Depuis le 1er janvier 2023, cette fonction n’est plus l’apanage des seules personnes disposant de ce statut, et nommées en conseil des ministres. En l’espèce, les effectifs de la fonction préfectorale avaient déjà diminué ces dernières années. Par ailleurs, les fonctionnaires ne pourront plus à terme plus occuper une fonction préfectorale plus de 9 ans, afin d’encourager le renouvellement des préfets. Des changements qui s’inscrivent dans une réforme plus large de la haute fonction publique, qui a notamment abouti à la suppression de l’ENA et de certains « grand corps », non sans susciter des oppositions, comme cela a récemment été le cas lors d’une grève rarissime au Quai d’Orsay.
Derrière le symbole – la mise en cause d’un corps constitué – et le souhait d’ouverture, des menaces se drapent. D’abord, cette réforme risque d’entraîner une perte de compétence des futurs préfets si le gouvernement sélectionne des profils peu rompus aux logiques de fonctionnement de l’Etat. Or, cette fonction revêt à la fois une dimension technique et de gestion politique forte, raison pour laquelle un concours spécifique était nécessaire pour l’exercer. De plus, la fin de l’esprit de corps et de la garantie d’être nommé quelque part conduit à une dépendance totale des préfets à l’égard du pouvoir, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Les préfets seront moins des traits d’union entre les départements et le pouvoir central, mais plutôt des agents d’exécution. Enfin, tenus par le besoin de quitter leur fonction au terme des neuf ans, ils seront incités à servir le pouvoir pour préparer leur reconversion. Là où jusqu’à présent, des préfets « indépendants » prenaient uniquement le risque d’une mauvaise affectation, dans un département jugé moins prestigieux.
Suppression de leur spécificité, notation, rotation : les préfets sont affaiblis par les réformes et leur neutralité gravement menacée.
Cette reprise en main de la fonction préfectorale la fait donc basculer vers son pan le plus politique. En 2021, le gouvernement Castex avait déjà annoncé une refonte de l’évaluation des préfets. Leur notation reposera désormais sur la bonne mise en œuvre de réformes incontournables du gouvernement, telles que le plan France Relance. Ce système rend les préfets personnellement responsables de la réussite de la politique du gouvernement, sans prise en compte des moyens alloués. En outre, il traduit une défiance inédite à l’égard de la loyauté de ce corps de hauts fonctionnaires. Les résultats de cette évaluation ne sont en revanche pas publics.
Peut-être une conséquence de ce système, environ la moitié des préfets (47) a changé d’affectation depuis le 1er janvier 2022. Un mouvement de rotation inédit en l’absence d’alternance politique à l’Elysée ou à l’Assemblée nationale. Les nominations atteignent même les deux tiers du corps depuis 2021. Ceci signifie que les fonctionnaires en place ont eu peu de temps pour se familiariser avec leur territoire et se forger une légitimité propre, ce qui les rend encore plus dépendants du gouvernement en place.
Une fonction administrative de plus en plus politique
Certes, les profils choisis ont toujours reflété une certaine orientation politique. Par le passé, les préfets se repartissaient entre fonctionnaires plutôt marqués à droite ou plutôt classés à gauche. En fonction de leur passage dans les cabinets ministériels et de l’historique de leur promotion, une certaine tendance pouvait en effet être définie. Toutefois, la tradition voulait que, issus de la haute administration, ils préservent à l’extérieur leur neutralité. Ce principe a volé en éclat.
Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, un secrétaire d’État a ainsi retrouvé un poste de préfet. Cette illustration des passerelles entre monde politique et fonction préfectorale constitue un fait sans précédent, traduisant une politisation croissante de la fonction. De récentes nominations ont également entraîné des polémiques, comme celle de Marc Guillaume, ancien secrétaire général du gouvernement devenu préfet de Paris et celle de Régine Engström, préfète du Loiret, visée par une enquête pour prise illégale d’intérêts. L’apparent volonté d’ouverture et de modernisation de la fonction publique bénéficie donc en premier lieu à des proches du pouvoir.
Cette révision s’accompagne de nominations plus politiques. Les préfets doivent-ils servir l’intérêt général ou celui du pouvoir en place?
Si l’essentiel des contingents préfectoraux sont toujours issus de l’ENA (au moins 57 préfets), le souhait d’affaiblir la haute fonction publique, décrite par Emmanuel Macron comme l’incarnation d’un « État profond » ne doit duper personne. Derrière des accents populistes, il s’agit de resserrer le contrôle sur un rouage essentiel de la machine étatique. On rappellera ici que les préfets sont notamment en charge du maintien de l’ordre, devenu stratégique depuis les gilets jaunes. Cette mise en cause du principe de neutralité de l’administration vise donc à la fois une certaine mise au pas de l’Etat déconcentré et la satisfaction des intérêts politiques locaux.
Les préfets sont-ils en sursis ? Ceux que l’on a connu peut-être. Outre les conséquences potentielles sur la répression des mouvements sociaux, le choix de les transformer en agents du pouvoir présentent d’autres inconvénients. Tout d’abord, la dépendance au pouvoir central et la volonté de satisfaire tel ou tel élu local ouvre la porte à toutes sortes de pratiques à la limite de la légalité, comme le rappelle le cas de Marie Lajus. Cette politisation se traduit aussi par une judiciarisation des relations avec les élus locaux, qui s’observe notamment vis-à-vis des mairies marquées à gauche, comme celles de Poitiers ou de Strasbourg, dirigées par EELV. Enfin, l’indépendance des préfets permettait au pouvoir d’avoir une mesure fiable de l’état d’esprit dans les territoires. Les rapports préfectoraux, si précieux pour l’analyse historique, risquent de devenir de moins en moins objectifs, afin de flatter le pouvoir en vue d’une future promotion. In fine, cette évolution pourrait donc entraîner la renaissance d’un esprit de cour, à l’inverse du principe républicain en place depuis des décennies.