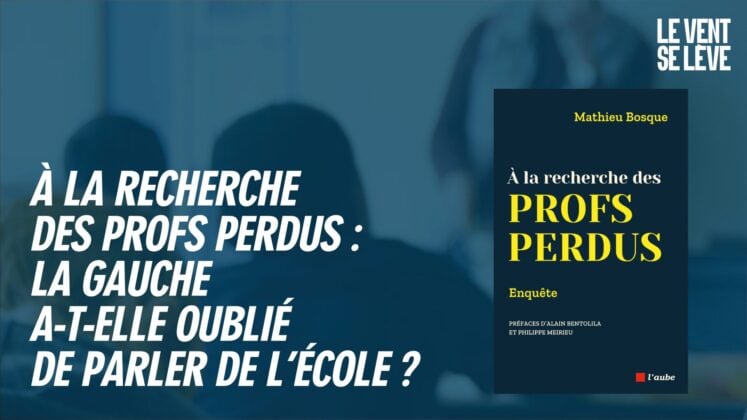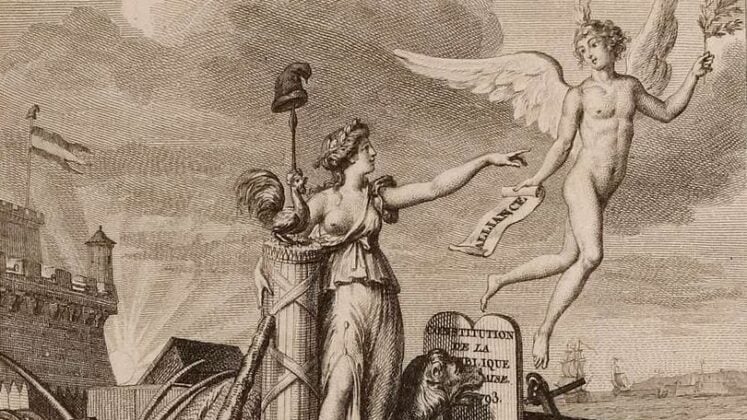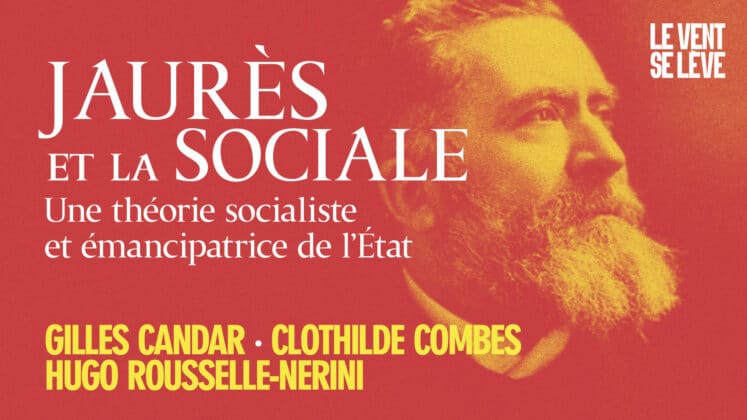Vivant à 75% d’argent public, l’enseignement privé reste extrêmement peu contrôlé. La polémique déclenchée par Amélie Oudéa-Castera sur le lycée Stanislas a entraîné un regain d’intérêt pour cette question aussi vieille que la République française. Au vu des atteintes à la laïcité longtemps ignorées et du séparatisme social grandissant que permet le secteur privé, une nouvelle réforme s’impose.
Le passage éclair d’Amélie Oudéa-Castera à la tête du ministère de l’Éducation nationale début 2024 a révélé un fossé profond entre l’école publique et l’école privée. À peine en fonction, la ministre a dû faire face aux révélations de Mediapart concernant la scolarisation de ses enfants en établissement privé, une information pour laquelle elle a rejeté implicitement la « faute » sur les enseignants du public, qui seraient trop souvent absents. Un commentaire qui a suscité une vague d’indignation, la plaçant en opposition directe avec les syndicats d’enseignants et une grande majorité des acteurs du secteur public.
La scolarisation de ses enfants au prestigieux lycée Stanislas a accentué les critiques, y compris au sein même de son camp, alors que nombre de macronistes sont eux-mêmes passés par l’enseignement privé. La maladresse de ces déclarations empreintes de mépris pour le travail des enseignants du public a ravivé le débat sur l’engagement des responsables politiques envers l’école publique, surtout dans un contexte où ses prédécesseurs, Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal, ont laissé derrière eux un bilan plus que mitigé. Depuis, le choix de Michel Barnier de nommer Anne Genetet, qui a a priori une plus grande appétence pour les questions de défense et de fiscalité, à la tête de l’Éducation nationale semble indiquer une faible priorité accordée à ce ministère qui rassemble pourtant le plus grand nombre de fonctionnaires. La question de l’avenir de l’école publique reste en suspens.
Un débat aussi vieux que la République
La question de l’existence et du degré d’autonomie de l’enseignement privé, très largement catholique, est presque aussi vieille que la République française elle-même. Sous la Seconde République, la loi Falloux de 1850 donne ainsi lieu à de vifs débats : si la liberté d’enseignement dans le primaire et le secondaire exigée par les curés est alors consacrée par le Parti de l’Ordre, la gauche, ainsi que l’écrivain Victor Hugo s’y opposent de manière véhémente, y voyant un endoctrinement religieux. Mis en sourdine sous le Second Empire, le débat resurgit dès le début de la Troisième République : dès 1879, l’État crée des Ecoles normales pour former des enseignants laïques, avant de rendre l’école gratuite, laïque et obligatoire avec les lois Ferry (1881-1882) et écarte progressivement les religieux de l’enseignement public à travers une loi de 1886. Après la loi de séparation de l’Eglise et de l’État en 1905, le clergé revient à la charge et ouvre une période de « guerre scolaire » qui durera jusqu’en 1914.
Après un fort soutien du régime de Vichy aux établissements privés catholiques, la Quatrième République suspend le financement public de l’enseignement privé, mais le clivage gauche/droite sur cette question demeure toujours vif. Finalement, face à l’afflux d’élèves et à l’incapacité de l’État d’intégrer tout le monde dans le système public, le Premier Ministre Michel Debré, qui assure alors également l’intérim du ministère de l’Éducation nationale, tranche le débat par une loi de compromis fin 1959.
Ce qui devait être une solution temporaire s’est inscrit dans la durée, conduisant à un modèle de financement du privé par le public, qui s’est consolidé au fil des décennies.
Celle-ci restaure le financement public des écoles privées, mais à condition qu’elles acceptent tous les élèves et qu’elles enseignent le programme défini par l’État. Ce dernier prend ainsi en charge les salaires des enseignants et les frais de gestion des établissements sous contrat. Les établissements dits « hors contrat » peuvent eux continuer d’enseigner comme bon leur semble, mais sont exclus des financements publics. S’ils sont souvent médiatisés, ils ne scolarisent en réalité qu’une infime minorité des élèves en France (moins de 1 %). Ce qui devait être une solution temporaire s’est inscrit dans la durée, conduisant à un modèle de financement du privé par le public, qui s’est consolidé au fil des décennies et qui consacre le rôle du privé dans le paysage éducatif français.
Une perfusion d’argent public, presque aucun contrôle
La polémique déclenchée par Amélie Oudéa-Castera début 2024, comme d’autres auparavant, a au moins permis de rouvrir le débat sur les limites de ce système vieux de 65 ans. Le rapport d’information des députés Paul Vannier (LFI) et Christopher Weissberg (Renaissance) dévoile ainsi des données préoccupantes dans le financement public des établissements privés en France. Bénéficiant de plus de 10 milliards d’euros annuels d’argent public (dont 8,5 directement de l’Etat), le secteur privé vit à 75% des impôts des contribuables.
En plus de la part de dépenses financées par l’État, il existe des dépenses difficilement quantifiables en raison de la multiplicité des sources de financement, notamment en dehors du programme budgétaire officiel (programme 139). Il s’agit de subventions facultatives que les collectivités peuvent financer, pour des travaux, l’achat d’équipements informatiques, des aides sociales. Comme le révèle Mediapart, ce sont au moins 1,2 milliard d’euros de fonds publics (entre 2016 et 2023) qui ont été versés par les régions aux lycées privés, en plus de leurs obligations légales. Les financements octroyés par les collectivités territoriales échappent largement à un suivi centralisé car ils ne sont pas compilés par la Direction générale des collectivités locales. Cette opacité budgétaire compromet, selon les auteurs du rapport, les principes de transparence et de rigueur financière, entraînant une probable sous-estimation des fonds publics versés au privé.
Le suivi des établissements privés sous contrat est jugé largement insuffisant, avec une fréquence estimée à une fois tous les 1500 ans, alors que le public est 10 fois plus contrôlé.
Les révélations du rapport sont également alarmantes concernant les mécanismes de contrôle des établissements privés. La quasi absence de contrôles pédagogiques, administratifs et budgétaires de ces établissements suscite des questions sur l’équité et la responsabilité des politiques publiques. Le suivi des établissements privés sous contrat est jugé largement insuffisant, avec une fréquence estimée à une fois tous les 1500 ans, alors que le public est 10 fois plus contrôlé. Un élément qui poussent les rapporteurs à conclure que « les contreparties exigées des établissements privés sont également loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation. »
Dérives pédagogiques et atteintes à la laïcité
Cette absence de contrôle pédagogique des écoles privées sous contrat suscite des interrogations croissantes, notamment pour les établissements à caractère religieux, dont 96 % sont catholiques. Ces établissements, tenus par la loi Debré de respecter les programmes de l’Éducation nationale et de garantir un accueil sans distinction d’origine, de croyance et d’opinion, semblent cependant parfois dévier de ces obligations. Une enquête récente de Libération a révélé des atteintes à la laïcité, avec des pratiques et des décisions en contradiction avec leurs engagements contractuels. Des témoignages d’enseignants et de spécialistes du sujet soulignent des cas de « re-catholicisation » de certains établissements. Ismail Ferhat, professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris-Nanterre, relève ainsi l’arrivée de directeurs plus engagés religieusement, souvent placés par des responsables de l’Église, et poussant des initiatives qui favorisent une influence catholique accrue dans l’enseignement.
Parmi les exemples rapportés figurent des refus d’intervention du planning familial en raison de ses positions en faveur de l’avortement et la contraception à Pau, ou l’organisation de cours de catéchèse assurés par des professeurs durant leurs heures de travail en Auvergne, donc financés par des fonds publics. Certaines écoles imposent même des messes obligatoires et des journées spéciales pour célébrer les saints patrons de l’établissement. Les témoignages recueillis par les journalistes de Libération viennent de sources anonymes, de Bretagne, d’Occitanie, de Paca, de Savoie, etc, soulignant le fait que ce phénomène touche tout autant les villes que les campagnes de toute la France. Ces pratiques remettent en cause les principes de laïcité et de neutralité auxquels l’école française est pourtant tenue. Les inspecteurs de l’Éducation nationale semblent préférer fermer les yeux sur ce sujet, ou ne pas s’en mêler en raison du caractère privé de l’établissement.
À la suite de cette enquête et de protestations de plusieurs syndicats en septembre 2024, le directeur de l’ensemble scolaire Immaculée Conception Beau Frêne de Pau est suspendu par le rectorat pour « atteintes à la laïcité ». Des pratiques mises en place dans cette école incluaient « des cours de catéchisme obligatoires et évalués, des censures d’ouvrages, des intervenants réactionnaires ou des entraves à la liberté de conscience ». Une décision qui s’imposait, mais qui donne l’impression de n’être que la face émergée de l’iceberg.
Deux écoles pour deux classes sociales
Au-delà d’une application encore insuffisante de la laïcité, l’enseignement privé pose un véritable problème de concurrence avec le public, au détriment de ce dernier. La controverse autour des propos d’Amélie Oudéa-Castera, qui a qualifié l’école publique d’incompétente en pointant notamment l’absentéisme des professeurs, a révélé une sorte de mépris de classe. La ministre, qui scolarise ses enfants dans le privé, avait justifié son choix en évoquant son souhait de les voir « heureux, épanouis, qu’ils [aient] des amis, qu’ils [soient] bien, qu’ils se sentent en sécurité, en confiance », induisant de fait que l’école publique n’assurerait en rien le bien-être de l’enfant. Des déclarations jugées « lunaires et provocatrices » par les syndicats d’enseignants qui y voient une attaque injustifiée et méprisante contre le service public et l’Éducation nationale. En réponse, les enseignants concernés ont précisé qu’il n’y avait aucun problème d’absentéisme dans l’établissement, et que la ministre cherchait surtout à faire sauter une classe à son fils en maternelle. Si les propos de la ministre ont pu choquer, ils sont pourtant partagés par nombre de Français, qui voient dans le privé un enseignement de meilleure qualité que dans le public.
Cette affaire met en lumière une perception de plus en plus marquée d’un « embourgeoisement » de l’école privée, décrite par les sociologues Stéphane Bonnéry et Pierre Merle dans la revue La Pensée. Selon eux, l’école privée bénéficie depuis une vingtaine d’années de mesures favorables qui contribuent à en faire un choix prisé par certaines élites, renforçant ainsi un sentiment de classe. Un effet de resserrement se crée par l’homogénéisation sociale des établissements. « Les collèges publics pauvres sont encore plus pauvres, […] le collège privé favorisé est encore plus favorisé. » Stéphane Bonnéry précise, en comparant avec un système éducatif allemand dont les constats et résultats sont similaires, que contrairement à nos voisins qui favorisent la mixité dans les établissements afin d’amoindrir les resserrements sociaux, nous faisons en France l’exact contraire. Les résultats scolaires s’en font par conséquent ressentir. Le taux de réussite au bac est de 98 % dans le privé contre 94 % dans le public (données du ministère de l’Éducation nationale pour 2022).
Là où le public a perdu 56.000 enseignants en vingt ans (- 7 %), le privé en a perdu seulement 3.800 (- 2,6 %). Le nombre d’élèves du public ayant baissé de plus de 200.000 élèves, le privé en gagne quant à lui 100.000. Les écoles privées ont donc eu la capacité de choisir leurs « clients » ce qui entraîne une « élitisation » des élèves. En 2011, les élèves du privé étaient à 35,9 % issus d’un milieu « très favorisé » et 14,4 % d’un milieu « favorisé ». En 2022, ces mêmes données sont passées à 42,5 % et 15,6 %. Au contraire, les élèves de la classe « moyenne » et « défavorisée » ont respectivement baissé de 29,9 % en 2011 à 26,5 % en 2022 et de 20 % à 15,7 %. Ainsi, les écoles privées qui sont de plus en plus dépendantes de l’argent public, créent une alternative en faveur d’une société plus fortunée, un entre-soi de plus en plus clair. Cela touche particulièrement les responsables ou élus politiques. Par exemple, les ministres de l’Éducation nationale qui se sont succédé ont pratiquement tous eu au moins un enfant scolarisé dans le privé. C’est général à la classe politique et particulièrement visible en Île-de-France, et ce, de la gauche jusqu’à la droite la plus extrême.
Les écoles privées ont la capacité de choisir leurs « clients », ce qui entraîne une « élitisation » des élèves.
Suite à la publication de l’indice de position sociale (IPS), une mesure du ministère de l’Éducation nationale pour évaluer le statut social des élèves à partir des professions et catégories sociales de leurs parents, la rupture entre privé et public est claire. En sélectionnant les 10 % de collèges à plus faible IPS, on ne compte que 3,3 % d’établissements privés. Au contraire, en sélectionnant les 10 % à plus haut IPS, c’est 60,9 % d’établissements privés. La question de l’égalité face à l’enseignement se pose : alors que tout le monde contribue, par l’impôt, à financer l’école privée, les classes les moins favorisées ont très peu de chance d’en bénéficier.
L’urgence d’une réforme de fond
L’État ne s’est finalement jamais pleinement engagé auprès de l’école publique en pérennisant une sorte de statu quo avec l’enseignement privé alors qu’il aurait pu absorber de plus en plus d’élèves en investissant dans le public ce qu’il donne au privé. Au contraire, il a laissé les mains libres au privé, amorçant un tri social des élèves tout en concentrant des financements avantageux. À la même heure, nombre d’établissements publics partent en désuétude comme le montraient les lycéens eux-mêmes sur les réseaux sociaux au début de l’année 2024, filmant des locaux aux plafonds effondrés ou sans chauffage.
Un amendement des députés insoumis adopté dans le budget 2025 prévoit de reporter 6 milliards d’euros du privé vers le public pour rendre gratuits les cantines, les transports et fournitures scolaires.
Ne serait-il pas temps d’abroger la loi Debré et de remettre l’école de la République au cœur de l’émancipation citoyenne ? Faut-il une mesure choc au point de déséquilibrer l’entièreté du système éducatif ? Les députés Insoumis – Nouveau Front Populaire ont eu le mérite d’avoir proposé un amendement – adopté – au Projet de Loi de Finance 2025 en reportant 6 milliards d’euros destinés à l’enseignement privé du premier et second degré vers le public, afin de rendre gratuits les cantines, les transports et fournitures scolaires. Si certains objecteront que, privé de cette somme, les établissements privés la répercuteront sur les tarifs facturés aux parents d’élèves, ces derniers auront toujours le choix de revenir vers le public…
Si la mesure a peu de chances d’être conservée après le passage du budget au Sénat et un probable usage de l’article 49.3 de la Constitution, elle propose néanmoins une piste pour trouver des financements éminemment nécessaires pour l’école publique, dans un contexte de disette budgétaire. Si l’option d’une suppression de l’école privée fait toujours peur à la gauche quarante ans après l’échec de la loi Savary en 1984, il ne fait aucun doute que le système actuel à deux vitesses ne peut pas perdure en l’état. A minima, un plus fort contrôle des pratiques du privé et un resserrement des financements publics pour les attribuer aux établissements qui en ont le plus besoin semble évident. Quant aux disparités sociales entre établissements, elles ne pourront être résorbées que par une contrainte forte imposée par l’État, voire une fin de l’école privée.