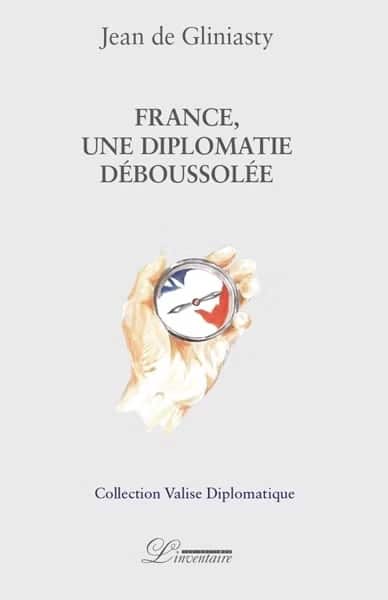« Europe puissance » : tel est le mot d’ordre dans les sphères dirigeantes du Vieux continent, à droite et à gauche, depuis la réélection de Donald Trump. Le 7 novembre 2024, Emmanuel Macron déclarait : « Le monde est peuplé d’herbivores et de carnivores. Si l’on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront ». Ou bien les Européens choisissent la voie de l’égoïsme national, ou bien ils font le pari d’une défense européenne suffisamment unie pour contrer les impérialismes américain, russe et chinois. Cette idée n’est pas neuve. Elle fut portée par les « pères fondateurs » de la construction européenne des décennies durant. Elle ne connut jamais un semblant de réalisation. Derrière la chimère d’une défense européenne, c’était une défense américaine qui était à l’ordre du jour.
Rêves continentaux, réalités nationales
Dans Regards sur le monde actuel, Paul Valéry déclare : « Les misérables Européens ont mieux aimé jouer aux Armagnacs et aux Bourguignons, que de prendre sur toute la terre le grand rôle que les Romains surent prendre et tenir pendant des siècles dans le monde de leur temps. L’Europe aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine. Toute sa politique s’y dirige ». Jean-Pierre Chevènement rapportera dans son livre, La France est-elle finie ?, un propos analogue du président Mitterrand : « Je ne pense pas qu’aujourd’hui la France puisse faire autre chose que passer à travers les gouttes ».
C’est par un lugubre mois d’octobre que sont nés à quarante-cinq années d’écart Paul Valéry et François Mitterrand. Lugubre pour le premier car en cette approche de la Toussaint, il ne s’agissait pas de commémorer les défunts mais de regretter amèrement que la France n’eût pas triomphé de la terrible guerre franco-prussienne de 1871 survenue quelques mois plutôt. Lugubre pour le second car c’est en octobre 1916 (l’année de Verdun) que sa mère lui infligea la vie. Paul Valéry et François Mitterrand, outre l’amour de la langue française, ont en commun d’être nés en plein milieu d’un grand traumatisme et d’avoir atteint la force de l’âge (43 ans en 1914 pour Valéry et 24 ans en 1940 pour Mitterrand) en plein déroulement d’un second. C’en était fini de la génération décrite par Alfred de Musset dans ses Confessions d’un enfant du siècle, avide de guerres napoléoniennes, du panache de la révolution et d’une France fière et victorieuse. Désormais, la patrie de 1789 connaissait l’horreur des tranchés puis de la collaboration, s’effondrant et entraînant avec elle toutes les autres nations d’Europe.
Ces deux témoignages sont riches d’enseignement sur les traumatismes de l’entre-deux-guerres, nés de la certitude que les nations étaient responsables des carnages, et que désormais la France seule ne compterait plus dans le jeu des grandes puissances. Ce choc accoucha, dans les années 1930, d’une vision du monde qui, par de nombreux aspects, contient les germes de la pensée européenne qui lui succédera après 1945. Car si l’Union Européenne puisé sa source dans l’oeuvre dé Robert Schumann et de Jean Monnet, il faut remonter à l’entre-deux guerres pour comprendre son insignifiance géopolitique. À lire Aristide Briand, Otto de Habsbourg-Lorraine ou Richard Coudenhove-Kalergi, ardents paneuropéens, un même paradigme lé droit et le « doux commerce » permettront de brider les États-nations. Intrinsèquement belliqueux, ceux-ci ne parlent que la langué de la force.
« L’Europe intégrée, ça ne pouvait pas convenir à la France, ni aux Français… Sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis » (le Général de Gaulle, cité par Alain Peyreffite)
En 1923, dans Paneuropa, le comte Richard Coudenhove-Kalergi, issue d’une grande famille d’aristocrates polyglottes, commente en ces termes l’emblème de l’union paneuropéenne qu’il appelle de ses voeux : « La croix rouge des croisades du Moyen Âge est le symbole le plus ancien d’une union européenne supranationale. Aujourd’hui, elle est l’emblème de l’humanitarisme international. Le soleil figure l’esprit européen dont le rayonnement éclaire le monde entier ». « Supranational » : le terme n’est pas lâché au hasard. Cette hostilité au principe de souveraineté des nations accompagne les premiers théoriciens d’une « union européenne ».
Ces idées ont acquis une certaine prééminence au sein des élites en raison de plusieurs événements historiques. D’abord, la boucherie de 1914-1918 et la popularité du « plus jamais ça » les imprègnent d’un pacifisme intra-européen. Ensuite, la révolution bolchevique d’octobre 1917 – et ses émules européennes – apparaît comme un traumatisme. Il devient urgent de souder un bloc occidental face au danger communiste. Otto de Habsbourg-Lorraine, fils aîné de Charles Ier, ira même jusqu’à discuter avec Frankin D. Roosevelt d’une confédération danubienne anticommuniste. Confronté au péril rouge, il devient urgent d’oublier ses intérêts nationaux.
Tandis que ces réflexions théoriques suivent leur cours, des mutations géopolitiques bien réelles surviennent, et notamment l’érosion de la puissance britannique, au profit de sa cousine nord-américaine. Celle-ci souhaite étendre son hégémonie sur le continent européen, et veille à ce qu’aucune super-puissance n’y soit trop dominante. C’est ainsi qu’un axe Berlin-Washington se développe dès l’entre-deux guerres, visant à affaiblir la France, grand vainqueur de la Première guerre. En 1923, le président français Poincarré est contraint de céder sur l’occupation par la France de la Ruhr, suite à la pression du secrétaire d’État américain Hughes. En 1927-1928, le Plan Young liquide définitivement les réparations de guerre de l’Allemagne. En 1938, le patronat américain se félicite des accords de Munich et craint une nouvelle guerre faite à l’Allemagne.
Longtemps, Washington a des yeux de Chimène pour Berlin et vice-versa. Scinder l’Allemagne de la Russie apparaît comme une priorité aux diplomates américains – cette crainte d’un Heartland géopolitiquement uni, théorisée par Harold Mackinder, sera reprise par Zbigniew Brzezinsky dans son Grand échiquier. Suite à la défaite de l’Allemagne nazie, les États-Unis peuvent reprendre leur lune de miel interrompue avec l’Allemagne – et pour de bon.
« The United States is a European Power »
Jean Monnet écrit dans ses Mémoires : « En 1944, j’étais parvenu à des conclusions qui n’ont cessé depuis de guider ma conduite. Il n’y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale, avec ce que cela entraîne de politique de prestige et de protection économique […] Cette prospérité et les développements sociaux indispensables supposent que les États d’Europe se forment en une fédération, ou une entité européenne. » Le 5 août 1943, à Alger, il notait déjà : « la paix ne renaîtra pas en Europe si les nations se reconstituent à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun ».
Citons encore cet ancien industriel qui fit sa fortune dans le Cognac, à la fin de ses Mémoires : « Ais-je assez fait comprendre que la communauté que nous créons n’a pas sa fin en elle-même ? Les nations souveraines du passé ne peuvent rester et devenir le cadre des problèmes du présent. La communauté elle-même que nous créons n’est qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain. » Une simple étape ? Le propos est clair : Jean Monnet n’a jamais souhaité que la Communauté européenne naissante devienne un État-nation. Aux nationalismes d’Europe, il ne voulait pas substituer un nationalisme continental. Il ne souhaite nullement qu’une Europe avec des intérêts propres et une géopolitique propre émerge ; et moins que tout face aux États-Unis.
Comme l’écrit le chercheur Boris Hazoumé dans un article sur Jean Monnet : « l’Europe [pour ce dernier] ne peut être que fédérale, dans le cadre d’un partenariat euro-américain […] À ses yeux, la notion d’Europe indépendante ne fait pas sens et les États-Unis sont un partenaire incontournable de son intégration »[1]. Des documents récents, issus des archives fédérales américaines déclassifiées, viennent à l’appui de son propos.
On y trouve notamment une lettre de la banque Chase Manhattan adressée à Jean Monnet, qui témoigne d’une correspondance entre le futur Commissaire général au Plan et un certain Dean Acheson – Secrétaire général du président Truman de 1949 à 1953. Si la lettre de la Chase Manhattan rappelle que Monnet fut détenteur d’un compte de 200 000 dollars dans ses coffres, régulièrement approvisionné pour financer des « opérations d’influence », le document le plus évocateur demeure le courrier de Dean Acheson intitulé « The United State is a European Power »[2].
Dean Acheson y fait ainsi état de la nécessité de concevoir « un marché annexe néo-américain pour écouler les sur-capacités productives de l’après-guerre », avec à sa tête une « commission exécutive » en vue de former « un seul ensemble géopolitique » entre les États-Unis et l’Europe.
La Communauté européenne de Défense, sous-marin des États-Unis ?
Sa correspondance tend à démonter que derrière Jean Monnet, ce sont les États-Unis qui sont à la manoeuvre. Dans une note du 6 mai 1943 provenant des archives déclassifiées, adressée au secrétaire d’État américain Harry Hopkins, Monnet s’emporte et déclare : « Il faut se résoudre à conclure que l’entente est impossible avec de Gaulle, qu’il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu’il est un ennemi de la construction européenne (et) qu’en conséquence, il doit être détruit dans l’intérêt des Français »[3].
Derrière la vision européenne de Jean Monnet, une américanophilie dirigée contre l’URSS, dans le cadre d’une Guerre froide naissante. De Gaulle, à ses yeux, pêchait par mollesse vis-à vis de l’URSS. Si Monnet appelait à « détruire » le Général, l’homme du 18 juin ne le tenait pas en haute estime – il suffit de lire les pages que son ministre Alain Peyrefitte, dans C’était de Gaulle, lui consacre : « L’Europe intégrée, ça ne pouvait pas convenir à la France, ni aux Français… Sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis ».
Ce lien organique entre construction européenne et tutelle américaine, les débats autour de la Communauté européenne de Défense (CED) devaient le mettre en lumière. De 1951 à 1954, de sérieuses négociations visaient à fusionner les armées d’Europe de l’Ouest sous commandement de l’OTAN. Entamées à Washington, les discussions en faveur de la CED visaient originellement à permettre le réarmement de l’Allemagne afin de protéger le continent européen d’une supposée menace soviétique. Devant le refus de l’allié français, la mémoire vive des douloureuse années d’occupation, les États-Unis proposèrent un réarmement dans le cadre de l’Alliance atlantique.
Que Washington soit à l’origine du projet n’a pas empêché que l’on présente la CED comme une initiative « européenne ». L’indignation fut vive à Paris. Des communistes à de Gaulle, on dénonçait le retour de la Wehrmacht sous pavillon américain. La presse de l’époque, et plusieurs historiens contemporains, n’hésitent pas à évoquer une « affaire Dreyfus de la IVè République ». Les chrétiens-démocrates du MRP et une majorité de socialistes soutient la CED par crainte de Moscou, tandis que gaullistes et communistes se retrouvent alliés objectifs.
De Gaulle conçoit l’Europe comme un « levier d’Archimède » permettant à la France de conquérir une taille lui permettant de concurrencer les grands empire
Face à la pression populaire, le gouvernement centriste repousse le vote à de nombreuses reprises. C’est seulement en 1954 que Pierre Mendes-France tranche le nœud gordien et autorise l’Assemblée à se prononcer. Le résultat est sans appel : le 30 août, 319 voix rejettent la CED – contre seulement 264 en sa faveur. La France torpillait ainsi l’Europe de la Défense. Le Traité de Rome, trois ans plus tard, se gardait bien d’esquisser la moindre perspective de fédéralisation de la Défense. Et lorsqu’en 1992 le Traité de Maastricht est adopté, s’il pose les jalons d’une monnaie fédérale, la chose militaire demeure prérogative nationale.
Chant du cygne de l’indépendance française
Ce cri français d’hostilité devait perdurer. Le second retournement intervient avec le retour au pouvoir du Général de Gaulle en 1958. S’il ne sortit jamais du Traité de Rome, il n’en fut pas moins adversaire résolu des velléités fédérales de la CEE et de son premier commissaire, Walter Hallstein. Le cadre européen d’alors est restreint (six États-membres), protectionniste (tarif extérieur commun) et dirigiste (quotas laitiers). Monnaie unique et règles supranationales de Maastricht sont encore loin. Une vision nationale de l’Europe est affirmée par le Général à plusieurs reprises ; le 15 mai 1962 : « Il ne peut pas y avoir d’autre Europe que celle des États, en dehors des mythes, des fictions, des parades. ». La messe est dite.
Toutefois, en matière européenne, de Gaulle connut quelques fluctuations. Il reprit même, brièvement, la rhétorique de l’Europe puissance. Dès son célèbre discours à l’Université de Strasbourg, le 22 novembre 1959, il conspue l’Europe américaine au profit d’une Europe dite européenne, allant « depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural ». Un paradigme qui s’éloigne des visées américanophiles d’un Jean Monnet. Cette idée d’une Europe-puissance se précise lors des deux plans Fouchet que propose la France à l’Allemagne en novembre 1961 et janvier 1962. De Gaulle espère voir les six acheter du matériel militaire français et se fondre dans la politique étrangère de la France. À Peyrefitte, il confie concevoir l’Europe comme un « levier d’Archimède » permettant à la France de conquérir une taille lui permettant de concurrencer les deux empires américain et soviétique. Le Traité de l’Élysée était né.
C’est à Jean Monnet, cette fois, d’éructer, et de mener un lobbying intense auprès des parlementaires allemands pour faire avorter ce projet. Une fois ratifié en France, le traité doit l’être par le parlement allemand pour entrer en vigueur. Et contre l’avis d’Adenauer, le Bundestag intègre un préambule dans le Traité de l’Élysée qui stipule de l’appartenance indéfectible de la RFA à l’OTAN. Le traité est subitement vidé de sa substance. Monnet a gagné : l’Europe européenne ne verra pas le jour.
Américanisation de l’Europe
Les présidences de Valery Giscard d’Estaing et de François Mitterrand devaient acter l’intensification de la construction européenne, puis l’abandon de nombreuses prérogatives nationales. Le coeur industriel de l’Europe était ouvert aux quatre vents de la mondialisation, et n’en ressortirait pas indemne.
De nombreux processus devaient rendre le continent européen dépendant des États-Unis en matière de Défense. Les élargissements de l’Union européenne de 2004 à 2007 actent l’intégration de pays prompts à s’armer auprès de Washington depuis la Chute du Mur. Leur forte tradition anticommuniste devait en faire des alliés structurels des États-Unis. Mais plus largement, le cadre européen issu de Maastricht mettait en péril la résilience et l’autonomie des secteurs productifs européens, y compris dans la Défense. Sanctuarisation de la rigueur budgétaire et libre-échange obéraient toute politique industrielle de grande échelle.
Leur impact sur le secteur de la Défense fut sans appel : de nombreux pays durent se résoudre à abandonner toute velléité d’indépendance en la matière, se fournissant directement auprès des États-Unis. La tutelle américaine permettait aux Européens de déléguer leur protection à l’OTAN, et de se plier à l’austérité voulue par l’Allemagne. Le vieil axe Washington-Berlin était plus vivace que jamais. Ce protectorat honteux, Donald Trump devait le mettre au centre du débat, protestant (en 2016 comme en 2024) contre le coût financier de l’OTAN. À l’idéalisme du langage diplomatique européen, il opposait le plus froid réalisme.
Cette nouvelle présidence Trump actera-t-elle enfin la constitution d’une « Europe puissance », autonome des États-Unis ? La protestation des chancelleries est vive. Pour autant, on imagine mal les gouvernements baltes, polonais ou allemand s’autonomiser, pour de bon, du maillage militaro-industriel des États-Unis. Du reste, il est douteux que ceux-ci souhaitent réellement se retirer du Vieux continent. Toute la rhétorique isolationniste de Donald Trump ne calme pas sa frénésie de vente de F-35. Et l’Europe a-t-elle cessé d’être aux yeux des États-Unis, selon le mot de Dean Acheson, « un marché annexe néo-américain pour écouler les surcapacités productives » ?
Notes :
[1] Boris Hazoumé, « Jean Monnet, “l’inspirateur” », Inflexions, 33, 2016
[2] Éric Branca, L’ami américain : Washington contre de Gaulle, 1940-1969, Perrin, 2017
[3] Ibid.