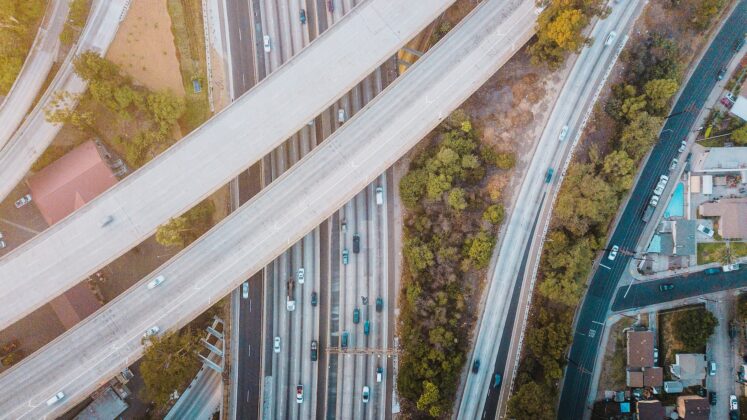Au temps des multiples luttes contre les différentes formes de domination, il est un mouvement relativement discret qui gagne pourtant en audience au sein des sociétés occidentales : l’antispécisme. Les militants de cette cause, les antispécistes, promeuvent la fin de l’exploitation animale par l’intermédiaire d’un nouveau mode de vie, le véganisme. Cette manière de vivre, reposant sur un rejet total de toute forme de consommation de produits ayant fait intervenir un animal, paraît bien souvent radicale, et ses zélateurs, marginaux. Arthur Hacot, auteur d’un mémoire de sociologie basé sur une enquête dans une association antispéciste, répond ici à quelques questions concernant une cause souvent caricaturée.
Qu’est-ce que l’antispécisme ?
L’antispécisme est une idéologie fondée sur l’idée selon laquelle l’espèce d’un individu ne doit pas être un critère permettant une discrimination. Cette théorie, née dans les années 1970, est avancée par des chercheurs tels Richard D. Ryder ou Peter Singer, officiant tous deux à l’Université d’Oxford. L’antispécisme dérive du terme specism, lui-même fondé sur d’autres formes de discriminations que sont le racisme ou le sexisme. L’avènement du courant antispéciste a dès lors donné une nouvelle dimension à la cause animale, jusqu’alors cantonnée à la question de la souffrance animale. Ainsi, l’antispécisme incarne un courant, parmi d’autres, de la très vaste cause animale.
Le mode de vie associé à l’antispécisme est le véganisme, ensemble de pratiques visant à rejeter, dans la vie de tous les jours, toute consommation de produits ayant fait intervenir des animaux. Ainsi, les pratiquants du véganisme, les véganes sont non seulement végétaliens (ils ne consomment aucun aliment d’origine animale, peu importe si l’aliment en question a nécessité ou non la mort d’animaux), mais ils rejettent également la laine, le cuir, la soie, critiquent les cirques traditionnels, les zoos, l’usage d’animaux de laboratoire… Certains poussent même la radicalité jusqu’à refuser de manger des légumes ayant poussé dans une terre fertilisée avec du lisier, ou des fruits dont les arbres ont été pollinisés par des abeilles domestiques. Les rares fois où ils sont présentés dans les médias, par des commentateurs ou des militants, l’antispécisme et le véganisme apparaissent de façon obscure, et leurs militants, paradoxalement, comme des marginaux. Malgré un gain d’audience de ce courant dans la société française, comme la montre la croissance de 24% du marché des produits véganes en 2018, il reste particulièrement minoritaire et incompris [1].
Les antispécistes sont-ils de doux rêveurs ?
La présentation des militants antispécistes, que ce soit dans les médias ou directement sur la place publique, participe d’une forme de caricature. On les voit bloquer des abattoirs, enlever les animaux pour les placer dans des « sanctuaires », construire des mises en scène morbides et violentes, se faire marquer au fer rouge et scander, la voix étranglée par la colère, des slogans prônant l’abolition de l’exploitation animale. Pour certains, le fanatisme affiché reflète véritablement la radicalité qu’ils portent et habillent volontiers de pratiques révolutionnaires confinant parfois au terrorisme. C’est le cas par exemple des militants de l’Animal Liberation Front, association fondée en 1979 et généralement considérée comme la plus radicale et active au sein du mouvement antispéciste. Les associations qui incarnent ce mouvement sont finalement très loin des représentants canoniques de la cause animale en France que sont la Société protectrice des animaux et 30 Millions d’amis. Pour qui voit les choses de l’extérieur, le combat pour l’abolition absolue et intégrale de l’exploitation animale a donc de quoi apparaître comme une lubie de plus pour des jeunes en mal de combats à mener et de populations à défendre.
Le plus souvent, c’est l’observation d’une scène morbide, filmée clandestinement dans les abattoirs par des associations telles que L214, qui pousse les individus vers le véganisme. L’élément déclencheur, c’est le rejet d’une souffrance jugée arbitraire et, dans le cadre de nos sociétés occidentales, superflue. À l’origine, la condamnation de cette violence repose sur une logique bourgeoise de la distinction : la bestialité, c’est pour les classes populaires. C’est d’ailleurs pour cela que les premières associations végétariennes fondées au 17ème siècle en Angleterre l’ont été par des bourgeois protestants et puritains. Si le mouvement s’est ensuite laïcisé, il est resté très enclin à critiquer le comportement jugé violent des « masses ». Les associations de lutte contre la cruauté animale ont à l’époque beaucoup construit leur mouvement en dénonçant, par exemple, le traitement réservé par les charretiers à leurs bœufs ou leurs chevaux. La prise de conscience a été provoquée par la multiplication des animaux domestiques dans les foyers bourgeois et les mouvements en question ont obtenu que les abattoirs soient construits à l’écart des villes, pour en dissimuler la violence. Et l’on a défendu principalement les animaux dits nobles, tels que les chiens, chats et autres chevaux, au détriment du bétail. Ce n’est que par la suite que des mouvements d’origine plus humaniste ont décidé d’introduire la question de la souffrance animale à une échelle plus large, avec les premières dénonciations, par exemple, de la corrida.
Aujourd’hui, la violence exercée à l’égard des animaux est exacerbée par l’industrialisation des activités agricoles. Chaque jour, des milliers d’animaux sont abattus pour la consommation humaine. D’autres milliers sont exploités pour leurs œufs, leur miel, leur laine, parfois dans des conditions particulièrement indignes. Cela mérite que nous nous questionnions. Les militants antispécistes, certes de manière radicale, et moyennant parfois un discours passionnel qui peut sembler irréaliste, posent des questions fondamentales à nos sociétés occidentales, pour qui prend la peine de lire entre les lignes.
Les antispécistes sont-ils vraiment écologistes ?
On présente souvent les militants de la cause animale comme des écologistes et certaines associations parmi les plus radicales, l’ALF par exemple, comme écoterroristes. Cela se comprend, dès lors que l’animal est perçu comme un représentant emblématique de l’environnement, de la nature. La souffrance animale est parfois comparée à la déliquescence de notre écosystème. Le discours des antispécistes promeut un mode de vie se présentant volontiers comme constituant un horizon indépassable : le véganisme, mode de vie exclusivement végétal et partagé par nombre d’écologistes. D’une certaine manière, l’abolition de toute forme d’exploitation animale est présentée comme constituant un progrès moral salutaire pour les sociétés, condition de leur survie. En effet, dans le cadre d’une lutte contre le réchauffement climatique, il devient préférable de réduire drastiquement la production et la consommation de protéines animales – les antispécistes voulant même l’abolir.
Cependant, dans les faits, le mariage entre écologisme et antispécisme a des limites. Certes, les militants antispécistes participent activement aux marches pour le climat pour critiquer l’élevage intensif, la consommation de viande, activités jugées polluantes. Ici, les arguments écologiques servent la cause animale, mais ce n’est pas toujours le cas, par exemple concernant les vêtements : un antispéciste préférera un coton d’origine lointaine à une laine d’origine locale, plaçant l’éthique animale au-dessus de l’empreinte carbone. L’opposition au sein du monde associatif est d’ailleurs farouche entre les associations antispécistes qui reprennent des arguments écologistes, et celles qui critiquent l’idée selon laquelle on utiliserait la libération animale pour des raisons écologiques. La libération animale doit être un impératif catégorique, et non hypothétique.
En réalité, la cause animale n’a historiquement que peu d’affinité avec l’écologie. Les antispécistes cherchent, en quelque sorte, à bénéficier d’une fenêtre d’opportunité politique en se greffant à des causes plus visibles dans la société, ou en en reprenant les codes et la rhétorique. Ainsi, les antispécistes sont des écolos intermittents pour des raisons pragmatiques, mais leur discours ne se fond que difficilement dans le combat écologiste, qui ne peut à lui seul permettre l’avènement d’une société exempte d’exploitation animale.
L’antispécisme est-il un mouvement de citadins ?
L’antispécisme est un produit de la modernité, qui repose notamment sur l’industrialisation, le capitalisme, l’urbanisation et l’individualisme. Pour des raisons déjà évoquées, les antispécistes critiquent l’industrialisation de l’exploitation animale, qui exacerbe les souffrances que subissent les animaux. Mais c’est avant tout le produit du processus de civilisation, que Norbert Elias décrit comme reposant en partie sur la diffusion de mœurs bourgeoises tolérant de moins en moins la violence : même celle que subissent les animaux devient insupportable. C’est également le produit de l’urbanisation. La ville, produit du capitalisme, arrache l’Homme à la nature pour en faire un consommateur mû par « son utilité », comme disent les microéconomistes. Elle est de ce point de vue un espace aliénant en ce que tout bien n’y est vu que comme un bien de consommation. En fait, la redécouverte du lien « entre l’animal et l’assiette », selon les militants véganes, s’effectue avec davantage de violence qu’il était oublié. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si aujourd’hui le discours végane est particulièrement diffusé en ville, où les enseignes véganes se multiplient.

La compréhension des dérives des sociétés capitalistes est sans doute ce qui fait la force de ce discours, mais son citadino-centrisme fait également sa faiblesse. Certaines problématiques, qui rendent difficile l’adoption d’un comportement végane ou antispéciste, ne se posent pas en ville, par exemple l’invasion menaçante d’un nid de frelons. Voilà pourquoi l’antispécisme se diffuse plus difficilement à la campagne, où les nuisibles sont plus nombreux. Nous pouvons aussi noter que la proximité avec les animaux y pacifie la relation avec l’Homme, qui y a moins oublié le sort qui leur est réservé. Le moteur antispéciste reposant sur le dévoilement y trouve moins son carburant. De manière plus concrète, il apparaît difficile d’aller promouvoir le véganisme à des personnes qui vivent, et actuellement assez pauvrement, de l’élevage. Il faut également relever l’occidentalo-centrisme de l’antispécisme, qui ne prendrait pas, par exemple, chez les Inuits ou les Massaïs où chez ces derniers, la chasse et l’élevage sont synonymes de survie.
Mais jusqu’où ça peut aller ?
En spéculant un peu, on est en droit de se demander si, sous couvert de critiquer les excès de la modernité, le discours antispéciste ne les renforce pas, et cela pour plusieurs raisons.
Rappelons tout d’abord la place qu’occupe la question de la souffrance dans la cause animale : le plus souvent, c’est la cause première de l’engagement, et l’argument le plus rentable sur le plan militant. Plus nous savons et voyons que les animaux souffrent (sur la base d’une conception anthropocentrée de la souffrance, par exemple la fuite face à une menace, un cri suite à une blessure), plus il apparaît nécessaire de lutter contre leur exploitation. Certains militants trouvent cette violence d’autant plus détestable qu’elle se fait au nom du plaisir gustatif. Nous retrouvons là une forme de puritanisme ascétique proche de celui des protestants étudiés par Max Weber. Le puritanisme ascétique renvoie à la volonté de tourner entièrement son existence vers une conduite jugée acceptable au regard d’une morale que l’on s’est fixée. Celui des protestants est particulièrement exigeant, et ressemble, en certains points, notamment par son rigorisme, au mode de vie végane. Qu’à cela ne tienne, nous n’avons qu’à manger des légumes qui, eux, ne souffrent pas.
Pourtant nous sommes en train de découvrir que les arbres communiquent, on leur prête même des émotions, alors pourquoi pas une souffrance ? [2] Que pourrait-il alors se passer ? Il est possible que cette souffrance nous apparaisse également insupportable, et qu’apparaîtront les anti-régnistes, opposés à l’idée selon laquelle le règne, animal ou végétal puisse constituer un critère de discrimination. Nous finirons alors par oublier totalement que se nourrir repose nécessairement sur une destruction du vivant. Déciderons-nous alors, au grand dam de l’écologie, de nous nourrir de gélules, certes sans intérêt gustatif, mais avec la garantie de n’avoir fait souffrir personne ?
Un autre phénomène peut s’observer et susciter une réflexion sur l’avenir de ce mouvement. Dans la rhétorique des antispécistes, on observe bien souvent la volonté d’anthropomorphiser les animaux. L’objectif est de mettre l’accent sur leur souffrance, les émotions qu’ils ressentent, leur intelligence. Certains n’hésitent pas à invoquer le génocide juif pour parler de l’exploitation animale, à comparer l’insémination des vaches à un viol… La réduction de la frontière entre l’homme et l’animal peut être envisagée comme une prémisse à sa future abolition. Certains discours, certes très marginaux et pouvant faire sourire, semblent aller dans ce sens : sur le net, certaines personnes, dénommées otherkins, racontent ainsi être des animaux enfermés dans un corps d’humain [3]. Des militants transgenres ont d’ailleurs critiqué les otherkins, les accusant de ridiculiser leur cause en mettant sur un pied d’égalité identité de genre et identité d’espèce.
Quoique l’on en pense, ce qui apparaît aujourd’hui inconcevable peut devenir banal à l’avenir et aurait de profondes implications pour la société. Ainsi, la critique des frontières et des assignations identitaires ouvre autant la voie à des aspirations émancipatrices qu’à la consolidation d’un régime ultra-libéral. Interroger les implications philosophiques de l’antispécisme demeure alors une précieuse boussole pour ne pas laisser place à une conception très fluide de l’identité, selon laquelle l’identité ne dépendrait que de soi, mais devrait être reconnue par chacun.
En définitive, distinguer les raisons d’être de l’antispécisme et le discours qu’il porte
Le mouvement antispéciste, par sa simple présence et la radicalité de son discours, oblige les sociétés occidentales à repenser le lien qu’elles entretiennent avec les animaux, le vivant, et plus généralement l’écosystème. Mais il faut bien distinguer les raisons qui font exister un discours, le discours en lui-même, et les effets du discours. Les raisons qui font exister l’antispécisme nous inclinent – car ce mouvement dérange – à questionner le fonctionnement des économies capitalistes industrialisées. La volonté de lutter contre la souffrance animale fait écho à l’exacerbation de cette souffrance engendrée par la surproduction de produits d’origine animale. Mais les solutions apportées par le mouvement lui-même semblent parfois néfastes en raison de leurs déterminants davantage émotionnels que rationnels. Finalement, l’antispécisme traduit peut-être lui-même la contradiction qu’il prétend pourtant combattre : d’une part, il incarne une critique de la dérive industrialiste et destructrice de nos économies. D’autre part, il peut cependant permettre, collatéralement, l’avènement d’une conception totalement dissolue de l’être humain qui ne peut que servir le consumérisme d’individus réduits à des atomes sans attaches, au bénéfice du capitalisme.
Pour aller plus loin :
La cause animale, par Christophe Traïni. (2011)
De la secte religieuse à l’utopie philanthropique. Genèse sociale du végétarisme occidental, par Arouna Ouedraogo. (2000)
[1] Selon un article de Ouest-France, “Le marché végétarien et végan a augmenté de 24% en 2018”, publié le 08/01/2019.
[2] En témoigne le best-seller de Peter Wollheben, La vie secrète des arbres, publié en 2017.
[3] Voir l’article du Monde, “Pas complètement humain : la vie en ligne des thérians et otherkins”, publié le 20/05/2014.