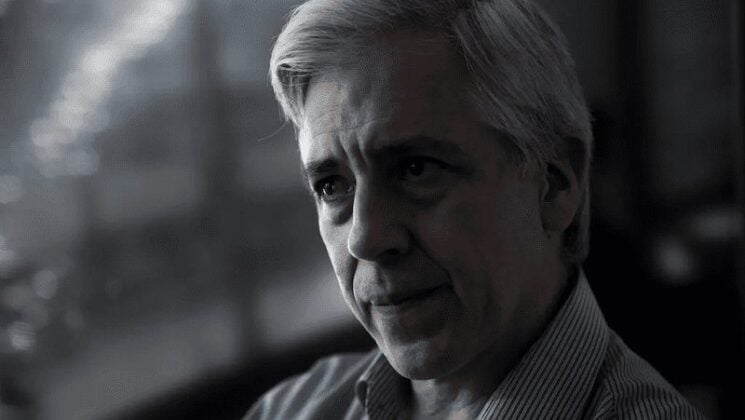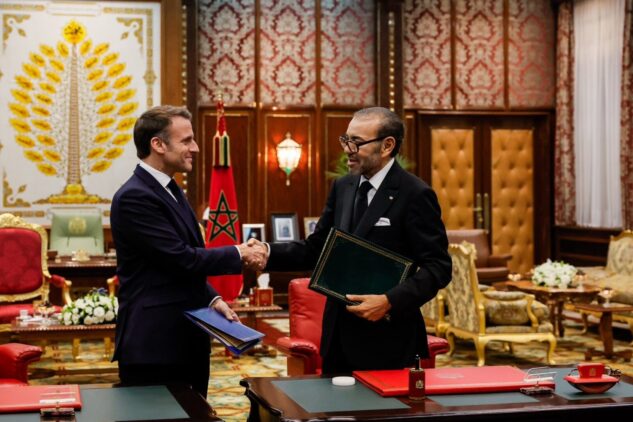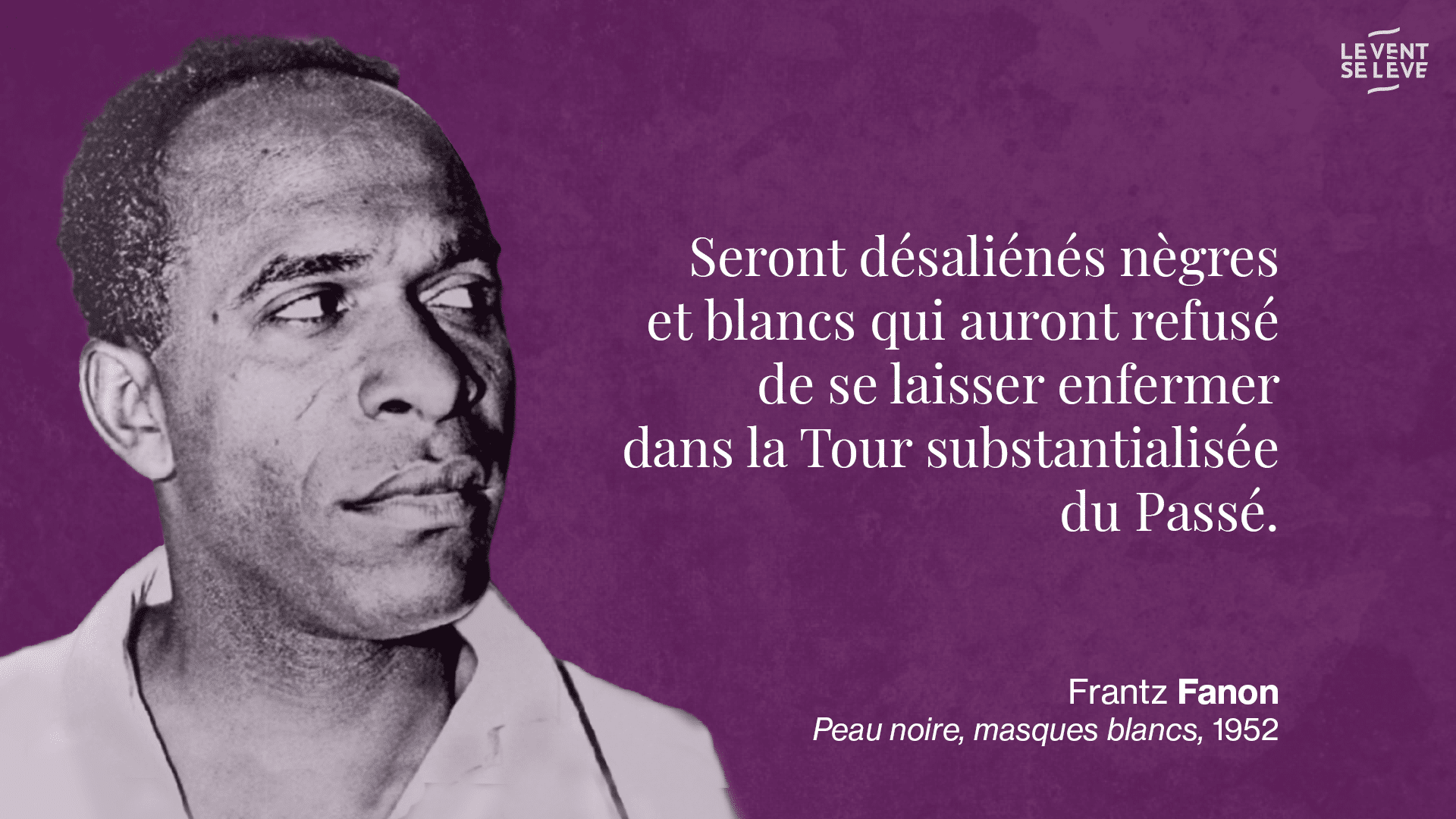Cet été, un enchaînement d’événements a déclenché un débat en Croatie sur l’histoire tourmentée du pays, sa culture politique et son avenir. Un concert à Zagreb, dont l’artiste principal cache mal sa nostalgie à l’égard de la période fasciste (1941-1945), et qui a attiré un demi-million de personnes, a été le théâtre du déploiement d’une abondante symbolique d’extrême droite. S’il ne s’agit pas du premier événement de cette nature, la présence du Premier ministre de centre-droit Andrej Plenković, qui jouit d’une image de « modéré » et de « pragmatique », est un fait nouveau. Ce mouvement souterrain qui secoue le pays pourrait être accru par le militarisme ambiant : la hausse du budget de Défense exigée par l’Union européenne – aux dépens des services sociaux – sera-t-elle obtenue, en Croatie, en réactivant un imaginaire fasciste ? Par Nikola Vukobratović, traduction par Alexandra Knez.
L’une des principales chaînes de télévision croates a consacré une émission spéciale sur les événements, qui s’est ouverte avec cette déclaration : « La moitié de la Croatie considère le 5 juillet comme le début de quelque chose de magnifique, tandis que l’autre moitié y voit le début de quelque chose d’inquiétant. » À cette date, un concert de Marko Perković, star du folk-rock d’extrême droite surnommé « Thompson » (en référence à la mitraillette du même nom), avait été organisé à l’hippodrome de Zagreb.
Initialement prévu en mai, juste avant les élections locales, ce concert était largement perçu comme un défi lancé par l’extrême droite à l’administration de la capitale croate, dirigée par une coalition des Verts et du parti social-démocrate Nouvelle Gauche. Invoquant des problèmes d’organisation, les autorités ont reporté l’événement à une date postérieure aux élections, que la même coalition a d’ailleurs gagné à nouveau.
Neuf ans à la tête du pays, M. Plenković était jusqu’alors vu comme un « pragmatique », parvenu à réduire l’influence de l’aile droite de son parti
Les concerts de « Thompson » ne sont jamais de simples événements culturels. Depuis plus de vingt ans, ils sont l’occasion de rassemblements politiques de grande ampleur, marqués par des messages, slogans et banderoles au racisme à peine voilé. Ses chansons décrivent les Croates comme un peuple élu au « sang bleu » et au « visage blanc », faisant souvent référence à l’imagerie romantique des croisés du Moyen Âge. Il exhorte même ses spectateurs à brandir une croix ou une épée (lui-même brandit fréquemment une épée factice sur scène) pour défendre la nation contre des ennemis démoniaques – allusions transparente à la gauche et aux Serbes.
Au-delà des références aux guerres yougoslaves des années 1990, de nombreuses chansons de « Thompson » expriment subtilement la nostalgie de l’État fasciste fantoche de la Seconde Guerre mondiale : « l’État indépendant » de Croatie et son principal mouvement, les « Oustachis » (Ustaše). Ses liens avec des groupes célébrant ce régime sont bien documentés. Auparavant, il exprimait ouvertement son admiration pour les dirigeants de ce mouvement, même s’il a parfois cherché à prendre ses distances par rapport à ses soutiens les plus manifestes.
En revanche, les nombreux fans de « Thompson » sont beaucoup moins subtils : ils arborent des T-shirts aux symboles oustachis et entonnent des chants des années 1940. À Zagreb, l’opinion publique progressiste a été choquée par des images de spectateurs chantant une chanson militaire oustachie en plein centre-ville, avant le concert. De telles manifestations ne sont pas inhabituelles, mais elles se produisent généralement dans les zones rurales, et échappent souvent à l’attention des médias. Cette fois-ci, les choses se sont passées différemment. Pendant les semaines précédant le concert, la plupart des médias nationaux ont couvert en détails les préparatifs de ce qu’ils ont appelé « le grand événement », affirmant qu’il s’agissait du plus grand concert payant de l’histoire, bien que le nombre de participants n’ait jamais été vérifié et que beaucoup avaient obtenu leurs billets gratuitement.
Ses partisans comme ses détracteurs y ont vu une manœuvre provocatrice de la droite pour s’emparer de la ville en organisant le plus grand concert de l’artiste jamais donné à Zagreb, bastion du centre gauche. Le large soutien reçu par les élus et les médias proches du parti au pouvoir semble confirmer cette hypothèse.
L’aval du gouvernement
Loin d’un ordinaire rassemblement rural d’extrême droite, le Premier ministre Andrej Plenković, leader du parti de centre droit Union démocratique croate (HDZ), a présenté ses enfants au chanteur lors d’une séance photo ostentatoire, juste avant le concert. Le HDZ est la force politique dominante en Croatie depuis vingt-sept des trente-cinq dernières années. Et même pendant les brèves périodes où il n’a pas été au pouvoir, il a généralement conservé le contrôle des principales institutions de l’État, notamment le pouvoir judiciaire, les entreprises publiques et les organisations sportives et culturelles. S’il mobilise toujours une rhétorique nationaliste, le parti a diversifié ses rangs, attirant désormais nombre de technocrates « apolitiques ».
M. Plenković entame son troisième mandat de Premier ministre. Au cours des neuf dernières années, il a généralement été considéré comme un « pragmatique » et une facteur de modération, réduisant considérablement l’influence de l’aile droite du HDZ et incluant, pendant un certain temps, des représentants de la communauté serbe de Croatie au sein de son gouvernement.
Deux poids lourds du parti ont également assisté au concert. Le ministre de la Défense, Ivan Anušić, s’est ouvertement vanté d’avoir utilisé le salut « Pour la patrie – Prêt ! » lors de l’événement. Ce slogan, inventé à l’origine par le leader oustachi Ante Pavelić dans les années 1930, puis utilisé par un groupe paramilitaire croate pendant les guerres de Yougoslavie lors de l’éclatement de l’État plurinational, reste juridiquement controversé.
Gordan Jandroković, président du Parlement croate et souvent moqué comme parangon de l’opportunisme politique – loin d’un idéologue fanatisé -, a loué à plusieurs reprises le concert comme étant une expression de « patriotisme et d’unité ». Les médias laissent entendre qu’Anušić et Jandroković seraient en lice pour succéder à Plenković – qui, selon certaines rumeurs, souhaiterait jouer un rôle plus important au sein de l’UE ou de l’OTAN – à l’issue de son troisième mandat. Si tel est le cas, leur compétition pour le leadership pourrait également refléter un glissement vers la droite. Lors du concert, « Thompson » a d’ailleurs appelé les Croates à aider à « restaurer l’Europe dans ses racines chrétiennes traditionnelles afin qu’elle redevienne forte ».
Moins d’un mois plus tard, un second concert a eu lieu dans la petite ville de Sinj, dans le sud du pays. Thompson y a intensifié sa rhétorique, vouant la gauche aux gémonies comme « yougoslave » (bien que personne dans la sphère politique croate n’ose parler en des termes laudatifs de l’ancienne fédération yougoslave) et exigeant que ceux qui « ne respectent pas les anciens combattants des années 1990 » quittent le pays. De nombreux membres du parti au pouvoir, le HDZ, ainsi que des personnalités proches de ce parti, comme l’entraîneur de l’équipe nationale de football, ont exprimé des propos similaires. Un prêtre de Sinj a profité de la fête de l’Assomption pour souhaiter aux détracteurs du concert « de souffrir et de mourir sous la torture ».
Réaction discrète de la gauche
Comme prévu, les fans de Sinj sont allés plus loin que ceux de Zagreb en occupant le centre-ville pour chanter à l’unisson une chanson célébrant les camps de la mort du régime oustachi durant la Seconde Guerre mondiale. Intitulée Jasenovac i Gradiška Stara, en référence à l’emplacement des camps, cette chanson, autrefois interprétée par « Thompson » lors de concerts, mais qui ne fait plus partie de son répertoire, reste l’hymne officieux de ses admirateurs les plus fervents. Elle glorifie les « bouchers » et les « chemises noires » oustachis, et célèbre sans ambivalence aucune le « massacre » des Serbes.
Malgré les nombreuses attaques dont elle fait l’objet, la gauche a fait preuve d’une étonnante retenue dans sa réaction aux événements. Les Verts, au pouvoir à Zagreb, auraient pu annuler le concert, car il se tenait dans un lieu appartenant à la ville. Ce n’aurait pas été sans précédent : des concerts de l’artiste ont déjà été annulés en Croatie et dans d’autres pays. Cette fois-ci, cependant, pour éviter de provoquer la droite, ils ont choisi de ne pas le faire. De son côté, l’ancienne députée de gauche Katarina Peović, l’une des critiques les plus virulentes du chanteur, a reçu des centaines de menaces de mort dans le cadre d’une campagne coordonnée par l’extrême droite.
Les deux concerts ont eu lieu à peu près au moment de la grande fête nationale du « Jour de la Victoire », qui commémore l’opération « Tempête » de 1995, qui a permis à la Croatie de reprendre le contrôle de la majeure partie de son territoire et a provoqué l’exode de plusieurs centaines de milliers de Serbes. Des hommes politiques de gauche, invités d’honneur au défilé militaire, ont assisté passivement aux brutalités infligées par la police à plusieurs manifestants pacifistes, dont certains ont échappé de justesse au lynchage par la foule. Plus tard, ils ont assisté à d’autres célébrations du Jour de la Victoire au cours desquelles des élus de droite ont prononcé des discours haineux, tandis que d’anciens paramilitaires et des hooligans défilaient en brandissant des slogans et des bannières d’extrême droite. Les Verts et les sociaux-démocrates n’ont réagi qu’après les faits – par des déclarations pour le moins tièdes.
Paysage politique en pleine mutation
Comme on pouvait s’y attendre, le fait que ces slogans soient publiquement tolérés lors d’événements parrainés par l’État a alimenté la montée en puissance des symboles d’extrême droite, avec des vidéos devenues virales montrant des enfants scandant « Pour la patrie – Prêt ! » dans les rues et des stades entiers criant « Allez, les Oustachis ! » pendant les matchs de football.
Pourquoi une telle escalade ? Malgré toute la rhétorique anti-serbe, les Serbes de Croatie ne forment aujourd’hui qu’une petite communauté, à peine l’ombre d’elle-même. La Serbie et la Croatie, qui n’ont jamais été en bons termes, semblent pourtant très proches actuellement sur le plan géopolitique : la Serbie fournit de grandes quantités de munitions à l’Ukraine et à Israël, tandis que la Croatie tente d’utiliser son statut de membre de l’UE pour offrir un soutien diplomatique à ces mêmes pays.
Il n’est toutefois pas impossible que ce virage à droite soit lié à une dynamique géopolitique plus large, notamment aux pressions croissantes en faveur de la militarisation de l’Union européenne, un programme qui, comme il en est de plus en plus question dans les États membres, pourrait également donner lieu à une nouvelle vague d’austérité. Étant donné la petite taille de la Croatie, il est peu probable qu’elle joue un rôle majeur dans les futures stratégies militaires de l’Occident. Néanmoins, comme on nous le rappelle périodiquement, elle devrait contribuer, du moins selon les informations publiquement disponibles, à la production d’armes légères et de drones.
Quoi qu’il en soit, quels que soient les projets des autorités nationales ou européennes, la voie est aujourd’hui beaucoup plus dégagée qu’il y a quelques mois pour faire passer des changements régressifs et impopulaires. La population étant mobilisée ailleurs et mise au pas, et l’opposition effectivement neutralisée, une résistance significative semble de plus en plus improbable.
Article originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « Croatia’s Fascist-Saluting Summer ».