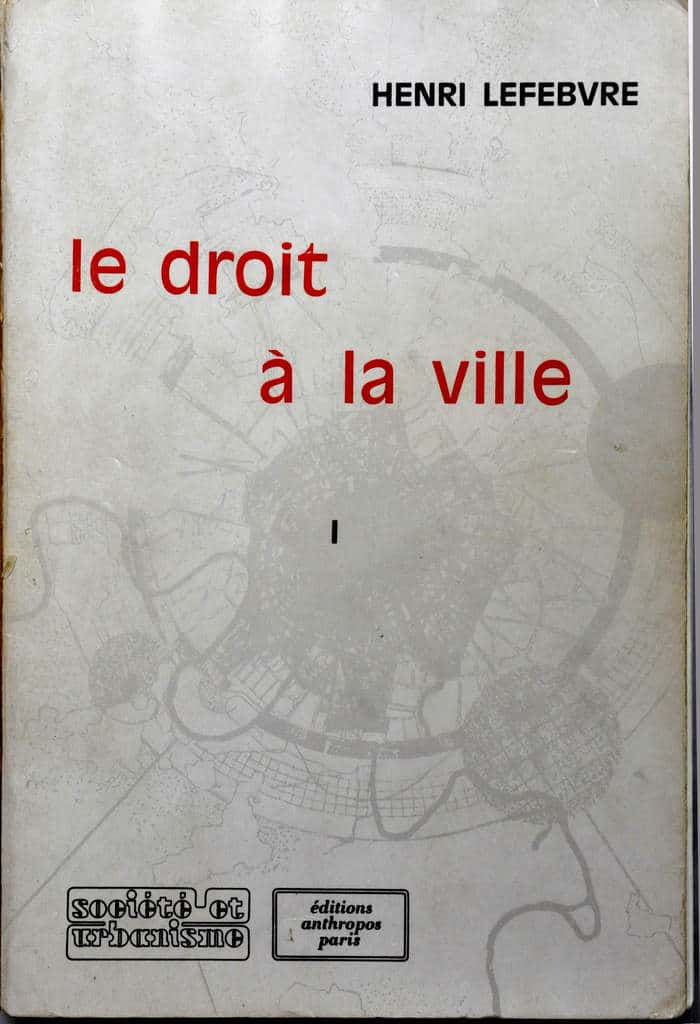Réactionnaire ? Visionnaire ? Progressiste authentique critique de la modernité ? Christopher Lasch a suscité les mêmes controverses, aux États-Unis, que Jean-Claude Michéa en France – qui est souvent décrit comme l’un de ses continuateurs. Son oeuvre phare, La révolte des élites, a tour à tour été acclamée comme ayant saisi l’esprit du temps, et décriée comme un pamphlet sans rigueur historique ou sociologique. Alors que le thème de la sécession des élites prend une place croissante dans le monde médiatique, il convient de s’intéresser à l’auteur de la notion.
Une prophétie désabusée
Quand Christopher Lasch écrit La révolte des élites en 1993 et 1994, il y consacre ses derniers mois. C’est le constat d’un homme qui n’a plus rien à espérer. Aidé par un élan d’un pessimisme dépressif, il se lance dans l’écriture de l’un des ouvrages de prospective qui fera date dans l’histoire du domaine. Il meurt en février 1994 d’un cancer généralisé. Stoïque face à la mort, il refuse toute forme d’acharnement thérapeutique.
Faut-il y voir la marque d’une cohérence entre sa vie et sa pensée ? Historien de métier, l’universitaire américain consacre sa carrière à l’analyse de l’évolution des mœurs et de la famille aux États-Unis. On lui doit entre autres un ouvrage majeur sur la « transition narcissique » des sociétés occidentales1, une analyse prospective du déclin des élites2 et un ouvrage posthume sur le féminisme3.
Lasch est un historien étrange. Il n’hésite pas çà et là à faire des emprunts à la psychanalyse (…) et prend un ton de prêcheur. Si l’on surmonte ces réserves, on peut apprécier la cohérence du propos.
Il s’y fait souvent plus chroniqueur qu’historien, utilisant l’arrière fond de ses connaissances historiographiques pour faire un tableau sans pitié de l’histoire qu’il voit se dérouler devant lui. Moraliste, il s’y fait le critique le plus fervent de l’individualisme contemporain, de l’atomisation sociale, et du broyage lent de la famille traditionnelle, prise en étau par l’extension concomitante du domaine du marché et de celui de l’État.
Lasch fait l’objet d’un culte souterrain. Culte parce qu’un fan-club réduit se plaît à soutenir que la majorité de ses hypothèses prospectives se sont vérifiées plus que quiconque n’aurait osé l’imaginer4. Souterrain, parce que ses analyses détonnent souvent avec ce qu’il est de bon ton de professer dans la sphère médiatique. Souterrain, aussi, parce que Lasch est inclassable. Car Lasch n’a eu de cesse de rejeter l’artificialité des clivages du monde politique contemporain. À une époque où il fallait choisir entre le New York Times ou la National Review pour mieux arriver dans le monde, il n’a appartenu ni à l’un ni à l’autre.
Réactionnaire pour les uns, il est trop progressiste pour les autres. Critiquer en même temps l’impérialisme américain et la révolution sexuelle lui a valu les foudres des uns et des autres. C’est cette ambiguïté fondamentale qui le plonge dans la solitude et, il faut le souligner également, le conduit à un échec politique violent. La révolte des élites est un livre où se disputent le fatalisme et l’amertume.
On le rapproche souvent, outre-Atlantique, de Cornelius Castoriadis. Il n’y connaîtra que peu de continuateurs en France. On ne pourra citer comme héritier notable que Jean-Claude Michéa5, à qui nous devons la préface de la présente réédition6. Son statut en marge du système universitaire empêche d’y voir une reconnaissance officielle. Exception qui mérite d’être notée, un livre lui a été consacré par Renaud Beauchard, professeur d’université à Washington7.
L’une des œuvres antérieures de Lasch avait fait l’objet d’une publication dans une collection dirigée par Emmanuel Todd chez Robert Laffont 8. On reconnaît l’influence de Lasch sur toute une série de sujets qui parcourent son travail (la stratification éducative, l’évolution des mœurs…). Mais il prend lui-même ses distances. Dans son essai politique sur la crise des gilets jaunes 9 il se méfie d’un auteur qu’il trouve un peu moralisant.
Lasch historien

(Source : Université de Rochester)
Lasch est un historien étrange. Il refuse de mettre en avant les marques formelles de sa démonstration. Il n’hésite pas çà et là à faire des emprunts à la psychanalyse. C’est la partie de son livre qui est incontestablement datée. Tout son appareillage empirique est par ailleurs renvoyé en bibliographie. Cette démarche ne peut qu’agacer le quantitativiste ou l’amateur d’histoire sérielle10. Lasch demande trop souvent qu’on le croie sur parole. Pire, peut-être, il prend un ton de prêcheur.
Si l’on surmonte ces réserves, on peut apprécier la cohérence du propos. La Révolte des élites est avant tout une tentative d’histoire récente. Il y fait défiler l’essentiel des mutations de la vie américaine et de ses élites depuis la fondation du New Deal. Prenons un homme dans ces élites. Appelons-le John Junior (Jr). John Jr est le fils d’un militaire. Son père est un patricien de la côte est. Un bon épiscopalien. Sa famille a fondé les États-Unis. C’est ce qu’il vous dira.
John Senior a fait la Seconde Guerre mondiale. Comme tant d’homme de l’aristocratie américaine, il a été poussé par la culture de son milieu, pleine de patriotisme et d’esprit du devoir. En rentrant il est devenu homme d’affaires. Quelques années plus tard, il s’est fait élire comme député dans la législature de son État. Quelques années après, il était sénateur au Congrès.
John Junior n’ose pas le dire, mais il trouve ça désuet. Comme beaucoup de jeunes diplômés des nouvelles classes supérieures, il a pu éviter ou reporter sa participation à la Guerre du Vietnam. Les rednecks de son âge, enfants de ceux que son père avait commandés en Normandie n’eurent pas ce privilège. John Jr est devenu conseiller juridique dans une grande firme à New York. Son fils, plus tard, ira en Californie.
Ce qui peut arriver aux Américains de l’intérieur ne l’intéresse pas. Comme beaucoup de jeunes diplômés, il a fait sécession par le haut. Au fil de sa carrière il a vu bien des choses passés. Enfant du baby-boom, il a gardé le plein emploi. Quand les usines ont fermé, il ne s’est pas inquiété. Pour lui c’était normal. Il faut que les rednecks s’adaptent. “Le monde il bouge et il bouge vite.” Ils n’avaient qu’à faire des études. Ou s’ils n’ont pas pu en faire, c’est parce qu’ils ne sont pas intelligents.
John Jr ne croit plus en la démocratie. Il trouve que c’est idiot. Idiot parce que les rednecks sont bêtes, pas très utiles et mal éduqués. C’est ce qu’il vous dira. S’il lui professe un profond attachement, ce n’est plus que par pure convention sociale. Ses collègues sont passés par le supérieur. Ils pensent tous comme lui.
Dans une société où le débat public fondé sur des questions matérielles (salaires, infrastructures) a disparu il est tout à fait rationnel de déposséder l’État de ses leviers d’action au profit d’institutions subsidiaires dédiées au clientélisme local et à la représentation symbolique des minorités.
John Jr peut sembler inférieur à ce qu’était son père. Dans les faits, il l’est. Ce n’est qu’en tant que bloc sociologique que sa puissance s’est accrue. John Sr était pris dans la masse nationale. Le groupe des patriciens de la côte Est, très fermé, n’a jamais prétendu à l’autarcie. John Jr quant à lui peut vivre dans son milieu. Avec les enfants du reste de l’aristocratie américaine, il a été rejoint par les transfuges des classes populaires, aspirés par le système scolaire. Ils se sont regroupés dans des villes pour eux, des quartiers pour eux. Par effet de polarisation géographique, sur des États tous entiers. Ils ont leurs propres élus, au local et au fédéral. Ils n’ont plus de compromis à faire, ou alors à la marge.
Lasch plus que personne avait compris la puissance politique de ce mépris social des nouveaux éduqués. A la suite de Michael Young11, ce livre en est la longue démonstration. Ce qui était à l’état d’intuition à son époque prend sa pleine force aujourd’hui.
Il montre le renfermement sur lui-même de ce groupe. Renfermement géographique, politique, mais aussi professionnel. Les ascensions sociales spontanées, fondées par l’expérience empirique du travail et de la vie quotidienne sont en déclin. À la place il faut un diplôme pour tout, et les éduqués supérieurs se recrutent entre eux, en silo. Le civisme, moteur populiste de la démocratie américaine, s’est enrayé. Lasch en tire deux conséquences principales, fruits de l’évolution intellectuelle des John Jr d’Amérique.
Lutte culturelle contre lutte sociale
Il croit observer un décalage complet quant aux débats idéologiques qui ont cours au sein des élites. Incapables de s’opposer sincèrement les uns aux autres sur des questions d’ordre matériel, les éduqués supérieurs ont ravivé la politique comme lutte culturelle (dévoiement de la question des LGBT sur des luttes symboliques et marginales, questions migratoires, etc). C’est une grande lutte symbolique entre le Bien et le Mal, où le Progrès doit triompher. Elle s’oppose aux aspirations fondamentales des Américains, qui font converger d’un côté le modèle familial traditionnel, le travail et la probité, avec la défense d’un État social minimal fondé sur l’aide ponctuelle à ceux qui traversent une phase difficile. Par le jeu des partis, ils ont aujourd’hui tout perdu.
En conséquence, le communautarisme est érigé en modèle national. Il faut comprendre sa cohérence avant de le critiquer : dans une société où le débat public fondé sur des questions matérielles (salaires, infrastructures) a disparu il est tout à fait rationnel de déposséder l’État de ses leviers d’action au profit d’institutions subsidiaires dédiées au clientélisme local et à la représentation symbolique des minorités.
Mais la défense acharnée de la diversité est aussi une conséquence de la lutte culturelle. Elle pose comme enjeu moral central l’exaltation de différences ethniques marginales entre des groupes aux intérêts convergents. Si John Jr a plus de sympathie pour les Noirs et les Latinos que pour les rednecks, ils n’en sont pas moins plus économiquement proches les uns des autres qu’ils ne le seront jamais de lui.
En découle aussi une gestion quartier par quartier. John Jr et les siens sont paternalistes. Ils cultivent une clientèle afro-américaine, mais ne lui feraient jamais confiance pour élever ses propres enfants. La vie familiale de quartiers tout entier est donc absorbée par ceux que Lasch appelle les “professionnels de la pauvreté” et la bureaucratie de l’assistance sociale.
Cette désagrégation accompagne le déclin des rôles traditionnels. Lasch étudie le déclin des solidarités de quartier et de la segmentation des activités des adultes. Loin de faciliter la cohabitation, la disparition progressive des sociabilités spécifiquement masculines ou spécifiquement féminines a un impact sur la psychologie des adultes, et supprime un bon nombre de soupapes de décompression. La disparition de la vie de quartier quant à elle, prive les enfants d’une éducation qui s’était toujours partiellement faite en dehors du foyer.
Non contents d’avoir détruit les réseaux traditionnels de confiance, John Jr et les siens ont prétendu en créer de nouveaux. Ils ont exalté le statut de victime. Ils ont encouragé les mouvements communautaires. Plutôt que de respecter le caractère civique de la lutte pour l’égalité – sans parler de sa dimension économique -, ils n’ont voulu voir que dans les Noirs des victimes immémoriales. De là un mépris pour leur éducation, où sous prétexte de ne pas les aliéner à la culture blanche fut toléré qu’on enseigne aux enfants noirs des programmes aux rabais.
On ne comprendrait pas la puissance de la chute sans la préciser un peu. Lasch fait une histoire du déclin de la presse. Il montre que les têtes qui sortent vides du système scolaire perdent toute chance de se remplir. Ou alors plus par le biais des chaînes traditionnelles. Le conformisme et la culture des relations publiques ont vidé la grande presse de toute forme d’intérêt. De là découle le déclin des mots dont le stade final est un monde inversé.
« Somme de passages percutants et de chapitres inutiles, le livre est étrange », notait Serge Halimi. Nous ajouterions : pour comprendre la pertinence comme les limites du sentiment de “sécession des élites” qui caractérise l’esprit du temps, il faut lire Lasch.
Et la dégradation du langage ne trouve aucun secours dans l’Université. Lasch reproche aux universitaires de s’être réfugiés derrière un jargon incompréhensible qu’ils parviennent à faire passer à leurs yeux hallucinés pour de la scientificité. Loin de défendre le canon, ils s’y attaquent par un pseudo-radicalisme qui ne parvient à faire illusion qu’auprès de leurs critiques droitiers, ravis d’avoir enfin trouvé une hydre. Lutter contre cette hydre devient alors le sport national de la droite américaine, à défaut de proposer un véritable projet de société.
Lasch moraliste
Qualifier Lasch de moraliste, c’est commettre un doux euphémisme. Lasch est un auteur intensément moral. Il oscille tour à tour entre le dévoilement ironique propre aux moralistes classiques (La Bruyère, La Rochefoucauld), la violence des pamphlétaires marxistes et le lyrisme vigoureux du prêcheur évangélique. C’est, en fonction du goût, ce qui fait son charme ou les pires de ses défauts.
Lasch ne cache pas sa préférence pour les anciennes élites. “Elles au moins avaient le sens des responsabilités.” L’adhésion à des valeurs collectives comme le patriotisme et la foi chrétienne avait l’effet d’un contrôle anthropologique sur leurs esprits. Elles atténuaient par là la brutalité du capitalisme de marché. Elles pouvaient mépriser le peuple, mais “c’était le leur“. Et le refus des élites de se préoccuper du peuple, c’est la fin de la démocratie. Les derniers chapitres de La Révolte des élites sont si moraux qu’ils en sont presque métaphysiques. Le début de l’essai déjà, annonçait la couleur. Au chapitre 4, Lasch ne se demande pas si la démocratie peut survivre. Il se demande si elle le “mérite”. C’est incontestablement l’une des limites de Lasch, qui tend comme le notait Serge Halimi à sous-estimer la brutalité des élites du passé.
Ces réserves, profondes, n’enlèvent rien au caractère contemporain de sa critique des élites. On peut y trouver une filiation dans l’œuvre de Christophe Guilluy. Sa France périphérique12, c’est Lasch spatialisé, et actualisé au contexte français. En effet, la métropolisation conclut le processus lent de séparation des élites du reste de la population. Elles ont achevé par la distance physique leur séparation de classes populaires avec qui elles ne sentent plus rien de commun et qu’elles ont abandonnées dans la mondialisation.
Sa pensée gagnerait-elle à être étudiée en France ? Dans le conflit des gauches, Lasch a incontestablement un rôle à jouer. Sa critique au vitriol du progressisme libéral, qui n’est liée en rien aux intérêts réels de la majorité de la population, trouve un écho tout particulier dans le contexte de la primaire EELV.
« Somme de passages percutants et de chapitres inutiles, le livre est étrange », notait Serge Halimi : « juste et sommaire, stimulant et irrecevable, subversif et réactionnaire ». Nous ajouterions : pour comprendre la pertinence comme les limites du sentiment de “sécession des élites” qui caractérise l’esprit du temps, il faut lire Lasch.
Notes
1. Christopher Lasch. Culture of Narcissism : American Life in An Age of Diminishing Expectations. WW Norton & Co, 1979.
2. Christopher Lasch. The Revolt of the Elites And the Betrayal of Democracy. WW Norton & Co, 1994
3. Christopher Lasch. Women and the Common Life : Love, Marriage, and Feminism. 1997.
4. On laissera au lecteur le soin de juger dans quelle mesure, cf supra.
5. Philosophe d’obédience marxiste.
6. Christopher Lasch. La Révolte Des Elites – Et La Trahison de La Démocratie. Champs Essais. Flammarion, 2020.
7. Renaud Beauchard. Christopher Lasch : Un Populisme Vertueux. Le Bien Commun. Paris : Michalon éditeur, 2018. isbn : 978-2-84186-898-8.
8. Christopher Lasch. Le complexe de Narcisse : la nouvelle sensibilité américaine. French. Paris : Éditions Robert Laffont, 1981. isbn : 978-2-221-00621-4.
9. Emmanuel Todd et Baptiste Touverey. Les Luttes de Classes En France Au XXIe Siècle. Paris XIXe : Éditions du Seuil, 2020. isbn : 978-2-02-142682-3.
10. Courant historiographique qui s’est développé dans les années 1950 à 1970. Il a proposé une lecture de l’histoire appuyée sur les sources chiffrées et leur analyse à long terme.
11. Auteur de The Rise of the Meritocracy, en 1958, où il invente le terme. En 2034, sa dysto- pie offre le tableau de ce que donnerait selon lui une société qui se prétend gouvernée par l’équation QI+Effort=Mérite.
12. Christophe Guilluy. La France Périphérique : Comment on a Sacrifié Les Classes Populaires. Paris : Flammarion, 2014. isbn : 978-2-08-131257-9.



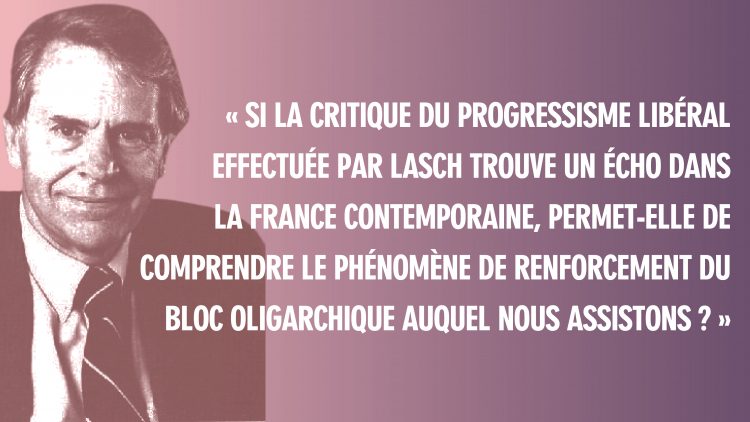


















 Cet antagonisme politique aboutit aux journées du 31 mai et du 2 juin 1793 lorsque la Convention est entouré par 80 000 hommes issus de la Garde nationale et des sections parisiennes. Elle doit alors se plier aux revendications de mettre en accusation plusieurs députés girondins. Ces journées essentielles voient ainsi la Convention passer sous la mainmise des Montagnards, soutenus par la Plaine.
Cet antagonisme politique aboutit aux journées du 31 mai et du 2 juin 1793 lorsque la Convention est entouré par 80 000 hommes issus de la Garde nationale et des sections parisiennes. Elle doit alors se plier aux revendications de mettre en accusation plusieurs députés girondins. Ces journées essentielles voient ainsi la Convention passer sous la mainmise des Montagnards, soutenus par la Plaine.