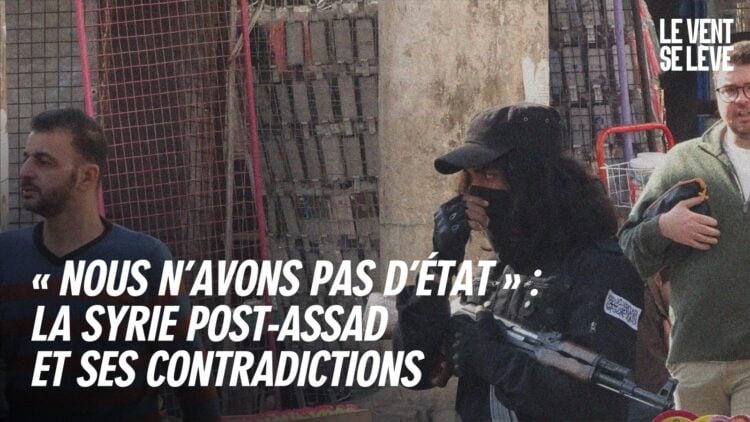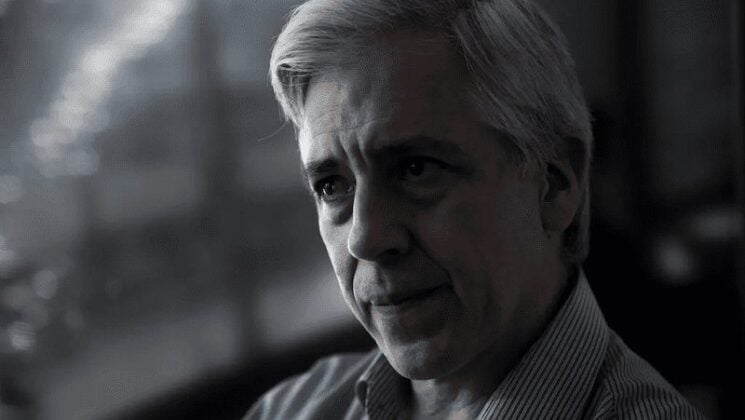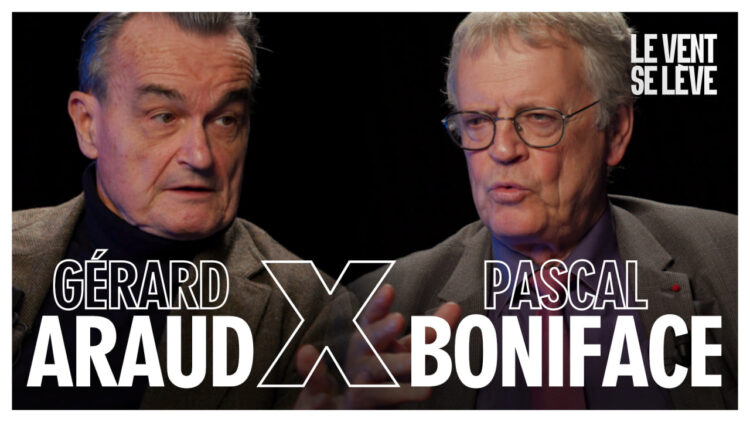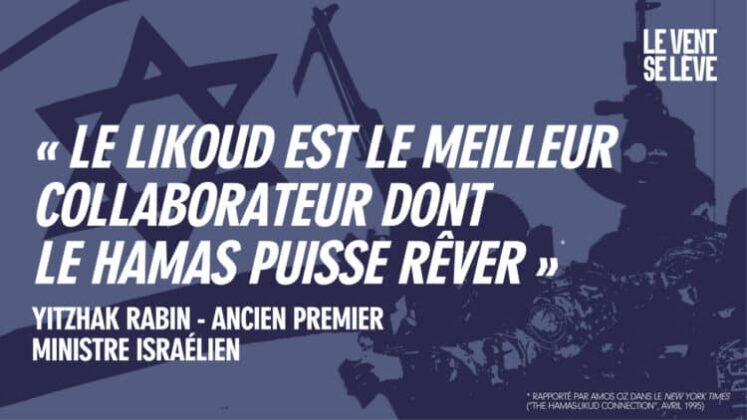Si les interrogations autour du Hayat Tahrir al-Sham (HTS, la milice au pouvoir en Syrie) ont cristallisé l’attention de la presse, un autre phénomène est demeuré dans l’ombre : le démantèlement de l’État hérité de l’ère Assad. Autour de 300.000 fonctionnaires ont été licenciés, au motif de lutter contre un système clientéliste. Sur ses décombres renaît une société civile bridée par des décennies d’autocratie, mais aussi une violence anti-alaouite exponentielle. Dans ce vide s’engouffrent des puissances étrangères, et notamment la Turquie, avec l’aide de laquelle le HTS a conquis le pouvoir. Bien davantage que de Damas, c’est autour d’Idlib que semble désormais graviter la Syrie. Et tandis qu’une libéralisation tous azimuts menace de faire progresser la pauvreté, les sanctions financières continuent d’étouffer le pays. Reportage.
« Nous ne sommes pas alaouites, sunnites, chrétiens ou druzes. Nous sommes Syriens ». Dans l’hôtel Safir de Homs, 150 kilomètres au nord de Damas, une conférence est organisée début janvier, à l’initiative de plusieurs ONG. Les prises de parole se succèdent, souvent passionnées. « Les gens ont soif de parler », sourit un organisateur. Dans le public, un homme prend le micro. Alaouite, il évoque la peur qui habite sa communauté. Assimilée au régime d’Assad, elle est victime d’agressions qui ne décélèrent pas. Puis : « pour avancer vers la réconciliation, il faut aussi que nous, alaouites, acceptions de nous questionner quant à notre attitude sous Assad. Sur notre silence, sur notre passivité ». Applaudissements.
La conférence chargée de dissoudre les milices en unités civiques de sécurité a été repoussée à juin. Aura-t-elle jamais lieu ?
À la fin de l’événement, on regrette que le HTS ait poliment décliné l’invitation, prétextant un conflit d’agenda. Et que la conférence ait avant tout réuni les intellectuels de Homs. On se promet d’organiser la suivante dans « un lieu populaire ». Mais tout de même : c’est un début. Et un instant de fraternité partagée, dans un contexte inflammable. Soudain, l’étincelle tant redoutée crépite.

Dans le hall, des hurlements interrompent les discussion. Un homme de haute stature, l’oeil balafré, tonne contre « une communauté hostile à la nouvelle Syrie » et nostalgique d’Assad. Il dénonce la « protection policière » dont elle bénéficie. Il critique l’installation de checkpoints autour de ses quartiers, visant à les mettre à l’abri des agressions. Il faut que cette communauté ressente la peur, autrement elle se sentira puissante. « Alaouites » : le mot est lâché. « Discours de haine », résume un spectateur. Il se désole : « c’est tout ce que les gens retiendront de cette réunion ».
« Qui sont ces criminels encagoulés ? Impossible de le savoir »
« Nous n’avons pas d’État ». Dans un appartement de Homs, cette phrase revient comme un refrain. Depuis la chute d’Assad, on s’aventure peu à y sortir de nuit.
Cette ville a connu les bombardements les plus aveugles de l’armée syrienne, et plusieurs exactions commises à l’encontre des alaouites par l’opposition. Si l’architecture porte les cicatrices du conflit, les habitants demeurent hantés par les massacres perpétrés. Ils peinent à prendre toute la mesure du changement de régime.
« Je ne sais que penser. C’est un sentiment nouveau ». Aux côtés de sa tante et de son oncle, Mariam [1], jeune fabricante de produits cosmétiques, fait part de ses impressions successives. D’abord l’euphorie consécutive à la chute d’Assad. À son évocation, sa tante se lève en hurlant de joie. Elle se précipite dans une pièce voisine, et revient nous offrir une crème ornée d’un drapeau de la « nouvelle Syrie ». Un cadeau qu’elle a spontanément confectionné pour son entourage, explique-t-elle. Ancienne communiste, elle avait été détenue et torturée sous Hafez al-Assad. Fervent soutien de la révolution syrienne, elle s’en est éloignée à mesure que des éléments islamistes la phagocytaient. Elle déplore la perte de sa soeur, communiste elle aussi, assassinée par l’État islamique.
Dans un premier temps, les actions du HTS ont rassuré cette famille alaouite. « Notre communauté s’attendait à un génocide. Cela n’a pas été le cas ». Exécutions d’ex-soutiens d’Assad, climat d’insécurité, menaces sporadiques dirigées contre les alaouites, attaques isolées, mais nulle épuration. Et des appels à la concorde du président Ahmed al-Charaa (qui affiche volontiers son nom d’état civil et non de chef de guerre, Abou Mohammed al-Jolani).

Pourtant, les semaines passant, l’intensité des agressions n’a pas diminué. Il est rare qu’un jour ne charrie pas son lot de tueries. Répression d’anciens partisans du régime ? Délinquance ordinaire ? Crimes de haine à l’encontre des alaouites, perpétrés par des fanatiques isolés ? Par des membres du HTS ? Ou commandités par la hiérarchie ?
« Impossible de savoir », résume Hossein, l’oncle de Mariam, « car il n’y a pas de police régulière. Nous n’avons pas d’État ». L’ensemble des fonctionnaires de police ayant été limogés, c’est la milice HTS elle-même qui assure le maintien de l’ordre. Encagoulés, en treillis ou de noir vêtus, sans unité vestimentaire mais armés d’une mitraillette, ils patrouillent de jour comme de nuit, et quadrillent le pays de checkpoints. Il n’est pas difficile pour des criminels d’usurper leur identité. Ou pour des militants HTS de commettre des crimes : comment les reconnaître derrière leur masque ? Et auprès de qui se plaindre ?
[NDLR : cet article repose sur un reportage effectué en janvier 2025 ; une unité de sécurité « civile » a été mise en place par les autorités, institutionnellement séparée du HTS depuis mars. Du moins officiellement]
« Les autorités pourraient faire davantage pour nous protéger », continue Hossein, hésitant. Il souhaite effectuer un jugement équilibré sur le HTS – qu’il ne cesse de curieusement de nommer Jabhat al-Nosra, le nom de la milice à l’époque où elle était affiliée à al-Qaeda[2]. Il porte un regard critique sur le manque de recul de sa communauté. Il déplore l’incapacité des alaouites à comprendre d’où vient la défiance à leur égard. Et notamment de treize années de division entretenue par Assad, qui cooptait des alaouites dans les forces de sécurité.
Il souligne l’imprévisibilité et l’opportunisme du nouveau pouvoir. Mais aussi son impuissance : « même si les autorités le souhaitaient, dans l’état actuel des choses, elles ne pourraient pas vraiment nous protéger ». Ahmed al-Charaa avait prévu une conférence nationale en mars, destinée à unifier les milices en une police nationale. Elle a été repoussée à juin. Aura-t-elle jamais lieu ? En attendant sa tenue, ce seront les mêmes milices qui continueront d’assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Et qui seront à l’origine des mêmes accidents ? « Nous n’avons pas d’État », répète Hossein.
Démantèlement d’un système clientéliste ou purge néolibérale ?
Le HTS a procédé à un démantèlement méthodique des institutions héritées du régime d’Assad. D’un certain point de vue, il s’agit du plan d’austérité budgétaire le plus radical que le monde ait connu ces dernières années. Sur un million de fonctionnaires, pas moins de 300.000 ont été licenciés, parmi lesquels l’intégralité des militaires et policiers. En décembre, le paiement des salaires et des retraites a été suspendu. En janvier, il n’a repris que progressivement. Fin février, certains fonctionnaires n’avaient rien touché depuis novembre.
Outre des motivations budgétaires, le HTS met en avant la la lutte contre un système clientéliste. Des anecdotes de profiteurs des deniers publics reviennent sans arrêt. « Certains cumulaient six emplois publics, et six salaires », proteste une Damascène, fraîchement revenue du Qatar où elle était exilée. « La régime d’Assad fonctionnait de cette manière : en achetant la loyauté des agents publics. Il faut que cela change ». « Les fonctionnaires jouent un rôle redistributif important, nuance l’employé d’une centrale électrique. Il existait bien des cas de corruption. Mais s’il s’agit de licencier les oisifs, pourquoi ne pas effectuer des contrôles ? Il aurait suffi d’ouvrir la porte des bureaux ! »

À Damas, en ce début de janvier, le futur semble ouvert. Le pire est encore possible, mais il n’est plus certain. On sait gré aux autorités d’avoir fait droit à un pluralisme que l’on n’attendait pas d’une milice islamiste. Ainsi, à quelques centaines de mètres des ministères, une conférence est organisée par l’association féministe « Mouvement politique des femmes syriennes » dans l’hôtel Sham Palace. Un événement impensable sous Assad, qui satellisait l’ensemble des initiatives citoyennes sous sa férule. « Nous devons construire la nouvelle Syrie avec le HTS, et contre le HTS », résume une organisatrice. Elle se montre un brin agacée de la stupeur des Occidentaux face à la tenue d’un tel événement.
Tandis que nous commentons l’incongruité apparente de la situation dans un café damascène, un tintement ferrailleux résonne entre les discussions. Notre interlocuteur Mahmoud, artiste et écrivain, sourit : « ça me rappelle les bruits de mon enfance ». Il s’agit d’un vendeur de gaz qui fait le tour de la ville en camion, et frappe sur ses bonbonnes avec une clef en métal. « C’est un bruit magnifique pour les Syriens. Sous Assad, nous n’avions accès qu’au gaz subventionné par l’État, qui suffisait à peine pour deux ou trois jours. À présent, il est disponible en excès. »
L’optimisme est alimenté par l’abondance qui revient sur les marchés. La profusion, même. Depuis que les contrôles arbitraires ont été levés et que les échanges avec les pays limitrophes ont repris, les étals sont pleins. Mais les Syriens peuvent-ils acheter ces produits ?
« Ma retraite ne me suffisait pas à acheter la moitié de ces médicaments, et le HTS l’a supprimée »
« La pauvreté s’est sans doute accentuée depuis depuis la chute du régime », estime Akram Kachee, docteur en économie, auteur d’une thèse d’économie sur la crise de régime syrienne. « Alors que la Syrie a, plus que jamais, besoin d’investissements massifs et d’une sécurité sociale, le régime a imposé une vision néolibérale ». Outre le licenciement des centaines de milliers de fonctionnaires, il mentionne la libéralisation des prix des produits de première nécessité – le sachet de pain, bloqué à 700 livres syriennes en novembre, s’achète désormais à 4.000 livres.
Au sein de la « société civile » renaissante de Damas, on considère qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour rebâtir l’économie syrienne. Et on s’inquiète moins des velléités hégémoniques du HTS que de sa faiblesse. On considère avec déplaisir, au sud, l’arrogance de l’armée israélienne. Et, au nord, l’omnipotence de la Turquie. On observe d’ailleurs la multiplication de produits turcs à bas coût sur les marchés – jusqu’aux bouteilles d’eau dans les bars -, et on s’enquiert de leur impact sur la production syrienne.

Mais depuis Damas, le Golan occupé par Israël et Idlib contrôlée par les Turcs semblent encore loin. À l’abord d’un bus pour Lattakié, un mendiant nous tend un billet, qu’il souhaite vendre contre des dollars : il s’agit d’une livre turque.
« Pensez-vous que nous ayons profité du régime d’Assad ? »
La région côtière au climat doux de Lattakié alimente toutes les controverses. Des éléments armés du gouvernement précédent y demeurent, ainsi que deux bases russes. Fief de la famille Assad, elle concentre une forte proportion d’alaouites. Depuis la chute du régime, ils sont la cible d’exactions régulières.
« Je défie qui que ce soit de dire que nous avons profité du régime d’Assad : regardez notre misère », proteste Layla, retraitée de Lattakié. Contrairement à Homs, la ville ne présente nul paysage désolé par les bombardements ; mais dans les foyers, le dénuement y est plus accentué. L’électricité publique y est rationnée à l’extrême : elle ne fonctionne que trente minutes toutes les douze heures. Pour de nombreux ménages, trop pauvres pour avoir accès à des sources alternatives, c’est l’unique moyen à disposition pour s’éclairer ou se chauffer.
Lattakié a été épargnée par la guerre. Mais elle a été touchée de plein fouet par les sanctions financières, notamment nord-américaines. Ciblant l’énergie et la Banque centrale dès 2011, elles se sont progressivement étendues à de nombreux secteurs de l’économie. Le Caesar Act de 2019 accentue les sanctions dites « secondaires » : les banques qui financent les entreprises commerçant avec la Syrie sont menacées d’être débranchées du système financier international. Leur effet désincitatif est considérable.
« Ces sanctions ont été plus dures que celles contre l’Iran ou la Russie, analyse Akram Kachee. Mais la Syrie n’a pas une taille et une marge de manoeuvre similaires à celles de l’Iran ou de la Russie. Elle ne peut pas vendre son pétrole à la Chine comme l’Iran, ou construire une économie de guerre comme la Russie. » Les effets macro-économiques des sanctions sont conséquents. En 2011, un dollar s’échangeait contre 50 livres syriennes. En 2025, il permet d’en obtenir 11.000. Les réserves de change de la Banque centrale ont été réduites à néant.
Avec l’isolement, les habitants ont découvert les pénuries de masse. « Nous avions l’un des secteurs pharmaceutiques les plus florissants de la région », évoque Haya, pharmacienne. Aujourd’hui, il est au bord de l’écroulement. « Plusieurs fois, des clients ont été hospitalisés parce qu’ils s’effondraient sous nos yeux, après avoir vainement réclamé un médicament. Chaque jour, je dois refuser des produits. Les prix sont tels qu’on ne me demande plus des paquets, mais seulement des pilules individuelles. Avec mes collèges, nous plaisantons en disant qu’un jour, quelqu’un nous demandera peut-être une tablette entière ! ».
Layla souffre de maladies cardio-vasculaires. Dans un appartement tamisé, dont la fumée des cigarettes et tasses de maté fait varier les nuances de gris, elle fait défiler sous nos yeux les médicaments qui lui sont prescrits. « Une boîte de rosova, qui permet de réduire le cholestérol, coûte 16.000 livres. C’est huit fois plus qu’avant les sanctions. Le valsartan permet de contrôler l’hypertension artérielle : son prix a triplé. »

Elle expose une autre boîte : « voici de l’alfacalcidol ». En raison de ses maux cardiovasculaires, Layla a subi une ablation des glandes parathyroïdes, qui affecte la régulation de calcium de son organisme. L’alfacalcidol lui est indispensable pour éviter une carence de cette matière argentée : « En 2011, une boîte me revenait à 1.000 livres syriennes. Aujourd’hui, elle coûte 51.000 livres ! Ma retraite ne me suffisait pas à acheter la moitié de ces médicaments ». Une retraite dont le paiement a été suspendu par le HTS, comme celle de tous les fonctionnaires.
Les coupes budgétaires consécutives à sa prise de pouvoir ont accentué un dénuement déjà massif. Les principales avenues de Lattakié regorgent d’étals où l’on vend des habits d’occasion. « Ce sont ces retraités privés de retraite, commente Majd, jeune informaticien. Il n’ont plus que leurs habits à vendre ».
Les secteur de l’énergie n’a été épargné ni par les sanctions, ni par les réformes du HTS. Privée de sources étrangères, la Syrie a dû compter sur un sous-sol pétrolifère et gazifère qui lui échappe largement : l’or noir abondant de Deir ez-Zor, dans l’Est du pays, est sous contrôle de forces kurdes soutenues par l’OTAN, tandis que le gaz du nord est sous emprise turque. Avec la guerre, l’extraction pétrolière a été divisée par huit, et l’extraction gazière par trois, tandis que le prix de marché d’une bonbonne a été décuplé. Et le HTS a tout bonnement supprimé les subventions sur le gaz…
Ces mesures libérales de choc ont pu être interprétées comme autant de signaux aux investisseurs, notamment occidentaux, afin d’inciter à une levée des sanctions. Celle-ci n’est pas encore à l’ordre du jour : si l’Union européenne multiplie les déclarations, si les États-Unis envisagent de multiples exemptions, les restrictions demeurent sur l’énergie et la Banque centrale. Pour l’heure, la Syrie expérimente les effets combinés d’un embargo financier et d’une thérapie de choc.
Dans la pénombre de son appartement, nous écoutons Layla nous détailler cette évolution. Soudain, l’appartement s’illumine, et tout un chacun se précipite pour recharger son téléphone portable. Pour une demi-heure, le foyer aura accès à l’électricité.
« Êtes-vous alaouite ? »
« Hier soir, le lieu de travail de mon voisin a été pillé », confie un passant. « Quelques heures plus tôt, deux membres du HTS étaient venu le voir, en lui avaient demandé : “êtes-vous alaouite ?”. Nous ne sommes pas habitués à cette violence confessionnelle ».
Damas décide-t-elle encore de quoi que ce soit en Syrie ?
Au sein de la mosaïque religieuse de Syrie, les alaouites de Lattakié aiment à souligner leur singularité. Non sans un brin d’orgueil : « nous sommes musulmans, nous lisons le Coran, déclare Layla. Nous buvons aussi du vin, nous faisons la fête, nous n’avons pas d’interdits vestimentaires, nous nous mêlons aux autres communautés. C’était notre vie, avant la prise de pouvoir d’Ahmed al-Charaa ». Elle ajoute : « Nous sommes culturellement étrangers au fanatisme du HTS. État islamique, Al-Nosra, Hayat Tahrir al-Sham… ce sont les mêmes ».
La région de Lattakié a été brutalement tirée de son innocence en décembre 2024, lorsque l’aviation israélienne a bombardé ses infrastructures militaires. Puis, lorsque la milice HTS est survenue, armes à la main. Ali se remémore ce changement d’époque : « En quelques heures, “HTS” est apparu dans notre vocabulaire ». Les deux premiers jours ont été pacifiques, même si l’invasion de l’espace public par des miliciens encagoulés a soulevé quelques inquiétudes. « Sur la plage, autrefois très fréquentée, j’ai vu des combattants de toute nationalités y affluer, avec leurs femmes en niqab. Certains avaient un phénotype est-asiatique. Ce sont sans doute des djihadistes ouïghours ». Puis les incidents se sont multipliés.

Layla ne sort de chez elle que quelques heures par jour. « Deux de mes cousins ont été tués. L’un d’entre eux était un ancien officier, qui avait quitté l’armée pour ouvrir un petit commerce. Il a été abattu par balles ; des personnes encagoulées sont arrivées en voiture puis ont fui ». Un autre a été retrouvé décapité. « Il n’avait que vingt ans ».
Attaques terroristes isolées ? Brigandage ordinaire grimé en attentats djihadistes ? Actions du HTS lui-même ? Son fonctionnement milicien limite le contrôle sur ses éléments. « L’un de mes amis proches – traumatisé, qui refuse d’en parler aux étrangers – a été séquestré par trois hommes encagoulés prétendant être du HTS, rapporte Majd. Ils lui ont tiré une balle dans la cuisse, voulant lui faire avouer sa participation à des actions pro-Assad. Après quelques minutes de torture, mon ami leur a donné le nom de connaissances haut-placées à Idlib. Surpris, ils l’ont relâché et se sont confondus en excuses. Le lendemain, nous nous sommes rendus auprès des autorités. Elle nous ont rétorqué que ces agresseurs n’étaient pas membres du HTS. Comment aurions-nous pu requérir une enquête ? Mon ami n’a pas même vu leur visage ».
Beaucoup ne voient dans le discours d’unité nationale d’Ahmad al-Charaa qu’une manoeuvre tactique à destination de l’Occident. Et ceux qui lui prêtent une réelle volonté d’apaisement estiment que le véritable centre du pouvoir syrien ne se trouve plus à Damas.
« Nous appartenons à la Turquie, à présent »
À Idlib, fief du HTS depuis 2016, la présence turque ne cherche pas à se faire discrète. Trente kilomètres à l’Ouest de la ville, c’est un gigantesque drapeau rouge orné d’un croissant et d’une étoile que croisent les autobus. Sur place, la livre turque y a cours légal ; si le dollar circule en parallèle, les billets syriens, eux, ont cessé d’être utilisés. Et c’est un système de télécommunications basé à Ankara qui a remplacé le précédent.
Idlib constitue l’une des portes d’entrée des produits turcs à bas coût qui se répandent dans le pays. Au point de compromettre la relance d’une production endogène ? « Dans de nombreux contextes post-conflits, le monnaie s’est appréciée de manière significative, mais cela n’a pas été le cas en Syrie, note Akram Kachee. Le contraire serait étonnant : la production syrienne est au point mort. Une monnaie stable et forte s’appuie sur une industrie, locomotive de l’économie. Le nouveau pouvoir, en actant l’ouverture des frontières aux produits turcs, ne semble pas indiquer qu’il souhaite reconstruire la production syrienne », estime-t-il.

Récemment, les autorités syriennes ont bien réhaussé les barrières tarifaires sur les produits turcs, afin de les harmoniser avec celles des autres pays limitrophes. Mais l’ampleur de l’ingérence turque et l’hybridation des institutions d’Idlib avec celles de son parrain du nord jettent un doute sur l’effectivité des contrôles.
À Idlib, le caractère transnational du HTS apparaît aussi plus nettement. Les anciens djihadistes en provenance d’Asie centrale ou de Chine, qui avaient rallié l’État islamique avant de suivre la scission d’al-Charaa, sont aisément visibles. « L’arabe de plusieurs miliciens HTS n’est pas natif, déclare un local. Certains viennent de pays asiatiques environnants. Parfois même d’Europe ».
Idlib se trouve-t-elle encore en territoire syrien ? « Nous appartenons à la Turquie à présent », lâche un lycéen d’Idlib. Avant de se reprendre : « seulement pour le monnaie ». Puis de préciser : « ma mère a été tuée il y a dix ans dans un bombardement du régime. Les Turcs ont été nos libérateurs ».
À Damas, Mahmoud médite sur les contradictions de la « nouvelle Syrie ». Il veut croire que les tensions sociales qui éclosent ici et là, les agressions contre les alaouites, les pratiques miliciennes du HTS, ne sont que les inévitables douleurs qui accompagnent l’accouchement d’une ère nouvelle. « On ne peut pas mettre fin à treize ans de haine tout en douceur », regrette-t-il. Il ose croire que les mouvements citoyens permettront à une véritable « Syrie démocratique » d’éclore. « Depuis décembre, à Damas, on a goûté à la liberté. On ne pourra plus nous l’enlever ». Mais Damas décide-t-elle encore de quoi que ce soit en Syrie ?
Notes :
[1] Le nom de tous les Syriens mentionnés dans l’article a été modifié.
[2] Ahmed al-Charaa a d’abord rejoint les rangs de l’État islamique avant de fonder le Jabhat al-Nosra, affilié à al-Qaïda. En 2013, résistant aux velléités hégémoniques de l’État islamique, il rompt avec cette organisation. En 2016, il décrète la dissolution du Jabbat al-Nosra et l’abandon de la stratégie djihadiste au profit d’une organisation unitaire destinée à renverser Bachar al-Assad : le Hayat Tahrir al-Sham (« Front de libération du Levant ») est né sur cette base.