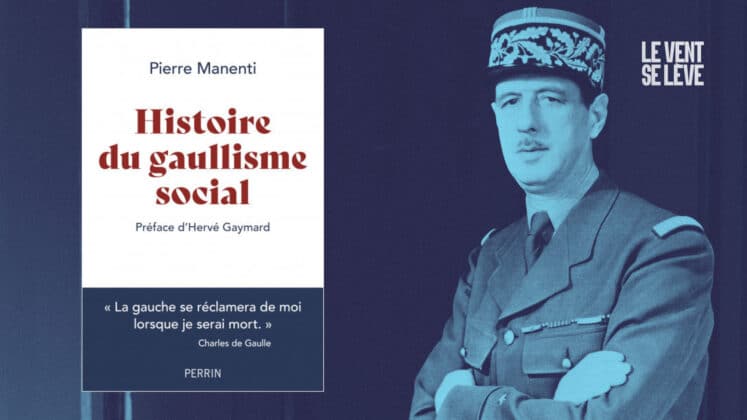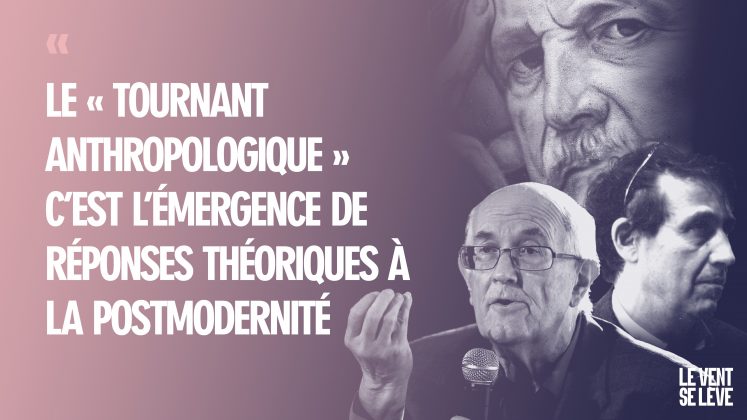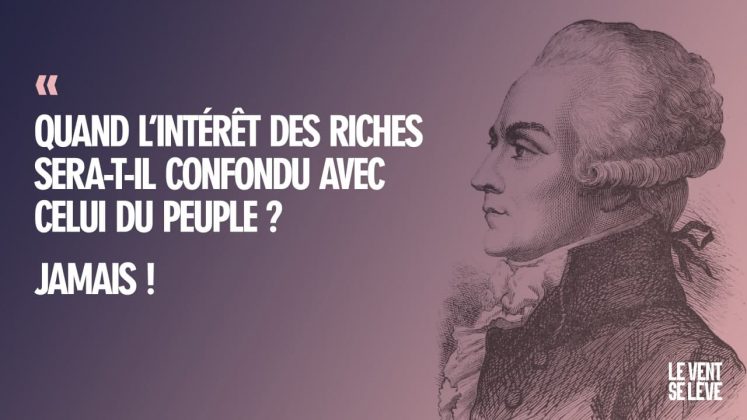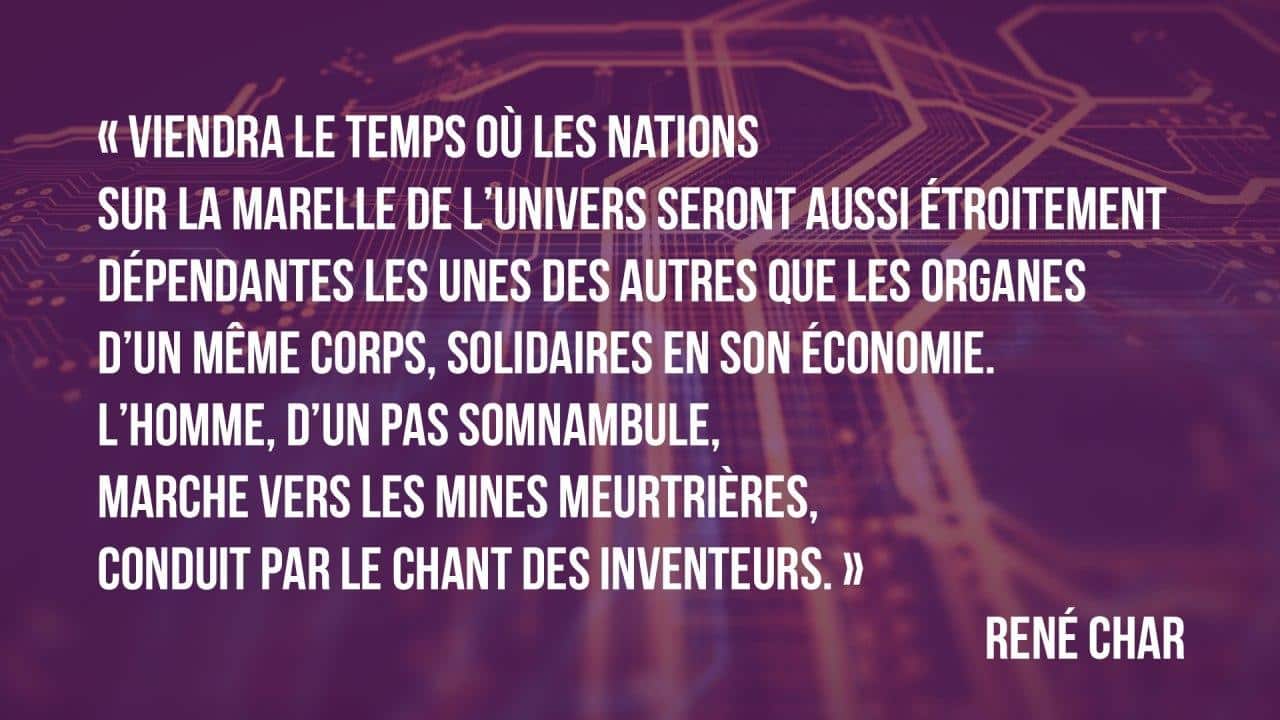À l’occasion de la sortie de l’ouvrage qu’ils ont dirigé, La France d’Antonio Gramsci, Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, respectivement professeur et professeur émérite d’études italiennes à l’École normale supérieure de Lyon, reviennent dans cet entretien sur le lien qu’entretenait le penseur marxiste italien avec la France. Ils abordent la fonction spécifique de l’histoire, de la politique et de la culture françaises dans la réflexion d’Antonio Gramsci, tout en insistant sur le fait que la France constitue pour le penseur sarde un point de comparaison plus qu’un modèle. Ils rappellent également que certains de ses concepts les plus importants trouvent leur source dans l’histoire française, à l’instar du jacobinisme ou du national-populaire. Entretien réalisé par Léo Rosell et Victor Woillet, retranscrit par Anne Wix.
LVSL – Pour quelles raisons avez-vous choisi de revenir sur le lien particulier qu’entretient Antonio Gramsci avec la France dans le cadre de cet ouvrage collectif ?
Jean-Claude Zancarini – Pour Gramsci, la France est un point de référence extrêmement important à la fois dans sa formation mais aussi dans sa réflexion en prison, et d’ailleurs pas seulement en prison. Cela s’explique d’abord par le fait que Turin, où il étudie, est une ville très liée au monde intellectuel français. Dans sa formation intellectuelle et dans sa formation d’étudiant, la France est donc très présente, avec la littérature française, mais aussi des grands noms du socialisme français, de Sorel à Péguy, en passant par Romain Rolland ou encore Henri Barbusse.
L’histoire de la France, et en particulier l’histoire de la Révolution française, est un point de référence et de comparaison utile pour essayer de comprendre ce qui se passe en Italie et, en particulier, toute la réflexion sur les raisons qui ont fait qu’il n’y a pas eu en Italie une révolution qui ressemblait à la révolution bourgeoise française, la grande Révolution française. Il se demandait pourquoi il n’y avait pas eu l’équivalent du jacobinisme, pourquoi les problèmes internes de l’Italie n’ont pas été résolus, pourquoi le processus de Risorgimento s’est développé sous une forme de colonisation du Sud par le Nord. La France lui permet de penser cela, comme un point de référence, mais aussi comme un point de comparaison.
Le livre a beaucoup évolué par rapport au colloque qui s’est tenu à l’École normale supérieure de Lyon en 2017, à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de la mort de Gramsci. Ce ne sont pas véritablement les actes du colloque mais une nouvelle réflexion à partir de celui-ci. À cette occasion, il y avait des événements un peu partout en Italie, et nous voulions faire quelque chose en France. L’idée était de faire une intervention spécifique en France, qui plus est à Lyon, où il y avait eu le dernier congrès du Parti communiste auquel Gramsci a assisté en janvier 1926. C’était aussi lié à la question de sa formation et sa façon de travailler. Pour lui le comparatisme est une façon de comprendre le monde en articulant un point de vue national et un point de vue international.
Romain Descendre – Il y avait très peu de productions sur ce sujet du lien que Gramsci entretient avec la France. Il y avait un seul livre, qui a des qualités mais qui n’avait pas eu un fort impact à ce moment-là. C’est assez étonnant parce qu’il suffit d’ouvrir et de lire un peu les Cahiers de prison pour se rendre compte à quel point, aussi bien l’histoire que la politique, la culture et la littérature qui viennent de France sont omniprésentes. Tout se passe comme si c’était «naturel», comme si c’était une évidence qui n’avait pas besoin d’être interrogée.
En y regardant de plus près, nous nous sommes rendu compte que cela n’avait jamais été fait. Il y a quelques points plus particuliers qui ont été beaucoup travaillés comme la question de la Révolution française, mais cela n’a pas donné lieu à un travail d’ensemble où plusieurs chercheurs se mettent ensemble pour s’interroger sur ce sujet, donc l’enjeu était aussi essayer de comprendre cet oubli qui semblait venir d’une évidence partagée : « Oui bien sûr la France c’est fondamental chez Gramsci », mais on ne l’interroge pas en tant que telle parce que c’est évident.
LVSL – Comme vous le montrez, la France sert de référence à de nombreuses réflexions de Gramsci, que ce soit à travers l’histoire, la politique ou la culture. Vous insistez sur l’articulation entre un « point de départ national » pour une perspective qui serait en fait internationale. Faudrait-il alors voir dans les références de la France revisitées par Gramsci un simple moyen de penser la situation italienne d’un point de vue comparatiste ou bien ces références répétées révèlent-elles au contraire une affinité particulière, de nature politico-intellectuelle, avec la France ?
R. D. – Ce n’est pas une alternative, les deux sont indissociables évidemment et c’est ce qui est vraiment intéressant. Il pense sans arrêt les questions nationales, et nationales-populaires, celle de la constitution d’une nation dans un double sens qui justement est typiquement français, à savoir la constitution tout à la fois de la nation et du peuple.
Pour Gramsci, le national et l’international vont ensemble et il s’intéresse à la France pour ce que la France a de spécifique mais aussi pour ce qu’elle lui dit sur l’Italie. C’est pour cela qu’il était intéressant d’aborder de front dans un même livre des questions qui ont trait plutôt à sa formation, et à l’importance de la France dans sa formation, et ses affinités pour la France qui sont effectivement indéniables, à commencer par un premier fait qu’on ne relève pas toujours : la seule langue qui est évidente pour Gramsci, au-delà de l’italien, c’est le français. Très vite il maîtrise le français et il le maîtrise très très bien. Quand il fait des exercices de traduction dans les Cahiers, il traduit de l’allemand et du russe et fait des exercices d’anglais parce qu’il en a besoin, mais il ne traduit jamais du français. Il lit directement en français.
Ses affinités sont aussi liées au fait que sa culture est à la fois universitaire et politique. Cela commence en Sardaigne bien sûr, mais les années tout à fait décisives sont celles de Turin, à partir de 1911 quand il y arrive à tout juste vingt ans. C’est une culture qui est entièrement turinoise, c’est-à-dire qu’elle est située à Turin, au cœur de l’Université de Turin et au cœur du mouvement socialiste et des jeunes socialistes de cette ville, qui est la plus grande ville industrielle de l’Italie à ce moment-là. Celle où il y a la classe ouvrière la plus nombreuse et la plus organisée de tout le pays. De plus, il se trouve que Turin est un des lieux qui, pour des raisons historiques et géographiques évidentes, est un des lieux italiens les plus francophiles, les plus français même. Les échanges avec la France sont constants depuis toujours d’une certaine manière.
C’est pour cela aussi que nous avons insisté notamment sur deux domaines dans lesquels cette culture française est importante pour lui et où effectivement on peut voir des affinités très fortes qui se suffisent à elles-mêmes d’une certaine façon, et pas encore dans une perspective comparatiste. La formation universitaire et intellectuelle d’une part, à travers laquelle il se spécialise très vite en linguistique, sachant que la tradition linguistique italienne est en lien avec ces linguistes français dont on parle dans l’introduction. D’autre part, ce sont des intellectuels français de l’époque, des philosophes, des écrivains, qui interviennent en même temps dans le domaine politique, comme Bergson, Péguy, Rolland ou Barbusse, qui sont absolument décisifs et qui sont des points de référence pour lui. Dans tous ses textes de jeunesse, dans les journaux dans lesquels il écrit, avant même L’Ordine Nuovo, les deux principaux étant L’Avanti et Il Grido del Popolo, qui sont en fait des feuilles turinoises socialistes, les références à ces auteurs français sont omniprésentes.
Il y a une autre chose qui est fondamentale, bien sûr, c’est le statut spécifique de la France à travers son histoire politique.
C’est après, dans un deuxième temps, que la France l’intéresse dans cette perspective comparatiste, au même titre que d’autres pays. Gramsci est un lecteur omnivore et d’une curiosité extraordinaire. Il s’intéresse au monde entier en réalité. Dans les Cahiers, c’est impressionnant : il s’intéresse à toutes les cultures et aussi à toutes les histoires politiques dans ce qu’elles ont de spécifique et d’irréductible. Si Maurras l’intéresse, c’est que Maurras est un cas unique pour lui. Il considère que c’est quelque chose de tellement différent de ce qui se passe en Italie, même si c’est une autre forme de fascisme d’une certaine manière – bien qu’il ne le dise pas comme cela. Il y a une autre chose qui est fondamentale, bien sûr, c’est le statut spécifique de la France à travers son histoire politique.
Si on fait une espèce de synthèse de l’ensemble, au risque de schématiser un peu, on peut dire que la dimension de modèle que peut avoir la France, non pas en termes de valeurs mais en termes de processus historique, c’est le fait qu’à partir de la Révolution française, la France va présenter dans toute son histoire jusqu’au début du XXe siècle aux yeux de Gramsci une forme de constitution d’une hégémonie bourgeoise pleinement accomplie. C’est effectivement un des éléments qui permet à Gramsci – mais pas qu’à lui car c’était déjà le cas avant lui – de réfléchir constamment sur le Risorgimento en comparaison avec la Révolution française d’une part, et l’histoire de la France au XIXe et de la République d’autre part. C’est cela qui en fait un point de comparaison indispensable pour l’Italie.
LVSL – Sur le rôle particulier de la France du point de vue de son histoire politique, on dit souvent qu’elle apparaît, au même titre que l’économie anglaise et que la philosophie allemande, comme une source majeure du marxisme. Elle attire logiquement l’attention de Gramsci. On a déjà parlé de la Révolution française qui fait partie évidemment des moments marquants qu’il analyse, mais ce n’est pas le seul. Quels éléments, quelles périodes de notre histoire sont les plus dignes de son intérêt et quel usage en fait-il dans sa réflexion ?
J.-C. Z. – Ce qui l’intéresse vraiment, c’est l’histoire de l’Europe après la Révolution, à savoir la période de « révolution passive » de la fin de la Révolution française à sa transformation en napoléonisme et le processus de transformation de l’Europe qui doit tenir compte de ce qui s’est passé pendant la Révolution française, en laissant les masses de l’époque à l’écart du centre-même de l’action politique. Il s’intéresse à tout et pas seulement à la France.
La lecture d’un grand livre de Benedetto Croce sur l’histoire de l’Europe l’interpelle, car il se demande comment on peut commencer l’histoire de l’Europe en enlevant le point de départ qu’est la Révolution française, parce que L’Histoire de l’Europe de Croce commence en 1815, précisément au moment où la phase expansive de la Révolution française et de son évolution napoléonienne était terminée avec le Congrès de Vienne.

Il s’intéresse à l’ensemble de ces processus et par la suite, logiquement, au processus français, à ce qui se passe dans la politique française quand il écrit, ce que signifie à l’époque l’affaire Dreyfus et l’émergence de l’Action française. Mais le point de départ fondamental pour lui, c’est l’expérience jacobine qui le mène à avoir une réflexion sur ce qu’est la forme d’hégémonie pour une classe sociale, et surtout comment elle peut devenir une force hégémonique, ne pas être seulement une force dominante, mais aussi une force dirigeante et donc une force hégémonique.
Il lit cette expérience jacobine comme la capacité qu’a eue la révolution bourgeoise française à faire l’alliance entre la ville et les campagnes. C’est le point de départ à partir duquel il fait des allers-retours avec ce qu’indiquait Machiavel en Italie au XVIe siècle, qui n’a pas eu d’écho en Italie, qui n’a pas procuré à l’Italie le même type de force hégémonique qu’ont été les jacobins. C’est cela son intérêt pour la France. Un intérêt majeur qui est lié au fait que l’expérience politique de la Révolution française est un des points de départ fondamentaux de sa réflexion, parce que c’est le rapport entre la politique et la philosophie, qui interprète d’un point de vue philosophique la politique française.
Il y a un moment donné où la politique française et la Révolution française sont fondamentales pour fonder sa réflexion sur Machiavel, sa réflexion sur la politique et sa réflexion sur ce que doit être, pour une classe sociale, d’obtenir l’hégémonie, c’est-à-dire pas seulement les armes et l’action de coercition mais aussi l’action d’alliance et d’hégémonisation des forces paysannes qui sont la grande partie du peuple. Le Risorgimento n’a pas fait ça et donc la comparaison, la mise en parallèle de l’expérience française dirigée par les jacobins et l’expérience du Risorgimento où les forces radicales n’ont pas réussi à prendre la direction du mouvement, en particulier parce qu’ils n’ont pas posé cette question fondamentale que se sont posée les jacobins, à savoir l’alliance des villes et des campagnes. Ils ne l’ont pas posée parce qu’ils ne voulaient pas faire de réforme agraire et donner la terre aux paysans. Ils sont donc restés à la traîne des modérés, c’est-à-dire de la monarchie piémontaise et de ses porte-paroles politiques en particulier Cavour.
L’essentiel de son intérêt pour la France est là. Pour le reste, il s’intéresse aussi à la Chine par exemple, à l’Angleterre ou encore au Japon, mais c’est aussi lié à son expérience de l’internationalisme : il a beaucoup lu, mais a aussi rencontré de nombreux communistes du monde entier en particulier quand il était à Moscou pour représenter le Parti communiste d’Italie.
LVSL – N’y a-t-il pas quand même, chez Gramsci, un statut particulier du socialisme français ? Il cite beaucoup Sorel, Péguy, Barbusse et Rolland – d’ailleurs, étonnamment, il ne parle pas du tout de Jaurès. Comment analyse-t-il justement ce socialisme français et sa grande portée morale ?
J.-C. Z. – Il y a des gens qui l’intéressent comme des penseurs auxquels il fait référence, notamment pendant l’affaire Dreyfus, quand il découvre Charles Péguy. Une autre expérience de Péguy a lieu avec sa lecture de Notre jeunesse, c’est-à-dire le Péguy qui revendique une espèce de fusion pour la vérité qui doit informer l’action des républicains. Pendant la guerre et juste après la guerre le mouvement Clarté de Barbusse, la position de Romain Rolland, le refus de la guerre l’intéressent.
Gramsci prend aussi chez Sorel l’idée du mythe dans lequel peuvent se reconnaître les classes populaires. Il va l’italianiser avec l’idée du Prince nouveau comme un mythe sorélien.
Il y a l’idée d’un idéal, d’une foi, de la volonté humaine qui transcendent les éléments économiques, et qui est toujours présente chez lui. Barbusse joue un rôle majeur, il vient plusieurs fois à Turin pendant la période de l’Ordine Nuovo et le mouvement Clarté développé par Barbusse est un point de référence pour le mouvement de culture prolétarienne qu’incarne l’Ordine Nuovo.
Il prend aussi des choses chez Sorel : l’idée du mythe dans lequel peuvent se reconnaître les classes populaires. Il va l’italianiser avec l’idée du Prince nouveau comme un mythe sorélien. Ce n’est jamais une adhésion à l’ensemble des thèses. Il prend quelque chose qu’il va importer dans sa propre conception de l’action politique et de l’action culturelle au sens large du terme. L’éducation n’étant jamais coupée de l’éducation possible des masses populaires. Il a ces références-là, il n’y a aucun doute.
Mais il y a d’autres auteurs, d’autres nationalités avec lesquels il a un rapport important et qui lui permettent de penser à partir du moment où il commence vraiment à travailler sur Marx. Évidemment il y a Lénine, Engels, il fait le lien entre Hegel et Marx. Ensuite il y a les romanciers, et finalement, ceux auxquels il fait le plus référence, ce sont les Russes, en particulier Tolstoï et Dostoïevski, plus que les Français.
R. D. – Une chose assez éclairante qui peut être ajoutée, c’est le fait qu’il y a deux grands ensembles d’intellectuels, de pensées et de productions intellectuelles contemporaines qui sont fondamentaux dans ses écrits de jeunesse en particulier pendant la guerre. Les uns et les autres ne sont pas forcément des révolutionnaires mais lui sont utiles pour penser et donner des bases théoriques et morales – morales, le mot est effectivement extrêmement important – à sa propre position qu’il appelle intransigeante révolutionnaire. Or dans les deux cas, ce ne sont pas forcément des auteurs qui peuvent être considérés comme les plus révolutionnaires qui soient.
Du côté italien, il va chercher du côté de l’idéalisme en philosophie qui à ce moment-là est un peu l’avant-garde philosophique, dans les années 1910, Benedetto Croce ou Giovanni Gentile sont des philosophes qui ont et qui prennent de plus en plus d’importance mais qui ne représentent pas la philosophie académique à ce moment-là. Ce ne sont pas des révolutionnaires et pourtant, il trouve chez eux toute une série de notions et de concepts qui vont lui servir à penser sa propre position révolutionnaire.
L’autre groupe est effectivement une série de socialistes français, dont certains ne sont pas forcément les plus socialistes d’ailleurs ou ne le sont pas en tout cas dans tous leurs textes. Péguy ne l’est pas dans tous ses textes, Bergson ne l’est pas non plus, Barbusse l’est beaucoup plus, mais Rolland ne peut pas être entièrement assimilé à ce qui serait la déclinaison française du socialisme à cette époque-là. C’est tout autre chose. C’est le pacifisme bien sûr, et effectivement le volontarisme. C’est l’idée que les lois de l’économie et de l’histoire, qu’un certain marxisme défend comme étant un modèle d’explication du monde social, ne suffisent pas. Qu’il y a un engagement nécessaire, une réflexion et une organisation du rapport entre les intellectuels et les masses qui est nécessaire, des actions de type éditorial, publiques, qu’il faut mener dans l’espace public. Ces gens-là le disent et le font.
Or, il se trouve que Gramsci a besoin de ce type de positionnements et les met en avant parce que le socialisme italien, qui est à la fois fort et très varié, est quand même dominé par un courant réformiste qui, tout en parlant de révolution, en disant qu’elle va arriver, estime qu’en attendant on peut collaborer avec le gouvernement de Giolitti, avec les libéraux, que ce n’est pas un problème parce que de toute façon « l’histoire nous donnera raison ». Au-delà de la caricature, c’est comme cela que Gramsci voit ces gens extrêmement influents à la direction du Parti socialiste, et il les combat.
Tout cela évolue et l’arrivée de Mussolini, socialiste révolutionnaire à un moment, est très bien vue par des jeunes comme Angelo Tasca, Gramsci ou Togliatti, parce que c’est un de ceux qui donnent un grand coup de pied dans ce socialisme réformiste extrêmement dominateur dans l’Italie de ces années-là. Il y a aussi justement beaucoup d’échanges entre Croce, qui n’est pas du tout socialiste, et Sorel, qui lui l’est bien sûr. Sorel est très présent en Italie et pas seulement parce que des gens comme Gramsci le lisent mais parce qu’il est publié, traduit, lu – il y a même des textes de Sorel qui sont directement publiés en italien avant même d’être publiés en français. Ce sont des mouvements novateurs et il se trouve que ces réformistes sont finalement les plus marxistes à ce moment-là. C’est-à-dire que le Marx qui domine au sein de ce monde socialiste italien pendant les années de guerre, c’est le Marx de la Deuxième Internationale, hyper économiste, avec cette idée que les lois, les superstructures, les lois de l’histoire sont celles-là : le capitalisme va entrer en crise, d’ailleurs la guerre en est une des manifestations, et la révolution adviendra inexorablement quand il faudra qu’elle advienne.
Gramsci, dès qu’il est tout jeune, est contre ces idées-là et il sera toujours contre ces idées-là. Il va devenir marxiste, évidemment. Il ne l’est pas encore à ce moment-là. Les socialistes français sont importants pour Gramsci avant que Marx ne le devienne, parce que le Marx qui domine chez les socialistes italiens est celui qu’il conteste d’où d’ailleurs ce texte très célèbre, « La révolution contre le Capital » où sa première réaction face à la révolution d’octobre est de dire que les bolcheviques ont donné tort à Karl Marx. C’est à ce moment-là qu’il va se mettre à lire sérieusement Karl Marx et que les choses vont évoluer. Mais les Français ont cette position-là, d’être des outils pour penser une certaine forme de volontarisme et d’organisation d’une volonté collective qui fait que la politique doit primer.
LVSL – Justement, par rapport à l’histoire de la politique française, il y a une référence qu’on pourrait attendre de la part de Gramsci c’est celle de la Commune de Paris, dont on fête cette année le cent-cinquantième anniversaire. Ça n’a pas l’air d’être un événement qui l’intéresse particulièrement… A-t-il proposé une interprétation de la Commune de Paris, dans la lignée de Marx et de la littérature marxiste ?
J.-C. Z. – Il en parle très peu. L’événement politique majeur qui l’intéresse pour comprendre le Risorgimento italien, pour comprendre le fonctionnement des classes sociales et de savoir comment elles deviennent dominantes et dirigeantes, c’est le jacobinisme, c’est la Révolution française et l’expérience politique du jacobinisme.
Il cite quelquefois la Commune, mais très rarement, dans les Cahiers, comme « la saignée » de la Commune, expliquant que cela marque une rupture entre la tradition jacobine et la tradition d’après. Il dit cela à propos de Sorel justement. C’est vraiment le seul endroit où il en parle, par rapport aux morts qu’il y a eu lors de la répression par les Versaillais. Il dit : « Là apparaissait ce nouveau peuple », qui n’était jusqu’alors pas présent, qui l’avait été autrefois, les ouvriers et les faubourgs parisiens qui n’ont pas été au cœur du processus et qui avaient de toutes façons été arrêtés par Thermidor. Ce qu’il dit, c’est que là émergeait un nouveau peuple qui n’était pas le même peuple que celui de la Révolution française mais celui du prolétariat urbain de Paris. Il est dans une situation où il se dit que Sorel a pensé qu’il pouvait être le porte-parole de cette nouvelle classe, de l’émergence de ce nouveau monde populaire et faisant cela il a développé ses théories sur le syndicalisme révolutionnaire. À part cela, il n’y a pas d’analyse spécifique de la Commune de Paris.

R. D. – C’est une hypothèse mais l’importance de la révolution russe est telle – de portée mondiale et en plus victorieuse – que cela efface les possibles raisons d’enquêter davantage sur l’histoire de la Commune de Paris. On peut interpréter les choses de cette façon.
J.-C. Z. – Ce qu’il met en parallèle, c’est la révolution de la bourgeoisie et le système d’alliance qu’a mis en place la Révolution française, et la révolution prolétarienne de 1917. C’est ce parallélisme-là qu’il établit. Cela dit quelque chose, cette évocation de la saignée de la Commune de Paris. C’est à ce moment-là qu’émerge un nouvel acteur politique, mais c’est ce nouvel acteur qui l’intéresse et qu’il va analyser, pas l’événement en lui-même. Ce qui est important c’est l’émergence d’une nouvelle classe, actrice de l’histoire, mais qui va se réaliser en Russie et pas en France.
LVSL – Nous avons parlé de l’influence des Lumières, du jacobinisme. Les articles qui traitent de ces liens entre Gramsci et les Lumières, de l’influence de Rousseau ou encore du jacobinisme posent le problème politique du passage du particulier à l’universel. Dans quelle mesure Gramsci s’inspire-t-il de ces théories dans sa réflexion sur la volonté collective nationale populaire et sur le volontarisme politique ? Identifie-t-il des limites dans la théorie du contrat social rousseauiste d’une part, et dans l’expérience du jacobinisme d’autre part ?
J.-C. Z. – L’intérêt pour les Lumières, pour Rousseau, vient du fait que, dans sa façon de penser, cela prépare la Révolution française. Sans entrer dans le détail des analyses qu’il fait sur Rousseau et l’éducation, au fond ce qui l’intéresse, c’est comment un mouvement culturel de longue durée prépare une transformation sociale.
Dans l’expérience jacobine, ce qui l’intéresse, c’est la politique. On est vraiment là à l’intersection entre l’hégémonie politique et culturelle avec une focalisation sur un processus culturel d’assez longue durée, cette mise en place des idées, du point de vue des sermons, des textes, des journaux, tout ce qu’on peut avoir comme traces de ce qui prépare culturellement la Révolution française ; c’est pour cela qu’il s’intéresse à plusieurs reprises au livre de Bernard Groethuysen, Origines de l’esprit bourgeois en France (Paris, 1927).
Il se dit qu’il faudrait qu’ils soient capables eux aussi de préparer une transformation prolétarienne radicale. Ces deux aspects fonctionnent en même temps. Son intérêt pour les Lumières et Rousseau d’un côté et son intérêt pour les jacobins de l’autre, sont de façon schématique d’un côté la focalisation culturelle et de l’autre la focalisation politique. Qu’est-ce qu’on fait pour transformer le monde ? Il faut une politique centralisée mais capable d’alliances ou en tout cas de résoudre au moins pour un moment par un processus d’alliances la contradiction fondamentale entre ville et campagnes, afin de constituer une hégémonie. Ils ont constitué une hégémonie en étant capables de ne pas laisser simplement les bourgeois des villes faire le travail.
S’ils n’avaient pas été capables d’avoir avec eux la majorité des paysans français avec les décisions politiques qui sont prises, ce qui s’est passé dans l’ouest de la France, en Vendée, se serait passé partout et Paris n’aurait pas tenu. Sans cette capacité des jacobins à faire ce bloc – même s’il n’était pas complet puisqu’il y a eu les mouvements royalistes en Vendée –, s’ils n’avaient pas été capables de l’obtenir massivement au niveau de la population française, ils n’auraient pas gagné. C’est vraiment cette question-là, mais sous ces deux aspects, avec ces deux points de vue, l’un culturel/politique et l’autre politique/culturel.
LVSL – Peut-on revenir sur les aspects fondamentaux de la distinction entre la volonté générale de Rousseau et la volonté collective nationale-populaire de Gramsci ? Gramsci reproche par exemple à la volonté générale d’être abstraite et de ne pas prendre en compte la situation historique…
R. D. – C’est un des aspects d’un phénomène plus large qui est vraiment intéressant à interroger chronologiquement – et c’est ce que font de façon différente à la fois Giuseppe Cospito et Giulio Azzolini dans le volume – : le fait que pendant toute une première période, celle de la jeunesse de Gramsci, que ce soit le jacobinisme, Rousseau ou les grands principes républicains issus de la Révolution française sont plutôt perçus d’un mauvais œil par Gramsci. En cela, il reflète une attitude qui est plus diffuse, et qui est commune à d’autres intellectuels italiens dès le XIXe siècle, dès l’époque du Risorgimento. Celle d’une Italie qui a subi ce qu’il pouvait y avoir de plus violent et négatif dans les prétentions à l’émancipation révolutionnaire française à partir du moment où elles étaient imposées de l’extérieur sur la base de grands principes : la justice, l’humanité pour l’humanité, l’idée d’universel, mais qui s’appliquaient par la violence et par les armes.
Gramsci ne va pas conserver la position marxiste typique de remise en question et de critique radicale des droits de l’homme, des Lumières comme ensemble de valeurs bourgeoises. Il va non seulement essayer de comprendre comment cela a été absolument fondamental dans la genèse du processus révolutionnaire en France mais aussi avoir des réflexions sur ces valeurs.
Dans le livre nous parlons « d’aversion initiale » de Gramsci. Quand on se penche sur les auteurs que Gramsci lisait le plus dans ces années-là, de jeunesse, et à commencer par Benedetto Croce, c’est omniprésent. C’est étonnant pour nous, français, de se dire que ces mots-là sont presque immédiatement péjoratifs. « Jacobinisme », à ce moment-là, c’est vraiment une critique, avec cette idée que ce sont des principes abstraits qui peuvent être pleins de bons sentiments humanitaires mais qui en réalité cachent une violence évidente, qu’on voit d’ailleurs dans les parties les plus violentes de la Terreur pendant la Révolution, et dans l’exportation de la Révolution en Europe ensuite.
Les choses vont évoluer : à la faveur d’un processus qui repose essentiellement sur la Révolution russe et notamment la revendication par Lénine d’un héritage du jacobinisme et sur la façon dont il lit parallèlement l’historien Albert Mathiez, mais aussi sur un retour plus large des Lumières et de ses valeurs, Gramsci ne va pas conserver la position marxiste typique de remise en question et de critique radicale des droits de l’homme, des Lumières comme ensemble de valeurs bourgeoises. Il va non seulement essayer de comprendre comment cela a été absolument fondamental dans la genèse du processus révolutionnaire en France mais aussi avoir des réflexions sur ces valeurs : si on réussit à faire ce que lui appelle une « société réglée » – qui a toujours une dimension future, utopique, qu’il n’identifie pas à la réalité de l’Union soviétique dans ces années-là, mais à laquelle il ne renonce jamais comme horizon communiste – la liberté, la fraternité, l’égalité sont des choses qu’il peut revendiquer et projeter dans ce futur-là.
Finalement, c’est un peu ce que montre le texte de Giuseppe Cospito : ces valeurs qui, au début, pouvaient être critiquées à la fois du point de vue des philosophes idéalistes italiens, et du point de vue de Marx et de ceux qui héritent de Marx, reviennent d’une certaine manière dans les Cahiers de prison comme un horizon possible. Il y a effectivement la question de l’universel, du passage du particulier à l’universel, du règne de la nécessité au règne de la liberté.
LVSL – À quoi renvoie exactement la volonté collective nationale-populaire pour Gramsci ? Pouvez-vous en donner une définition simple ?
J.-C. Z. – On pourrait traduire avec un mot d’ordre, celui de la Constituante en Italie, et que Gramsci va préconiser contre le fascisme. La volonté collective se définit par le fait que les gens peuvent s’y reconnaître, qu’elle n’est pas énoncée par des intellectuels coupés du peuple, mais qu’elle est au contraire le résultat d’une fusion au moins espérée au sein du peuple italien, ce qui veut dire au minimum les ouvriers et les paysans mais pas seulement, raison pour laquelle, dans les Cahiers, il parle plus généralement des subalternes. La volonté collective est donc cette articulation, le résultat de ce travail qu’il nomme parfois, avec ce terme de l’époque, un travail de transformation moléculaire.
Ce rapport permanent entre les intellectuels et les subalternes repose par ailleurs sur l’idée que les intellectuels et les subalternes ne restent pas à leur place, les uns ayant des capacités que les autres n’ont pas, et qu’il faut arriver à faire fusionner ces capacités. Il les appelle la capacité de sentir et la capacité de comprendre. Il faut donc une sorte d’osmose entre les deux et c’est cela qui peut faire émerger un mot d’ordre, des mots d’ordre qui seront l’expression de cette volonté collective nationale-populaire. En fait le moléculaire définit l’articulation qui va se faire, le passage permanent des dominants aux dominés, des intellectuels aux non-intellectuels, car les non-intellectuels apprennent auprès des intellectuels et les intellectuels apprennent auprès des non-intellectuels.
Par rapport au concept d’intellectuel organique, c’est simplement l’idée que chaque classe fait émerger ses propres intellectuels et que les subalternes doivent aussi faire émerger des intellectuels qui sont organiquement liés à eux. Cela nécessite un rapport entre les intellectuels traditionnels, ceux du moins qui se rangeront du côté des subalternes, et les subalternes eux-mêmes qui passeront de leur statut de subalternes à celui de personnes qui, par ce travail permanent d’osmose, par ce travail moléculaire, deviendront eux-mêmes des intellectuels organiques des subalternes.
R. D. – La volonté collective nationale-populaire est aussi d’une certaine manière le résultat escompté, constaté, d’une construction qui est celle d’un nouveau processus d’hégémonie au cœur duquel le rôle du Parti communiste est indispensable, mais qui ne se définit plus prioritairement en termes de classes. C’est l’opposé d’une stratégie de classe contre classe. C’est une stratégie dans laquelle l’échelle décisive est l’échelle nationale, pas en lien avec quelque forme de nationalisme que ce soit mais tout simplement parce que c’est l’échelle politique existante, réaliste, efficace, celle qui fonctionne, celle de l’histoire en train de se faire dans les années 1930.
Ce n’est pas un hasard si, alors que pendant longtemps il utilise le mot classe systématiquement, à partir d’un certain moment il parle de groupe, parce que […] la stricte séparation en termes économico-matérialistes de type classe n’est plus amenée à être opératoire.
C’est notamment en ce sens-là qu’il faut comprendre ce concept, au sens d’une échelle de l’action politique, qui est aussi l’échelle de l’État, et nationale-populaire au sens aussi où si une hégémonie des subalternes devient possible : c’est à partir d’eux qu’une forme de nouveau consensus peut se produire, qui réunisse dans une même direction les différentes classes. Gramsci ne fait pas de typologie. Ce n’est pas un hasard si, alors que pendant longtemps il utilise le mot classe systématiquement, à partir d’un certain moment il parle de groupe, parce que si on pense jusqu’au bout en termes d’hégémonie, en termes gramsciens, la stricte séparation en termes économico-matérialistes de type classe n’est plus amenée à être opératoire.
C’est donc cette volonté collective nationale-populaire qui prépare en quelque sorte une société sans classe, qu’il appelle une société réglée. Gramsci pense tout cela en termes de processus. C’est l’inverse de l’idée selon laquelle la révolution est inéluctable et imminente. Elle n’est pas du tout inéluctable, c’est tout un travail. Elle n’est pas du tout imminente, c’est un processus : on va vers elle et pour y aller on crée de nouveaux outils de pensée, qui ne prétendent pas sortir du marxisme, mais qui restent à l’intérieur de cette pensée qui s’appelle désormais philosophie de la praxis, avec une stratégie de long terme. Parallèlement, la dimension philosophique et la dimension stratégique vont de pair et impliquent de penser de nouvelles catégories, et celle-ci est absolument centrale.
C’est un processus au sens où Gramsci le pense comme tel mais aussi dans la façon dont il y arrive lui-même. C’est-à-dire que l’idée de volonté collective nationale-populaire émerge à la toute fin de 1931 et qu’elle est vraiment développée en 1932, alors que cela fait deux années qu’il travaille en prison sur ces questions.
J.-C. Z. – Ce qu’il faut bien avoir en tête pour comprendre, c’est qu’à ce moment-là,
la ligne de l’Internationale communiste, c’est la stratégie de classe contre classe, et Gramsci est complètement en opposition avec cette ligne. Il prend l’exact contrepied de ce qu’est devenu le stalinisme. Il écrit en sachant ce qui se passe en Russie, et c’est à ce moment-là qu’il y a vraiment une rupture.
LVSL – Il suivait aussi avec attention l’extrême-droite française, lisait régulièrement Maurras et l’Action française. Quel intérêt voyait-il dans l’étude de ces courants politiques qu’il combattait, qui lui étaient opposés ? Est-ce que les mouvements conservateurs français servaient là aussi de point de comparaison avec le fascisme italien ou faisaient-ils l’objet d’un intérêt particulier de la part de Gramsci ?
R. D. – Cet intérêt renvoie à plusieurs aspects, et il évolue au fil des années. Il porte un intérêt à ces mouvements bien avant les Cahiers. Il s’y intéresse dans une optique qui est à la fois stratégique et politico-culturelle, c’est-à-dire qu’il voit très vite que l’Action française est un mouvement assez particulier. Ce ne sont pas les idées qui l’intéressent mais le mouvement. D’abord, c’est un journal. Il s’intéresse à tout ce qui – y compris à l’opposé de l’échiquier politique, chez les ennemis directs – peut avoir eu une efficacité dans l’organisation de la politique et de la culture à partir des outils que sont en particulier les journaux à ce moment-là.
Ce qui est intéressant en plus dans le cas de l’Action française, c’est qu’il s’agit d’un mouvement extrêmement élitiste et qui est en même temps populaire. C’est quelque chose qui ne peut qu’intéresser Gramsci, ne serait-ce que par curiosité, et c’est quelque chose d’uniquement français. Il parle de cela comme d’un « jacobinisme à l’envers ».
L’Action française comme journal l’intéresse d’abord et avant tout car il s’agit d’une de ces expériences où la dimension du journalisme et de l’édition rencontre le lien entre la politique et la culture, le débat d’idées et l’implication des intellectuels d’une part, et d’une partie beaucoup plus large de la population d’autre part. Il ne s’agit bien sûr pas de dire que c’est l’équivalent de l’Ordine Nuovo à l’extrême droite, mais ça l’intéresse à ce titre-là, comme un exemple de mouvement qui peut avoir un impact fort tout en n’étant ni un parti politique, ni un syndicat, et où l’action intellectuelle a une efficacité, où les idées ont une force.
Ce qui est intéressant en plus dans le cas de l’Action française, c’est qu’il s’agit d’un mouvement extrêmement élitiste et qui est en même temps populaire. C’est quelque chose qui ne peut qu’intéresser Gramsci, ne serait-ce que par curiosité, et c’est quelque chose d’uniquement français. Il parle de cela comme d’un « jacobinisme à l’envers ». Évidemment, on ne comprend l’expression que si on a le sens premier du jacobinisme, chronologiquement, pour Gramsci, c’est-à-dire une idéologie humanitaire avec des grandes idées de justice, d’égalité, mais qui est très abstraite et martelée. C’est un « jacobinisme à l’envers » parce que c’est l’envers du jacobinisme et des idées de la Révolution française, mais cela marche de la même manière. Que cela fonctionne l’intéresse. C’est un premier point.
Un autre point extrêmement important, c’est un exemple très précis de son intérêt pour la France. Est-ce que la France l’intéresse pour elle-même ou pour l’Italie ? Les deux. D’un côté c’est quelque chose de typiquement français et en même temps ça l’intéresse parce que dans les années 1920, et tout particulièrement à partir de 1926, il y a un renversement avec une très forte condamnation de l’Action française. Elle se voulait catholique, mais tout le monde au sein du mouvement n’était pas d’accord. Une partie des catholiques se retrouvaient dans l’Action française et une partie de la hiérarchie aussi mais en 1926, le Pape Pie XI condamne l’Action française et se met à l’attaquer très durement.
Ce qui l’intéresse beaucoup dans tout cela c’est qu’on a parallèlement en Italie un rapprochement très fort entre le pouvoir fasciste et le Vatican qui va aboutir au Concordat, aux accords du Latran en 1929, donc un traitement très différent, au même moment, pour des idées communes. Certes, il s’agit de doctrines différentes dans les deux pays mais il y a beaucoup de choses en commun entre le fascisme italien et le mouvement de l’Action française maurrassien. Il analyse avec une certaine ironie et surtout beaucoup d’intérêt le fait que l’Église va avoir deux poids deux mesures, deux discours différents, ce qui lui permet de mettre en évidence la teneur profondément politique des positions de l’Église. À travers cette analyse comparée, il étudie des tendances de fond, qui ne sont ni vraiment idéologiques, ni vraiment religieuses, mais profondément politiques, dans les choix que fait l’Église à ce moment-là dans l’Italie de Mussolini.
LVSL – Par rapport à l’hégémonie de l’extrême-droite française sur l’extrême-droite italienne, vous reprenez dans l’ouvrage un passage assez ironique dans lequel l’Action française parle du « stupide XIXe siècle » et où l’extrême-droite italienne reprend cette expression alors que le XIXe renvoie en Italie à une tout autre réalité. Gramsci se servait de cet exemple pour montrer une sorte de colonisation des intellectuels italiens par les intellectuels français, alors même qu’ils critiquaient le modèle français. Est-ce lié selon lui, à l’absence d’intellectuels nationaux-populaires italiens à l’époque ?
R. D. – On évoque ce passage sur le « stupide XIXe siècle » dans notre introduction mais c’est surtout Marie Lucas qui le commente. Gramsci explique que cette expression de Léon Daudet n’a de sens que dans un contexte français. En Italie, on ne fait pas référence aux mêmes choses si on parle du XIXe siècle donc effectivement c’est un signe : les mêmes qui disent du mal de la France ne se rendent même pas compte eux-mêmes qu’ils reprennent des expressions qui n’ont de sens que dans un contexte français et montrent par là qu’ils sont finalement tout à fait sous la domination idéologique de ceux qu’ils dénoncent. Mais ce sont surtout des intellectuels liés au fascisme, ce ne sont pas des fascistes en tant que fascistes.
J.-C. Z. – À mon sens, toutefois, on ne peut pas dire que l’Action française est un mouvement fasciste. C’est un mouvement réactionnaire qui a des idées politiques très à droite, mais il diffère historiquement et idéologiquement du fascisme.
R. D. – Oui, l’idée n’est pas de dire que l’Action française est un mouvement fasciste, c’est davantage lié à l’opposition entre position monarchiste et position républicaine. Gramsci revient sur le fait que dans un contexte français, l’Église, Rome, est tout à fait d’accord avec les positions républicaines et condamne le monarchisme de l’Action française. En revanche en Italie il est hors de question d’être républicain. Cela l’intéresse plus par rapport à la position du Vatican.
LVSL – Ce mouvement de balancier comparatiste entre la France et l’Italie avec cet exemple pose la question de la traduction qui est majeure dans l’œuvre de Gramsci. Dans l’introduction de votre ouvrage, vous détaillez l’influence de la linguistique française du début du XXe siècle sur sa réflexion. Cette thématique de la traduction au sens fort du terme est centrale dans la lecture que vous faites de l’œuvre gramscienne. Comment interprétez-vous cet apport de la formation linguistique à la réflexion de Gramsci ?
R. D. – Ce sont deux périodes tout à fait différentes. Tout ce qu’il développe sur la question de la traduction qui va jusqu’à en faire une catégorie, la traductibilité du langage qui devient centrale dans la façon dont il pense la philosophie de la praxis, c’est la période des Cahiers de prison, bien avancée, après plusieurs années de réflexion, dans les années 1930.
La linguistique française est vraiment liée à sa formation – et là on est dans les années 1910. C’est tout un ensemble de visions de la langue comme un « fait social total », pour employer l’expression de Durkheim. Une langue qui est le produit de l’histoire, de la géographie, de la société elle-même et des interactions entre classes sociales, entre groupes. C’est à la fois une dimension sociale complète – la façon dont on voit la langue et son évolution – et l’interprétation de la langue comme étant entièrement un phénomène à penser historiquement, en tant que produit historique. Cela ne concerne pas que les Français. Nous en avons parlé dans ce volume qui était consacré à Gramsci et la France, et nous voulions rappeler et approfondir des choses qui ont déjà été dites par des spécialistes et en particulier par Giancarlo Schirru.
Se demander comment les langues se développent, comment elles s’imposent, comment elles fonctionnent, permet de penser comment une hégémonie peut se constituer.
Nous avons poussé l’enquête dans cette direction. Un livre fondamental par exemple est l’Essai de sémantique de Bréal, qui est cité dans les Cahiers et dont certaines notions réapparaissent dans les Cahiers, pas tant pour la question de la traduction et de la traductibilité que pour la question de la langue et du langage comme conception du monde et l’importance de tout ce qui est de l’ordre de l’idéologie dans le cadre d’une pensée de l’hégémonie, à partir d’un modèle qui est celui du langage. Se demander comment les langues se développent, comment elles s’imposent, comment elles fonctionnent, permet de penser comment une hégémonie peut se constituer.
Par ailleurs, il y a une dimension plus épistémologique dans cet héritage de la pensée linguistique, notamment française, de Gramsci qui est par exemple de toujours savoir que les concepts qu’on utilise et en particulier ceux du matérialisme historique, à partir même du concept de matérialisme lui-même, sont des métaphores. Il développe l’idée que le langage est profondément métaphorique et que nos outils conceptuels comme par exemple infrastructure et superstructure sont des métaphores pour expliquer avec des outils méthodologiques ce qui paraît être le fonctionnement du réel : ce sont des façons de le comprendre et non pas des dogmes, des vérités.
Tout cela est extrêmement important aussi dans le rapport que Gramsci entretient avec la philosophie dans laquelle il se reconnaît, qui doit énormément à Marx et Engels, une philosophie avec laquelle il ne faut surtout pas avoir un rapport dogmatique. Dès qu’on oublie que ces concepts fondamentaux sont des métaphores, on a avec eux un rapport dogmatique.
Un exemple de métaphore est la notion de « loi » appliquée à l’histoire : Gramsci refuse cette application à l’histoire de la notion de loi au sens des sciences naturelles. Mais justement, pour lui, il y a une autre science importante qui décrit un certain nombre de lois, c’est la linguistique historique. La loi étant le résultat du processus d’abstraction produit à partir du constat de l’existence de régularités historiques. Il y a des lois du langage. On sait que tels mots prononcés dans telle région à telle époque vont se transformer de telle et telle manière non pas parce qu’on peut le prévoir mais parce qu’on le constate. De là on tire une loi, une loi phonétique par exemple, qui n’est jamais que la description d’une régularité. C’est la même chose pour les lois de l’histoire, les lois de l’économie.
Ce sont des outils qui lui viennent de la linguistique et il nous importait dans ce livre de rappeler que c’est écrit de façon très claire dans les textes de Meillet, qui était une des références de Gramsci quand il étudiait la linguistique avec son professeur Bartoli à Turin. Ce sont des choses qu’on retrouve encore dans les Cahiers de prison et ce qui est assez étonnant, c’est que les tout derniers textes des Cahiers de prison sont écrits au printemps 1935 et c’est le dernier cahier spécial qui est sur la linguistique. Il commence donc par cela dans ses études les plus sérieuses quand il est tout jeune et il termine avec des questions de grammaire historique à la toute fin. Cela a eu une importance de longue durée pour lui.
LVSL – L’œuvre et la vie de Gramsci ont longtemps été méconnues en France. Choisir de retracer et d’analyser les différents aspects qui lient l’œuvre de Gramsci à la France s’inscrit-il d’une certaine façon en réponse à la réception particulière que ce dernier a connue dans notre pays ?
J.-C. Z. – Il n’est pas tout à fait exact de dire qu’il n’y a pas eu de réception de Gramsci. Il faut en faire une historicisation. Brièvement, Gramsci a été reçu, lu et traduit en France. Ce qui pose problème c’est que le Gramsci que l’on reçoit d’après la guerre, c’est le Gramsci du PC italien. C’est important car le gauchisme italien, tout le courant de l’extrême-gauche pendant très longtemps ne l’a pas reçu, pas lu, parce que c’était le PC italien. Gramsci a été construit par le PC italien et en particulier par Togliatti et ses proches camarades comme une icône du PC italien, qui a fondé son parcours en se référant à Gramsci jusqu’à l’eurocommunisme.
En France, le PCF, qui regardait avec orthodoxie la ligne du PC italien, se disait qu’il n’allait pas reprendre Gramsci qui servait aux communistes italiens à justifier leurs propos, en faveur de l’eurocommunisme, contre la ligne de l’URSS. Au milieu des années 1960 à l’Union des étudiants communistes, il y a un bureau « italien », dans lequel on trouve par exemple Alain Forner, Pierre Kahn et Bernard Kouchner. Ce bureau s’oppose à la ligne officielle du PCF. Il y a donc eu une réception par un courant qui se réclamait du marxisme.
Au moment où il n’y a pas encore de distinction entre PC italien et PC français, il y a tout de suite la traduction des Lettres. La première édition des Lettres est pour le coup complètement fabriquée par Togliatti avec des omissions, des coupures, qui en fait une bonne édition littéraire à tel point qu’elle remporte un grand prix de littérature italien (le premio Viareggio) dès l’année de sa parution. C’est traduit tout de suite en français par les maisons d’édition du PCF.
Ensuite il y a cette distinction qui se fait, qui est liée à la lecture du PCF qui est assez réticente envers les lectures de Togliatti allant vers l’abandon de la dictature du prolétariat car il y a encore des débats sur la question de garder ou pas la dictature du prolétariat dans les années 1970. Donc la réception de Gramsci est complexe. Ce n’est pas une non réception ou un retard de réception. Il y a ensuite le rôle d’André Tosel, qui reste au parti mais qui est de formation catholique, qui est important. Il y a aussi des lecteurs de Gramsci, qui se réfèrent à Gramsci mais qui passent à la droite, comme Hugues Portelli par exemple.
En 1975, à peu près en même temps que Portelli, mais avant Tosel, sort un livre extrêmement important, celui de Christine Buci-Glucksmann, Gramsci et l’État (1975), qui est détachée du lien avec le PCF, dans un rapport critique. Ensuite ce sont des marxistes hétérodoxes, d’extrême-gauche, comme Robert Paris plutôt lié au courant « bordighiste », du nom d’Amadeo Bordiga, premier dirigeant du parti italien, avant Gramsci, qui fait l’édition des Écrits chez Gallimard puis l’édition presque complète des Cahiers aussi chez Gallimard. Il fait cela pour embêter les « staliniens » ! Mais avant cela il y a des anthologies, par exemple Gramsci dans le texte, aux Éditions sociales, par Tosel qui a une position compliquée : il reste au parti mais il est très ouvert aux propositions politiques du PC italien. Pour répondre à votre question, non, cette question de la réception n’a pas vraiment joué dans notre démarche.
R. D . – Un autre aspect de votre question portait sur le fait que plus récemment, il y eu une sorte de retour de Gramsci, voire de Gramsci-mania, où tout le monde se dit gramscien et personne ne sait de quoi il parle, et dit beaucoup de grosses bêtises. À la radio, on a entendu récemment Philippe de Villiers déclarer, tout fier, qu’il avait lu Gramsci dans le texte, mais à écouter la suite de l’interview, on se rend compte que c’est faux, ou alors qu’il n’y a pas compris grand-chose. Le dernier en date à se dire « gramscien », n’est autre que Jean-Michel Blanquer. On ne voit pas trop le rapport.
LVSL – Justement, quel regard portez-vous sur les usages actuels et très contemporains de la figure de Gramsci, cité à droite à gauche ?
R. D. – Ce qui revient toujours, ce sont ces deux idées finalement assez semblables : « hégémonie culturelle » et « bataille des idées ». « Il faut gagner la bataille des idées, comme le disait Gramsci », dit-on, or il n’a jamais dit cela comme ça. Certes, il y avait une rubrique « la bataille des idées » dans L’Ordine Nuovo, mais c’est la seule chose historiquement vraie dans cette référence.
L’hégémonie culturelle qu’on attribue abusivement à Gramsci est par ailleurs un concept passe-partout qui veut tout et rien dire, qui réduit la pensée gramscienne et notamment toute sa dimension stratégique à dire : « il faut qu’il y ait beaucoup d’intellectuels de notre côté et que leur voix domine les médias ». C’est en fait le Gramsci vulgarisé par la Nouvelle droite d’Alain de Benoist. Un des enjeux de ce livre, même si nous ne l’avons pas formulé comme cela, c’est que traiter en France la question de la France de Gramsci, c’est affirmer qu’une bonne connaissance de Gramsci est intéressante non seulement pour Gramsci lui-même, non seulement pour ceux qui s’intéressent à lui, mais aussi pour tous ceux qui s’occupent de la France, d’une certaine manière.
Avec ce livre, nous prenons le contre-pied de la méconnaissance de Gramsci : à l’usage superficiel qui en est couramment fait en France, nous opposons la connaissance extrêmement fine, profonde et de longue durée que Gramsci avait de la France.
En effet, sur la question fondamentale de l’histoire de France, de la culture ou de la littérature françaises, Gramsci a des choses à apporter que les spécialistes de ces domaines en France ne connaissent pas du tout et dont ils n’ont même pas idée. Alors que nous avions tous les deux travaillé sur Gramsci il y a très longtemps, que nous nous y étions intéressés de près des années plus tôt, nous avons repris ce travail d’abord avec l’idée qu’avec nos propres outils, nous pouvions faire entrer dans le débat intellectuel français un rapport à Gramsci qui soit nouveau, philologiquement et historiographiquement beaucoup plus précis et pertinent, et le diffuser.
Car ce n’est pas nous qui inventons tout cela. Il y a un travail énorme qui est fait depuis plus de vingt ans à tous les niveaux autour de l’œuvre de Gramsci, qui fait que nous connaissons et comprenons infiniment plus de choses que vingt ans plus tôt. Avec ce livre, nous prenons le contre-pied de la méconnaissance de Gramsci : à l’usage superficiel qui en est couramment fait en France, nous opposons la connaissance extrêmement fine, profonde et de longue durée que Gramsci avait de la France, et ses analyses qui peuvent intéresser des gens qui ne s’intéressent pas spécifiquement à lui.
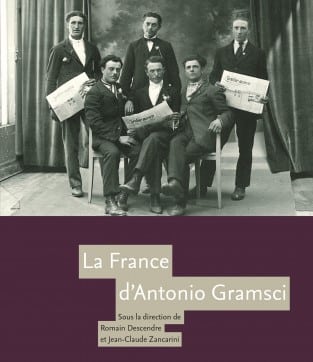
J.-C. Z. – Il y a une fable de La Fontaine qui doit s’appliquer à ces personnes qui citent Gramsci sans véritablement le connaître, et qui s’intitule « L’âne vêtu de la peau du lion » :
« De la peau du Lion l’Âne s’étant vêtu / Était craint partout à la ronde, / Et bien qu’Animal sans vertu, Il faisait trembler tout le monde. […] / Force gens font du bruit en France / Par qui cet apologue est rendu familier. / Un équipage cavalier / Fait les trois quarts de leur vaillance. »
Je crois qu’elle les décrit assez bien, oui.