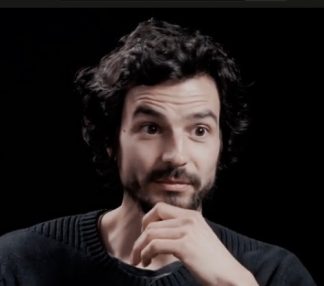Gaël Giraud est économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’École nationale des Ponts et Chaussées et auteur. Spécialisé sur les interactions entre économie et écologie, il est également l’ancien chef économiste de l’Agence française de développement (AFD). Dans la première partie de cet entretien-fleuve, nous revenons notamment sur l’incapacité pour Emmanuel Macron de conduire une véritable transition écologique, sur le financement de celle-ci et la nécessaire réforme des traités européens qui la conditionne. Nouvelle économie des communs, dérive illibérale du gouvernement… Nous abordons également des questions relatives aux rapports entre foi chrétienne, laïcité et écologie. Gaël Giraud est, en plus de tout le reste, prêtre jésuite. Première partie. Retrouvez la seconde partie de l’entretien ici. Réalisé par Pierre Gilbert et Lenny Benbara.
Télécharger l’entretien complet en PDF ici (idéal pour impression)
LVSL – Vous travaillez sur les interactions entre changement climatique et économie. Vous avez par ailleurs soutenu la liste Urgence Écologie aux élections européennes. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron ne conduit-il pas le pays vers une transition écologique ?
Gaël Giraud – Je pense que l’erreur de fond d’Emmanuel Macron, en termes de transition écologique, est de croire qu’il peut la mener dans le respect de l’interprétation actuelle des traités promue par la Commission européenne et par Bercy.
Sa stratégie européiste, si je la résume, consiste à affirmer : « Moi, je suis un bon élève de la classe européenne, je fais mes devoirs à la maison et ensuite on renégocie les traités ». Or cette stratégie est vouée à l’échec car les contraintes budgétaires, notamment sur l’interprétation de la réduction du déficit public en zone euro, sont telles que, dans le contexte actuel, elles rendent impossible le financement public de la transition écologique. D’ailleurs, elles rendent impossible le financement des services publics tels qu’on les connaît aujourd’hui en France, de sorte que notre pays est en sous-investissement public chronique : environ 3% du PIB d’investissement publics, cela ne suffit même pas pour maintenir à niveau le patrimoine public français : la France, aujourd’hui, s’appauvrit chaque année.
Qui peut croire que respecter une interprétation des traités permettra ensuite de mieux les renégocier ? Imaginez que l’on veuille vous couper une jambe pour vous aider à courir un cent-mètres-haies. Préconiser l’austérité par temps de déflation n’est pas moins absurde… Croyez-vous donc vraiment que commencer par vous faire amputer soit le meilleur moyen, ensuite, de faire comprendre à votre interlocuteur que vos deux jambes — le secteur public et le secteur privé — sont nécessaires pour courir ? La rigueur budgétaire à laquelle nous contraint l’interprétation actuelle des traités est tout simplement en train d’engendrer un effet Brünning en France : encore moins d’inflation, davantage de gilets jaunes ou rouges dans la rue, de pompiers, de policiers, de profs, d’urgentistes, d’aides-soignants en colère… et, à la fin, plus de voix pour le Rassemblement national. Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, tout en se présentant comme l’ultime rempart démocratique contre le fascisme, la République en marche fait le lit du Rassemblement national. Regardez l’Italie qui, depuis Berlusconi, sert de laboratoire politique à toute l’Europe avec une dizaine d’années d’avance sur nous : Renzi y a tenu le rôle que tente d’occuper aujourd’hui Macron. Ce qui n’a nullement empêché Salvini d’arriver au pouvoir, bien au contraire.
Tout aussi grave est le fait qu’en se privant des moyens possibles de financer la transition vers une société sobre en carbone, le président de la République fait perdre des années précieuses à notre pays, à l’Europe et au monde entier. Car mon expérience, c’est que, malgré la petite taille de notre économie, beaucoup de pays du Sud continuent d’observer ce que fait la France, pour éventuellement s’en inspirer. La démission de Nicolas Hulot en septembre 2018 a témoigné du fait que l’écologie ne pèse rien, aux yeux de ce gouvernement, face aux contraintes budgétaires. S’ajoute à cela des décisions incompréhensibles de la part de ce gouvernement comme, par exemple, l’extension de la liste des oiseaux éligibles à la chasse alors que l’effondrement du nombre d’oiseaux en Europe est l’une des marques de la destruction de la biodiversité dont notre modèle de société est en grande partie responsable. Nous avons perdu au moins 400 millions d’oiseaux en Europe depuis 1980. La situation n’est pas aussi tragique qu’en Amérique du Nord, où 3,5 milliards d’oiseaux ont disparu depuis cette date. Voilà certainement un terrain où nous ne souhaitons aucunement entrer en compétition avec l’outre-Atlantique. La décision française, à l’origine de la démission de Hulot, est tout simplement un cadeau électoral fait au lobby des chasseurs – dont le prix du permis a, par la même occasion, été divisé par deux – et une provocation pour la conscience citoyenne des Français. Il y a, semble-t-il, une part d’improvisation et de provocation de la part de ce gouvernement à l’égard des questions écologiques qui témoigne que ce n’est nullement sa priorité. Ceci n’est pas incompatible avec une communication extrêmement rodée comme au G7 à Biarritz, destinée à donner l’illusion du volontarisme gouvernemental. Les observateurs de la politique française doivent apprendre plus que jamais à faire le départ entre les discours du président et la réalité de ses décisions politiques.
L’autre raison pour laquelle je doute malheureusement que ce gouvernement fasse la transition écologique, dans ce mandat comme dans le suivant s’il devait être réélu en 2022, c’est qu’il est extrêmement sensible au lobby bancaire et que la plupart des banques européennes, en particulier françaises, sont intrinsèquement hostiles à la transition écologique. Pourquoi ? Parce que beaucoup d’entre-elles ont dans leur bilan énormément d’actifs hérités de la révolution industrielle et qui sont donc liés aux hydrocarbures fossiles. Rien de très étonnant à ça : le bilan de nos banques est simplement le reflet de notre histoire.
Si demain matin on décidait de faire du charbon et du pétrole des actifs échoués (stranded assets), c’est-à-dire de les interdire dans le commerce, une grande partie de nos géants bancaires serait en faillite ou proches du précipice. Ils savent très bien que ce risque de transition associé au climat (« le deuxième risque » dans la typologie esquissée par le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, dans son fameux discours de 2015 sur la tragédie des horizons) est mortel pour eux. Donc, tout en faisant du green washing qui consiste à faire croire que les banques se sont mises au vert, en réalité, ces dernières n’ont aucune intention de financer pour de bon un changement de société qui signifierait la fin de leur modèle d’affaires actuel. Un exemple : les fameuses obligations vertes. Deux amis, l’ancien trader Julien Lefournier et le mathématicien Ivar Ekeland, ont montré que ces obligations n’ont strictement rien de vert: elles financent en moyenne les mêmes projets que les obligations traditionnelles. Cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, elles ne pourront pas financer de vrais projets liés à la transition écologique mais, jusqu’à présent, elles ont essentiellement servi à faire… de la publicité.
LVSL – Combien coûterait la transition écologique ?
G.G. – Il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais on peut dire, en étant certain de ne pas se tromper, que c’est plus de 30 milliards et moins de 100 milliards par an pour mettre en œuvre les grands chapitres de la transition écologique en France. Soit entre 1,5 et 4% du PIB français. En quoi consiste un tel programme ? Plusieurs scénarios ont été élaborés par le Comité des experts pour le débat national sur la transition écologique commandité par la ministre d’alors, Delphine Batho, et présidé par Alain Grandjean. Ils diffèrent selon le bouquet énergétique retenu pour 2035. Mais ils ont tous en commun les mêmes étapes en matière d’efficacité énergétique : la rénovation thermique de tous les bâtiments (publics et privés), la mobilité verte avec un déploiement massif du train et du ferroutage – car nous ne pourrons pas acheminer la nourriture sur des camions électriques ou roulant à l’hydrogène – et le verdissement des processus industriels et agricoles. Voilà un authentique projet de société vers une France verte, sobre et juste. Ces travaux ne peuvent pas être délocalisés et ce ne sont pas des ouvriers chinois qui vont réhabiliter les combles de nos passoires thermiques. Un tel programme est donc extraordinairement créateur d’emplois locaux. À tel point que les entreprises du BTP nous préviennent : n’allez pas trop vite, nous disent-elles, car nous n’avons pas assez d’ouvriers spécialisés pour réaliser la rénovation thermique à grande échelle. Ouvrons alors des filières d’apprentissage ! Bien sûr, il y aura aussi des pertes d’emplois : notamment les emplois liés aux deux mines de charbon encore en activité sur notre territoire. Mais l’Allemagne, cette fois, est en train de donner le bon exemple en fermant toutes ses centrales à charbon et en déployant un ambitieux programme de reclassement pour les ouvriers de la mine. Au nom de quoi la France serait-elle incapable d’en faire autant ? La transition vers une société zéro carbone est aussi une très bonne nouvelle pour la balance commerciale française car elle réduit notre dépendance au pétrole, et donc à la principale importation (70 milliards chaque année), qui creuse le déficit de notre balance courante. Et qui dit moins de déficit de la balance extérieure, dit moins de déficit public car, comptablement, l’acteur qui in fine supporte le coût excédentaire de nos importations, c’est l’État.

LVSL – Comment financer la transition écologique ?
G.G. – D’un point de vue macro-économique, si nous économisons plusieurs dizaines de milliards de déficit commercial, cela fait autant d’argent qui peut être dépensé autrement dans le pays. L’État pourrait donc d’entrée de jeu engager cette dépense en étant certain que cela lui reviendra sous forme de recettes fiscales simplement parce que l’argent économisé en achetant moins de pétrole se retrouvera au moins en partie dans ses caisses. Mais sans même entrer dans cette logique macro-économique qui, toute élémentaire qu’elle soit, échappe à beaucoup d’observateurs, nous disposons d’un grand nombre de marges de manœuvre inexploitées. Premièrement, la mise en place d’un grand emprunt national comme Giscard l’avait fait en 1976 pour lutter contre la sécheresse. La situation actuelle est bien plus grave que la sécheresse de 1976 : le stress hydrique dû au dérèglement climatique se fait sentir désormais chaque année dans les zones rurales françaises, il n’y a que les urbains pour ne pas s’en rendre compte. Cela justifierait amplement d’en appeler à titre exceptionnel à l’épargne nationale. Deuxièmement, on peut reconstituer des marges de manœuvre budgétaire en rétablissant l’impôt sur la fortune, car selon le rapport de la Commission des finances, le passage de l’ISF à l’IFI a fait perdre 3,5 milliards d’euros à l’État sans réel impact positif sur l’économie française, au contraire[1]. Je pense qu’il faut un grand big bang fiscal qui permette de rendre de nouveau l’impôt français redistributif, ce qu’il n’est plus aujourd’hui. Cela suppose de restituer le débat fiscal, terriblement embrouillé aujourd’hui, sur des bases saines. Je ferai prochainement une proposition dans ce sens.
Troisièmement, il faut considérer un degré de liberté que nous n’utilisons absolument pas et qui est l’interprétation de la règle des 3 % du déficit public imposée par l’article 140 du Traité du fonctionnement de l’Union européenne. En fait, comme l’ont montré avec force Alain Grandjean et la Fondation Nicolas Hulot[2], il est tout à fait possible de discuter du périmètre sur lequel on applique les 3% et, par exemple, de retirer du calcul du déficit public certaines dépenses d’investissement public liées à la transition écologique. On l’a fait pour certaines dépenses associées au sauvetage des banques en 2008 et 2009, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour sauver la planète ? Par ailleurs, l’État est bien le seul acteur économique pour qui aucune distinction n’est faite entre des dépenses d’investissement de long terme, dont l’amortissement s’étale sur plusieurs décennies, et des dépenses de fonctionnement. Que diraient nos entreprises si leur comptabilité était construite sur cette confusion ?
Cela suppose une discussion avec la Commission européenne sur l’interprétation du périmètre sur lequel s’applique la règle des 3 %, mais modifier son périmètre d’application n’impliquerait pas une violation des traités. Le Comité budgétaire européen, un organe consultatif indépendant de la Commission, a rendu début septembre un rapport très critique sur l’évaluation des règles budgétaires : complexité inutile et illisibilité de règles qui échouent, de toute façon, à atteindre leurs objectifs, effets délétères sur l’activité économique et l’investissement public, réponse inadéquate aux divergences accrues des taux d’endettement public entre le Nord et le Sud… il est temps que nous révisions l’herméneutique des traités européens de fond en comble.
À mon sens, il y a des dépenses incompressibles qu’on doit retirer du calcul des 3 %. Je l’ai dit : la dépréciation du patrimoine français induit un appauvrissement national net, et donc une réduction inacceptable de notre souveraineté. Un exemple caricatural est donné par le rapport sénatorial Chaize-Dagbert[3] sur les ponts en France : 25 000 ouvrages français sont en danger de sinistre. Si nous ne voulons pas revivre la catastrophe du pont Morandi de Gênes du 14 août 2018 ou celle du tunnel du Mont Blanc d’il y a vingt ans, il faut absolument réhabiliter ces ponts dans les années qui viennent. C’est une question de sécurité nationale. Du moins, si vous voulez que vos enfants continuent de traverser des ponts en France ! De la même manière, les circuits d’adduction d’eau en milieu rural en France sont vétustes : sans une rénovation massive, Véolia, Suez ou la Saur pourraient se trouver en difficulté pour assurer l’adduction d’eau potable dans nos campagnes au cours des années à venir. C’est un service public élémentaire. Je ne vois pas le début d’une réflexion sérieuse, au gouvernement, sur ces questions et ceci, sans doute pour des raisons d’orthodoxie budgétaire qui proviennent simplement d’une interprétation parmi d’autres des traités européens.
Enfin, quatrièmement, nous disposons d’une batterie d’instruments à notre disposition qui consiste à utiliser intelligemment la garantie publique. On a mis plus de 70 milliards d’euros de garanties publiques pour Dexia. BPI France a accordé l’an dernier près de 20 milliards de garantie publique à l’export pour faciliter les exportations des entreprises françaises à l’international. Et c’est fort bien ainsi. Mais qu’est-ce qui nous empêche, dès lors, de mettre 30 à 40 milliards d’euros de garanties publiques pour financer la transition écologique en France ? La garantie publique reste hors du bilan de l’État et, contrairement à ce qu’on raconte parfois, ce n’est pas de la dette. Pas même de la dette en puissance, à moins que vous ne soyez convaincu que l’argent sera dépensé en pure perte…
Comment procéder en pratique ? Nous pouvons mettre en place un fonds ou une société de droit privé qui puisse jouir de la garantie publique et qui pourrait emprunter de l’argent sur le marché obligataire en vue de financer la transition. Nous l’avons fait, en France, avec la SFEF, la Société de financement de l’économie française, précisée par Michel Camdessus en 2009, afin de sauver les banques. D’ailleurs, autant que je sache, la SFEF existe toujours : nous la conservons en réserve de la République pour le prochain maelström financier. Qui nous empêche de l’utiliser pour financer la transition en France ? Dans un contexte où les investisseurs internationaux s’arrachent la dette publique française au point d’être prêts à consentir des taux d’intérêt négatifs – autrement dit : ils paient l’État français pour que celui-ci s’endette auprès d’eux, ils ne barguigneraient pas pour prêter plusieurs dizaines de milliards à une SFEF destinée à financer la rénovation thermique des bâtiments publics, la réhabilitation de nos charmantes voies de chemin de fer de 1945 en vue d’aménager des circuits courts d’alimentation, etc. On pourrait aussi utiliser intelligemment les canaux de création monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d’investissement qui sont tout à fait en mesure de refinancer des dépenses d’investissement liées aux infrastructures vertes.
LVSL – Les Verts sont divisés sur cette question récurrente qu’est le capitalisme. Est-il compatible avec l’écologie ? Qu’en pensez-vous ?
G.G. – Je pense que c’est un faux débat. J’aimerais bien que ceux qui, par exemple opposent Yannick Jadot et David Cormand sur cette question me donnent leur définition du capitalisme. Il n’y en a pas une, mais des dizaines : le capitalisme rhénan ou celui de la Suisse dans les années 60 n’a rien à voir avec le capitalisme texan d’aujourd’hui qui lui-même n’a rien à voir avec la Suède, qui n’a rien à voir avec le Japon aux heures glorieuses du toyotisme… Déjà Michel Albert faisait valoir l’affrontement entre deux types, au moins, de capitalisme. Et mon collègue Bruno Amable, lui, en identifie au moins cinq. J’ignore, donc, si la transition vers une société zéro-carbone est compatible avec le capitalisme, et je vous avoue que cette question ne m’intéresse pas. Elle sert à alimenter nos discussions de bistros, tout comme, autrefois, l’affaire Dreyfus ou l’eschatologie communiste, sans faire avancer la discussion sur la vraie question qui est : par où commence-t-on la transition ?
Il est beaucoup plus intéressant à mon avis de discuter du rapport à la propriété privée et à la finance, qui est un aspect commun aux différents capitalismes contemporains. Ce n’est certes pas le seul mais il joue un rôle central dans la financiarisation de nos sociétés. Un monde de marchandisation intégrale de l’humanité et de financiarisation de nos relations est incompatible avec la durabilité écologique. Ce qui est très important aujourd’hui c’est la lutte de tous les instants à mener contre la colonisation de nos esprits par un imaginaire managérial et cybernétique qui voudrait que tout être humain soit une marchandise, contrôlable et échangeable. Certains économistes, lorsqu’ils vont parler à l’Académie des sciences morales et politiques, expliquent qu’il est normal qu’on puisse donner un prix de marché à la vie humaine, à votre vie, par exemple. En effet, à travers la spéculation sur les actifs financiers dérivés sur les contrats d’assurance, on fixe le prix de marché de ces contrats, et donc, implicitement, on donne un prix à la vie des personnes qui ont signé ce contrat. Quand bien même les marchés financiers seraient efficients, c’est inacceptable. Et quand on sait le degré d’inefficience et d’irrationalité des marchés financiers, de tels propos deviennent quasiment criminels. De la même manière, donner un prix aux services écologiques rendus gratuitement par la nature ou à la survie de l’espèce des tigres du Bengale ne permettra pas de sauver les tigres. Au contraire, la magie noire de la marchandisation les rend alors interchangeables avec n’importe quelle autre marchandise qui posséderait le même prix. C’est cette logique qui fait dire à certains de mes collègues que la disparition programmée de la faune halieutique dans nos océans n’est pas une tragédie : la pisciculture permettra, pense-t-on, de substituer des poissons de bassins à ceux que nous péchions autrefois dans la mer. De même, la disparition programmée des abeilles donnerait lieu, entend-on, à l’invention de robots articulés qui iront polliniser à leur place. C’est évidemment du délire, qui oublie que les robots eux-mêmes ont besoin de minerais et d’énergie et que, précisément, les minerais et l’énergie ne sont pas disponibles gratuitement en quantité illimitée. La vérité, c’est que ce sont les femmes pauvres des campagnes qui iront polliniser à la main. Cela s’est, hélas, déjà vu…
Il faut sortir de cette utopie de la privatisation du monde. Ce qui suppose une révolution anthropologique en vue de renouer avec une forme d’humanisme politique, social, économique : l’être humain est intrinsèquement un être de relations aussi bien dans nos familles que dans la société, dans le monde, avec les animaux que nous aimons et ceux que nous aimons moins, avec notre environnement, avec nos morts et avec les enfants qui ne sont pas encore nés. C’est la prospérité de ces relations qu’il faut promouvoir bien davantage que la réduction du monde à un vaste supermarché.
LVSL – Quelle est l’alternative ?
G.G. – La gestion et la célébration des communs. Autrement dit, la promotion de ressources partagées, aussi bien des ressources matérielles qu’immatérielles. Par exemple, comment faire en sorte qu’un étang, une forêt ou un hot spot de biodiversité en France puisse devenir un commun et ne pas être détruit en étant réduit à des marchandises ? Comment faire en sorte que la faune halieutique qui est en train de disparaître dans nos océans (sous les coups conjugués de leur acidification à cause de nos émissions de CO2, de leur réchauffement, de la pollution plastique et de la pêche industrielle en eaux profondes) puisse devenir un commun ? Tant que les poissons seront la propriété privée de celui qui les pêche, nous courrons le danger de ne plus avoir de grands pélagiens, soit les poissons comestibles dans nos mers d’ici 2040 ou 2050.
Sur Internet s’inventent énormément de rapports renouvelés à la propriété comme les logiciels libres ou le Copyleft. Le Copyleft, c’est le contraire du copyright : il donne à tous le droit d’usage d’une invention mais à la condition expresse que personne ne tente de se l’approprier de manière privative. Ce bouillonnement d’inventions sur la Toile est le symptôme que nos sociétés sont en travail : elles cherchent d’autres moyens de partager nos ressources que leur simple destruction par leur privatisation. Wikipédia est un extraordinaire commun, bien plus efficace, complet et rigoureux que son équivalent public (c’est-à-dire étatiste) : il y a moins d’erreurs sur Wikipédia que dans l’Encyclopaedia Britannica…
Et puis, les communs, c’est certainement notre rapport au monde le plus ancien, le plus archaïque : avant l’invention de la propriété privée par des juristes romains, l’humanité a toujours considéré la Terre comme un commun, une ressource appartenant à tous pourvu que l’on en prenne soin. Mais les communs ne concernent pas seulement les ressources naturelles et Internet : comment faire, par exemple, pour que le travail ne soit pas une marchandise privée ? Comment mettre fin à la régression esclavagiste qu’est l’ubérisation de nos relations au travail, laquelle se dissimule derrière la promotion du statut d’auto-entrepreneur ? Comment faire en sorte que le travail puisse être un commun ? Cela suppose une refonte radicale du droit de travail qui va à contre-courant de ce que fait le gouvernement. Nous pourrions nous inspirer des remarquables travaux d’Alain Supiot sur le sujet. De même, comment redéfinir l’entreprise aux articles 1832 et 1833 du Code civil non plus comme une boîte noire qui produit du cash pour les actionnaires qui en sont, croit-on, les propriétaires privés, mais comme une communauté de destins qui veut mettre en œuvre un projet socialement utile ? Cela suppose d’aller beaucoup plus loin que la loi Pacte qui a accouché d’une souris. Pourtant la Commission Nota-Sénart, qui m’a auditionné, avait des propositions tout à fait intéressantes. Las, elle a été bridée par Matignon et l’Élysée… Pour aller plus loin, nous pourrions, là aussi, nous inspirer du travail de Daniel Hurstel, Cécile Renouard et moi-même.
Comment, enfin, faire de la monnaie un commun ? Cela passe par la promotion de toutes ces monnaies locales complémentaires qui bourgeonnent un peu partout en France, y compris dans la Creuse. Ces monnaies sont autant de moyens par lesquels une communauté, quelle qu’elle soit, s’efforce de se réapproprier le pouvoir de création monétaire qui a été confisqué par les banques privées depuis que les États de la zone euro sont privés du droit de battre monnaie. Nous sommes de fait les seuls au monde à l’avoir fait, en mettant en place une véritable indépendance de la Banque centrale à l’égard du politique, nous avons privatisé la monnaie en Europe.
LVSL – Pourquoi ?
G.G. – Parce que la BCE n’a pas de compte à rendre auprès des États, et elle rend formellement compte ex post de ses activités auprès du Parlement européen, sans que celui-ci ne puisse intervenir en amont sur ses décisions de politique monétaire. Du coup, la BCE est largement inféodée au lobbying des banques privées et vous n’aurez aucun mal à interpréter toutes les décisions prises par Francfort depuis 2008 comme des décisions favorables aux intérêts du secteur bancaire. Je vous mets au défi de trouver une seule exception. Pourtant, croyez-vous que les intérêts du secteur bancaire privé coïncident avec l’intérêt général ?
Mais revenons aux communs : ces quatre chantiers – la promotion des ressources naturelles et des ressources de l’intelligence collective sur Internet, le travail et la monnaie comme communs -, esquissent les contours d’un projet politique très ambitieux, où la première mission de l’État ne consiste plus seulement à gérer les biens publics – ce qu’il doit continuer de faire : l’école, la santé, la poste, etc. -, mais aussi à créer les conditions de possibilité d’émergence des communs dans la société civile. Voilà une utopie concrète qui va nous occuper pour plus d’un siècle. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle a déjà commencé…
LVSL – Vous êtes prêtre jésuite. Pourquoi avez-vous choisi cette voie-là ? Quelle relation entretenez-vous avec l’Église ? Vous vantez souvent l’héritage de la Révolution française et la sécularisation, seriez-vous donc un prêtre laïc ?
G.G. – Je n’utiliserais pas cette expression de prêtre laïc. Les jésuites ont une grande tradition d’engagement en faveur de la justice. On connaît le sort des jésuites du Salvador assassinés par la junte militaire en 1989 parce qu’ils soutenaient les pauvres. On sait moins, par exemple, que deux jésuites ont été assassinés à Moscou en 2008, parce qu’ils gênaient les collusions entre l’Église orthodoxe et le régime de Poutine. Bien sûr, nous n’avons nullement le monopole de l’engagement en faveur de la justice, même parmi les ordres religieux catholiques. Je pense notamment au Frère dominicain Henri Burin des Roziers, décédé hélas en 2017, et qui fut un ardent défenseur des paysans sans terre dans le Nordeste brésilien —un homme lumineux. Je pense à telle religieuse xavière, Christine Danel, une amie également, qui s’est rendue dans les centres de traitement d’Ebola en Guinée, au pire moment de la pandémie de 2014, pour aider à la mise en place d’un traitement de la maladie. Pour les Jésuites, disons que la promotion de la justice sociale et l’expérience de foi sont une seule et même mission. C’est ce qui m’a sans doute séduit dans l’ordre des Jésuites, avec, bien sûr, une certaine rigueur intellectuelle et, surtout, une profonde tradition spirituelle. C’est ce qui manque à beaucoup de nos contemporains, je crois : un espace de liberté intérieure. Beaucoup de jeunes sensibles à la question écologique cherchent à retrouver des espaces d’intériorité, de silence, de gratuité. Notamment pour s’évader de la prison du tout-marchandise, du tout-jetable ou du tout-détritus. Certains cherchent du côté des sagesses orientales parce qu’ils ne se sentent plus liés au patrimoine chrétien qui est, pourtant, le leur. Ou bien à cause du discrédit qui frappe à juste titre notre Église du fait des scandales liés à la pédo-criminalité. Pour ma part, je crois que le christianisme est très fondamentalement une école du désir (ce que le bouddhisme n’est pas, par exemple) et que beaucoup d’entre nous ont soif d’apprendre à découvrir le désir de vie qui sourd du plus profond d’eux-mêmes.
Je parle volontiers de façon positive de la Révolution française et de la modernité occidentale, c’est vrai. Dans son intuition de fond, elle est un produit du christianisme même s’il est vrai que des chrétiens en ont été les victimes, je pense notamment au prêtre Jean-Michel Langevin et aux martyrs d’Angers. Lorsqu’au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, une bonne partie de l’Église catholique a cru bon de s’opposer à la modernité, elle n’a pas reconnu que ce qu’elle avait en face d’elle, ce qu’elle a cru être son ennemie, était en partie son propre enfant. Bien sûr, il faut distinguer, au sein des Lumières, entre, disons, Rousseau et Voltaire. L’arrogance d’un Voltaire, riche commerçant esclavagiste, n’a pas grand chose à voir avec les intuitions démocratiques de Rousseau. Or, du point de vue du rapport du politique au religieux, les Lumières, disons, rousseauistes ont cherché à désacraliser le pouvoir politique : désormais, le pouvoir politique et la souveraineté n’auraient plus comme instance de légitimation un ordre sacré, transcendant fondé sur Dieu. C’est la “sortie de la religion” telle que Marcel Gauchet, par exemple, l’a thématisée. Gauchet a fort bien montré que le christianisme est justement la “religion de la sortie de la religion”. Ce n’est pas un hasard s’il n’y a, semble-t-il, que dans les sociétés de tradition chrétienne que la laïcisation du pouvoir politique est aussi avancée que chez nous. Or, depuis le début de l’aventure chrétienne, la grande tradition évangélique consiste à “rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu” (Luc 20,25).
Par ailleurs, l’autre grande leçon des religions bibliques, c’est qu’il nous faut apprendre à préférer la sainteté au sacré : Emmanuel Lévinas avais mis l’accent sur ce point en relisant le Talmud ; aujourd’hui, un théologien comme Christoph Theobald montre que cette intuition est centrale pour l’expérience chrétienne. Là où le sacré sépare (le pur de l’impur, le sacré du profane, l’homme de la femme, l’élite du peuple, etc.), l’Évangile nous apprend à découvrir les ressources de sainteté enfouies dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Il y a même de la sainteté chez les gilets jaunes ! (Rires.)
L’Église a fait l’erreur au Moyen Âge de prendre le pouvoir sur la souveraineté politique. Compte tenu de la désintégration de l’Empire romain et de la décomposition de l’Empire carolingien, il était sans doute nécessaire qu’elle assume la défense de l’intérêt général et du droit mais, après la réforme grégorienne du XIe siècle, elle a prétendu dicter ce qu’est un bon gouvernement, sacrer les rois et déposer les mauvais gouvernants. Aujourd’hui, c’est plutôt la Commission européenne qui tente de s’arroger un tel privilège, lequel n’est pas plus démocratique au XXIe siècle qu’il ne l’était sous le Pape Grégoire VII. Quand les institutions européennes font démissionner Berlusconi, tout le monde applaudit à juste titre, mais lorsqu’elles le remplacent par Mario Monti (qui, avec une étonnante inconscience, a démarré l’effet Brünning dans une Italie en pleine déflation), on est en droit de s’interroger sur le caractère démocratique de la méthode. Et quand elles obligent Tsipras à agir contre la volonté des citoyens grecs exprimée à 61,5% des voix lors du référendum du 5 juillet 2015, le doute n’est plus permis : Canossa n’est pas plus démocratique aujourd’hui qu’hier. L’Église, quant à elle, a mis un siècle à admettre que ce que les Lumières lui imposaient dans la violence — renoncer à se substituer au pouvoir politique souverain — venait, en vérité, de l’Évangile. Sa mission, aujourd’hui, c’est de dévoiler sans relâche les trésors spirituels dissimulés dans la création et dans le secret de nos relations sociales. Nous avons besoin de ces trésors pour y puiser l’énergie collective nécessaire à l’invention des communs sans lesquels la privatisation du monde achèvera de le détruire et de démanteler la démocratie. Finalement, l’encyclique Laudato Si’, telle que je la comprends, n’invite pas à autre chose. Les ressources d’intelligence collective partagées sont immenses mais fragiles, comme notre planète. L’État doit créer les conditions de possibilités juridiques d’émergence de ces communs ; l’Église, avec d’autres bien sûr, peut alimenter la soif spirituelle et le discernement nécessaires pour les faire émerger.
LVSL – Que pensez-vous de Pierre Teilhard de Chardin ?
G.G. – C’est un jésuite français qui a eu une intuition extrêmement forte : il y a une unité profonde entre l’évolution des conditions du vivant sur la terre et l’évolution de nos sociétés. Toute la recherche contemporaine en écologie montre que l’intuition de Teilhard était fondamentalement juste. Mes travaux au croisement de l’économie et de la thermodynamique suggèrent que l’économie est une structure dissipative analogue au métabolisme humain : nous absorbons de l’énergie et de la matière, que nous métabolisons pour fournir du travail, et nous exsudons des déchets. Ce qui signifie que la croissance du PIB ad nauseam n’est tout simplement pas compatible avec la capacité de charge finie de notre unique planète.
L’un des concepts-clefs de Teilhard, c’est la noosphère : l’intuition qu’à travers nos relations humaines se tresse un grand réseau d’idées, de paroles et d’actions en continuité avec le grand réseau du vivant. Internet, contrairement à une idée reçue, possède une empreinte matérielle très significative, à la fois en termes d’énergie, d’émission de chaleur et d’usage de minerais dans nos ordinateurs. Cette matérialité de la Toile rejoint l’intuition teilhardienne d’une continuité entre la matière et l’intelligence, même si la noosphère ne s’identifie nullement avec la sphère internet où il y a énormément de bruits, de brouillage et un flux d’information non pertinentes ou qui ne font grandir personne : pensez à la pornographie, par exemple. L’explosion de la sphère internet, par exemple, ne veut pas dire que la noosphère soit en croissance. Elle croît en revanche lorsque Wikipédia se développe, permettant un accès libre à la mise en commun de nos intelligences. Elle fera un grand pas le jour où les journaux français accepteront de rendre gratuit l’ensemble des articles dédiés au climat comme je l’ai récemment proposé dans une pétition qui a recueilli, à ce jour, 31 000 signatures…
LVSL – Quand régresse-t-elle ?
G.G. – Par exemple, lorsque des hackers russes réussissent à influencer les élections américaines et contribuent à faire élire un homme, Donald Trump, qui, au début des années 1990, était ruiné et dont les dettes ont été payées… par des oligarques russes. De là à faire l’hypothèse que Trump, en réalité, travaille pour la Russie, il n’y a qu’un pas. Les travaux de l’historien Timothy Snyder vont, hélas, dans ce sens. D’ailleurs, vous pouvez relire l’ensemble des décisions prises par Trump en matière de politique internationale depuis deux ans en vous interrogeant : servent-elles les intérêts des États-Unis ? Desservent-elles les intérêts de Moscou ? Vladimir Poutine — reçu comme un ami par notre président au fort de Brégançon pendant l’été— finance par ailleurs Matteo Salvini, Marie Le Pen et Boris Johnson. Autant de figures politiques dont le projet avoué est de déstabiliser l’Union européenne. L’ambition de Poutine, à ce sujet, est explicite : restaurer un pan-slavisme russe jusqu’en Europe de l’Ouest. Combien de temps faudra-t-il à l’Europe pour parler d’une seule voix, et avec fermeté, face à une menace aussi grave ? Angela Merkel serait-elle la seule à avoir pris la mesure de ce danger ?
LVSL – Revenons un instant à l’Église : quel devrait être le rapport entre l’État et l’Église et entre l’État et les autres religions ?
G.G. – Le compromis français de laïcité républicaine est le bon et il ne faut pas revenir dessus. L’Église catholique a pris une juste distance vis-à-vis de la souveraineté politique. Il y a bien sûr des courants réactionnaires qui veulent de nouveau sacraliser le pouvoir politique, mêler à nouveau le sabre et le goupillon mais je ne crois pas que l’Église catholique reviendra sur le compromis dont l’Évangile est, en fait, la source première. En tout cas, pas sous l’extraordinaire pontificat de François.
LVSL – L’Église est souvent perçue comme réactionnaire au sujet des questions liées aux mœurs. Que pensez-vous du mariage pour tous, de l’avortement, de la PMA ?
G.G. – Je ne dirais pas que l’Église catholique est réactionnaire. Le Magistère romain a longtemps défendu une certaine vision de la famille qui est promue aussi bien par les psychanalystes lacaniens, par exemple. Il y a une analogie très forte entre l’anthropologie lacanienne et celle du Magistère. Et je ne suis pas sûr qu’on puisse accuser les psychanalystes lacaniens d’être réactionnaires, quand bien même il existe aussi, évidemment, des psychanalystes qui ne sont pas lacaniens : pensez à Donald Winicott, par exemple.
Quoi qu’il en soit, nous assistons en Occident à la décomposition du schéma traditionnel de la famille. À titre personnel, je suis inquiet pour la croissance humaine d’un certain nombre d’enfants dans certaines familles complètement disloquées ou recomposées. Reste que les évolutions qui ont conduit à la légalisation de l’avortement, au mariage pour tous et à la légalisation de la PMA, me paraissent irréversibles. Ce ne sont pas les bons combats pour l’Église aujourd’hui. Le bon combat, c’est de s’opposer à la GPA. La privatisation du corps de la femme, ça, c’est inacceptable. Cela fait partie de cette grande utopie néolibérale, mortifère, de privatisation du monde. La transformation des femmes en objets de consommation procède de la même déshumanisation que la destruction de l’environnement, la maltraitance des enfants ou des personnes âgées et la foi dans la toute-puissance des marchés (relisez l’incroyable paragraphe 123 de l’encyclique Laudato Si’ à ce sujet). À cela, il faut s’opposer avec la dernière énergie car la GPA revient, au sens littéral, à pouvoir acheter un enfant : elle permettra, en effet, de faire venir au monde un enfant, à la demande de parents dont il ne partagera aucune part du code génétique, porté dans le ventre d’une femme qui ne sera ni sa mère génétique, ni sa mère d’adoption. Alors la vie humaine sera entièrement marchandise. Ce fantasme post-libéral signe la fin de la dignité humaine et n’a plus rien à voir avec le libéralisme classique du XVIIIe siècle.
Les nostalgiques du schéma traditionnel de la famille, quant à eux, doivent lire Emmanuel Todd et sa réécriture de la cartographie leplaysienne de la famille. Car ce qu’ils ont en tête n’est qu’un schéma parmi beaucoup d’autres : il n’y a jamais eu de schéma universel et définitif de la famille. Les structures familiales ont évolué dans le temps et dans l’espace, notamment pour s’adapter à des contraintes agraires et climatiques de long terme. L’essence éternelle de la famille est introuvable. Le modèle nucléaire-égalitariste (où l’héritage est partagé équitablement entre des enfants qui, à l’âge adulte, quittent le foyer de leurs parents hétérosexuels) est un produit de l’histoire, hérité notamment du bassin parisien, et ne s’est imposé un peu partout en Occident que récemment. Il vole aujourd’hui en éclats parce que, l’énergie étant apparemment gratuite, beaucoup de couples peuvent se payer le luxe d’entretenir plusieurs foyers. Je ne suis pas sûr que cela durera très longtemps. Par contre, il est indéniable que le statut de la femme diffère grandement d’un schéma familial à un autre. Et que, malheureusement, beaucoup de régions des pays du bassin indo-méditerranéen régressent en ce moment vers des schémas de familles communautaires (où les enfants restent dans le giron familial, même à l’âge adulte) nettement défavorables à l’émancipation des femmes. Les femmes iraniennes jouissaient sous le Chah d’une liberté qu’elles ont hélas perdue.

LVSL – Observez-vous, au plus haut niveau de l’État, une dérive illibérale ? Comment se concrétise-t-elle ?
G.G. – J’observe qu’une partie de la haute fonction publique française ne croit plus en l’État au sens où elle est persuadée que la République, telle que nous l’avons construite à travers les grands compromis d’après-guerre, est velléitaire, contradictoire, n’a plus les moyens de sa politique ou n’a plus de vision. De sorte que rien ne vaudrait une bonne assemblée sanglante d’actionnaires qui maximisent leurs profits à court terme. Ces propos, que j’entends y compris à l’Inspection générale des finances, font froid dans le dos. Il est vrai qu’il y a peu, Michel Pébereau se vantait qu’il y ait plus d’inspecteurs généraux des finances ayant pantouflé à la BNP Paribas que travaillant pour l’intérêt général dans la fonction publique. Cela veut dire que la haute fonction publique elle-même doute de sa propre mission. En témoigne également le nombre de pantouflages de hauts fonctionnaires : le directeur général du Trésor français s’en va travailler pour un hedge fund chinois, le Hongrois Adam Farkas, l’actuel directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne, s’apprête à prendre la tête de l’Association des marchés financiers en Europe, un puissant lobby qui défend les intérêts du secteur bancaire privé. Imaginez-vous le patron de la police de Bogotá qui deviendrait le principal lieutenant de Pablo Escobar ? Remarquez, en France, nous avons nommé à la tête de l’autorité monétaire suprême un ancien cadre dirigeant de BNP Paribas puis, à la tête de l’État, un inspecteur des finances ayant pantouflé chez Rotschild… Il y a heureusement des exceptions remarquables : des hauts fonctionnaires qui ont conservé envers et contre tout un haut sens de l’État. Mais, souvent, leur intégrité pénalise leur carrière, en particulier sous l’actuel gouvernement.
Cet état d’esprit délétère participe d’une forme de sécession des élites françaises et, plus généralement, occidentales, liée au schisme éducatif du tiers éduqué supérieur. Aujourd’hui, comme mon ami Todd a été le premier à le faire remarquer, je crois, un tiers environ de la population de notre pays fait des études supérieures à l’issue d’un bac généraliste. C’est à la fois peu (les membres de ce tiers s’imaginent souvent représenter 80% de la population) et beaucoup : un tiers, cela permet de vivre dans l’endogamie quasi-complète. Si vous appartenez à ce tiers-là, demandez-vous quand il vous arrive de rencontrer quelqu’un qui n’a pas son bac. Le tiers des études supérieures ne sait plus ce qui se passe dans le reste du corps social et ne le comprend plus. D’où son étonnement, parfois sincère, face aux gilets jaunes ou à la victoire du Non au référendum de 2005 sur l’établissement du Traité constitutionnel. Lorsque la haute fonction publique, ou une partie de ses membres du moins, doute de sa mission, elle doute de l’utilité de travailler pour ceux et celles qu’elle ne rencontre plus, qu’elle ne connaît plus. Une autre fraction de cette même noblesse d’État, penche au contraire pour une démocrature, dans laquelle on imposerait les décisions technocratiques qu’elle estime être les seules raisonnables. Sans s’apercevoir que, le plus souvent, ces décisions ne servent que ses propres intérêts de court terme. Il y a là un malentendu extrêmement profond.
Inversement les deux tiers du corps social français qui ne font pas partie de cette élite de masse ne se sentent plus représentés par des médias entièrement financés par et pour le tiers éduqué supérieur, lequel cumule tous les pouvoirs : financiers, économiques, politiques et, parfois, même culturels. Les autres, la majorité donc, ont l’impression d’être abandonnés par les privilégiés des centres-villes métropolitains. Dans bien des régions rurales de France, les trains s’arrêtent de moins en moins, il n’y a plus d’hôpital, plus de banque, la Poste et les écoles ferment. Les jeunes, évidemment, s’en vont… Certains protestent avec raison contre cet abandon incompatible avec le pacte républicain entre nos concitoyens. Les gilets jaunes ne sont qu’un aspect de cet immense malaise social. Le Grand débat national organisé à la suite des premières manifestations de décembre était un simulacre de discussion qui n’a pas permis la prise en compte sérieuse des revendications des deux tiers. Je crains que cela ne s’aggrave dans les mois et les années à venir. Et quand je vois des policiers français tirer avec des LBD sur des pompiers français, je m’interroge : l’élection de Marine Le Pen aurait-elle davantage divisé les Français ? Je n’en suis plus certain aujourd’hui. Encore une fois : le paradoxe de ce gouvernement, c’est qu’il gouverne pour une toute petite élite et, pour les autres, semble n’avoir rien d’autre à proposer que la violence et le mépris de classe. Le Rassemblement national aurait-il fait autrement ? Il est vital pour le débat démocratique que la scène politique française sorte de ce duel en miroir entre Le Pen et Macron.
LVSL – Pour finir, votre expérience au Tchad et à l’AFD vous a ouvert sur les relations internationales. On observe un retour des politiques protectionnistes dans les pays qui sont les plus influents aujourd’hui : Chine, États-Unis, Russie, Allemagne, Japon… la France, de son côté, brade son industrie stratégique, comme Alstom, et ses fleurons nationaux (ADP…). Ce qui faisait la puissance française est largement dilapidé. Pourquoi à votre avis ? Pensez-vous que les élites françaises soient les idiotes du village-monde ?
G.G. – Je ne crois pas qu’elles soient les idiotes de la globalisation. Ce phénomène de fuite de Varennes que je caractérisais à l’instant me semble important et grave : la sécession des élites par rapport au reste du corps social a des racines profondes. La Révolution française a consacré la défiance de la noblesse vis-à-vis du Tiers ordre. Depuis lors, les élites françaises restent traumatisées par la peur des États-Généraux et de la Jacquerie — ce qui n’est le cas ni de l’Angleterre, ni de l’Allemagne.
La grande peur des bourgeois de centre-ville au moment de l’acte IV des gilets jaunes procède d’une sorte de résurrection de cette hantise séculaire vis-à-vis d’un peuple français qui, si on ne le mate pas par la violence comme l’armée versaillaise a décimé les Communards, est capable de couper la tête du roi. Le fait est qu’aujourd’hui les élites parisiennes ont davantage comme terrain de jeu le monde cosmopolite des élites des autres capitales de la planète que le reste du territoire national. Un homme d’affaires du centre-ville parisien se sent plus proche d’un collègue du centre-ville londonien ou new-yorkais que de son compatriote d’Aulnay-sous-Bois. Dès lors, une partie de ces élites n’a plus aucun scrupule à brader les trésors industriels nationaux français du moment que cela semble servir ses intérêts à court terme. De la même manière, beaucoup de ceux qui se retrouvent à des postes de régulateur financier n’ont aucun scrupule à bloquer toute initiative qui nuirait aux intérêts des banques ou des fonds spéculatifs, vers lesquels ils pantouflent ensuite afin de bénéficier de paiements pour service rendu. Voilà pour l’explication socio-psychologique, si l’on veut.
Évidemment, ce n’est pas elle qui est mise en avant par les apôtres du libre-échange. Cette démission est généralement justifiée par les contes de fées du doux commerce de Montesquieu, qui n’ont pourtant aucun fondement analytique. En présence de mobilité du capital, je ne connais aucune justification rigoureuse du libre-échange y compris au sein de la théorie économique la plus favorable au néolibéralisme. Les travaux empiriques effectués, y compris par le GATT, ces derniers 40 ans, montrent que ces gains nets apportés par la suppression des barrières douanières sont très faibles : de l’ordre de quelques centaines de milliards de dollars, ce qui est ridicule comparé aux sommes en jeu (le revenu annuel mondial est de l’ordre de 70 trillions de dollars). Qui plus est, le seul vrai gagnant du libre-échangisme des quarante dernières années semble être la Chine.
Il est temps de revenir à une compréhension raisonnable du protectionnisme. Pour cela, il faut commencer par se défaire du mythe selon lequel le libre-échange serait synonyme de paix et le protectionnisme rimerait avec la guerre. Deux exemples : en 1868, la France et la Prusse ont signé un accord de libre-échange et deux ans après, elles se faisaient la guerre. Inversement, pendant les Trente glorieuses, tous les pays de l’Ouest européen étaient protectionnistes : pourtant, nous ne nous sommes pas fait la guerre.
La globalisation marchande des trente dernières années a essentiellement permis à l’Occident de continuer à orienter la production des ressources minières d’Afrique et d’Amérique du Sud à son profit tout en bénéficiant des produits manufacturés chinois bon marché et des bénéfices commerciaux, chinois également, recyclés dans les marchés financiers occidentaux via le rachat de dette publique américaine. Cette ère-là est close depuis la crise financière de 2008 mais le monde n’a pas encore trouvé de nouveau cycle global. La mise en place d’une régulation intelligente du commerce international et, en particulier, des flux de matières premières dont nous avons absolument besoin pour sauvegarder la souveraineté de la France, est une nécessité si nous voulons éviter les prochaines guerres qui seront celles de l’eau, de l’énergie et des minerais. Les travaux historiques de Christophe Bonneuil, encore un ami, montrent que l’économie française joue le rôle d’un parasite depuis plus d’un siècle en matière de flux de matière : mis à part la biomasse, nous importons la quasi-totalité de la matière dont nous avons besoin pour vivre. Si, en Europe, nous nous accrochons à cette idéologie sans fondement scientifique qu’est le libre-échange, nous allons tout simplement nous priver des moyens de négocier un juste commerce des produits dont nous avons besoin. Pendant ce temps, la Chine et les États-Unis continuent de piller le sous-sol de nombreux pays du Sud. En d’autres termes, le plus sûr moyen de courir vers des guerres de l’eau, du pétrole ou du cuivre dans les années qui viennent, c’est de ne pas réguler le commerce, de ne pas entamer une négociation maintenant. La réforme de la gouvernance du FMI, par exemple, réclamée par de nombreux pays émergents, serait une première étape. La réforme de l’OMC également. À l’inverse, la guerre civile syrienne est née en 2011 d’une pénurie d’eau prolongée, très mal gérée par la dictature de Bachar el Assad. Le libre-échange est la meilleure recette pour étendre le chaos syrien au reste du monde. Et mes travaux, avec Olivier Vidal et Fatma Rostom notamment, montrent que nous ne pourrons pas continuer à augmenter indéfiniment l’extraction de cuivre sur la planète[4]. Qui, en France, se soucie de trouver des substituts aux usages industriels du cuivre et d’améliorer l’efficacité du recyclage du cuivre que nous gaspillons aujourd’hui ? Cela aussi, ça fait partie des défis de l’industrialisation verte.
[2] Alain Grandjean, Agir maintenant – notre plan pour un New Deal vert, LLL, 2019.
[3] http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-609-notice.html
[4] Olivier Vidal, Fatma Zahra Rostom, Cyril François, Gaël Giraud,“Global Trends in Metal Consumption and Supply: The Raw Material-Energy Nexus”, Elements, 2017, 13(5), pp. 319-324, et “Prey–Predator Long-Term Modeling of Copper Reserves, Production, Recycling, Price, and Cost of Production”, Environ. Sci. Technol, 2019, 53(19), 11323-11336.