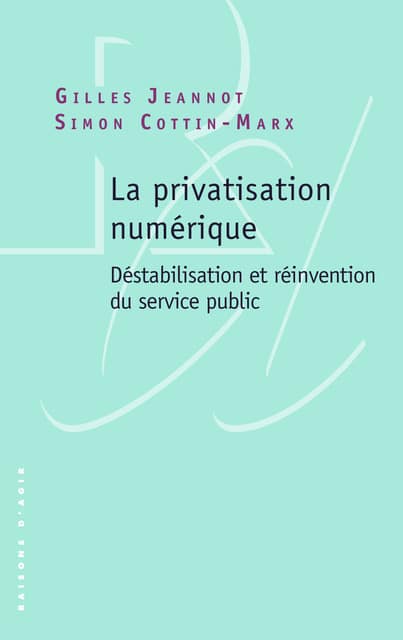Ces cinq dernières années, les obligations de connexion ont explosé : prendre un rendez-vous avec un conseiller Pôle Emploi, faire une demande de RSA, renouveler des papiers d’identité, valider une autorisation de travail… la moindre démarche administrative requiert un ordinateur, une bonne connexion et une aisance dans son utilisation. Au-delà du seul aspect technique, il faut surtout connaître ses droits, maîtriser le langage administratif et ses codes et réussir à naviguer sur des interfaces en constante évolution. Résultat : en 2021, selon l’INSEE, c’est un adulte sur trois qui a renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne. Et ce n’est pas un hasard : la dématérialisation sert une politique sociale qui ne dit pas son nom, de réduction des effectifs et de fermeture des guichets, dont les conséquences sont la mise à distance de l’administration et la fragilisation des plus précaires.
Rencontre organisée par le Mouton numérique avec Clara Deville, sociologue, Gabriel Amieux, animateur du Secours Catholique 93 membre du collectif « Bouge Ta Préfecture », et Habib, travailleur sans-papier, mobilisé avec le Secours Catholique 93. Rencontre animée par Anne-Charlotte Oriol, transcrite par Dany Meyniel et éditée par MBB.
Mouton numérique – On justifie souvent la numérisation des administrations en parlant de modernisation de l’action publique, de simplification de la relation avec l’usager. Or, cette même dématérialisation constitue souvent un obstacle à l’accès aux droits, comme le souligne l’INSEE : en 2021, c’est un adulte sur trois qui a renoncé à effectuer une démarche en ligne. Quel est le lien entre dématérialisation et non-recours aux droits ?
Clara Deville – L’histoire de la rencontre entre dématérialisation et le « non-recours » se tisse au fil des réformes de l’action publique entre 2014 et 2020. La dématérialisation, qui est avant tout un outil de rationalisation administrative par le numérique, a longtemps été perçue comme un obstacle au bon fonctionnement de l’action sociale. Vous ne trouverez d’ailleurs pas un seul document de réforme, pas un seul rapport public qui prouve qu’il y ait un quelconque effet d’amélioration de l’accès aux droits par la dématérialisation.
Le non-recours émerge comme problème au moment de son premier chiffrage officiel, en 2012, pour l’évaluation du RSA. Il est alors estimé respectivement à 34% pour le RSA socle et 68% pour le RSA activité, soit un tiers de personnes qui n’accèdent pas à leurs droits – et on est sur les mêmes chiffres depuis 2012. Comme il advient souvent, le chiffrage confère une espèce de solidité au phénomène en question, qui acquiert une importance administrative et politique. Mais à l’époque, la dématérialisation était loin de constituer une réponse au problème du non-recours : elle était perçue comme problématique pour l’accès aux droits en raison de la fracture numérique, mais aussi de la complexité de la coordination administrative (CAF, départements).
La CAF a entamé des réorganisations s’appuyant sur le numérique depuis les années 1990, dans un objectif central de rationalisation de l’activité de ses agents, pour en rendre plus efficace le travail. Elle s’inscrit en cela depuis 1996 dans les réformes de rationalisation budgétaire qui ont réduit les moyens des caisses de la Sécurité Sociale, notamment en personnel… Puisqu’il y a toujours plus de pauvres et toujours moins de moyens, l’une des solutions était de rendre plus efficace le travail en interne. Mais on n’attribuait pas au numérique la mission de faciliter l’accès aux droits.
« L’essentiel tient ici à la responsabilisation des individus qui abandonnent les démarches. On responsabilise le non-recourant et on dépolitise le problème du recours, évacuant du cercle des causes retenues les responsabilités administratives et politiques. »
MN – D’où vient cette rencontre entre dématérialisation et rationalisation budgétaire ?
Clara Deville – Elle advient au moment de la réforme du RSA, pendant le quinquennat Hollande. Voulant prendre en charge le problème du non-recours, on va produire une forme de définition du phénomène et en spécifier les causes – c’est toute la question de la catégorisation en sociologie. Le SGMAP (Secrétariat Général de la Modernisation de l’Action Publique) en produit une définition très individualisée. Il va proposer des types de non-recourants identifiés avec des personas, des profils-type : des non-recourants « par choix », des non-recourants « traumatisés », « abandonnistes », par « manque d’information », « non concernés », etc. L’essentiel tient ici à la responsabilisation des individus qui abandonnent les démarches.
On responsabilise le non-recourant et on dépolitise le problème du recours, évacuant du cercle des causes retenues les responsabilités administratives et politiques. Dans cette optique, si, malgré l’accès à l’information, les aides sont trop compliquées, alors il faut aider les gens à comprendre. Il faut « simplifier » pour que les gens comprennent mieux, faciliter l’accès à l’information. Une fois individualisé le problème, on peut en individualiser les solutions, notamment par la dématérialisation qui permettra de faciliter l’accès à l’information.
Cet encadrement du non-recours va produire des conséquences très concrètes lors de la mise en œuvre de la réforme par les CAF et le reste des acteurs du social. Dématérialiser signifie changer les modes d’accueil du public. Il y a d’une part la fermeture de points les plus éloignés de la ville-centre, notamment en milieu rural, et la mise en place de l’accueil par rendez-vous. On commence par fermer les antennes dans les territoires les plus populaires, c’est-à-dire en milieu rural, ceux qui pourraient potentiellement avoir le plus besoin d’une interaction administrative physique pour qu’on leur explique comment fonctionne l’accès aux droits…
On a retiré les guichets des CAF à partir de 2014-2016, on a fermé des agences en affirmant qu’il n’y avait pas de rupture de services grâce à la dématérialisation. Puis on a institué l’accueil par rendez-vous : à partir de 2016, il n’est plus possible de se présenter spontanément aux guichets, il faut prendre rendez-vous par internet ou téléphone – sachant qu’à l’époque la CAF faisait payer l’appel. Et la prise de rendez-vous s’accompagne d’une reconfiguration complète des agences qui proposent des espaces libre-service où les demandeurs peuvent faire une partie de leurs démarches qui leur sont imposées avant d’avoir accès à un rendez-vous. Ainsi, la CAF délègue le « sale boulot », celui trop coûteux et qu’elle ne veut plus faire, aux usagers. Conséquence : une partie du public, la plus précaire, va se retrouver face à un vide administratif et bureaucratique.
« La CAF délègue le « sale boulot », celui trop coûteux et qu’elle ne veut plus faire, aux usagers. »
Les CAF disent qu’au niveau local elles font leur boulot, qu’il y a des bornes, un site internet et en plus des espaces libre-service. Les Départements, qui sont l’autre porte d’accès essentielle vers le RSA, soutiennent qu’ils sont concernés par l’insertion et non par l’accès aux droits. Il y a ainsi une espèce du jeu du Mistigri qui s’installe, entre CAF et Départements où le valet de piques qu’il ne faut pas tirer est l’accès aux droits. Ce que prévoient ces acteurs c’est de refiler ce Mistigri à un ensemble flou non financé, non formé qui s’appelle « les acteurs locaux » : des centres sociaux, des associations qui vont se retrouver face au public qui va venir frapper à leurs portes.
Mouton Numérique : Et quelles sont les difficultés de l’accès aux droits, par-delà le rapport à l’État, dans le rapport plus spécifiquement au politique ?
Clara Deville – Lorsqu’on est exclu de l’accès aux droits, lorsqu’on vit des expériences malheureuses avec l’État, on recueille une série d’indices sur la manière dont le gouvernement fonctionne. La manière dont la CAF fonctionne, l’éloignement et la fermeture des services publics donnent tout un tas d’indices aux gens sur ce que le gouvernement pense et fait des « gens comme eux » et sur la manière dont ils sont traités. C’est le terreau fertile de la mise en retrait de la vie politique des classes populaires. Sur le terrain, j’ai pu constater qu’il y a un lien entre le fait de se voir refuser le RSA ou de l’obtenir après plus de deux ans, ce qui veut dire vivre deux ans sans ressources. Cela induit une distance au politique : l’idée « qu’eux », les politiques, ne s’occupent pas des gens comme « nous ».
Intervention du public – Je suis surpris que toute cette politique de dématérialisation, dont on voit bien l’enjeu démocratique, n’ait jamais fait l’objet d’aucune délibération. Les conventions d’objectif et de gestion, qui sont les outils par lesquels toutes les caisses de la Sécurité Sociale sont financées et gérées, passent toujours par la voie de l’exécutif. C’est toujours un dialogue technique qui ne passe jamais par la voie de l’Assemblée Nationale, du Sénat, ou même du Conseil Économique Social et Environnemental. Même le Défenseur des droits, qui est quand même une autorité administrative indépendante, peut écrire des rapports pour dénoncer les politiques de dématérialisation et leurs conséquences sur les droits et ça ne change rien.
« Aujourd’hui, le seul indicateur de performances sur l’amélioration de l’accès aux droits est le taux de dématérialisation des procédures. On prouve que la solution est efficace en évaluant la solution elle-même… »
Clara Deville – La dématérialisation n’a pas été uniquement promue par des mesures techniques. Elle est descendue du gouvernement jusqu’aux CAF par les COG (Convention d’Objectifs et de Gestion – contrats passés entre l’État et la CNAF qui allouent les moyens données aux CAF en contrepartie d’objectifs à atteindre). Mais avant que ça arrive dans les COG, ça a été voté. C’est vrai que ce n’est même plus la peine maintenant, le mythe de la dématérialisation comme un outil efficace contre le non-recours tient bon. Aujourd’hui, le seul indicateur de performances sur l’amélioration de l’accès aux droits est le taux de dématérialisation des procédures. Ça tourne en rond. On prouve que la solution est efficace en évaluant la solution elle-même…
MN – Et quelles sont les conséquences sur les usagers et les réponses des acteurs sociaux, comme le Secours Catholique 93 ?
Gabriel Amieux – L’un des problèmes les plus graves que pose la dématérialisation pour l’accès aux droits concerne l’accès aux titres de séjour. La dématérialisation a permis aux différents gouvernements de mettre un frein réel à la régularisation et, comme le disait Clara Deville, de se décharger de ses responsabilités sur les acteurs du monde associatif et les avocats qui sont mobilisés pour défendre l’accès aux droits. L’accès aux droits, qui est un devoir de l’État, ne serait pas garanti sans l’aide de ces acteurs.
La majorité du public que nous accueillons dans les permanences juridiques du Secours Catholique est constitué de personnes sans-papiers qui ont légalement le droit à un titre de séjour et qui cherchent à être régularisées. Il y a sept ou huit ans quand on se rendait en préfecture, on pouvait déposer un dossier, ça pouvait prendre des heures, parfois on arrivait au milieu de la nuit. À Bobigny, les files d’attente étaient longues, ce n’était pas beau à voir, les gens étaient sous la pluie les jours de mauvais temps. Maintenant c’est plus joli, il y a des agents de sécurité qui empêchent tout le monde de passer sans rendez-vous… Tout le problème, c’est de prendre rendez-vous.
Depuis 2018, quand vous voulez prendre rendez-vous en Seine-Saint-Denis, il faut aller sur le site de la structure : on clique, on a accès à un calendrier et on peut choisir une page pour le rendez-vous… Seulement, on n’a jamais vu cette page. Déjà en 2016, dans le rapport « À guichets fermés » la Cimade avait montré avec un petit logiciel qu’elle avait fait tourner sur le site de plusieurs préfectures qu’il n’y avait jamais de rendez-vous.
Ce qui veut dire qu’il n’y avait que deux solutions pour obtenir un rendez-vous pour un dépôt de titre de séjour en préfecture : une solution illégale, c’est à dire acheter des rendez-vous sur internet, qui se vendaient entre 800 et 900 euros, ou une solution légale en passant par une association, par un avocat, en attaquant la préfecture au tribunal pour que celui-ci enjoigne la préfecture à donner un rendez-vous. Les tribunaux administratifs sont engorgés à cause de ça. Selon la présidente du tribunal administratif de Versailles, les tribunaux administratifs de l’Île de France sont devenus des « Doctolib des préfectures », puisqu’ils gèrent la prise de rendez-vous.
Clara Deville – Il y a beaucoup de points communs entre l’accès au RSA et l’accès aux droits des étrangers. On retrouve la barrière du rendez-vous et celle du travail à accomplir pour l’obtenir. C’est facile pour une certaine catégorie de population, les gens dotés en capital culturel, que la dématérialisation arrange bien. Elle convient aussi à certains travailleurs aux guichets, qui sont de moins en moins payés, de moins en moins formés et de plus en plus précaires et qui se retrouvent donc un peu à l’abri de la file d’attente. Mais la dématérialisation ne permet pas de lutter contre le non-recours pour tout le monde et surtout pas pour ceux qui en ont besoin.
Il y a un réflexe, qui ressemble à ce que Pierre Bourdieu appellerait une pensée d’État, ces choses auxquelles on croit sans le savoir et qui accompagnent l’action publique, qui consiste à associer les démarches d’accès aux droits à une décision individuelle. Les pauvres, ceux qui ont besoin de l’État, décideraient à un moment donné de demander le RSA. Ils se réveilleraient un jour et, en tant qu’individus calculateurs bien informés, décideraient de faire valoir leurs droits. Inversement, d’autres gens se seraient mis au courant, ou n’auraient pas envie de dépendre du RSA et de la CAF.
Tout mon travail de thèse a consisté à faire du terrain avant l’administration, donc à rencontrer les gens avant qu’ils obtiennent le RSA, avant qu’ils rencontrent une administration – donc bien avant le guichet. Au fin fond du Libournais, je n’ai jamais pu apercevoir un instant de prise de décision dans les parcours d’accès aux droits. C’est pour ça que je préfère parler de parcours d’accès au RSA et d’inégalités dans ces parcours. Cela permet de comprendre ce qui conduit les gens à se tourner vers l’État. Et de décrire, aussi, ce qui constitue les rapports à l’État. La sociologie a bien montré que ce sont des rapports inégalement répartis. Il y a des catégories de population, principalement les classes populaires, qui vont accumuler des expériences malheureuses avec l’État, avec la CAF qui contrôle et sanctionne, avec l’école ou l’hôpital où ils sont mal accueillis.
MN – On retrouve certainement la question du rapport à l’État dans la question de la régularisation…
Gabriel Amieux – Pour beaucoup de sans-papier, l’État se réduit à un écran pour les rendez-vous et à la police.
Habib – Je suis en France depuis 2007, je suis marié ici en France, je travaille, je paie des impôts. En 2014, j’arrive ici dans ce département, j’ai des enfants à l’école, un de sept ans et un autre de cinq ans. En avril 2019, je me suis dit que c’était le moment de déposer un dossier et j’ai commencé par chercher des informations sur Internet. Je n’ai pas trouvé de rendez-vous. Je suis resté trois ans comme ça. Dans ce laps de temps, j’ai fait quatre cent soixante-quinze captures d’écran. J’ai contacté le Secours catholique en octobre 2021, on a commencé une autre série de quatre mois de captures d’écran, avant de déposer un dossier. J’ai eu un rendez-vous un an et trois jours après. Trois ans de captures d’écran, trois fois le tribunal et le résultat est un rendez-vous un an et trois jours après. Entre temps, je ne sais pas quand je pars le matin de la maison si je vais pouvoir rentrer le soir … On travaille et puis direct à la maison parce qu’il faut se cacher … Depuis quinze ans je vis comme ça.
Gabriel Amieux – Dans ces situations, même une arrestation pour un titre de transport qui n’a pas été payé peut provoquer un dépôt au centre administratif de rétention administrative, voire une expulsion.
En ce qui concerne le rapport à l’État, on voit bien que les administrations sont capables d’automatiser d’un côté mais pas de l’autre. Lorsque les personnes ont un titre de séjour qui expire, la CAF tombe direct, il n’y a pas de souci, ils savent coordonner les fichiers. En revanche quand les gens ont un titre de séjour ils ne savent plus les coordonner…
Ces articles sont issus d’un cycle de rencontres entre travailleurs, chercheurs et militants sur la dématérialisation du service social et sur les algorithmes publics organisés par l’association le Mouton Numérique. Les rencontres passées sont à lire ou à écouter sur le site du Mouton numérique, avec les détails de la programmation 2023.