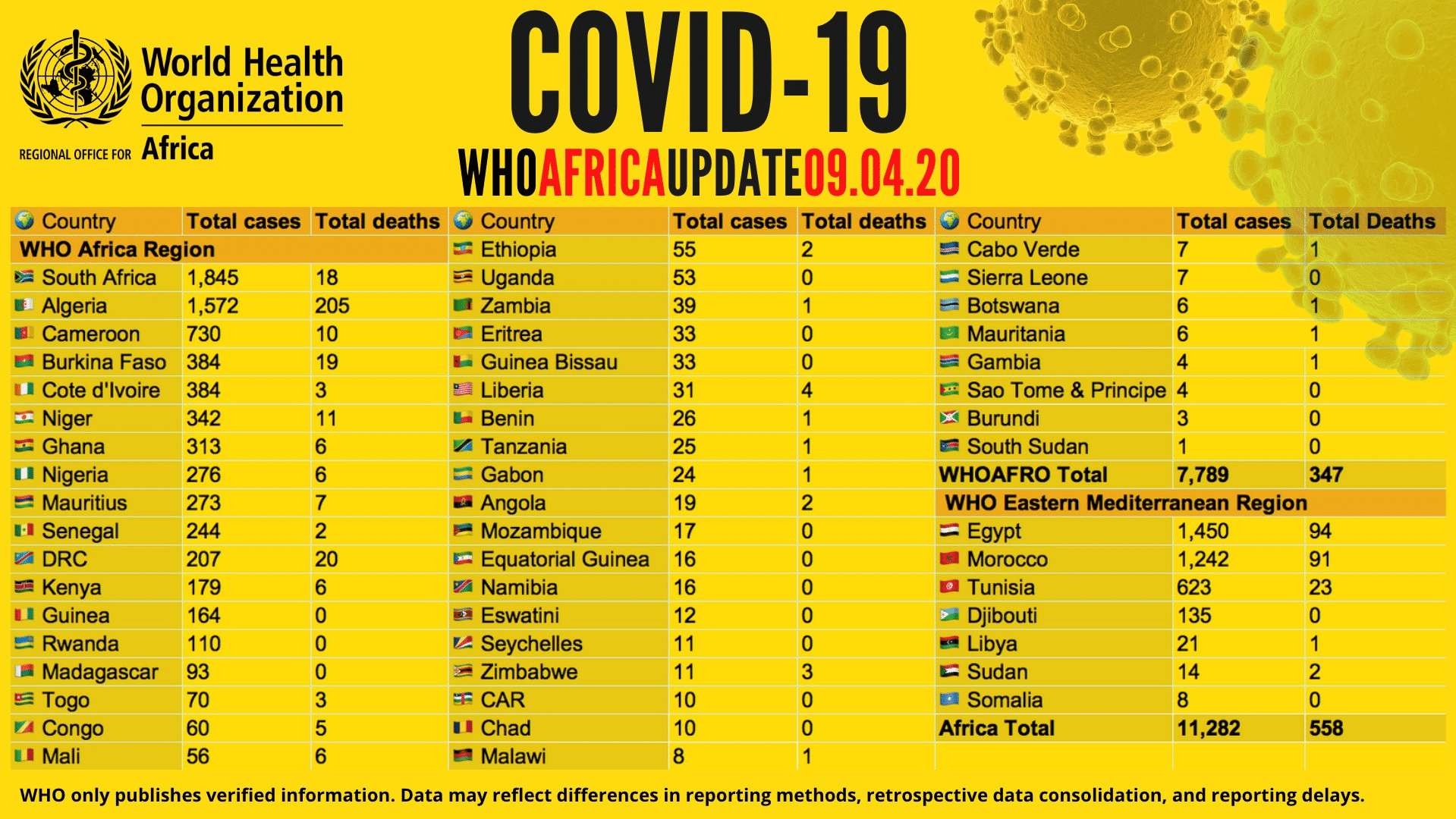Depuis plus d’un demi-siècle, les institutions financières occidentales que sont le FMI et la Banque mondiale jouent un rôle déterminant dans le financement des pays en développement. L’hostilité grandissante envers ces institutions et les réformes structurelles qu’elles obligent ont, peu à peu, permis à d’autres États et organisations de s’imposer. En particulier, après des années de très forte croissance, la Chine est devenue un créancier de taille dans de nombreuses régions, notamment en Afrique. Son ralentissement économique et démographique vient toutefois refroidir ses grandes ambitions. Désormais, forts du pouvoir qu’ils ont acquis par des soutiens publics toujours plus importants, les créanciers privés occupent un poids grandissant dans le financement des pays en développement. Le signe d’un basculement ?
Une crise de la dette est proche. Les effets de la crise sanitaire, de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêten Occident et de la hausse globale du dollar ne cessent de fragiliser des pays déjà en proie à des difficultés de toute sorte. Sur les trois dernières années, 18 défauts de paiement ont été enregistrés dans dix pays en développement, soit plus qu’au cours des deux dernières décennies. Les plus à risque restent ceux à faible revenu, dont les emprunts sont pour près d’un tiers émis à taux variable. Environ 60% de ces pays sont considérés comme surendettés ou en phase de le devenir. Ainsi, selon l’ONU, 3,3 milliards de personnes souffrent du fait que leurs gouvernements sont contraints de privilégier le paiement des intérêts de la dette sur des investissements essentiels. Et en 2024, le coût global du service de la dette devrait augmenter de plus de 10% pour les pays en développement, et de 40% pour les pays plus pauvres. Face à cette situation aux conséquences économiques, politiques et sociales parfois désastreuses, les réformes en cours de l’architecture financière internationale n’apportent aucune réponse.
Les institutions occidentales contraintes de se réinventer ?
Les programmes du FMI et de la Banque mondiale imposés depuis quatre décennies en vertu du Consensus de Washington connaissent un rejet grandissant. L’été dernier, le président Tunisien Kais Saied avait notamment refusé un prêt du FMI de 1.9 milliard. Dans un monde de surcroît fragmenté, les institutions financières occidentales sont contraintes de se réinventer.
Le 9 octobre dernier s’ouvraient ainsi, pour la première fois en Afrique depuis 50 ans, les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Au programme : réforme des institutions de Bretton Woods et financement climatique. L’objectif : teinter les nouveaux prêts d’un vert clair qui laisseraient presque croire à des dons. Depuis plusieurs années déjà, le FMI propose des prêts à des taux proches de zéro et à échéance 20 ans avec pour objectif de « financer l’action climatique » dans les pays les plus pauvres. Alors que la contribution de ces derniers dans les émissions de carbone mondiale est quasi nulle, et que les pays du Nord n’ont pas tenu, selon les échéances décidées, leur engagement de financer à hauteur de 100 milliards de dollars annuels les plus pauvres dans leur politique climatique…
Les États-Unis peuvent appliquer un droit de veto systématique aux décisions importantes qui nécessitent, toutes, 85% des votes à minima.
Parallèlement, ces réunions ont soulevé la question fondamentale de la gouvernance de ces institutions – largement dirigées par les pays occidentaux et pourtant créées pour stabiliser le système financier international au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Aucun changement véritable n’a été négocié puisque les pays émergents (où figurent les BRICS) conservent une place très minoritaire et non influente tandis que l’Afrique subsaharienne n’a obtenu qu’un troisième siège, peu significatif, au Conseil d’administration du FMI.
Dans ces deux institutions, les droits de vote de chaque pays dépendent de leur quote-part (contribution au capital des institutions) calculée, de manière arbitraire, selon leur poids économique et géopolitique dans le monde. Les États-Unis détiennent 17,4% des votes, la Chine 6,4% (alors que son économie représente 20% du PIB mondial environ) et l’Allemagne 5,6%… Ce qui permet à l’Occident de réunir aisément une majorité, et aux États-Unis d’appliquer un droit de veto systématique aux décisions importantes qui nécessitent, toutes, 85% des votes à minima.
Enfin et surtout, l’objectif affiché de ces réunions fut de modifier la politique de financement de ces institutions pour accorder davantage d’emprunts. Comme les pays membres fournissent la majeure partie des financements selon leur quote-part dans chaque institution, une proposition visant à augmenter de 50% les quotas distribués a été validée. Néanmoins, alors que les conditions d’emprunts se resserrent dans les pays avancés (qui distribuent une part significative des prêts) face à des niveaux d’endettement publics historiquement élevés et des finances publiques dégradées, le volume de leurs financements risque de diminuer. Dans la continuité des années passées, cette situation devrait théoriquement bénéficier à la Chine dont le statut de créancier n’a cessé de prendre de l’importance. Mais le gouvernement de Xi Jinping est confronté à des difficultés majeures.
La Chine, puissant créancier en panne
Depuis plus d’une décennie, la Chine se concentre particulièrement sur son développement extérieur (au détriment de sa population). Pour ce faire, elle recycle l’épargne qu’elle a accumulée pendant ses années de forte croissance pour prêter à ceux qui ont des besoins de financement. À travers une politique singulière où les emprunts ne sont assortis d’aucunes conditionnalités, elle se démarque des institutions financières occidentales. Les méthodes de remboursement sont en théorie plus souples car la dette du débiteur est souvent rééchelonnée si celui-ci est proche du défaut de paiement (au même titre, finalement, que le Club de Paris à la fin du 20ème siècle) et des prêts de sauvetage sont instaurés si la situation financière du pays se détériore (à des taux avoisinants toutefois 5%, soit deux fois plus élevés que ceux pratiqués par le FMI notamment).
L’empire du milieu a notamment prêté en Asie centrale et en Afrique, où les ressources naturelles abondent, afin de renforcer les liens économiques utiles pour son développement technologique et militaire. Elle peut notamment compter sur ses banques étatiques (la Banque de développement et la Banque d’export-import) qui ont réalisé près de 70% des prêts chinois à destination des économies émergentes et en développement sur les vingt dernières années, mais aussi sur ses banques nationales. La majorité de ces prêts (80% environ) sont, toutefois, dirigés vers les pays émergents afin de protéger son secteur bancaire d’éventuels défauts de paiement. De plus, la Chine échange massivement avec ces pays jusqu’à devenir le principal partenaire commercial du continent africain depuis 2009, mais aussi de pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Pérou), et de nombreux autres.
Une ère s’achève cependant. Avec un modèle économique à bout de souffle , son statut de créancier se retrouve affaibli. Elle prête nettement moins qu’auparavant. En Afrique par exemple, les prêts chinois ont atteint seulement 1 milliard de dollars en 2022, soit leur plus bas niveau depuis 2004. Elle s’est par ailleurs retrouvée contrainte de déroger à ses pratiques habituelles en acceptant de rejoindre, entres autres, l’initiative occidentale DSSI créée par le G20 et visant à suspendre de manière ciblée les paiements des intérêts de la dette chez certains pays. Globalement, cette situation pénalise davantage les pays débiteurs que la Chine, dont la baisse des prêts à travers le monde n’est que le reflet d’une économie en déclin. En revanche, elle a longtemps profité aux créanciers privés.
Le poids grandissant des créanciers privés
La financiarisation économique des pays avancés a incontestablement déplacé le pouvoir du public au privé, d’autant plus à mesure que les programmes de soutien des pouvoirs publics (en particulier des banques centrales) envers les acteurs financiers se sont multipliés. La garantie de sauvetage que ces derniers ont obtenu, quoi qu’il en coûte, leur permet par ailleurs de prêter dans des conditions parfois risquées mais particulièrement rémunératrices. Contrairement aux États, les taux qu’ils proposent sont généralement deux fois plus élevés et les conditions de remboursement plus agressives. Ces acteurs sont aussi épargnés des initiatives publiques visant à annuler, suspendre ou restructurer des dettes, conduisant parfois à des subventions publiques indirectes lorsque l’allègement de la dette permis par un État se fait au profit des acteurs privés.
Ces dernières années, le rôle des créanciers privés dans le financement des pays en développement s’est intensifié. En particulier, celui des acteurs du shadow banking (hedge fund, capital investissement…), des banques de détail et d’investissement, ainsi que des gérants de matières premières (l’entreprise Glencore, par exemple, détient 20% de la dette du Tchad). Selon les chiffres de l’Institut de la finance internationale, les financements privés représentent désormais 27 % de la dette publique des pays pauvres, contre seulement 11 % en 2011. En Afrique, ils détiennent plus de 30% de la dette extérieure du continent. Et dans certains pays à revenu intermédiaire comme le Ghana et la Côte d’Ivoire, ce taux atteint près de 60%.
Les risques, nombreux, conduisent à des besoins de financement de plus en plus élevés. La diminution des recettes budgétaires et d’exportation, la hausse des taux d’intérêt, les variations de taux de change, les fuites de capitaux, la pénurie de devises, et enfin et surtout le ralentissement de la croissance sont tant de défis qui accentuent la dette des pays en développement. S’ajoutent, pour nombre d’entre eux, des problèmes de pauvreté ou d’extrême pauvreté, une situation politique parfois compliquée, et un système social en difficulté. Bien que les contraintes budgétaires des pays avancés peuvent freiner leur capacité à prêter, les créanciers privés restent, eux aussi, vigilants. La crainte de ne pas être remboursé et de recevoir un soutien plus faible des États pourraient les désinciter à prêter. La hausse des taux d’intérêts a aussi fortement ralenti les arbitrages (et par extension les financements) visant à emprunter à taux bas dans des pays avancés pour bénéficier de meilleurs rendements dans des pays en développement. En 2022 par exemple, les nouveaux prêts accordés par les créanciers privés aux pays en développement ont chuté de 23%, soit leur plus bas niveau depuis dix ans. En parallèle, ils ont reçu 185 milliards de dollars de plus en remboursement de capital que ce qu’ils ont prêté aux pays en développement. La Banque mondiale et les créanciers multilatéraux ont dû, de fait, intervenir.
Ainsi se pose la question du manque de financement et de la soutenabilité de la dette dans les pays en développement. Les annulations de dettes doivent se multiplier, pour donner des marges de manœuvre à des pays qui en ont cruellement besoin, et ne pas leur faire payer des risques dont ils ne sont pas responsables. L’architecture financière internationale doit ensuite être repensée, à travers la création de nouvelles institutions financières reflétant les réalités du monde actuel. Un monde multipolaire où nombre des pays émergents n’ont plus d’émergents que le nom tant ils sont devenus des puissances à part entière. C’est la condition sine qua non pour non seulement apporter des équilibres aux enjeux actuels, mais aussi préserver les démocraties très fragiles.
Article originellement publié sur OR.FR et réédité sur Le Vent Se Lève.