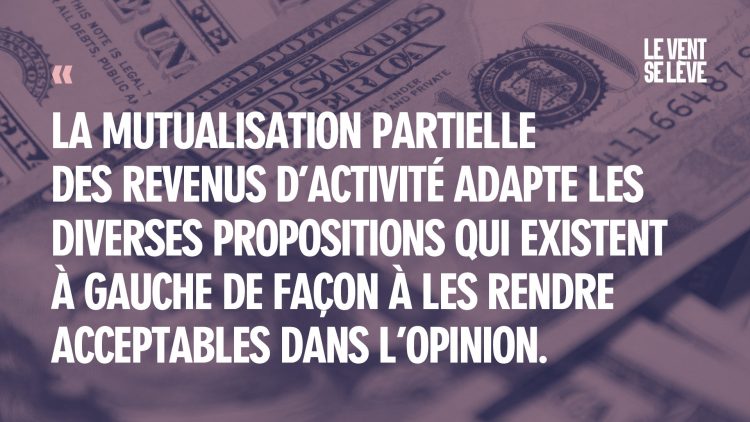Du revenu d’existence à la proposition d’État employeur en dernier ressort, de multiples propositions portant sur la distribution des revenus existent à gauche. Mais aucune de ces deux perspectives ne fait consensus, et toutes les deux présentent des faiblesses potentielles. Pour l’économiste Benoît Borrits, la mise hors marché d’une partie de la production privée, redistribuée pour garantir des revenus à toutes celles et ceux qui ont participé à cette production pourrait être un axe fédérateur.
Les prochaines élections présidentielles seront marquées par une forte division de la gauche et des écologistes. S’il est convenu d’étriller cette division sur la base de conflits de personnes, cet émiettement est surtout le reflet de profondes divergences. La distribution des revenus en est un exemple frappant. Tandis que les écologistes et certains socialistes promeuvent le revenu d’existence, la gauche radicale insoumise lui préfère l’emploi garanti.
Du revenu d’existence…
Le serpent du revenu d’existence hante la gauche depuis maintenant plus de vingt ans. Benoît Hamon s’en était fait le chantre à la dernière élection présidentielle. Mal lui en a pris. Si les écologistes l’ont intégré dans leur programme depuis longtemps – sans que cela soit leur mesure phare – une autre partie de la gauche y est clairement opposée pour diverses raisons. Certains ont peur que ce revenu d’existence représente un solde de tout compte d’un chômage de longue durée que l’on renoncerait à combattre. D’autres considèrent que si l’emploi est souvent synonyme d’exploitation, il est aussi un vecteur d’intégration sociale que le revenu d’existence ne représente pas ou peu.
Le principe du revenu d’existence consiste à prélever une fraction de la richesse monétaire produite pour la distribuer de façon égalitaire à toute personne quelle que soit sa position à l’égard de l’emploi, donc de sa participation à la production de cette richesse monétaire. Les partisans du revenu d’existence défendent l’idée que toute personne apporte quelque chose à la société, qu’une personne qui n’est pas en emploi dispose de temps libre pour réaliser du bénévolat, s’occuper de ses proches – ce qui n’est pas sans poser de problèmes dans une perspective féministe si cela favorise un retour des femmes à la maison – ou de ses voisins. La richesse de notre vie en commun ne peut en effet s’arrêter à la seule production monétaire.
Pour en savoir plus sur le revenu universel et ses limites, lire sur LVSL l’interview de l’économiste décroissant Denis Bayon par William Bouchardon : « Seuls les partisans libéraux du revenu universel sont cohérents »
Tout ceci comporte une part de vérité mais ne peut guère être systématisée. Pour le dire autrement, instaurer le revenu d’existence ne pourra se faire que si une majorité de citoyennes et citoyens est prête à l’expérimenter car il porte sur la confiance que nous portons en nos semblables. Il est donc, pour le moins incongru, de vouloir l’imposer dans un programme politique sans passer par une consultation populaire comme cela a pu être le cas en Suisse en 2016.
… aux minimas sociaux
Dans le cadre d’une consultation populaire comme dans celui d’un programme politique, la question de l’acceptabilité du revenu d’existence est fortement dépendante de son montant car celui-ci mesure de facto le niveau de confiance de la société en elle-même. Plus son montant sera faible, plus grande est la possibilité d’une acceptation majoritaire.
C’est pourquoi les montants proposés pour ce revenu d’existence tendent à se rapprocher des minima sociaux et, dans le cas de la France, du Revenu de solidarité active (RSA). Une critique récurrente faite au RSA est d’être soumis à une démarche d’insertion, l’appréciation de cette démarche étant réalisée par des administrations départementales plus ou moins tatillonnes, ce qui entraîne souvent des radiations abusives privant les bénéficiaires de tout moyen de vivre. Une revendication récurrente de nombreuses organisations caritatives est que ce RSA ne soit soumis qu’à des conditions de ressources. Et comme le revenu universel est complexe à mettre en œuvre puisque tout le monde doit en bénéficier et que cela demande un financement énorme, on glisse alors souvent d’un petit revenu universel qui n’a guère de portée émancipatrice à un revenu minimal garanti, comme cela a été le cas avec la proposition italienne du Mouvement cinq étoiles, une fois ce mouvement au pouvoir.
Le revenu d’existence est une aspiration noble – la possibilité d’un revenu accordé sur la base de la reconnaissance de l’apport de l’individu à la société du seul fait de son existence – qui nécessite une société de la confiance en ses semblables qui n’existe pas à ce jour. Parce que cette confiance devra se construire sur le temps long, il est dès lors difficile de considérer le revenu d’existence comme une solution.
L’État employeur en dernier ressort
Une autre proposition a récemment fait surface : la garantie d’emploi. Cette proposition a été théorisée par Hyman Minsky, économiste post-keynésien, sous le nom d’État employeur en dernier ressort (1). Dans son principe, l’État s’engage à embaucher toute personne qui le souhaite, au salaire minimum, pour réaliser des tâches que les collectivités locales vont déterminer en fonction des besoins. L’économiste Pavlina Tcherneva, conseillère de Bernie Sanders et de la gauche du parti démocrate est aujourd’hui l’égérie de cette proposition qu’elle rebaptise garantie d’emploi et qu’elle inscrit dans le programme du Green New Deal (2). En France, cette proposition a été intégrée dans le programme de la France insoumise.
A lire également sur LVSL, l’interview de Pavlina Tcherneva par Politicoboy, « Soit on garantit l’emploi, soit le chômage »
Sur le fond, cette proposition conteste que la montée en puissance de la robotisation rendrait impossible le plein emploi. Elle met en évidence le fait qu’il existe de nombreux besoins des collectivités locales auxquels le marché ne peut répondre. La garantie d’emploi propose donc un partage des rôles entre l’État qui embauche au Smic toute personne qui le souhaite et les collectivités locales qui vont déterminer ce que les personnes payées par l’État réaliseront. À l’appui de ce partage des rôles, Pavlina Tcherneva cite l’expérience française des Territoires zéro chômeur de longue durée, ce qui est pour le moins discutable car celle-ci fonctionne sur un principe assez différent.
La proposition de l’État employeur en dernier ressort part d’un postulat : « seul le secteur public peut offrir une garantie d’emploi. Il n’est ni possible ni souhaitable d’obliger les entreprises à le faire ». À aucun moment, Pavlina Tcherneva ne démontre en quoi il n’est ni possible, ni souhaitable d’obliger les entreprises à embaucher. Ce faisant, l’État est positionné en éternel pompier du marché et ce, dans une optique très keynésienne : « l’embauche des entreprises est procyclique, la garantie d’emploi est contracyclique ». Lorsque le marché ne produit pas assez d’emplois, le rôle de l’État serait alors d’embaucher les personnes qui le souhaitent de façon à les maintenir employables par le secteur privé lorsque la conjoncture se retournera favorablement. Dès lors, deux critiques peuvent être adressées à cette proposition : le risque d’un salariat à deux vitesses et la possibilité d’une étatisation mal cadrée de l’économie.
Pour une présentation du concept d’Etat employeur en dernier ressort, lire sur LVSL l’article de William Bouchardon : « L’emploi garanti, solution au chômage de masse ? »
Comme le rôle de l’État est d’être employeur en dernier ressort, à savoir d’embaucher celles et ceux que les entreprises rejettent, le salaire qui leur est proposé pour réaliser des tâches d’intérêt général est alors forcément le Smic. Pourquoi donc les tâches d’intérêt général seraient-elles moins payées que celles proposées par des entreprises dont la production n’est pas forcément pertinente d’un point de vue écologique et/ou social ? Est-ce que nous n’allons pas créer un salariat à deux vitesses entre celui que les entreprises choisiront et qui auront des salaires supérieurs au Smic et celui qui est rejeté et condamné à travailler à ce montant ? Dualité difficilement tenable pour une gauche transformatrice.
La seconde critique porte sur une étatisation mal contrôlée de l’économie. L’État peut se décharger de cette tâche sur les collectivités locales, mais à l’inverse de l’expérience des Territoires zéro chômeurs de longue durée qui partent de l’initiative des collectivités locales, celles-ci n’ont rien demandé et il est tout à fait possible qu’elles rechignent ou ne trouvent pas d’activités réelles. Ajoutons à cela le fait que de nombreux indépendants, notamment dans le domaine de l’agriculture, peinent à obtenir l’équivalent d’un Smic, on a alors un risque réel d’éviction des emplois et de gonflement artificiel d’une sphère publique dont l’efficacité sociale et écologique serait douteuse. C’est la raison pour laquelle la proposition d’État employeur en dernier ressort peut difficilement être intégrée en l’état par ce qu’il est convenu d’appeler la « deuxième » gauche, plus souvent attirée par le revenu d’existence du fait du caractère universel de celui-ci.
Les Territoires zéro chômeur de longue durée
Ces expériences diffèrent fondamentalement de l’État employeur en dernier ressort au sens où l’employeur n’est pas l’État mais une structure ad hoc.
Cette initiative part du constat que le chômage de longue durée coûte cher à la société : 18 000 euros par an par personne qui se répartissent entre les minima sociaux versés, les cotisations sociales manquantes, les frais induits de santé et les politiques de l’emploi. Plutôt que d’imposer à ces personnes de survivre avec des minima sociaux insuffisants, ne vaudrait-il pas mieux les employer pour réaliser des tâches qui répondent à des besoins écologiques et sociaux non satisfaits ? Une loi « d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée » a été adoptée en mars 2016 pour 10 premiers territoires qui seront progressivement étendus à 50 à partir de 2021.
Les collectivités territoriales candidatent auprès des pouvoirs publics pour participer à l’expérimentation. Si elles sont retenues, elles pourront alors créer une entreprise à but d’emploi (EBE) qui bénéficiera d’une subvention annuelle de 18 000 euros par chômeur de longue durée embauché au Smic. Comme l’équilibre économique de la structure est estimée à 23 000 euros par personne, l’EBE doit donc générer 5 000 euros de chiffre d’affaires par personne employée. Un comité local de l’emploi, réunissant les collectivités locales, des entreprises du territoire et des bénévoles, a pour tâche de recenser les travaux dont le besoin se fait sentir sur le territoire. Comme l’EBE est subventionnée par l’État, une règle extrêmement stricte veut que les activités de cette structure ne rentrent jamais en concurrence avec des entreprises et des emplois existants. Le comité local pour l’emploi doit vérifier le respect de ce principe. Dans les faits, l’EBE propose essentiellement des services à des structures ou personnes qui sont dans l’incapacité de payer un Smic pour ces services. Le film Nouvelle cordée de Marie-Monique Robin (3) portant sur l’expérience de Mauléon dans les Deux-Sèvres nous donne un bon aperçu de la diversité de ces activités qui, toutes, ne peuvent se réaliser que parce que l’emploi est subventionné pour assurer à chacun un Smic.
Si ces expériences sont des succès (4), notamment parce qu’elles ont sorti de la misère des personnes longtemps exclues de l’emploi et leur ont redonné confiance en elles-mêmes, il apparaît que ces EBE peinent à résorber totalement le chômage sur un territoire du fait de cette règle de non concurrence. On peut aussi apporter la même critique que celle que nous avancions pour l’État employeur en dernier ressort : pourquoi les personnes qui seraient rejetées par les entreprises devraient-elles se contenter du Smic ?
Le point fort de ces expériences par rapport à l’État employeur en dernier ressort est le fait que les créations d’emplois se font sur la base de besoins socialement exprimés qui ont été satisfaits du fait de la subvention. C’est donc la subvention de l’emploi qui est la source de la création d’emploi : sans subvention, les emplois n’auraient pas été créés. Mais le caractère discrétionnaire de cette subvention – réservée à la seule EBE – est aussi sa faiblesse puisqu’elle la restreint dans ses activités. Ne devrions-nous pas, dès lors, généraliser le principe de la subvention de l’emploi à toutes les entreprises, travailleurs indépendants compris ? Le montant de cette subvention est un objet de débat politique dont le maximum est le coût total du Smic. Comme pour les EBE des Territoires zéro chômeurs, la subvention permet aux entreprises de répondre à des besoins qui ne seraient pas solvables sans celle-ci.
La mutualisation partielle des revenus d’activité, une troisième voie
Si nous généralisons le principe de la subvention à l’ensemble des entreprises, il est probable que le budget de l’État soit alors insuffisant. L’alternative consiste à faire financer ces subventions par les entreprises elles-mêmes : il s’agit de construire un régime obligatoire à laquelle toutes les entreprises participeront comme l’est actuellement la Sécurité sociale. Le principe de base consiste à ce qu’une partie des flux de trésorerie d’activité (schématiquement, les encaissements de factures et de subventions moins les paiements de factures et d’impôts) soit affectée à payer ces subventions. C’est la proposition de Mutualisation partielle des revenus d’activité (MPRA) dans laquelle toutes les entreprises font leur déclaration en fin de mois et pratiquent l’autoliquidation : si une entreprise doit plus (la partie mutualisée des revenus d’activité) que ce à quoi elle a droit (une allocation par personne en équivalent temps plein), elle paye alors cette différence au régime ; dans le cas contraire, elle recevra la différence grâce au paiement des entreprises contributrices.
Dès lors, si le niveau de mutualisation est suffisamment élevé, le plein emploi est à portée de main. Supposons qu’il se fasse de façon à garantir un Smic pour chaque emploi. Ceci signifie que toute personne qui se déclare en indépendant se verra garantir un revenu au moins égal au Smic. Une entreprise qui embauche sait que la partie du salaire inférieure au Smic n’est plus payée par elle mais par l’ensemble des entreprises. Si elle embauche au Smic, il n’y a alors plus aucun coût salarial et la partie non mutualisée de ce que le salarié réalisera formera le profit de l’entreprise. Si, dans ces conditions, on peut penser que les entreprises proposeront de nombreux emplois au Smic, les individus auront en contrepartie un grand choix d’emplois et exigeront alors plus que le Smic, ce qui diminuera les profits. Le plus petit salaire deviendra alors supérieur au Smic, alors qu’il est le lot de 13 % des salariés aujourd’hui, pourrait concerner une plus grande part des salariés dans l’hypothèse de la mise en œuvre de l’État employeur en dernier ressort.

Le niveau de mutualisation est un débat politique. On pourrait considérer qu’une mutualisation au niveau du Smic est excessive : ne va-t-elle pas conduire à faire subventionner par des entreprises prospères des emplois qui ne devraient pas exister ? Il est, bien sûr, possible de moins mutualiser … à la condition que ce soit suffisant pour apporter le plein emploi. Pour le dire autrement et pour faire l’analogie avec les Territoires zéro chômeurs, il faut que le niveau de contribution par subvention soit tel qu’un maximum de besoins écologiques et sociaux soient couverts en ayant permis l’embauche de toutes les personnes qui le souhaitent.
Stopper le dumping sur les cotisations sociales
Une grande partie des politiques de l’emploi de ces dernières années se sont concentrées sur les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires. La gauche non gouvernementale a, en son temps, vilipendé le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) mis en place par Hollande et transformé en baisse de cotisations par Macron, comme un cadeau fait aux entreprises.
Pourtant, aucun des candidats de gauche à l’élection de 2022 n’a placé dans son programme la restauration des cotisations sociales sur les bas salaires. Ceci se comprend aisément : en rajoutant en gros 50 % de cotisations sociales patronales sur un Smic brut aujourd’hui à 1589 euros, ceci fera un coût salarial minimum de 2383 euros impossible à tenir pour de nombreuses activités économiques. Ceci induira des faillites dans de nombreuses PME avec une brusque remontée du chômage.
Et pourtant, le bilan des exonérations sociales sur les bas salaires est catastrophique autant sur le plan économique que social. Outre le fait qu’elles ont coûté en 2019, 66 milliards d’euros au budget (soit plus que le produit de l’impôt sur les sociétés et légèrement moins que celui de l’impôt sur le revenu), elles sont à la fois une aubaine pour des sociétés qui pourraient payer ces cotisations et une trappe à bas salaires qui dissuadent les entreprises d’augmenter les salaires.
La mise en place de la MPRA permettra de revenir sur ces exonérations en exigeant que ces cotisations sociales soient payées par l’ensemble des entreprises, en opérant des transferts des entreprises riches vers les entreprises qui ont du mal à payer le Smic et légèrement au-delà.
Un combat historique pour la gauche
La proposition de Mutualisation partielle des revenus d’activité adaptent les diverses propositions qui existent à gauche de façon à les rendre acceptables dans l’opinion. On peut ardemment souhaiter un revenu d’existence mais l’inconditionnalité de ce revenu est loin de faire majorité. La MPRA s’appuie sur le même principe qu’une partie de la rémunération soit garantie hors-marché mais la soumet au fait d’être en emploi dans un contexte dans lequel le plein emploi sera possible. Cette MPRA ne serait-elle pas alors pas un pas en direction du revenu d’existence ? Si demain, une majorité de la population souhaite expérimenter le revenu d’existence, alors tout ou partie de l’allocation de la MPRA pourra être versée directement aux individus, ce qui fera de celle-ci un outil de financement adéquat.
Il en est de même de l’État employeur en dernier ressort. Il faut convenir que l’extension de la shère économique de l’État ne fait plus l’unanimité et que l’initiative économique doit être individuelle ou collective et en tout état de cause, au plus près des citoyennes et citoyens. Pour le dire autrement, l’heure est à la démocratisation de l’économie dans la perspective du commun. En tout état de cause, si le champ d’intervention économique de l’État doit s’étendre, c’est pour répondre à des besoins précis plébiscités par la population, pas pour palier les défaillances du secteur privé. De même, un salariat à deux vitesses n’est pas acceptable surtout lorsqu’il existe d’autres solutions plus universelles pour résoudre le chômage tout en rétablissant les cotisations sociales sur les bas salaires.
La démarchandisation de l’économie est un combat historique de la gauche. La mise hors-marché de certains secteurs de l’économie en a été un axe. La Mutualisation partielle des revenus d’activité met hors-marché une partie de la production privée pour la répartir de façon égalitaire entre toutes celles et ceux qui l’ont réalisé. Ne serait-ce pas un nouveau combat historique pour la gauche ?
Notes :
(1) Quirin Dammerer, Antoine Godin et Dany Lang, « L’employeur en dernier ressort : une idée post-keynésienne pour assurer le plein emploi permanent » dans L’économie post-keynésienne, Histoires, théories et politiques, Seuil,
2018, p. 335.
(2) Pavlina R. Tcherneva, La garantie d’emploi, L’arme sociale du Green New Deal, La Découverte, 2021. Les citations suivantes sur l’emploi garanti sont également tirées de son ouvrage.
(3) Marie-Monique Robin, Nouvelle cordée, M2R Films, 2019
(4) Dares, Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, Rapport final du comité scientifique, Avril 2021