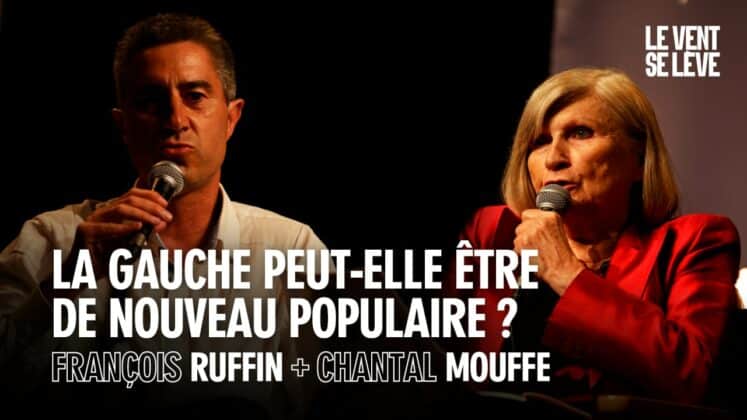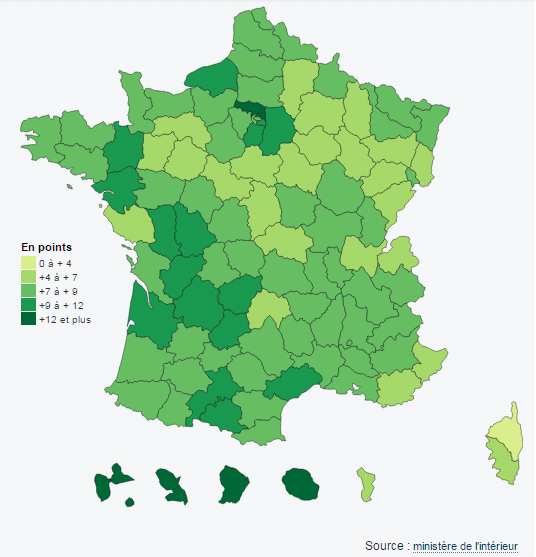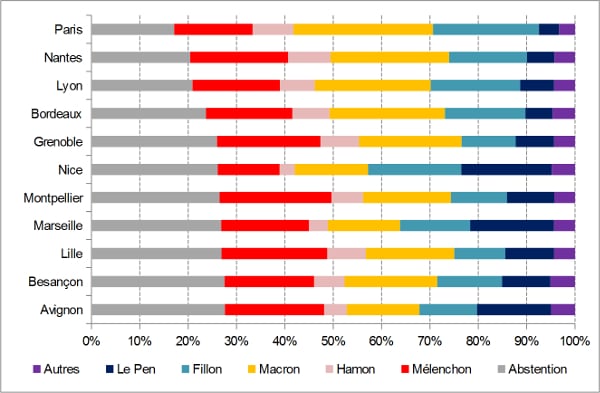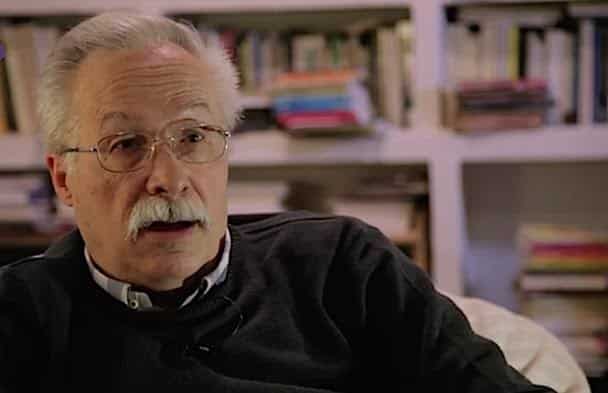[Long format] On a souvent considéré, à tort, que l’indépendantisme catalan pouvait se réduire à l’exacerbation d’un nationalisme conservateur ou à l’expression d’un simple égoïsme fiscal. Il existe pourtant, en Catalogne, un indépendantisme progressiste qui envisage l’indépendance comme une manière de recouvrer la souveraineté populaire, d’ouvrir un nouvel espace d’émancipation et de redéfinir les règles du jeu politique. Cet indépendantisme ancré à gauche, qui s’inscrit dans le sillage des mobilisations sociales que connaît l’Espagne depuis la crise de 2008 et qui revendique l’héritage du mouvement des Indignés (le 15M), est en partie incarné par la Candidature d’unité populaire (CUP), l’une des formations clés de la nébuleuse souverainiste. À la différence de Podemos, qui aspire à répondre à la « crise du régime de 1978 » par une réforme des institutions espagnoles et la reconnaissance du caractère plurinational de l’Espagne, la CUP envisage le séparatisme comme l’unique porte de sortie. Dans cet article, écrit à partir d’une lecture des manifestes du parti, d’observation participante à Barcelone et d’entretiens effectués avec des militants de la CUP, le choix a été fait d’analyser l’indépendantisme catalan dans ce contexte de crise politique et d’intensification des mobilisations sociales.
Le 10 octobre dernier, dans un discours sous haute tension prononcé devant le Parlement régional, Carles Puigdemont déclarait l’indépendance de la Catalogne avant de la suspendre dans la foulée. Sur les bancs de la majorité, c’est une standing-ovation enthousiaste qui accueille les propos alambiqués du président de la Généralité. Seule une poignée de députés parmi les rangs indépendantistes refuse de s’associer à la célébration : les dix élus de la Candidature d’unité populaire (CUP) restent de marbre. Peu après l’allocution de Carles Puigdemont, Arran, la branche jeunesse de la CUP, évoque dans un tweet une « trahison inadmissible », une violation du mandat populaire obtenu à l’issue du référendum du 1er octobre. Si les tergiversations vont aujourd’hui bon train au sein de la coalition Junts Pel Sí qui gouverne la communauté autonome, le message des responsables de la gauche radicale indépendantiste est clair : face à l’autoritarisme de Madrid, la déclaration unilatérale d’indépendance est la seule voie possible, et la proclamation de la République de Catalogne relève désormais de l’urgence.
La CUP, une formation d’inspiration municipaliste et assembléiste, a investi la scène politique catalane en 2012 à l’occasion des élections autonomiques. Le parti entend alors se faire le relai des luttes sociales et défendre un indépendantisme sur une ligne clairement anticapitaliste, en rupture avec l’État espagnol et les diktats de la Troïka. Malgré un faible score à 3,47% et seulement 3 sièges de députés, la CUP fait une entrée remarquée au Parlement régional. Les discours percutants de son chef de file David Fernández, qui définit les militants de l’organisation comme des « hackers de l’impossible », offrent au parti une visibilité sans précédent. Ainsi, en 2013, Fernández interpelle vigoureusement l’ancien patron de Bankia et du FMI Rodrigo Rato, aujourd’hui en prison pour détournement de fonds, concluant son intervention par un « On se reverra en enfer […] à bientôt gangster, dehors la mafia » resté célèbre.
“Le parti entend se faire le relai des luttes sociales et défendre un indépendantisme clairement anticapitaliste, en rupture avec l’État espagnol et les diktats de la Troïka.”
Aux élections autonomiques de 2015, convoquées par le président de la Généralité Artur Mas afin d’obtenir un « plébiscite » en faveur de l’indépendantisme, la CUP progresse et obtient 10 sièges de députés, avec plus de 8% des voix. Elle devient alors une pièce maîtresse de l’échiquier politique catalan, car la coalition indépendantiste Junts Pel Si nécessite le soutien de ses députés pour obtenir la majorité et former un gouvernement. Le refus de la CUP à une reconduction d’Artur Mas à la tête de la Généralité a d’ailleurs amené la coalition à proposer la candidature de Carles Puigdemont à la tête de l’exécutif catalan. La CUP, bien que représentant une fraction minoritaire du mouvement indépendantiste, n’en reste pas moins intéressante à étudier car elle est aujourd’hui, par la pression qu’elle exerce sur la coalition Junts Pel Sí, un acteur politique clé; elle permet également d’offrir un autre regard sur l’indépendantisme et de s’éloigner des idées préconçues sur le souverainisme catalan.
Indépendantisme et mobilisation populaire
« Ce que nous sommes en tant que peuple, nous ne le sommes pas par essence ou parce que notre peuple est issu d’un passé immémoriel, nous le sommes par tout ce que nous avons gagné dans les petites luttes et les grandes batailles menées dans chaque recoin du pays ». Cette citation du philosophe indépendantiste Xavier Antich, volontiers reprise par les leaders de la CUP, illustre la conception de l’identité catalane défendue par celle-ci. Pour les membres de la CUP, le sentiment national catalan ne repose pas tant sur des critères ethno-linguistiques que sur une conscience historique forgée dans la résistance à l’oppression subie. En témoigne notamment l’omniprésence des références antifranquistes dans les discours des leaders du parti.
La CUP entend faire des luttes sociales le ferment de l’indépendantisme catalan. Le parti a d’ailleurs apporté son soutien en 2016 à l’association Òmnium Cultural dans son initiative Lluites compartides (Luttes partagées), dont l’objectif affiché était de tisser un fil conducteur entre les mobilisations sociales qui ont conféré au peuple catalan sa spécificité. En ce sens, la revendication de l’indépendance de la Catalogne est mise en relation avec l’émancipation des classes subalternes. Alors que l’autonomisme est présenté comme un jeu de dupes qui donne lieu à de multiples et vaines tractations entre les élites espagnoles et catalanes, l’indépendantisme aurait vocation à prendre en compte les aspirations des milieux populaires trop longtemps reléguées au second plan. Le statut actuel de la Catalogne est dès lors perçu comme une impasse : il ne permet pas au peuple catalan de se prémunir de l’austérité du fait de la suprématie des politiques menées par le gouvernement central. Les militants de la CUP citent en exemple le rejet par le Tribunal constitutionnel espagnol en 2016 d’une loi adoptée par le Parlement catalan en vue de lutter contre les expulsions locatives. Dans le cadre de l’État des autonomies, toute tentative d’amélioration du sort des plus démunis serait ainsi vouée à l’échec : Madrid aura toujours le dernier mot.
“Pour la CUP, le sentiment national catalan ne repose pas tant sur des critères ethno-linguistiques que sur une conscience historique forgée dans la résistance à l’oppression subie […] La CUP entend faire des luttes sociales le ferment de l’indépendantisme catalan.”
L’indépendantisme est décrit comme la voie de l’émancipation. Comme le souligne le politiste Mathieu Petithomme, c’est d’abord l’« activisme militant » qui a permis ces dernières années à la revendication indépendantiste, historiquement minoritaire, de se transformer en véritable projet politique[1]. La CUP est l’une des parties prenantes de cette nébuleuse militante, englobant entre autres la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et des associations comme Òmnium Cultural et l’Assemblée nationale catalane (ANC), qui ne cesse depuis près d’une décennie de porter à l’agenda politique la question de l’autodétermination du peuple catalan.
Les mobilisations qui agitent la Catalogne, depuis l’organisation en 2009 de la première consultation indépendantiste dans la municipalité d’Arenys de Munt jusqu’au référendum du 1er octobre, en passant par la consultation nationale de 2014 et les manifestations spectaculaires à l’occasion de la Diada [la fête nationale de la Catalogne], auraient jeté les bases d’un nouveau sujet politique : le « peuple catalan ». Pour les leaders de la CUP, ces mobilisations ont donné corps à un « mouvement populaire de protestation parmi les plus importants au monde [qui aurait] obligé les politiques et les institutions à aller dans le sens d’une rupture démocratique à travers un référendum »[2].
Face à un État central considéré comme illégitime, l’exercice du droit à l’autodétermination est donc considéré comme un acte de désobéissance civile capable, non seulement de construire des citoyens critiques mais aussi d’exercer, selon les mots d’Henry David Thoreau, « une forme de responsabilité [qui] appelle à davantage de responsabilités ». Dans un contexte où tous les sondages indiquent que 70% des Catalans, quelle que soit leur opinion sur l’indépendance, sont en faveur de la tenue d’un référendum d’autodétermination reconnu par l’État central, le projet référendaire agit ainsi, selon la CUP, au nom d’un collectif majoritaire qui s’oppose à une majorité légale. S’appuyant sur les travaux d’Henry David Thoreau, d’Hannah Arendt et de Rosa Parks, et inscrivant leur combat dans le sillage de la lutte contre l’apartheid sud-africain et de l’insoumission au service militaire, la CUP considère que la désobéissance vis-à-vis de l’État espagnol devient un devoir civique.
Les consultations indépendantistes depuis 2009 et le référendum du 1er octobre dernier sont envisagés comme des outils démocratiques permettant d’impulser d’importants changements structurels. La CUP voit dans ces événements une formidable opportunité d’initier un processus de rupture par la société civile, « depuis le bas, depuis la rue ». L’acte de désobéissance civile comporte ainsi une potentialité révolutionnaire non négligeable en ce qu’il permet aux citoyens de développer une conscience civique pouvant défier l’ordre établi.
La CUP va jusqu’à développer le concept de « désobéissance civile institutionnelle », qui consiste à étendre le domaine de la désobéissance aux institutions, en l’occurrence au Parlement catalan. La « désobéissance civile institutionnelle » permet, aux yeux des leaders du parti, de dépasser deux oppositions habituellement effectuées par la tradition de la désobéissance civile : rue/institutions et peuple/élite. Il ne s’agit plus uniquement de désobéir « par le bas » et dans la rue, mais d’également de désobéir au sein des institutions quitte à faire alliance avec certaines élites (les élus de Junts pel Sí dans le cas catalan). Leur manifeste présente le référendum de 2017 comme un acte de désobéissance vis-à-vis de l’État central, supposé offrir deux opportunités : défier le pouvoir central jugé « autoritaire » en mettant tout en œuvre pour que le référendum soit organisé dans de bonnes conditions et que nul ne puisse contester son résultat ; ouvrir un processus constituant afin de permettre l’exercice de la souveraineté populaire dans le cadre du nouvel État catalan.
“Si la CUP a vigoureusement dénoncé les violences policières du 1er octobre, l’organisation avait parfaitement conscience du rapport de force qu’induirait la tenue du référendum et anticipait une réaction ferme de la part de l’État.”
Les membres de la CUP se sont donc ardemment mobilisés dans l’organisation du référendum du 1er octobre, s’opposant dans la rue au déploiement massif des forces policières. La CUP a notamment apporté son soutien au travail des « Comités de défense du référendum » (CDR) créés à l’initiative de mouvements sociaux à travers toute la Catalogne pour s’assurer du bon déroulement du référendum. Leur consigne face à la répression madrilène : « Nous devons défendre les urnes ». Au lendemain des tensions du 1er octobre, la députée Anna Gabriel déclarait ainsi : « les Comités ne doivent pas se dissoudre, ils doivent continuer à organiser la grève générale et devenir l’embryon de l’empowerment populaire ». Des mobilisations étudiantes contre le plan Bologne aux manifestations géantes organisées pour défendre l’accueil des réfugiés en février dernier, en passant par l’expérience du 15-M, la naissance de ces comités s’inscrit, elle aussi, dans le contexte d’intensification des mobilisations sociales que connaît la Catalogne depuis quelques années. Les CDR peuvent ainsi être considérés comme un « point de rencontre entre la gauche anticapitaliste et les autres options révolutionnaires »[3].
Si la CUP a vigoureusement dénoncé les violences policières du 1er octobre, l’organisation avait parfaitement conscience du rapport de force qu’induirait la tenue du référendum et anticipait une réaction ferme de la part de l’État. En septembre 2017, les élus de la CUP Albert Botran et Montse Venturós indiquaient la marche à suivre : face à l’usage disproportionné de la force depuis Madrid, les Catalans devraient faire preuve d’une résistance pacifique et se mobiliser massivement car « l’État n’a pas suffisamment de force entre ses mains pour arrêter la volonté démocratique du peuple catalan ». La mise en valeur d’une société catalane qui se dresserait pacifiquement pour réclamer le droit à l’autodétermination face à un État espagnol décrédibilisé par la répression obligerait ainsi les acteurs progressistes à se positionner de leur côté pour ne pas être identifiés à la politique réactionnaire du gouvernement.
La République catalane comme réponse à la crise du « régime de 1978 »
Les fortes mobilisations sociales que connaît l’Espagne depuis deux décennies, la crise économique de 2008 qui a débouché sur une crise sociale et politique, le mouvement du 15-M de 2011, la fin du bipartisme avec l’apparition de Podemos et de Ciudadanos, les victoires des forces du changement en 2015 à Madrid et Barcelone et la montée des revendications indépendantistes en Catalogne sont autant d’événements qui témoignent des fissures qui traversent aujourd’hui l’État espagnol. C’est dans ce contexte de bouleversement politique et d’intensification des mobilisations sociales que la crise catalane doit donc être comprise et analysée. Elle témoigne, bien sûr, des limites que connaît la formule institutionnelle de « l’État des autonomies », qui n’a pas scellé les débats sur la nature plurinationale ou non de l’État espagnol, mais elle est, plus généralement, le symptôme du bouleversement que connaît la vie politique espagnole et des failles du système hérité de la transition démocratique.
La Transition a longtemps été considérée comme un « cas modèle » et qualifiée de « success story » du fait de son supposé pacifisme et des compromis alors effectués entre les différents acteurs politiques[4]. Elle a débouché sur l’adoption de la Constitution de 1978 qui a donné naissance, après plus de quarante ans de dictature franquiste, aux institutions démocratiques espagnoles. Cependant, les commentateurs soulignent un consensus « relatif » et « instable » et pointent les limites de la Constitution espagnole : « les acteurs politiques ont conclu des accords ambigus ou contradictoires et, dans certains cas, ont repoussé la résolution [du problème] à une date ultérieure »[5].
“La Constitution de 1978 empêcherait toute remise en question d’un système politique hérité du franquisme. Parmi ces héritages, la CUP dénonce le principe de « l’unité de l’Espagne » et l’impossibilité de convoquer un référendum reconnu par le gouvernement central.”
Podemos et la CUP figurent parmi les principales forces de gauche qui analysent cette situation d’intensification des mobilisations sociales comme l’amorce d’une crise de régime et entendent s’appuyer sur ces failles pour initier une véritable rupture avec ce que les deux partis nomment le « vieux monde ». Tous deux proposent une lecture critique de la transition. Du côté de Podemos, les leaders entendent déconstruire le « mythe de la transition » et s’attaquer à la « culture de la transition ». C’est d’ailleurs le constat dressé par Juan Carlos Monedero, co-fondateur du parti, dans son livre La Transición contada a nuestros padres dans lequel il affirme que la transition correspondait à « un mensonge familial qui occultait un passé peu héroïque »[6]. Ils reconnaissent volontiers la nécessité de réformer la Constitution mais insistent en parallèle sur les compromis effectués pendant la Transition qui auraient permis de forger des institutions démocratiques fortes et de défendre d’importants droits sociaux aujourd’hui attaqués par la « caste ».
Au contraire, pour la CUP, à l’inverse du Portugal en 1976 ou de l’Italie en 1947, l’État espagnol n’aurait jamais marqué de véritable rupture avec le régime franquiste : « [Le] pacte a consisté en ce que les franquistes acceptent le côté démocratique de la nouvelle Constitution (pluralisme politique, droits sociaux, etc.) et que les antifranquistes acceptent le côté antidémocratique du texte constitutionnel (monarchie, économie de marché, prédominance du maintien de « l’unité nationale », etc »[7]. La Constitution de 1978 empêcherait toute remise en question d’un système politique hérité du franquisme. Parmi ces héritages, la CUP dénonce le principe de « l’unité de l’Espagne » et l’impossibilité de convoquer un référendum reconnu par le gouvernement central.
Les deux formations politiques défendent des programmes similaires sur plusieurs points (reconnaissance des nations qui composent l’Espagne, lutte contre la corruption, féminisation de la vie politique, transition écologique, redistribution des richesses, etc.) et vont même jusqu’à partager une certaine phraséologie (« régime de 1978 », transversalité, peuple contre élite, hégémonie, etc.). Toutes deux envisagent le 15-M comme point de rupture fondamental : Podemos entend « convertir l’indignation en changement politique » quand la CUP souligne que « le mouvement indépendantiste, à travers la rupture qu’il pose avec la Constitution espagnole, apporte un outil pour transformer l’indignation en changement »[8]. Alors que Podemos, bien que tentant de se présenter comme un « mouvement-parti », a privilégié une structure organisationnelle hiérarchique forte donnant peu de poids aux Cercles, la CUP n’a cessé, au contraire, de souligner l’importance d’adopter une organisation partisane assembléiste. Le parti va même jusqu’à déclarer que « le mouvement indépendantiste ne pourra défier le pouvoir étatique sans incorporer en son sein les demandes sociales et les méthodes de lutte du 15-M »[9].
Les deux formations divergent également lorsqu’il s’agit de construire une stratégie politique de rupture. D’un côté, les leaders de Podemos considèrent que la crise de 2008 et le mouvement du 15-M ont ouvert une « fenêtre d’opportunité » permettant l’élaboration d’une stratégie populiste capable d’arriver au pouvoir. En tant que parti d’envergure nationale, la stratégie de Podemos est tournée vers la conquête des institutions de l’État espagnol. Du côté de la CUP, les leaders parlent d’une situation politique ayant initié un processus destituant partiel et une rupture symbolique partielle avec le régime mais, à la différence de Podemos, le parti dénonce l’impossibilité de mettre en place un programme de rupture radicale depuis des institutions héritées du régime franquiste.
“La CUP, qui en appelle au pacifisme et à la démocratie, considère néanmoins qu’initier une rupture avec le « régime de 1978 » ne pourra se faire dans le cadre de la légalité. Les élections générales de 2016 et la reconduction de Mariano Rajoy à la tête du gouvernement espagnol témoignent de l’impossible réforme de l’État.”
Les leaders de la CUP attaquent implicitement la stratégie populiste transversale de Podemos. Elle a d’abord été défendue par Íñigo Errejón, ex « numéro 2 » du parti, qui, s’appuyant sur les travaux de Gramsci, considère que construire une contre-hégémonie nécessite, non pas de faire « table rase du passé » mais de se nourrir du sens commun de l’époque. Il écrivait ainsi : « Le processus ouvert par le 15-M de 2011 est, par exemple, contre-hégémonique dans la mesure où il ne dénonce pas le “mensonge” du régime de 1978 mais assume et part de ses promesses inaccomplies, en questionnant le régime selon ses propres termes […] Ce discours, ce sentiment qui se déploie, s’est montré, précisément pour sa lecture politique et son attention à l’hégémonie, un bien meilleur chemin de transformation que les principes moralisants et esthétiquement satisfaisants de la gauche traditionnelle »[10]. La CUP critique le fait que « de nombreuses personnes ont voulu convertir Gramsci en populiste » alors que, de l’auteur italien, il s’agit d’abord de retenir que « vivre signifie être partisan ». Dans un entretien accordé à Ballast en juillet 2017, Anna Gabriel, députée de la CUP, déclarait ainsi au sujet de Podemos : « Non seulement ils n’ont pas réussi à gagner et la force qu’ils représentent aujourd’hui n’est pas suffisante pour réussir à modifier la Constitution espagnole »[11].
La CUP, qui en appelle au pacifisme et à la démocratie, considère néanmoins qu’initier une rupture avec le « régime de 1978 » ne pourra se faire dans le cadre de la légalité. Les élections générales de 2016 et la reconduction de Mariano Rajoy à la tête du gouvernement espagnol témoignent de l’impossible réforme de l’État et, surtout, de la capacité d’auto-régénération du « régime de 1978 ». Le référendum d’autodétermination représente ainsi, aux yeux de ses leaders, une « opportunité de rupture » avec le régime qui refuse de reconnaître le droit des peuples à l’autodétermination. Sur la scène politique nationale, Podemos plaide pour la reconnaissance de la plurinationalité de l’État espagnol ainsi que pour la tenue d’un véritable référendum d’autodétermination en Catalogne, organisé avec l’aval de Madrid. Le parti se place du côté du dialogue. Ses leaders ont, par exemple, massivement partagé le hashtag #Hablamos (Parlons) lancé à l’initiative du mouvement citoyen Parlem? ¿Hablamos? créé en réaction à la crise catalane. Ce mouvement, qui se revendique « sans drapeau » et « sans parti », appelle au dialogue entre Madrid et Barcelone.
Les manifestants indépendantistes interrogés lors du rassemblement du 3 octobre dernier à Barcelone reconnaissent la bonne volonté de Podemos mais dénoncent son idéalisme – voire son hypocrisie – en soulignant que les institutions espagnoles, qui assurent avant tout « l’indissoluble unité de la nation espagnole », ne permettraient pas la mise en place d’un référendum pacté et ne reconnaîtraient jamais la validité juridique du référendum en cas de victoire du « oui » à l’indépendance. Suivant la lecture faite par la CUP de la situation politique, les manifestants parlent ainsi de « rompre avec le régime de 78 par la force ». Au contraire de Podemos, la CUP insiste donc sur la force du pouvoir constituant, permis par l’avènement de la République de Catalogne et capable d’initier une « véritable rupture collective » à la différence d’une simple réforme constitutionnelle qui ne ferait que perpétuer la continuité juridique du « vieil État ».
Vers l’indépendance et au-delà : République sociale, Pays Catalans et « fédéralisme de transformation »
Si la mobilisation populaire est essentielle à l’obtention de l’indépendance de la Catalogne, elle l’est encore davantage aux yeux de la CUP dans les phases qui suivent la proclamation de la République catalane. Elle doit permettre d’engager le processus constituant et de l’orienter dans un sens authentiquement démocratique et résolument progressiste. Si la cause indépendantiste justifie des alliances de circonstances transcendant les rapports sociaux et le clivage gauche/droite, la lutte pour la définition de la future République de Catalogne est bien une lutte de classes.
C’est la raison pour laquelle les dirigeants de la CUP distinguent deux axes dans leur stratégie politique : 1) la « mobilisation transversale » en faveur du processus d’indépendance, qui doit regrouper une pluralité d’acteurs et d’intérêts au sein d’une même coalition souverainiste ; 2) la lutte de classes au sein même du processus indépendantiste, qui divise la coalition souverainiste en un bloc progressiste et un bloc conservateur.
“Le processus constituant que la CUP appelle de ses vœux doit être un moment de profonde respiration démocratique, qui associerait l’ensemble des citoyens à la redéfinition des règles du jeu politique afin d’empêcher l’avènement d’un pacte entre élites sur le modèle tant critiqué de la Transition démocratique espagnole.”
Au lendemain de l’indépendance, ces deux blocs seront nécessairement amenés à s’affronter pour peser dans les choix qui présideront à la création de la jeune République catalane. Pour les membres de la CUP, il est clair que les élites indépendantistes, incarnées par le PDeCAT de Carles Puigdemont, tenteront de sauvegarder prioritairement les intérêts de la bourgeoisie catalane, poursuivant par là même les politiques d’austérité et la libéralisation de l’économie. C’est ce qui transparait dans l’un des tracts distribués par le parti à la manifestation du 3 octobre dernier : « Nous ne pouvons pas confier la défense et la construction de la République catalane à Carles Puigdemont et au parti bourgeois PDeCAT car ils ont des intérêts de classes incompatibles avec la lutte pour l’autodétermination qui est, en Espagne, une tâche révolutionnaire, comme l’a montré le référendum [en référence aux violences policières commises par la Garde civile] ». Plusieurs membres de la CUP avaient d’ores et déjà exprimé leurs doutes quant à la détermination de Carles Puigdemont à mener à son terme le processus d’indépendance. Une semaine avant la déclaration d’indépendance immédiatement suspendue, Paolo, jeune italien expatrié à Barcelone depuis trois ans et militant de la CUP, nous confiait : « Je pense que nos députés ont commis une erreur importante en donnant leur soutien à Carles Puigdemont ».
Si la CUP est convaincue que les Catalans, qui s’auto-définissent plus à gauche que les autres peuples d’Espagne, tourneront le dos au néolibéralisme, la mobilisation citoyenne n’en reste pas moins nécessaire pour éviter toute confiscation de la souveraineté populaire. Le processus constituant que les membres de la CUP appellent de leurs vœux doit donc être un moment de profonde respiration démocratique, qui associerait l’ensemble des citoyens à la redéfinition des règles du jeu politique afin d’empêcher l’avènement d’un pacte entre élites sur le modèle tant critiqué de la Transition démocratique espagnole. La gauche radicale indépendantiste souhaite ainsi voir essaimer sur tout le territoire des assemblées, des « espaces d’auto-organisation citoyenne » largement décentralisés en vue de débattre du contenu de la future constitution.
La CUP défend un idéal de République démocratique et sociale qu’elle veut en rupture avec les valeurs jugées intrinsèquement négatives d’un État espagnol encore imprégné de l’idéologie nationale-catholique. A l’État espagnol qui privatise et laisse les infrastructures se dégrader, ils opposent une République catalane à même d’investir et de nationaliser les secteurs stratégiques de l’économie. Face à un pouvoir étatique ferme à l’égard de l’immigration et soucieux d’uniformiser ses populations, la République catalane doit se montrer pionnière dans l’accueil des réfugiés et afficher fièrement sa diversité. Plus généralement, le processus constituant représente aux yeux des militants de la CUP un nouvel espace d’émancipation susceptible d’accueillir une pluralité de revendications, du combat contre le « capitalisme de copinage » à la lutte contre le patriarcat, en passant par l’engagement internationaliste pour une diplomatie au service de la paix et de la coopération entre les peuples.
“La communauté autonome de Catalogne est envisagée comme une construction arbitraire de l’État espagnol, encouragée par l’Union européenne dans sa politique de mise en concurrence des territoires. La CUP se donne donc pour but de faire émerger un sentiment national élargi au vaste ensemble des Pays Catalans.”
La proclamation de la République indépendante de Catalogne n’est donc pas une fin en soi. Elle l’est d’autant moins si l’indépendance est restreinte au cadre géographique de la communauté autonome catalane. Au mois de septembre, la CUP suscitait la polémique en appelant à étendre l’organisation du référendum d’autodétermination à l’ensemble des « Pays Catalans » (Països Catalans), une construction territoriale aux contours flous, supposée regrouper l’ensemble des territoires de « culture catalane ». Ils engloberaient les communautés autonomes de Catalogne, de Valence et des Iles Baléares, ainsi que la principauté d’Andorre et les Pyrénées orientales en France.
« La fragmentation du territoire des Pays Catalans est une démonstration claire de la situation de colonisation que vit la nation catalane », écrit Carles Riera, député au Parlement de Catalogne. Pour ce dernier, la division des territoires de culture catalane est le produit d’une logique de domination forgée par l’histoire et les conflits successifs, du traité des Pyrénées de 1659 qui voit la France annexer le Roussillon, jusqu’à la guerre civile et l’instauration de la dictature franquiste au cœur du XXe siècle. Aujourd’hui, la CUP déplore la dilution des Pyrénées orientales dans la grande région française d’Occitanie de même qu’elle critique l’organisation autonomique espagnole.
Limiter la revendication d’indépendance au seul cadre de la communauté autonome, c’est « assumer la cartographie de l’ennemi », poursuit Riera. La communauté autonome de Catalogne est en ce sens envisagée comme une construction arbitraire de l’État espagnol, encouragée par l’Union européenne dans sa politique de promotion des régions et de mise en concurrence des territoires. La CUP se donne donc pour but de faire émerger un sentiment national élargi à ce vaste ensemble des Pays Catalans, susceptibles en cas d’union de représenter sur la scène européenne et dans le bassin méditerranéen un « sujet d’influence ».
Cette revendication étendue aux Pays Catalans est un élément de distinction à l’égard de l’indépendantisme d’ « hégémonie néolibérale » du PDeCAT, dont le souverainisme se limite à la communauté autonome de Catalogne. La CUP n’est pas toujours très claire quant à ses intentions à l’égard des Pays Catalans, probablement compte tenu de l’état des rapports de force. Dans la communauté valencienne tout comme dans les Iles Baléares, sans parler des Pyrénées orientales en France, leur discours peine à rencontrer un écho. Il revient donc à la gauche indépendantiste de la communauté catalane de prendre à bras le corps cette « lutte de libération nationale dans les Pays Catalans ». La priorité réside alors dans la création de ponts entre les mouvements sociaux et les associations des territoires de culture catalane afin de « transgresser la carte autonomique ».
L’indépendantisme de la gauche radicale se projette en dehors des frontières, et c’est là un argument régulièrement opposé par la CUP à ses détracteurs qui lui objectent que l’indépendance de la Catalogne a vocation à jeter des barrières entre les peuples. Bien que les écrits des dirigeants du parti soient particulièrement pessimistes quant aux possibilités de modifier les structures de l’État espagnol, ceux-ci ne renoncent pas pour autant à un vaste processus de transformation sociale à l’échelle du pays. Leur stratégie est présentée par Mireia Vehí et Albert Noguera sous l’expression de « foquisme constituant » qu’ils opposent à la stratégie du « centralisme constituant ». Le terme « foquisme » est emprunté à la théorie de la guerre révolutionnaire d’Ernesto « Che » Guevara. Il désigne originellement, devant l’impossibilité de s’emparer du pouvoir par la conquête politique des institutions de l’État central, la création de foyers de guérillas dans les zones rurales, susceptibles de se répandre par la suite à l’ensemble du territoire concerné pour en renverser le régime.
“La brèche catalane et ses répliques sur le territoire espagnol doivent obliger les forces progressistes en Espagne à repenser un « fédéralisme de transformation » en termes de libre association entre une pluralité de peuples souverains, disposant chacun du droit à l’autodétermination.”
En l’espèce, et selon les mots du principal dirigeant de la CUP David Fernández, il s’agit « hier comme aujourd’hui [d’] ouvrir par le bas et depuis la périphérie ce qu’ils cherchent à refermer par le haut et depuis le centre ». Autrement dit, bien que les conditions ne soient pas réunies pour engager un changement politique et social depuis l’État espagnol, la Catalogne peut constituer un foyer de transformation. L’indépendance de la région peut ouvrir une brèche dans le régime de 1978 en s’attaquant à l’un de ses principaux piliers : l’unité nationale. En créant cette faille, le processus catalan devrait engendrer de l’instabilité sur l’ensemble du territoire espagnol, car il ferait immanquablement tâche d’huile dans d’autres régions, à commencer par le Pays Basque. Cette multiplication de « foyers » de contestation du régime révélerait alors l’incapacité de l’État espagnol à répondre à la crise.
Cette stratégie vise à inverser les rapports de force actuels et à ouvrir la voie à un « fédéralisme de transformation » qui se substituerait au « fédéralisme conservateur » actuellement en vigueur. Pour les théoriciens de la CUP, le « fédéralisme conservateur » aujourd’hui dominant est basé sur un modèle centre-périphérie : il consiste, lorsque apparaissent des revendications régionales, à octroyer depuis le centre certaines concessions aux périphéries afin d’atteindre un équilibre temporaire et d’assurer la survie du régime. C’est ce modèle, parfois qualifié par les politistes de « fédéralisme asymétrique », que la CUP entend faire voler en éclat. La brèche catalane et ses répliques sur le territoire espagnol doivent obliger les forces progressistes en Espagne à repenser un « fédéralisme de transformation » en termes de libre association entre une pluralité de peuples souverains, disposant chacun du droit à l’autodétermination. Le fédéralisme envisagé de cette manière se transforme, à leurs yeux, en la condition sine qua non permettant d’assurer, a posteriori, la mise en place de relations d’égalité et de solidarité entre des peuples devenus libres et souverains.
L’indépendantisme, catalyseur de l’indignation
La radicalisation de l’indépendantisme catalan ces dernières années est indissociable de l’émergence de nouvelles formes de protestation dans une Espagne profondément marquée par la crise économique et sociale. L’installation de la CUP dans le paysage politique catalan s’explique tant par l’intensité de son activisme militant, notamment à l’échelle municipale, que par son inscription dans cette immense vague de contestation du « régime de 1978 ». Parmi les militants indépendantistes de la CUP, nombreux sont ceux qui occupaient, il y a six ans, la Plaça de Catalunya aux cris de « Que no ens representen » (Ils ne nous représentent pas) et de « No som mercaderia en mans de polítics i banquers » (Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers). Au même titre que Podemos, la CUP ne peut être appréhendée comme « le parti des Indignés ». Elle prolonge néanmoins par son récit politique l’impulsion destituante du 15-M et tente d’y apporter une réponse à travers le projet indépendantiste et le processus constituant qu’elle appelle de ses voeux.
La CUP est parvenue à canaliser dans une certaine mesure la revendication d’une démocratisation de la société et des institutions. En Catalogne, l’indépendantisme est devenu le catalyseur de l’indignation, c’est ce qui explique la dimension transversale du mouvement indépendantiste qu’il est difficile de restreindre à un chauvinisme conservateur ou à la montée de l’égoïsme fiscal. La CUP souhaite offrir à cette jeunesse indignée la République de Catalogne comme nouvel horizon et fait pression en ce sens sur Carles Puigdemont, quitte à prendre ses distances avec les gauches espagnoles qui réclament avant tout davantage de dialogue. Un projet politique ambitieux, qui se heurte à la réalité des rapports de force actuels et à l’inflexibilité de Madrid.
Laura Chazel et Vincent Dain
[1]Petithomme, Mathieu. « La Catalogne, du nationalisme à l’indépendantisme ? Les enjeux d’une radicalisation », Critique internationale, vol. 75, no. 2, 2017, pp. 133-155.
[2]Referèndum 2017. La Clau que obre el pany, Livre collectif de la CUP.
[3]Badia Quique, Puig Sedano Xavier, « Comitès de Defensa del Referèndum: un vell talp que emergeix de nou », El Temps, Septembre 2017.
[4]Peres Hubert, Roux Christophe (dir.), La Démocratie espagnole. Institutions et vie politique, Presses universitaires de Rennes, 2016.
[5]Ibid.
[6]Fernandez Daniel, « Monedero: La Transición fue una mentira de familia que ocultaba un pasado poco heroico », Público, Août 2013.
[7]Referèndum 2017. La Clau que obre el pany, Livre collectif de la CUP.
[8]Ibid.
[9]Ibid.
[10]Errejón Íñigo, “Podemos a mitad de camino”, www.ctxt.es, 23 avril 2016, traduit de l’espagnol par Pablo Castaño Tierno, Luis Dapelo, Walden Dostoievski et Alexis Gales pour le site Ballast (http://www.revue-ballast.fr/)
[11]Entretien avec Anna Gabriel « C’est révolutionnaire de combattre la cartographie du pouvoir », Ballast, 26 juillet 2017.
Crédit photos :
https://elpais.com/ccaa/2015/10/01/catalunya/1443687185_019963.html
http://www.ara.cat/especials/gentada-centre-Barcelona-mitja-manifestacio_0_772122901.html
https://elpais.com/ccaa/2016/09/08/catalunya/1473354856_559392.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/parlament-aprueba-madrugada-sindicatura-electoral-referendum-admitir-tramite-ley-transitoriedad-juridica_2017090759b08edf0cf25c1bd7f0cc3e.html