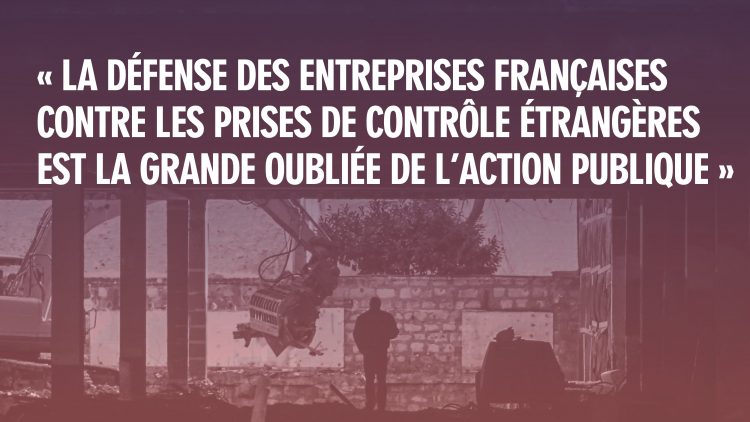De l’affaire Raytheon (1994) à l’affaire Alstom (initiée en 2014), la guerre économique a touché de plein fouet les entreprises françaises. Les États, bien loin des préconisations libérales, sont des acteurs constants de cette guerre économique, en particulier des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui s’affirment comme les plus en faveur de la libre entreprise. Loin de prendre la mesure des enjeux stratégiques de ce terrain d’affrontements, la politique publique française d’intelligence économique est demeurée insuffisante depuis que la chute de l’URSS en a renforcé les enjeux. La défense des entreprises françaises contre les prises de contrôle étrangères susceptibles de conduire à des transferts de technologies sensibles, ou de mettre en péril des emplois, est donc demeurée une oubliée de l’action publique.
En stratégie économique comme en art militaire, la réussite d’une politique publique demande autant d’initiative que d’anticipation : ce sont de tels préceptes qu’ont appliqué les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. À l’inverse, depuis les années 1990, les gouvernements français ont bien plus réagi à des chocs qui plaçaient les firmes nationales en mauvaise posture, qu’ils n’ont élaboré a priori des éléments stratégiques face aux nouveaux enjeux de la guerre économique.
L’intelligence économique, une culture aux États-Unis et une lacune française
À la faveur de la guerre froide, et des compétitions militaires, mais aussi techniques, économiques et scientifiques auxquelles elle donna lieu, les politiques publiques américaines ont pris à bras le corps la question de l’intelligence économique dès la fin du second conflit mondial. Il s’agissait dans un premier temps de faire profiter les entreprises américaines de l’information publique : dès les années 1950, des agences fédérales comme la National Science Foundation furent ainsi instituées, pour transmettre aux entreprises stratégiques les informations que produisaient les administrations. À mesure que la perspective d’un affrontement militaire avec la Russie soviétique s’éloignait, l’intelligence économique est devenue une préoccupation cardinale du ministère américain de la Défense, qui a déployé notamment une stratégie de financement et de protection économique de l’innovation : le financement de la recherche scientifique par le département de la Défense, monté brutalement 96% de la R&D publique en 1950, s’est maintenue par exemple à 63% de la R&D publique en 19871.
Cette préoccupation tôt manifestée par la communauté américaine du renseignement pour les sujets de stratégie économique a enraciné de puissants héritages et explique, encore aujourd’hui, la force des liens qui unissent les grands fleurons américains et les services secrets. À la fin de la guerre froide, une partie des moyens du renseignement américain a été du reste réorientée, faute d’ennemi, vers le renseignement économique ; de fait, la compétition entre les acteurs nationaux pour la conquête des marchés s’en est trouvée exacerbée. Cette culture de l’intelligence économique ne s’est toutefois pas implantée dans les mêmes conditions en France, qui est demeurée jusqu’aux années 1990 relativement imperméable à ce concept2. Si la France s’est d’abord intéressée aux politiques publiques d’intelligence économique, c’est qu’elle y a été obligée par le contexte de l’affaire Raytheon. En 1994, Thomson-CSF avait perdu, contre toute attente, le projet brésilien Sivam, un système de surveillance de la forêt amazonienne. Et pour cause : la NSA (National Security Agency) est intervenue pour intercepter des appels téléphoniques français, et livrer à Raytheon, le concurrent américain de Thompson, des informations stratégiques qui lui ont permis de remporter le marché3. Dans le cadre d’une forte mondialisation des marchés, la France s’est découverte mal armée pour parer de tels coups, pourtant distribués entre alliés. Désormais, les décideurs politiques se rendaient compte que, loin de l’idée d’une « concurrence libre et non faussée », les États-Unis faisaient preuve d’un réalisme agressif en faisant participer leurs services de renseignement à la conquête des marchés internationaux par leurs entreprises.
Les premières prises en compte françaises de l’intelligence économique
Suite à l’affaire Raytheon, des hauts fonctionnaires, comme l’ingénieur aéronautique Henri Martre, alors en poste au commissariat général au Plan, ont été convaincus de la nécessité de combler le « cloisonnement »4 entre les entreprises privées et les administrations publiques pour soutenir les acteurs économiques français. À la faveur de la recomposition de l’ordre mondial après la chute de l’URSS, la « guerre économique », entendue comme l’importance croissante des enjeux financiers dans les luttes globales entre les puissances, a gagné en importance, et a été enfin pleinement considérée, en France, comme une menace pour la sécurité nationale.
La NSA est intervenue pour intercepter des appels téléphoniques français, et livrer à Raytheon, le concurrent américain de Thompson, des informations stratégiques qui lui ont permis de remporter le marché.
Ces diagnostics ont donné lieu à la rédaction du rapport Martre, document fondateur de l’intelligence économique française, publié en février 1994. Le rapport définit l’intelligence économique comme « l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. » Les propositions du rapport ont conduit à l’institutionnalisation d’un organisme public dédié à l’intelligence économique, le Comité pour la compétitivité et la sécurité économiques (CCSE), placé auprès du Premier ministre. Cet organe a eu toutefois les plus grandes peines à œuvrer, délaissé par le pouvoir dans le contexte de l’élection présidentielle de 1995, et de la dissolution manquée de 1997. Le rapport Martre avait théorisé l’intelligence économique française, mais celle-ci fut donc d’abord très peu suivie d’effet.
Parallèlement à la publication du rapport Martre, la France s’est dotée dans les années 1990 d’un arsenal législatif plus adapté aux menaces : jusqu’en 1994, la protection du patrimoine économique était régie par l’ordonnance du 7 janvier 1950 qui mettait l’accent sur la régulation des pénuries, bien loin des impératifs de la guerre économique. Ce n’est qu’en 1994 que la nouvelle version du Code pénal intégra, parmi les intérêts fondamentaux de la nation, « les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique. » Ce n’est qu’en 2003 que la prise en charge de l’intelligence économique par les pouvoirs publics connut un regain d’intérêt.
Celui-ci fut d’une part causé par une autre affaire de guerre économique, celle de Gemplus, et d’autre part par le fait qu’au lendemain de l’effondrement de la bulle Internet en 2001, les décideurs publics se sont brutalement trouvés sensibilisés aux thématiques de l’intelligence économique. Une affaire servit d’abord de catalyseur aux politiques d’Intelligence Economique : en 2003, la société française Gemplus, leader mondial des cartes à puce, après avoir accepté l’entrée de Texas Pacific Group parmi ses actionnaires, n’a pu empêcher la nomination d’Alex Mandl à la tête de son conseil d’administration… Alex Mandl était un administrateur d’In-Q Tel, fonds d’investissement créé par la CIA, et supervisa le transfert de ces technologies françaises vers les États-Unis. Une fois encore, une entreprise stratégique française était victime des menées américaines en matière de guerre économique ; une fois encore, la France se découvrait mal armée politiquement pour répondre à ces menaces. Les alertes données au gouvernement par la Direction de la sûreté du territoire (DST) n’avaient pas été écoutées, et les services de renseignement français ne purent empêcher ni la destruction de nombreux emplois chez Gemplus, ni le transfert du brevet de la carte à puce vers le sol américain5.
Conscients de ces déboires, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le parlementaire Bernard Carayon ont poussé à la nomination d’Alain Juillet, directeur du renseignement de la DGSE, en tant que pilote et en qualité d’Haut commissaire à l’intelligence économique, le Secrétariat Général à la défense nationale. Service interministériel sous l’autorité du Premier ministre et ayant pourtant fait ses preuves, Nicolas Sarkozy le remplaça en 2009 par la Délégation Interministérielle à l’intelligence économique, dont les orientations étaient fixées par la Présidence de la République. Cette instance entrait alors en concurrence avec le Service de Coordination à l’Intelligence économique, dépendant du ministère des finances. Pour éviter les doublons administratifs, les deux instances furent fusionnées pour créer le Service de l’information Stratégique et de la sécurité économique (SISSE), qui constitue le dispositif existant. Cette nécessaire réforme ne fut achevée qu’en 2016 : cette lenteur témoigne bien de l’absence de prise en compte par les pouvoirs publics de la politique d’intelligence économique, dans un contexte pourtant marqué par le passage de la filière énergie du groupe Alstom, en 2014, sous pavillon américain.
Comment évaluer aujourd’hui l’action du SISSE, outil principal des politiques françaises de sécurité économique ? L’organisme semble réduit à réagir après coup aux menaces qui planent sur les entreprises françaises, et ce pour deux raisons. Premièrement, il ne s’occupe, comme en témoigne sa titulature, que de sécurité économique : cela signifie que la France renonce à faire de l’influence et à soutenir de manière décisive ses entreprises dans la conquête de marchés. Deuxièmement, comme nous le confiait Nicolas Moinet, spécialiste d’intelligence économique6, la structure même du SISSE n’est pas nécessairement la mieux adaptée : face à une menace multiforme qui pèse sur les entreprises françaises, un organisme centralisé auprès de la Direction générale des entreprises (DGE) n’est pas la forme la plus fluide que puisse prendre la politique de sécurité économique. Le renseignement économique demande au contraire des adaptations locales, qui pourraient passer de manière plus décisive par les préfectures, afin de recueillir des renseignements sur le terrain, et de parer plus efficacement les menaces. Certes, les préfectures ont été chargées, par une directive de 2005, de conduire des politiques de sécurité économique. Toutefois, comme le relevaient déjà Floran Vadillo et Nicolas Moinet dans une note de 2012, ces services préfectoraux n’ont pas atteint la taille critique qui permettaient de les rendre véritablement efficaces7.
Lire sur LVSL l’entretien de Nicolas Moinet : « Nous sommes en guerre économique. On ne peut pas répondre aux dynamiques de réseaux par une simple logique de bureau. »
L’intelligence économique française pâtit donc du manque de moyens déployés dans les services déconcentrés de l’État. Si des initiatives germent au niveau des collectivités, elles demeurent très aléatoires, et pour beaucoup insuffisamment opérationnelles : certaines régions, comme la région Auvergne Rhône-Alpes, produisent ainsi des documents à destination des entreprises pour les sensibiliser aux enjeux de la sécurité économique, sans que le résultat de ces communications soit assuré. La stratégie d’intelligence économique française souffre donc de deux carences majeures : d’une part, le SISSE, organe spécialisé dans la sécurité économique, n’est pas parfaitement taillé pour assurer la sécurité des entreprises nationales. D’autre part, les autres acteurs qui interviennent dans le champ sont trop peu dotés financièrement, et trop peu coordonnés entre eux. Quelles perspectives pour la sécurité économique sur le territoire français ? Les outils de contrôle des investissements étrangers pourraient porter leurs fruits s’ils sont mis en œuvre : l’affaire Photonis en fournit une parfaite illustration. Cette entreprise basée à Brive la Gaillarde, spécialisée dans les systèmes de vision nocturne – notamment à usage militaire – avait fait l’objet d’une offre de rachat par le fonds d’investissement Teledyne en septembre 2020. Le ministère des Armées avait alors opposé son veto à la vente de cette entreprise stratégique. Finalement, c’est le fonds européen HLD qui a acquis cette firme de 1 000 salariés.
Dans cette affaire, l’État a su s’opposer au rachat d’une technologie sensible par des investisseurs étrangers. Il ne faut toutefois pas faire de ce succès un triomphe : si le caractère stratégique de Photonis ne faisait pas de doute, du fait des implications militaires évidentes des technologies qu’elle développait, il n’en est pas de même pour toute entreprise. La réflexion sur ce qui doit être ou non un actif stratégique doit donc être engagée pour de bon : à l’échelle des Vosges, les usines textiles de Gérardmer peuvent par exemple être considérées comme un actif stratégique. Leur fermeture pourrait causer un fort taux de chômage sur le territoire, et partant, des mesures efficaces de protection économique doivent être mises en place par les pouvoirs publics pour éviter des rachats qui pourraient mettre en danger l’activité, et pour trouver, en anticipant les offres d’achat qui mettraient en péril la pérennité de l’activité, des repreneurs alternatifs. Il est toutefois peu probable qu’elles fassent l’objet d’un contrôle des investissements similaires à celui qui fut appliqué pour Photonis.
Lire sur LVSL l’entretien de Marie-Noëlle Lienemann : « Soutenir une politique d’intelligence économique, c’est un des moyens du redressement de la France. »
Le contrôle des investissements étrangers est donc nécessaire, et a donné dans l’affaire Photonis des résultats probants ; il n’est toutefois pas suffisant pour définir une politique d’intelligence économique idoine et protéger nos entreprises dans un contexte de guerre économique. La proposition de loi portée par Marie-Noëlle Lienemann au Sénat au printemps 2021 est parmi l’une des réponses formulées, en plus des décrets Montebourg et du nécessaire renforcement de l’arsenal juridique face à l’extra-territorialité du droit américain.
Sources :
1 – Audra J. Wolfe, Competing with the Soviets: Science, Technology and the State in Cold War America Baltimore : The John Hopkins University Press, 2013, 166 p.
2 – Eric DELBECQUE, Gérard PARDINI, Les politiques d’intelligence économique, PUF, 2008
3 – Lepri, Charlotte. « Les services de renseignement en quête d’identité : quel rôle dans un monde globalisé ? », Géoéconomie, vol. 45, no. 2, 2008, pp. 33-53.
4 – Préface d’Henri Martre, rapport Martre.
5 – « Stratégie de sécurité nationale et protection du patrimoine économique-industriel de la Nation. Thèse effectuée en 2018 par Alexis Deprau sous la direction du Professeur Olivier Gohin, Université Paris II Panthéon-Assas »
6 – https://lvsl.fr/nicolas-moinet-nous-sommes-en-guerre-economique-on-ne-peut-pas-repondre-aux-dynamiques-de-reseaux-par-une-simple-logique-de-bureau/
7 – Floran VADILLO, Nicolas MOINET, Sortir l’Intelligence économique de l’ornière, note du 5 avril 2012, Fondation Jean Jaurès.