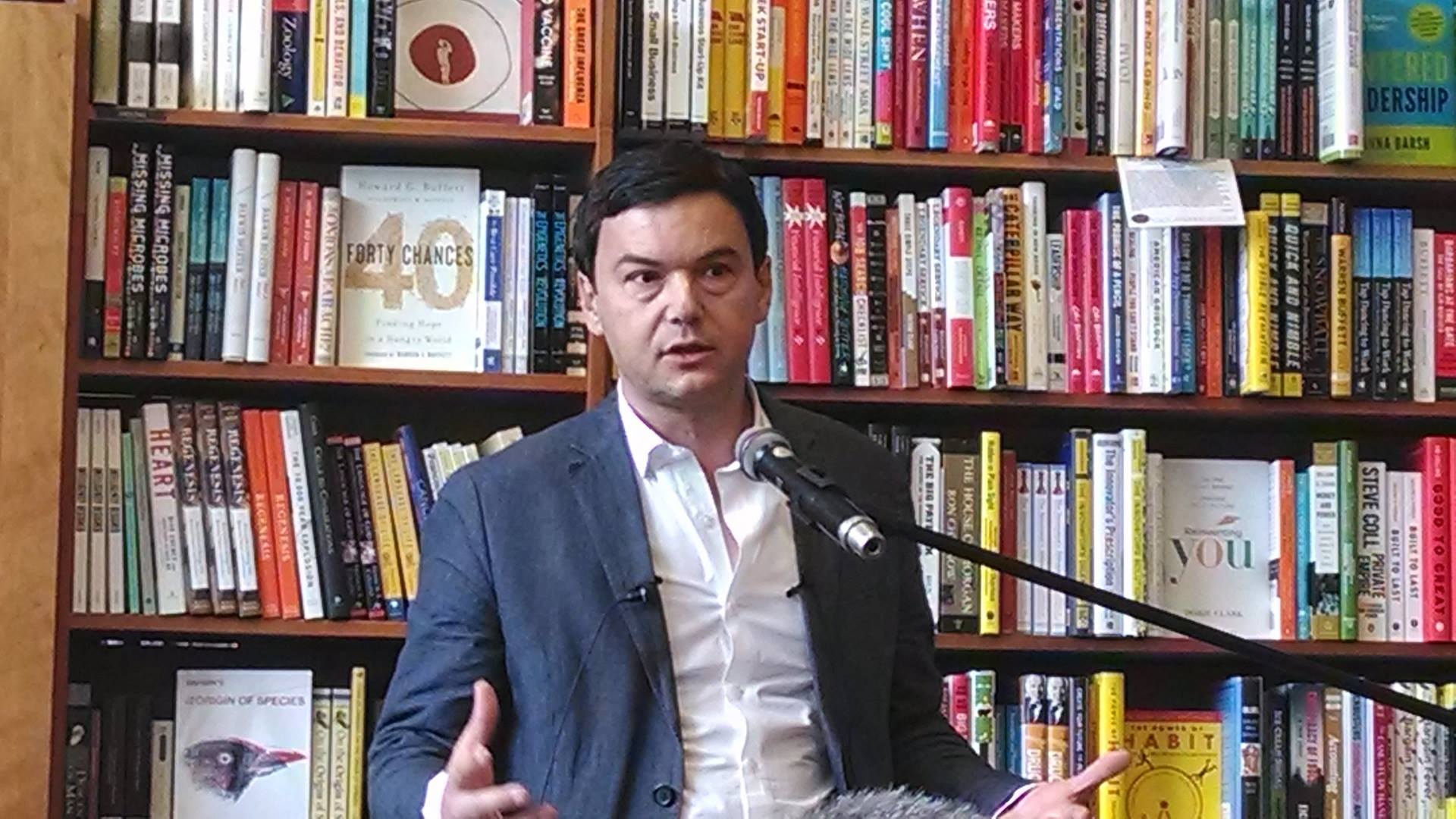Michel Aglietta et Nicolas Leron ont publié en 2017 La double démocratie, qui aborde les impasses de la construction européenne et ses défaillances politiques. Loin d’appréhender l’enjeu dans des termes purement techniques, ils en reviennent à une véritable économie politique européenne. À partir d’une analyse fine des problèmes liés à la zone euro et à l’absence d’une Europe politique, ils formulent des propositions afin de sortir par le haut de cette crise en établissant un système de double démocratie, qui n’irait pas à l’encontre de la souveraineté des États. Deux ans plus tard, et à l’approche des élections européennes, nous avons souhaité les interroger sur la pertinence d’une telle approche, alors que la crise européenne s’approfondit. Entretien réalisé par Lenny Benbara. Retranscrit par Anne Wix.
LVSL : On vient de fêter les vingt ans de la monnaie unique : où en est la zone euro ? Est-ce que le phénomène d’euro-divergence peut la faire imploser ?
Michel Aglietta : Il faut comprendre pourquoi il y a eu euro-divergence et donc en premier lieu comprendre quelles sont les dynamiques des années 1980 qui ont permis de décider de faire l’euro, et l’ambiguïté que cela a entraîné, du point de vue de la France notamment. Ce dont il faut se rappeler des années 1980, c’est qu’il y a un raz-de-marée, une véritable contre-révolution économique par l’arrivée de Thatcher et de Reagan, synonyme d’un néolibéralisme auparavant inconnu, aux États-Unis ou ailleurs. Le libéralisme politique américain observé par Tocqueville n’a rien à voir avec le néolibéralisme qui émerge alors. Il insiste sur les contrepouvoirs de la justice, des médias et de la répartition des responsabilités politiques entre les États fédérés et l’État fédéral. Au contraire, le néolibéralisme a pour caractéristique essentielle d’affirmer que l’État est un obstacle et que c’est le marché financier qui doit diriger l’économie dans son ensemble. Le rôle de l’État se réduit à ses fonctions régaliennes.
Vis-à-vis du néolibéralisme, la France est complètement en porte-à-faux avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir. Tandis que sont menées dans les pays anglo-saxons des politiques économiques restrictives, Mitterrand arrive avec un projet d’industrialisation du pays – que Chevènement lui avait soufflé – conçu sur la base des outils institutionnels dont on disposait, puisqu’on avait tout nationalisé, à la fois le secteur financier et la plupart des grandes entreprises des secteurs industriels. La notion qu’on nous a demandée de développer, à Robert Boyer et moi-même à cette époque, c’est celle de pôle de compétitivité. Le problème du porte-à-faux s’est immédiatement posé : la France a été mise en difficulté au niveau macro-économique par un déficit extérieur considérable et une pression énorme sur la monnaie. Nous étions déjà dans le SME, le système monétaire européen. Le tournant français se situe le 1er mars 1983 – j’étais à cette réunion – quand Mitterrand a convoqué des économistes sur le conseil d’Attali. Que faut-il faire ? Sort-on du SME ? Doit-on y rester ? La décision que Mitterrand a prise fut de rester dans le SME après une dévaluation conséquente puis de changer de politique en s’accrochant au deutschemark. La France est entrée dans la désinflation compétitive dont elle n’est jamais ressortie.
LVSL : Quelle était votre position à ce moment-là ?
MA : Ma position était qu’il fallait dévaluer de manière importante sans sortir du SME mais en prenant une position compétitive forte du fait d’une dévaluation massive. Il fallait surtout poursuivre dans la vision de Chevènement et développer les pôles de compétitivité. Une fois que la décision de suivre le deutschemark a été prise, la France s’est progressivement moulée dans le modèle néolibéral. Il y a eu deux étapes : 1986 avec les premières privatisations et ensuite 1995 avec l’abandon total de la propriété du capital des entreprises que Balladur avait voulu constituer en noyaux durs par les investisseurs institutionnels, c’est-à-dire les compagnies d’assurance essentiellement, de la propriété des grandes entreprises. L’actionnariat s’est rapidement internationalisé avec l’entrée des fonds de pension et des hedge funds anglo-saxons. Nous sommes entrés dans un système anglo-saxon en dix ans.
Sur le plan européen, la relance de l’Europe a suivi l’orientation britannique avec l’Acte unique européen de février 1987, par lequel nous poursuivons l’intégration dans le domaine financier. L’Acte unique est entièrement néolibéral puisque la monnaie est considérée à ce moment-là – c’est là que le groupe Delors est lancé et j’y participe – comme un couronnement de la finance pour pouvoir diminuer les coûts de transaction. C’est la finance qui doit être l’axe directeur de l’Europe à venir.
Arrive le deuxième choc qui est la réunification allemande. Mitterrand veut à tout prix accrocher l’Allemagne à l’Europe par ce qui est essentiel pour les Allemands, c’est-à-dire la monnaie. Kohl est d’accord mais sous la condition que la nouvelle monnaie, l’euro, ait les caractéristiques du deutschemark. Or l’ordolibéralisme germanique est profondément différent du néolibéralisme anglo-saxon. L’ordolibéralisme, développé par l’école de Francfort, est une doctrine qui se méfie énormément de la finance, ne reconnaît pas la notion de processus financier auto équilibrant, ni celle d’efficience financière. L’ordolibéralisme promeut un cadre institutionnel fort et centré sur la monnaie qui permet d’éviter que tout pouvoir arbitraire, notamment un pouvoir financier, ne s’assure une prépondérance politique.
LVSL : Il y a tout de même des points communs avec le constitutionnalisme économique présent chez Hayek…
MA : Sauf que Hayek ne pense pas à des institutions fortes. Il pense que l’ordre social est organiquement engendré par la conscience morale que les membres d’une société ont vis-à-vis du collectif qui les constitue. Bien évidemment il y a une origine autrichienne à cette position, mais essentiellement vis-à-vis de ce qui s’est passé dans les années 1920. Il s’agit de fermer la possibilité du nazisme. Ce n’est pas par hasard que la loi fondamentale allemande ait été créée bien avant la République fédérale. La loi fondamentale a un principe d’éternité dans sa conception de la démocratie qui est institutionnalisé dans le lien social qu’est la monnaie. La monnaie est considérée comme le pivot sur lequel s’établissent des institutions qui permettent d’éviter la prise du pouvoir politique par des entités, disons non libérales ; non démocratiques. La monnaie a besoin d’une légitimité politique. Vous avez donc deux sortes de légitimités qui arrivent en même temps en Europe et qui sont totalement contradictoires : le néolibéralisme et l’ordolibéralisme. Résultat : dès le début de l’euro, il y a divergence puisque la plupart des pays vont se mettre dans la logique de la dynamique néolibérale, dominante à cette époque. Il va donc y avoir dans les pays du Sud, mais aussi en Irlande, une spirale entre le développement de l’endettement privé et la spéculation immobilière qui est complètement contraire avec la position allemande. Et ce développement de l’endettement privé crée la divergence qui n’a jamais cessé malgré les politiques qui ont tenté de la réduire.
Ainsi, la crise de 2010-2012 en Europe n’est que l’accentuation de la crise de 2008. Autant les Américains ont contré la crise par des politiques très fortes, autant l’Europe n’avait pas la possibilité de le faire. La divergence est toujours là et c’est toujours la même logique. Donc, que fait-on ? Quel est véritablement le substrat politique nécessaire pour que l’euro puisse être une monnaie complète ? Est-ce qu’on choisit l’ordolibéralisme ou est-ce qu’on ouvre une autre voie ?
LVSL : Justement, à quel point l’euro-divergence est-elle encore un risque aujourd’hui et est-ce que vous identifiez d’autres risques qui pourraient mettre en cause l’existence même de l’euro ?
MA : L’euro-divergence est présente en Italie et de manière extrêmement forte. Les conditions dans lesquelles l’Espagne et le Portugal en sont sorti, c’est-à-dire par la déflation salariale, ont été des conditions extrêmement traumatisantes pour leurs propres systèmes sociaux.
Nicolas Leron : On a obtenu, du moins pour le temps présent et pour un avenir proche, une forme de stabilisation de la zone euro sur le plan macroéconomique. Elle a cependant eu un coût politique. On voit bien la montée des forces anti-européennes, voire anti-démocratiques actuellement. Elles gagnent du terrain en Europe occidentale.

Tout ne s’explique pas par la crise économique, mais c’est une cause forte de cette avancée des forces populistes au sens large et d’un affaissement des démocraties nationales. Vous parliez d’injecter du politique dans l’économique. Notre démarche, à Michel et moi, est un peu plus fondamentale que cela : il s’agit d’inverser le regard, de qualifier autrement la crise européenne et son point de départ. Nous disons que c’est une crise démocratique qui a des effets macroéconomiques. C’est d’abord une crise du politique, de la puissance publique, qui ensuite a des effets de déstabilisation macroéconomique. Et non l’inverse. Si nous faisons une forme d’analyse du discours, d’explication classique de la crise européenne, le point de départ, dans cet ordre de discours, c’est un problème de stabilisation d’une zone monétaire sous-optimale. Toute la réflexion du système européen consiste à savoir comment nous parvenons à stabiliser cette zone monétaire sous-optimale et le maître mot est stabilité. Selon nous, il faut remplacer l’objectif de stabilité, aussi important soit-il, par un problème de légitimité démocratique comme point de départ. Il faut ensuite aborder la question macroéconomique et les questions de l’investissement, de la stabilisation, etc. Mais le point de départ doit être démocratique. Lorsque l’on part du prisme de la démocratie, on requalifie et relit dans un nouveau sens l’ensemble des éléments connus et des données actuelles.
LVSL : Je voulais revenir sur l’Italie avant de passer à la phase des solutions puisque c’est une donnée fondamentale de ce qui se passe aujourd’hui dans la zone euro. L’Italie était une des trois économies généralistes de la zone, qui a, depuis son entrée dans celle-ci, une croissance quasiment nulle, voire une décroissance du PIB par habitant. Les indicateurs de productivité sont extrêmement préoccupants, le taux de créances pourries reste élevé et on ne sait pas exactement comment elles sont purgées des bilans des banques régionales italiennes. Dernièrement on a assisté à la victoire de la coalition Ligue-M5S qui a présenté un budget en conflit avec les règles – notamment de déficit structurel – défendues par la Commission européenne. Est-ce que vous pensez que la présence de l’Italie dans la zone euro est pérenne en l’état ? Quelle analyse faites-vous de la situation italienne ?
MA : L’Italie est un pays clé. Le système productif italien devait notamment son efficacité jusqu’aux années 1990 à l’ensemble de petites entreprises très dynamiques du Nord du pays. Il avait absolument besoin d’une compétitivité prix, c’est-à-dire qu’il fallait pouvoir systématiquement dévaluer, pour pouvoir tenir suffisamment d’avantages comparatifs pour que ces entreprises continuent à investir. Ces PME fonctionnaient très peu à partir de compétitivité hors prix et elles ont de ce fait été complètement étouffées dès que le pays a appliqué des politiques restrictives pour satisfaire aux critères d’admission dans la future zone euro. Ensuite, l’existence de l’euro ne leur permettait plus de dévaluer. L’Italie est un pays dont le taux de change réel est toujours surévalué. Il faut donc sans arrêt arriver à le compenser par la déflation salariale. Et en même temps, ils n’arrivent pas à avoir les progrès de productivité que seul un changement profond du système productif permettrait. Ce qui n’est pas simple. L’Italie n’a jamais été constituée comme cela. De plus, elle a toujours eu cette opposition Nord-Sud qui n’a jamais été résolue. L’Italie du Nord finançait sans arrêt le Sud. Si on est dans un pays qui est unifié politiquement et que vous avez quasiment deux sociétés dans le même pays, alors il y a des transferts budgétaires permanents. Ces transferts permanents, qui pouvaient aller avec la dynamique de croissance qu’avait l’Italie du Nord, n’ont plus fonctionné à partir de l’entrée en crise. L’antagonisme qui est dans la zone euro est interne à l’Italie. Je crois que c’est vraiment fondamental et comme c’est très structurel, cela se voit à travers la trajectoire de stagnation.
NL : Sur le plan géopolitique intra-européen, l’Italie est too big to fail pour ceux qui défendent la construction européenne et l’euro. Malgré tous ses défauts, Michel et moi sommes en faveur d’un projet européen qui préserve la monnaie unique. Remarquons que pour la Grèce, même s’il y a eu une très grande tentation de l’Allemagne, disons du bloc germanique, de lâcher le pays, il y a eu cet effort politique in extremis qui a été fait pour que la Grèce ne sorte pas de la zone Euro. Nous pouvons donc penser que compte-tenu de la taille systémique de l’Italie sur le plan politique et économique, il en sera de même. Ce qui se joue pour ce pays, notamment dans son rapport aux institutions européennes et avec ses partenaires européens, ressemble à ce qui s’est joué en Grèce. Cela ressemble un peu aussi à ce qui se joue en Hongrie ou en Pologne. À un moment donné, il y a le politique national qui éprouve son rapport de force à l’égard de l’Union européenne et de ses principaux États membres. Au travers de ce geste agonistique, on commence par s’émanciper ou feindre l’émancipation. On est offensif dans le rapport de force. C’est ce qu’a fait Tsipras, c’est ce que fait le gouvernement italien. Ensuite – et jusqu’à présent ça s’est passé ainsi – il y a une forme de rééquilibrage qui est fait des deux côtés. On retrouve un nouveau point d’équilibre, parfois au détriment du gouvernement en question comme en Grèce. Mais ça lui permet de s’assurer une sorte d’assise de légitimation politique nationale, tout en retrouvant un point d’équilibre intra-européen.
MA : Comment est-on citoyen européen finalement ? Qu’est-ce qui fait le lien social ? Ce qui fait le lien social est l’euro. Les citoyens européens de tous les pays disent à toutes les enquêtes « Ce qu’on veut, c’est garder l’euro ». Les gouvernements sont obligés de le prendre en compte quels qu’ils soient. On a vu l’évolution en Grèce. Sortir de l’euro paraissait être une solution pour Varoufakis. Ils ont été obligés de changer de position très rapidement et pas seulement à cause des pressions allemandes. Leurs propres citoyens ne veulent pas sortir de l’euro.
NL : On observe le passage d’un système d’opposition classique, démocratique, entre grandes alternatives de politiques publiques, de projets de société (policies), à un système d’opposition de principe. On est pour ou contre l’Europe. Le clivage politique se reconstruit au niveau du régime politique lui-même (polity). Mais même lorsque l’on arrive à faire prévaloir l’idée que l’on est contre l’Europe au sein d’un pays, on en revient à une donnée constitutive : est-ce que nous voulons vraiment quitter la zone euro ? Est-ce qu’on veut quitter l’Union européenne ? Or on constate que – y compris pour les Grecs qui ont particulièrement souffert du programme d’aide – l’attachement politique à la monnaie unique reste majoritaire. La dimension constitutive d’un destin national reste malgré tout attachée à l’idée européenne. Cela ne veut absolument pas dire que le peuple est satisfait de ce qu’on pourrait appeler « sa condition européenne ». Il y a un attachement qui d’ailleurs est plus fort pour la monnaie que pour l’Union européenne en elle-même. Si le Brexit peut avoir lieu, c’est sans doute parce que le Royaume-Uni n’est pas dans la zone euro.
MA : Ce qu’il faut comprendre c’est que la monnaie incarne le lien social. Ce n’est pas du tout un bien, une chose. Et cela, les citoyens l’ont véritablement incorporé dans leurs comportements.
LVSL : Quelles sont les solutions, comment pourrait s’enclencher un phénomène qui permettrait de compléter la zone euro ? Vous parliez de lien social, mais on voit que ce lien social reste incomplet d’une certaine façon. Quelles sont vos recommandations ?
NL – Avant de parler de recommandations, il faut bien comprendre notre analyse de la crise européenne. Si on qualifie la crise européenne comme une crise de la démocratie, une crise de la puissance publique en premier lieu, alors, la réponse, le grand levier du changement, sera en accord avec cette analyse. Ce que nous essayons de dire avec Michel, dans notre livre La Double démocratie, c’est que l’Europe, qui est d’abord une Europe de la règle, une Europe du marché intérieur, une Europe de la concurrence, vient en fait exercer une pression sur les démocraties nationales et leur pouvoir budgétaire. Il y a une tendance lourde d’affaissement du pouvoir budgétaire des parlements nationaux. Or qu’est-ce que le pouvoir budgétaire des parlements nationaux ? C’est en fait le cœur, la substance de la démocratie. C’est ce qui confère une réalité au pouvoir politique du citoyen via son vote. C’est-à-dire sa capacité d’élire une majorité parlementaire qui mettra en œuvre ses grandes orientations de politique publique grâce à un pouvoir budgétaire. Sous couvert d’une apparence affreusement technique, 90% des enjeux à l’Assemblée nationale se concentrent dans le projet de loi de finances. La démocratie moderne, autant conceptuellement qu’historiquement, se constitue autour du vote du budget, parce que c’est le vote des recettes, c’est-à-dire le vote de la richesse publique que la société se donne à elle-même. Et c’est le vote des dépenses, c’est-à-dire quels types de biens publics la société décide de produire pour elle-même, avec bien sûr des enjeux de répartition. Or nous constatons un affaissement de ce pouvoir budgétaire sur un plan qualitatif comme quantitatif.
D’un point de vue qualitatif, que nous ayons affaire à un gouvernement de gauche ou de droite, nous sommes soumis à une pression systémique qui vise à encourager une politique de l’offre, du fait du marché intérieur et de la concurrence réglementaire intra-européenne. Bien sûr, il y a des différences de méthode. Le redressement dans la justice de François Hollande n’est pas le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, ou encore le transformer pour libérer les énergies d’Emmanuel Macron. Mais structurellement, il existe une pression qui réduit les marges de manœuvre d’orientation des politiques publiques et qui se traduit par une réduction qualitative du pouvoir budgétaire national. Tandis que les règles budgétaires européennes impliquent une réduction quantitative du pouvoir budgétaire national.
Cette perte de pouvoir budgétaire des gouvernements nationaux – et donc du pouvoir politique du citoyen – ne s’accompagne pas de la construction d’un pouvoir budgétaire proprement européen.
La grande difficulté, lorsqu’on aborde la question européenne, c’est de parvenir à désinstitutionnaliser la lecture que nous faisons de l’Union européenne pour accéder à une compréhension substantielle des choses. Si nous regardons formellement ce qu’est l’Union européenne, nous constatons qu’elle est dotée d’un parlement, d’élections, d’un État de droit et d’un système de protection des droits fondamentaux. Tout cela est très précieux et nous pourrions conclure que son fonctionnement est démocratique, voire davantage démocratique que les États membres. Mais ce n’est pas le cas. S’il y a une démocratie institutionnelle et procédurale au niveau européen, fait défaut la substance de la démocratie. Le budget de l’Union européenne est de l’ordre de 1% de son PIB, dont une grande partie est dédiée à des dépenses fléchées de fonctionnement. Si vous rapprochez ce chiffre avec ce que prescrit l’ONU en matière d’aide au développement – 0,7% du PIB -, on voit bien que d’un point de vue substantiel, l’Union européenne ressemble peu ou prou, en termes de puissance de feu, à une super agence de développement sectoriel et territorial. Vous avez des secteurs circonscrits et des territoires – notamment à l’Est où se concentre les fonds de cohésion – qui sont très impactés par l’Union européenne.
Mais l’Union européenne, appréhendée de manière substantielle, n’arrive pas à franchir le seuil de significativité politique. C’est ici que se situe la grande différence lorsque nous abordons la question de la crise européenne depuis le prisme d’une lecture démocratique. Ce qui compte, c’est d’abord la question du budget, de la puissance publique européenne, et par extension, l’absence de cette dernière. Aujourd’hui, nous avons un budget qui est n’a pas la taille critique. L’enjeu primordial n’est pas de se doter d’un budget comme instrument de stabilisation, mais de considérer passer d’un budget technique à un budget proprement politique. Notre thèse est celle de l’institution d’une puissance politique européenne, et donc la création d’une figure charnelle du citoyen européen, ce qui implique que les élections européennes soient le relai d’un véritable pouvoir budgétaire parlementaire européen.
MA : À cette fin, il faudrait donc parvenir à ce que ce budget européen apparaisse au citoyen comme ayant un effet de bien-être supérieur, de manière à changer le régime de croissance en profondeur, en particulier dans le domaine environnemental. Il faut le faire dans des conditions qui paraissent équitables aux différentes couches sociales, à la fois par des investissements qui pensent l’avenir en termes de soutenabilité et qui, dans le même temps, assurent une croissance plus élevée. On ergote sur ce qui se passe actuellement, mais tant que l’Europe en reste à un niveau de 1,2 ou 1,5% de croissance, elle est totalement paralysée. Il faut revenir à l’essentiel : le monde est en train de changer en profondeur, nous sommes à la fin de cette phase bien particulière du capitalisme financiarisé, et c’est le moment ou jamais pour la puissance publique de reprendre la main sur le pouvoir économique. Cela suppose qu’il y ait un budget suffisamment dynamique et ce à deux niveaux. Les biens collectifs sont européens et le deviendront de plus en plus : réseaux, électricité, transports, etc. Les infrastructures tombent en ruine en Allemagne, un pont s’effondre à Gênes : voilà les véritables problèmes. Ces problèmes-là nécessitent une prise en charge par une puissance publique au niveau européen.
NL : C’est en quelque sorte le pendant de ce qu’a fait la BCE pour sauver la zone euro, en s’auto-attribuant une fonction de prêteur en dernier ressort. Par ce geste, elle a renoué le lien organique entre la monnaie et le souverain politique.
LVSL : Mais elle ne fait pas l’objet d’un contrôle. Il n’y a pas de souverain qui contrôle cette banque…
NL : Certes, mais elle a cependant entrepris un geste souverain qui a fait retrouver à la monnaie sa nature politique. Ce qu’il faut réhabiliter par cette puissance publique européenne, c’est la notion d’emprunteur et d’investisseur en dernier ressort. À un certain stade, on ne peut pas compter sur le marché pour répondre à des intérêts de long terme. Il est nécessaire que la puissance publique, par un acte politique, décide de ces grands investissements et de la production massive de biens publics européens.
LVSL : Justement, comment pensez-vous que nous puissions construire ce type de puissance sur un plan purement politique : comment faire en sorte que les pays y arrivent ? Quel serait le montant du budget nécessaire à ce type de préservation des biens collectifs, d’investissement, de changement de régime de croissance européen ?
NL : Ce qu’il faut bien faire comprendre au préalable – et qu’il faut graver dans la tête des dirigeants, des élites, des décideurs et des citoyens européens –, c’est que la vague de fond populiste ne sera pas contrebalancée par la méthode des petits pas. Autrement dit la méthode d’intégration actuelle, où nous essayons de colmater les dysfonctionnements par petits pas, par des déséquilibre fonctionnels constructifs. Cette méthode a constitué un coup de génie dans les années 1950 après l’échec du momentum fédéraliste, mais elle a épuisé aujourd’hui tout son ressort.
MA : Depuis la prise du pouvoir par la finance dans les années 1980, on ne peut plus fonctionner de cette manière. La finance est par nature un facteur de déséquilibre. On ne peut pas considérer la finance comme un secteur comme un autre, alors qu’il possède un impact sur tous les autres secteurs. Si nous raisonnons comme cela, nous nous heurtons à un mur. C’est ce qui s’est produit dès les années 1980 avec les contraintes rencontrées par François Mitterrand. La finance était « son ennemi », mais il ne comprenait pas quelle était la logique profonde qu’elle recouvrait. Dès les années 1980, ce processus ne pouvait plus fonctionner.
NL : Aujourd’hui nous sommes au bout de ce que l’on appelle en sciences politiques le néo-fonctionnalisme, qui sous-tend la méthode d’intégration actuelle. C’est le point de départ de notre essai La Double démocratie : il faut poser un nouvel acte fondateur politique européen. Lequel ? Il y a une manière de penser les choses en matière de souveraineté. C’est l’hypothèse fédéraliste, soit un acte fondateur qui engendrerait un transfert de souveraineté au niveau de l’Union européenne – au fond, le repli souverainiste du Brexit s’inscrit dans cette même logique. Nous pensons que ces deux hypothèses sont les deux faces d’une même pièce, caractérisées par une même obsession sur la souveraineté. La souveraineté appartient aux États-membres, cela n’a pas changé. Nous ne croyons pas beaucoup à l’hypothèse fédéraliste des États-Unis d’Europe.
L’autre levier sur lequel nous voulons travailler consiste à créer un saut de puissance publique. Cela ne passe pas par l’institution d’un État souverain, mais d’une démocratie européenne, donc d’une puissance publique européenne et d’un budget politique européen. C’est ici que nous introduisons la notion de double démocratie, qui s’oppose à celle de souveraineté, qui est une notion une et indivisible d’instance normative de dernier ressort, qui par définition, par géométrie disons, ne peut pas se partager, se décomposer, se fragmenter. S’il y a transfert de souveraineté vers le niveau de l’Union européenne, cela engendrerait une perte sèche de souveraineté pour le niveau national. Ce qui ne saurait être accepté par les peuples européens. En revanche, la démocratie peut effectuer ce saut car elle ne fonctionne pas dans une logique de vases communicants. Elle peut engager une logique de jeu à somme positive. Il peut y avoir une démocratie nationale à côté d’une démocratie locale. La région peut être une entité démocratique parfaitement légitime, sans être une entité souveraine. Nous défendons l’hypothèse d’un système à deux niveaux de puissance publique : la démocratique nationale qui demeure souveraine et une démocratie européenne sans souveraineté, mais réellement puissance publique, capable de produire des politiques publiques européennes décidées par les citoyens européens dans le cadre des élections européennes.
MA : Il y a une contrainte supplémentaire : il faut pouvoir travailler à traités constants. Il est impossible de dire que la révision des traités est la première étape pour réaliser cela. Les forces politiques qui existent en Europe l’empêchent. Il faut donc travailler à traités constants et voir ce que cela permet. Nous pouvons penser par exemple qu’il est nécessaire que le parlement européen vote un budget plus élevé, qui passerait de 1 à 3% du PIB. Mais le parlement européen ne peut pas voter cela, car les traités ne le permettent pas actuellement. Les ressources supplémentaires qui permettraient de développer des dépenses d’investissement en construisant des biens communs européens ne sont pas à disposition, principalement parce qu’on ne peut pas changer les traités.
LVSL : Et donc, comment fait-on ?
MA : Par la notion que nous avons mise en avant : les ressources propres. Dans les ressources du budget européen, la plus grande partie provient de subventions que les pays-membres donnent et qu’ils peuvent retirer, car en réalité, cela reste une attribution souveraine des pays-membres. Une puissance publique européenne ne peut donc se constituer durablement, parce qu’elle peut être à tout moment déstabilisée par les contraintes budgétaires des pays-membres – ne pouvant plus contribuer autant qu’avant au projet européen.
Il y a une ressource qui n’est pas soumise à ces contraintes : les droits de douane. Il faut donc développer d’autres ressources propres pour le budget européen que le Conseil peut accepter en tant que telles parce qu’elles ne violent pas les règles des traités. Elles permettront de développer une politique d’investissement public et d’investissement privé, accompagnées d’une nouvelle forme de croissance.
LVSL : Plus précisément, quel serait le montant de ces budgets pour vous en termes de pourcentage du PIB européen ?
MA : Nous l’estimons, comme Thomas Piketty, à plus ou moins 3% du PIB.
LVSL : Est-il vraiment possible d’imaginer la mise à disposition de centaines de milliards d’euros par le Conseil, alors qu’il peine à s’accorder par exemple sur la question des GAFA ?
MA : Le plus gros problème se situe au niveau de l’harmonisation fiscale. Nous avons évoqué l’ordolibéralisme allemand, mais les Pays-Bas constituent en Europe un obstacle plus grand encore, parce que c’est là-bas que les GAFA se trouvent. C’est là aussi que Ghosn a installé Nissan et Renault. Les Pays-Bas constituent en Europe le cœur du néolibéralisme. L’opposition qui existe en Europe entre les différentes souverainetés nationales s’inscrit ici. Il faudrait bien entendu parvenir à se rapprocher pour résoudre le problème des GAFA. Une harmonisation fiscale est indispensable. Comme cette harmonisation fiscale ne peut pas être mise en place telle quelle au départ, on a cherché des ressources qui sont plus facilement accessibles : d’où la mise en place d’une TVA européenne, d’une taxe carbone européenne, etc. C’est ici que réside le problème d’une ressource qui est liée à l’intégration des marchés de capitaux. Les conséquences de la polarisation et de la crise qui en a résulté, c’est qu’il n’y a plus d’intégration financière en Europe. Les banques ne prêtent plus qu’au niveau national. Pour remettre en marche cette intégration financière, il faudrait des ressources fiscales qui lui soient liées. Nous avons indiqué la liste des ressources nécessaires qui permettraient de monter à 3,5% du PIB.
NL : Lorsque nous en arrivons à cette dimension constitutive du politique en Europe, nous redécouvrons que l’Europe constitue fondamentalement un enjeu géopolitique intra-européen. Nous retombons sur de grandes logiques de compromis historique entre les puissances du continent, d’abord entre la France et l’Allemagne, et il faut commencer par convaincre l’Allemagne. Nous constatons, même lorsque nous avons un nouveau président fraîchement élu, qui met sur la table un volontarisme européen quasiment inédit, que les propositions françaises se font absorber, amortir par une forme d’immobilisme extrêmement enraciné propre à l’Allemagne, au gouvernement d’Angela Merkel. On l’a vu au sommet de Meseberg : Emmanuel Macron a fait tout son possible pour concrétiser l’idée d’un budget de la zone euro, sans succès significatif.
Comment convaincre l’Allemagne ? Car là est bien le défi premier. C’est au fond ce à quoi nous essayons de contribuer avec notre livre : il faut d’abord produire un nouveau paradigme d’appréhension de l’intégration européenne et de la crise actuelle, pour ensuite entrer dans le débat public allemand – intellectuel et politique – pour en modifier la configuration. À notre sens, le principal changement à opérer est de sortir d’une logique de la raison économique où les Français diraient aux Allemands : « Nos déficits sont vos excédents, donc il est normal que vous dépensiez plus », et où les Allemands répondraient : « Vous n’avez qu’à faire comme nous, nous partageons nos excédents avec le reste du monde ». C’est ce que nous observons jusqu’à présent et ça ne marche pas.
Si, en revanche, nous reconfigurons la discussion en termes démocratiques, mettant en avant le fait que l’enjeu n’est pas macroéconomique mais en premier lieu démocratique, nous arriverons peut-être à pénétrer davantage le débat public allemand, d’autant plus si l’on utilise leur propre conception de la démocratie, notamment celle développée par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans une sorte de jujitsu intellectuel. Car le point d’impossibilité à faire tomber est le kein Transfertunion. Il faut marteler à nos amis Allemands que celle-ci existe déjà : c’est le marché intérieur – et qu’ils en tirent grands profits. Mais cette union de transferts est centripète, mue par une dynamique d’agrégation des richesses vers un centre selon une logique de concurrence des intérêts privés. Elle ne peut se suffire à elle-même. Il faut nécessairement une contre-union de transfert mue par une dynamique centrifuge de distribution des richesses du centre vers la périphérie selon une logique de lutte pour la définition de l’intérêt général. L’existence même du marché intérieur produit une richesse qui génère des profits pour les grandes entreprises européennes. Il est normal, logique, sur un plan démocratique, de fiscaliser une partie de ces richesses produites aux fins de produire les biens publics nécessaires à la viabilité de l’ensemble.
MA : La solution n’est possible que si une dimension de long terme est remise au premier plan en Europe. La stabilisation concerne des mécanismes assez faciles à mettre en place. La question majeure, c’est la croissance potentielle. L’Europe s’affaiblit systématiquement au niveau mondial et la géopolitique aussi intervient, c’est-à-dire que l’Europe a besoin d’exister politiquement vis-à-vis du reste du monde.
LVSL : En général, les corps politiques se constituent en référence à un ennemi commun. Pour les nationalistes, il s’agit des immigrés. Pour une partie de l’establishment européen, il s’agit de la Russie. Pour les forces populistes de gauche, il s’agit des oligarchies européennes. Mais on assiste à l’émergence très rapide de la Chine qui arrive en Europe avec son projet géant de nouvelle route de la soie. Pensez-vous que celle-ci puisse constituer une menace suffisante pour obliger le continent à mettre en place des formes de solidarité et un protectionnisme européen ?
NL : L’Europe est avant tout un projet géopolitique. Ne perdons jamais cela de vue. C’est un projet géopolitique à la fois intra-européen et qui s’inscrit dans la donne mondiale. Il est symptomatique qu’Emmanuel Macron construit son discours européen autour de la notion de souveraineté européenne (pour une analyse critique, voir ma tribune publiée sur Telos : « Critique du discours européen d’Emmanuel Macron »), qui en fait envoie à l’idée d’autonomie stratégique. On voit bien qu’aujourd’hui la justification de la paix continentale se voit substituée par une justification par l’affirmation et la défense des intérêts et des valeurs de l’Europe dans le nouvel ordre mondial sino-américain, où l’hégémonie des valeurs occidentales n’a plus cours. C’est l’ensemble de l’infrastructure institutionnelle internationale, qui reposait sur l’implicite d’une domination du modèle de la démocratie libérale en expansion continue, qui se voit remis en question. Et l’Europe doit donc se repositionner. Mais la grande difficulté de cette justification par l’extérieur du projet européen est qu’elle fait l’impasse sur la justification par l’intérieur de l’Europe politique. Plus fondamentalement, une telle justification par l’extérieur renvoie implicitement à la logique d’alliance intra-européenne pour mieux se positionner dans le nouvel ordre mondial. Elle tend à refouler la question primordiale de la dimension constitutive du politique européen, du faire-société.
LSVL : Il nous semble cependant que, loin de converger, on assiste à une divergence politique croissante en Europe. L’Allemagne ne veut pas entendre parler d’union de transfert, régulièrement agitée comme un épouvantail dans la presse allemande. Les pays d’Europe de l’Est ont opéré un tournant illibéral. Le Royaume-Uni s’en va… Au-delà du plan écrit sur le papier, comment un gouvernement peut-il agir avec autant d’obstacles ?
NL : D’où la nécessité d’acter la fin de la méthode des petits pas, cette logique néo fonctionnaliste de l’intégration et de poser un nouvel acte politique européen fondateur, comme le furent la création du marché commun et de la monnaie unique. Seul un saut politique substantiel modifiant la configuration fondamentale du système juridico-politique européen sera en mesure d’inverser la dynamique de politisation négative qui affecte l’ensemble des démocraties nationales en Europe. Pour ce faire, il faut se resituer dans le temps historique, celui qui permet les grands compromis géopolitiques intra-européens. Ce n’est que de la sorte qu’on amènera l’Allemagne à lâcher le kein Uniontransfert, comme elle fut capable de lâcher le deutschemark. Cela suppose que la France arrête son argumentation macroéconomique pour enfin entrer véritablement dans une discussion politique.
LVSL : Le problème n’est-il pas que la zone euro et l’Union européenne se sont construites sur un modèle plus proche du Saint-Empire romain germanique que sur celui d’une res publica jacobine Une et indivisible ? La conception politique de l’Europe que vous proposez est très française. Les conceptions ordolibérales de la démocratie et les conceptions illibérales, qui ont le vent en poupe en Europe de l’Est, semblent peu compatibles avec ce que vous proposez, comme on va probablement le voir aux prochaines élections européennes…
NL : L’Union européenne et la zone euro ne trouvent pas vraiment d’équivalent dans l’histoire continentale et, au fond, mieux vaut ne pas s’épuiser à retrouver un précédent historique qui serait capable, croit-on, d’assoir la légitimité d’une Europe politique à venir. Ce que les Européens entreprennent depuis les années 1950 est foncièrement inédit. Il s’agit d’inventer une nouvelle forme politique qui dépasse l’État souverain tout en le préservant. Je ne sais pas si notre modèle de la double démocratie européenne est d’inspiration très française. À vrai dire, je ne le crois pas. Quelque part, elle s’appuie très fortement sur la théorie de la démocratie développée par la Cour constitutionnelle allemande. L’hypothèse de la double démocratie européenne s’écarte du modèle supranational fédéraliste mais également du modèle de la coordination fonctionnaliste horizontale, le fameux gouvernement économique qu’appellent de leurs vœux depuis deux décennies les élites françaises











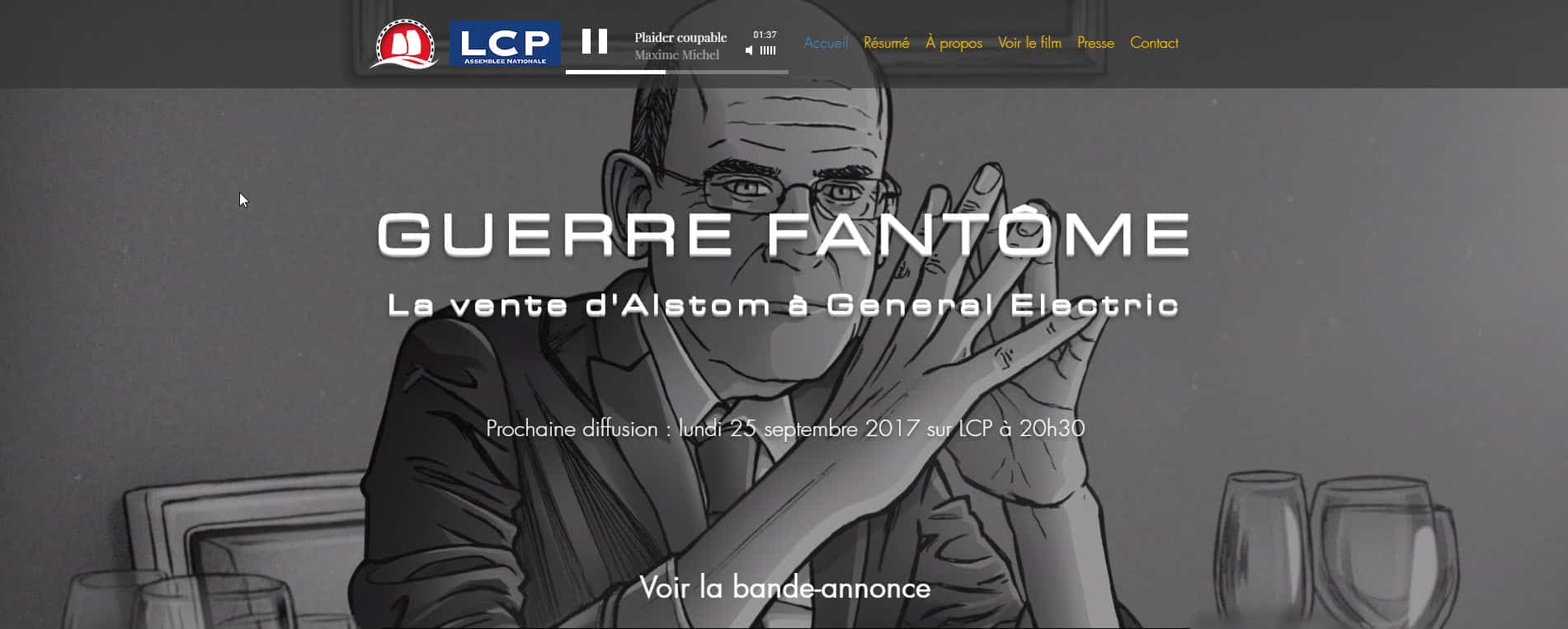






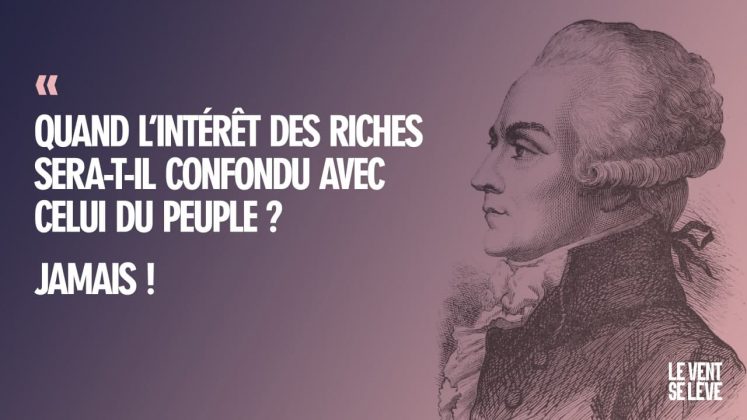

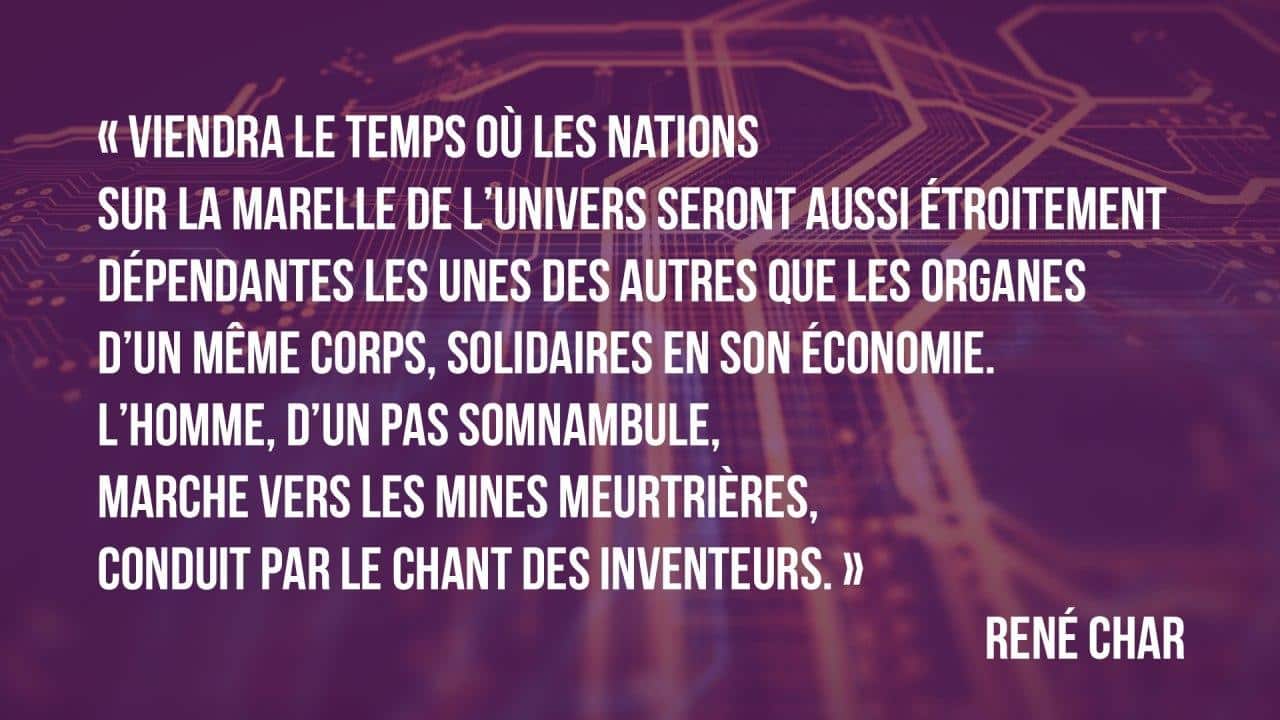








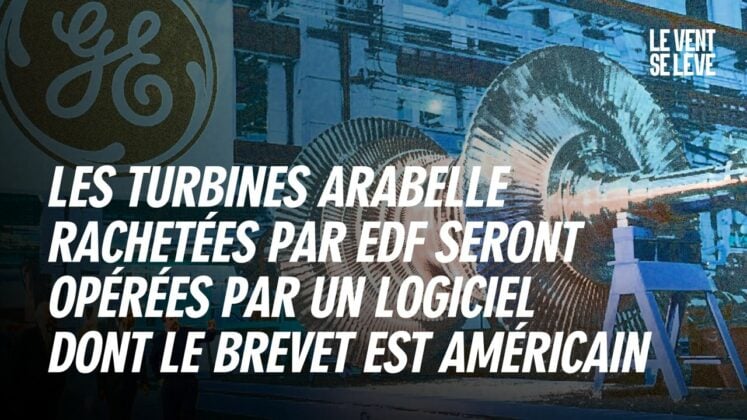













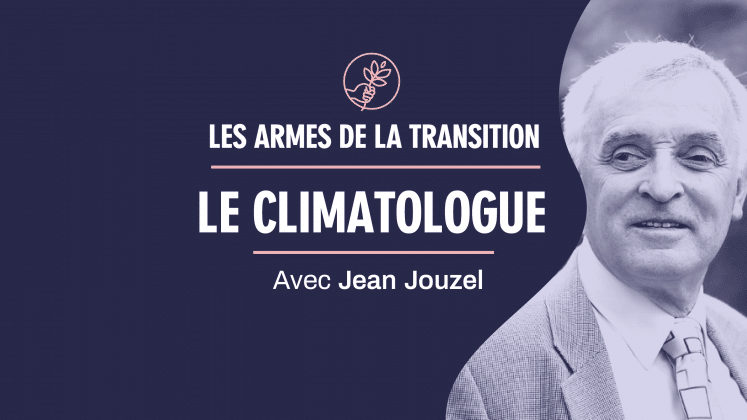
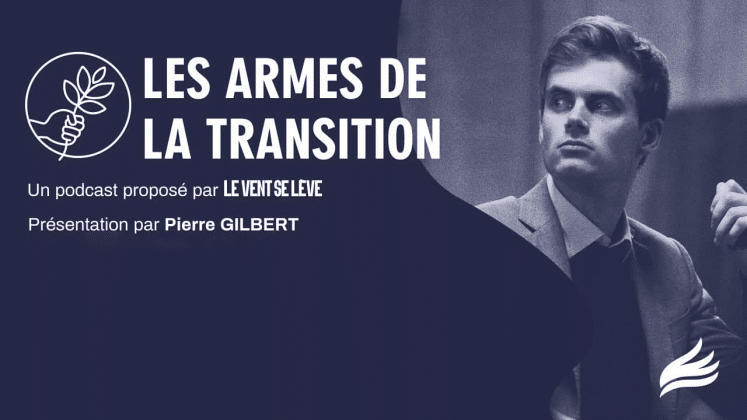
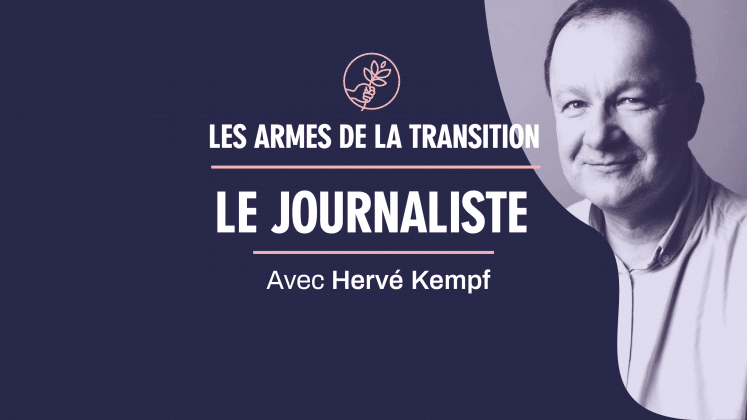

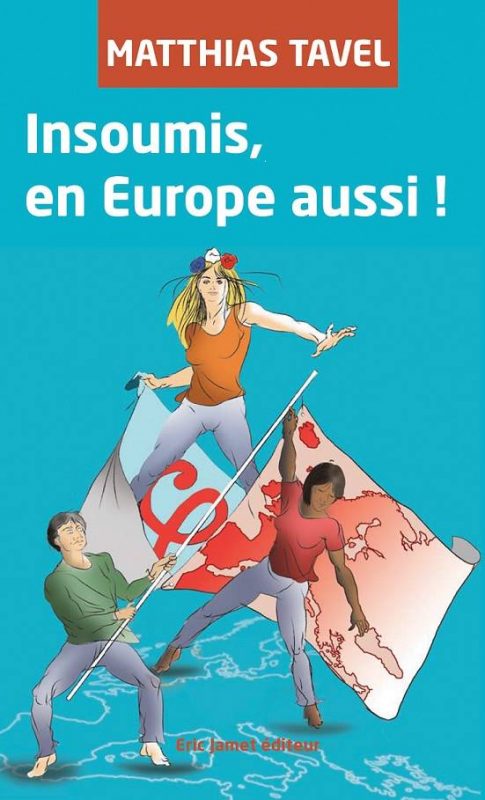 LVSL – Comment est-il possible de rompre avec cette Europe allemande ? Jusqu’où faut-il aller dans le rapport de force ? Dans votre livre, on peut lire un chapitre intitulé “soumettre l’euro ou le quitter”. Pouvez-vous nous en dire plus ?
LVSL – Comment est-il possible de rompre avec cette Europe allemande ? Jusqu’où faut-il aller dans le rapport de force ? Dans votre livre, on peut lire un chapitre intitulé “soumettre l’euro ou le quitter”. Pouvez-vous nous en dire plus ?