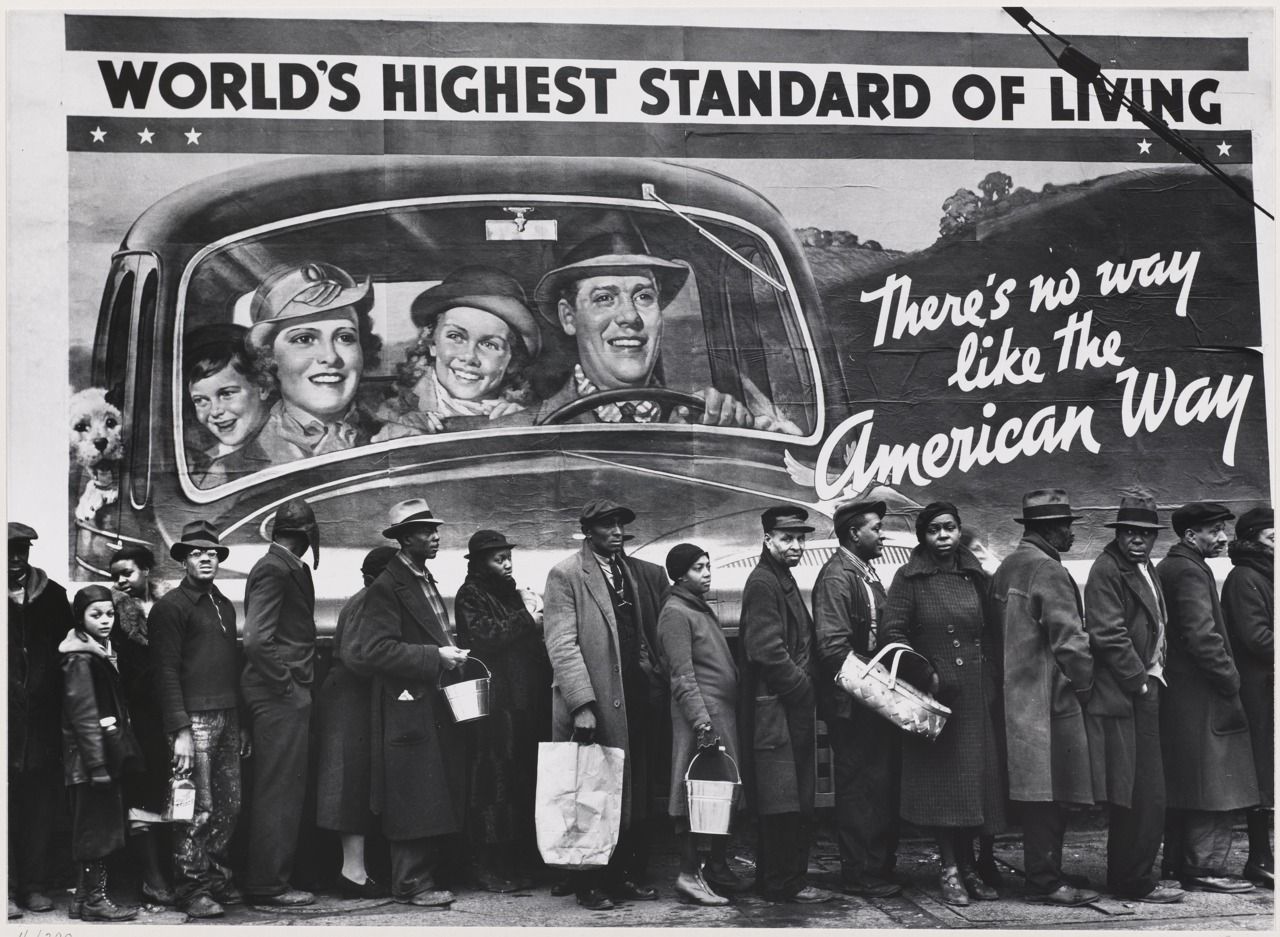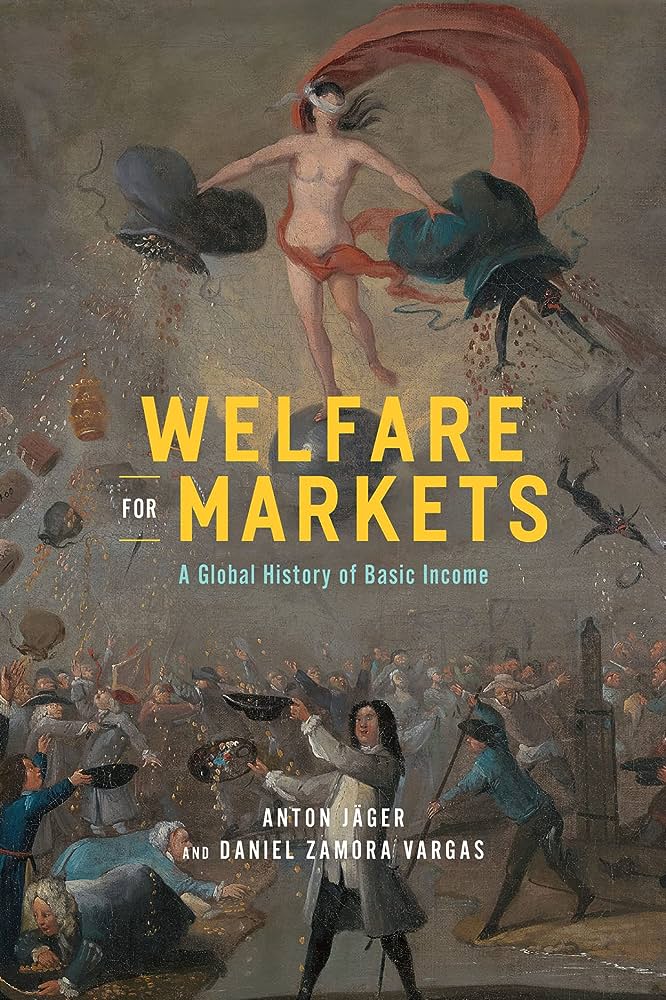L’émergence d’IA génératives capables de créer un texte, une image ou un son à partir d’une simple requête a bousculé le monde de la culture. Elle a suscité beaucoup de réactions, dont la majorité est empreinte de fantasmes, de colère ou de confusion, certains déclarant même imminente la mort de l’art. À rebours de ce récit alarmiste, il est possible de défendre l’idée que les IA génératives participeraient à un véritable renouveau de la culture populaire, à condition de lutter contre leur appropriation par les industries culturelles ou l’industrie de la tech.
L’inquiétude des artistes face à l’IA
Vent de panique international dans le monde de la culture : de nombreux artistes et organisations prennent publiquement position contre les intelligences artificielles dites « génératives » (abrégé GenIA), des nouvelles technologies qui permettent de composer textes, images ou audio grâce à une simple requête formulée en langage naturel [1].
Certains craignent d’être mis de côté par les industries culturelles et de perdre leur emploi, remplacés par des machines. C’est notamment l’un des objets d’une grève exceptionnelle qui a bloqué pendant plusieurs mois l’industrie du cinéma américain. Deux importants syndicats, la SAG-AFTRA (guilde des acteurs) et la WGA (guilde des scénaristes) se sont battus pour obtenir des studios une plus grande sécurité de l’emploi face à la menace grandissante de l’IA qui pourrait, dans un futur très proche, écrire ou mettre en scène des acteurs fictifs pour un prix dérisoire. Les grévistes ont reçu le soutien de nombreuses superstars hollywoodiennes, dont Meryl Streep et Leonardo DiCaprio [2].
D’autres s’indignent de ce que l’activiste et écrivaine Naomi Klein qualifie du « vol le plus important de l’histoire de l’humanité » [3] : l’utilisation par les entreprises d’IA de milliards d’œuvres, sans rétribution ni consentement de leurs auteurs. Les bots de ces entreprises arpentent Internet pour amasser images et textes, les utilisent comme matière brute afin d’entraîner leurs applications de GenIA [4], qui requièrent d’immenses quantités d’exemples pour apprendre à créer à leur tour. Les artistes Kelly McKernan, Sarah Andersen et Kayla Ortiz ont par ailleurs lancé une action légale contre Stability IA, Midjourney et DeviantArt pour violation du droit d’auteur.
Enfin, pour les plus pessimistes, la fin de l’art est proche, provoquée par le « grand remplacement » des artistes par les robots [5], la confiscation de la création par les machines. « Art is dead, dude. It’s over. A.I. won. Humans lost. » [L’art est mort, mec. C’est fini. L’IA a gagné. Les humains ont perdu 6], déclarait en 2022 au New York Times l’artiste Jason Allen, l’un des premiers à avoir remporté un prix d’art avec une image générée par IA.
Il est clair que les GenIA sont de nouvelles forces productives et que leur émergence pourrait transformer radicalement la production d’œuvres d’art.
Il est clair que les GenIA sont de nouvelles forces productives et que leur émergence pourrait transformer radicalement la production d’œuvres d’art, conduisant ainsi à modifier durablement les industries culturelles, le rôle social de l’artiste et les rapports de force dans la chaîne de production artistique. Toutefois, le monde de la culture et ses industries ne sont pas étrangers aux bouleversements liés à l’introduction de nouvelles technologies. Un cas présentant des similitudes avec l’émergence des GenIA est l’introduction d’outils numériques dans la production musicale à partir des années 1980. Ce qu’il s’est alors joué entre les artistes, le public, l’industrie musicale et l’industrie de la tech nous offre un cas d’étude pour analyser les transformations du présent.
En effet, avant les années 1980, produire un disque était cher et nécessitait des investissements conséquents. L’introduction, entre les années 1980 et 2010, d’outils numériques de conception musicale, ont entraîné une baisse drastique du prix de réalisation des albums. Cette tendance connut son point d’orgue avec l’arrivée de logiciels appelés « Digital Audio Workstations »(DAW) qui incluent le studio d’enregistrement dans son entièreté, instruments de musique compris. Un grand nombre de musiciens, amateurs et professionnels, ont alors pu produire des enregistrements de qualité depuis chez eux. Cette démocratisation de l’accès aux outils de production a entraîné une véritable révolution Do it yourself (DIY) dans le monde de la musique [7]. Elle a déstabilisé l’industrie musicale pendant des décennies : les studios d’enregistrement ont perdu leur place privilégiée dans le processus de production des disques, entraînant une crise dans le secteur suivie d’une dégradation des conditions de travail pour les ingénieurs du son, moins payés et contraints de faire plus d’heures pour des studios fragilisés [8]. Si l’industrie s’est restructurée autour du marketing et de la publicité, la création musicale s’est en revanche durablement décentralisée.
Le fantasme de la fin de l’art
Pour en revenir aux GenIA, penser qu’elles provoqueraient la fin de l’art est un fantasme. L’art est une forme d’expression entre des êtres doués de conscience. Les systèmes de GenIA n’ont pas de libre arbitre, contrairement à ce que le mot « intelligence » dans leur nom suggère. Ils ne sont qu’une série de nouveaux outils, à disposition de l’artiste pour exprimer ses intentions.
Le photographe Boris Eldagsen, qui a fait scandale en remportant cette année le prestigieux prix Sony World Photography Awards avec une image générée par IA, décrit ainsi son travail : «[c’est] une interaction complexe […] qui puise dans la richesse de [mes] connaissances en photographie […] [Travailler avec l’IA] ça n’est pas juste appuyer sur un bouton – et c’est fini. Il s’agit d’explorer la complexité du processus, en commençant par affiner des prompts, puis en développant un workflow complexe, et mélangeant des plateformes et des techniques variées. Plus vous créez un tel workflow et définissez des paramètres, plus votre apport créatif devient déterminant » [9]. Un journaliste du magazine WIRED, quant à lui, explique qu’il n’est « pas rare pour une image marquante de nécessiter 50 étapes » [10].

La photographie primée de Boris Eldagsen, conçue avec l’aide d’une IA.
Pas la fin de l’art donc, mais peut-être une nouvelle révolution Do it yourself (DIY) qui affecterait cette fois-ci tous les champs de la création culturelle. Le fondateur de l’entreprise qui distribue le DAW FruityLoops explique le succès de ce logiciel par le fait qu’un utilisateur peut être « opérationnel en quelques secondes » et qu’il est « presque impossible de créer quelque chose qui ne sonne pas » [11]. Les GenIA sont également des outils d’une incroyable accessibilité. Elles permettent à n’importe qui de créer des œuvres d’art, sans avoir à posséder toute une infrastructure de production, sans avoir les compétences techniques pour l’opérer, sans même avoir de compétences artistiques. De plus, il suffit pour les utiliser de posséder un simple téléphone ou ordinateur [12].
C’est précisément dans les champs artistiques qui requièrent des infrastructures de production très lourdes et des budgets conséquents, comme le cinéma et le jeu vidéo, que le changement pourrait être le plus profond. Des startups imaginent déjà comment les GenIA pourraient radicalement démocratiser la production de films en automatisant certaines opérations très coûteuses, et en permettant de tester rapidement différents choix artistiques [13]. En réduisant drastiquement le coût d’entrée dans l’industrie du cinéma, les GenIA pourraient permettre l’émergence de nombreux studios indépendants. À terme, elles pourraient même permettre à des amateurs de produire des films entiers, avec acteurs, décors, mouvements de caméras et effets spéciaux, seuls et depuis leur chambre.
Le potentiel radical des GenIA
Les GenIA, tout comme les DAW, permettent en réalité la numérisation d’une partie des compétences du monde de la culture, sous la forme de machines immatérielles qui peuvent produire plus rapidement, en quantité infinie et pour un coût bien moindre [14]. C’est une nouvelle occurrence de l’automatisation de la production industrielle, un phénomène ancien et intrinsèque au capitalisme qui a déjà touché de nombreux autres secteurs de l’économie. Marx, dans son Fragment sur les machines, décrivait en 1857 comment la quête incessante de productivité menait logiquement à la conception de machines qui intègrent le savoir-faire des travailleurs afin de déplacer ces derniers en périphérie du processus de production, remplaçant ainsi le travail par le capital.
À l’aune de la révolution du numérique, cette théorie a connu un regain d’intérêt grâce à des intellectuels comme Mark Fisher, Jeremy Rifkin, ou encore Paul Mason. Ces derniers postulent généralement que le chômage systémique et la surabondance des biens pourraient créer les conditions d’une émancipation du capitalisme, à condition de découpler le salaire du travail et de transformer les rapports de propriété [15]. En appliquant cette théorie au domaine de la culture, on peut envisager que les GenIA soient en réalité porteuses d’un potentiel radical : celui d’extraire la production culturelle des relations d’échange capitalistes. La posture à adopter face à ces nouvelles technologies serait alors de prendre une part active dans leur développement, afin de s’assurer qu’elles deviennent un bien commun, et profitent ainsi à l’ensemble de la société et non aux seules industries.
On peut envisager que les GenIA soient en réalité porteuses d’un potentiel radical : celui d’extraire la production culturelle des relations d’échange capitalistes.
C’est d’ailleurs le projet de fondations telles qu’EleutherAI ou Mozilla.ai qui développent des GenIA libres, c’est-à-dire qui puissent être inspectées, utilisées, modifiées et redistribuées gratuitement et par n’importe qui. Mozilla, la fondation derrière Firefox, a ainsi annoncé sur son blog la création de Mozilla.ai en début 2023 en déclarant : « Nous croyons que [les gens qui désirent faire les choses autrement], s’ils travaillent collectivement, peuvent créer un écosystème d’IA indépendant,décentralisé et fiable – véritable contrepoids au statu quo [des géants de la tech] » [16].
Cependant, ce potentiel révolutionnaire doit être considéré avec prudence : toutes les GenIA disponibles, y compris certaines présentées comme « libres », restent sous le contrôle d’entreprises telles que Facebook, Microsoft ou Google [17]. Le danger d’un récit qui présente les GenIA comme « outils révolutionnaires capables de démocratiser la création » est qu’il renforce l’image de « disrupteurs bienveillants » dont se parent les géants de la tech. Ces derniers ont une longue histoire d’appropriation des utopies imaginées par les pionniers de la contre-culture du numérique. Paul Mason, cité plus haut, était par exemple invité aux bureaux de Google à Londres en 2015 pour une présentation publique de son livre PostCapitalism, ensuite diffusée sur la chaîne YouTube « Talks at Google ».
Les déclarations de mission de ces entreprises sont, en outre, révélatrices d’une stratégie de communication consistant à faire croire au grand public qu’elles sont une force émancipatrice pour l’humanité. Ainsi, Meta (maison mère de Facebook) déclare sur son site web que sa mission est de « donner à chacun et chacune la possibilité de construire une communauté et de rapprocher le monde ». De son côté, au cours des années 2000, Google clamait son slogan « Don’t be evil », tout en développant une gigantesque entreprise d’extraction de données privées. Une analyse poussée des GenIA ne peut faire l’économie d’une distinction entre ce qui relève d’un véritable projet révolutionnaire et d’une stratégie publicitaire.
Une lutte de pouvoir, qui s’empare des GenIA ?
S‘il est vrai que les technologies ont le pouvoir de transformer la société, la société imprime réciproquement ses relations de domination et ses valeurs sur les technologies. Le débat sur l’impact des GenIA fait souvent l’impasse sur cette réciproque, en n’étudiant ni les acteurs qui dominent le présent ni les rapports de force économiques, sociaux et politiques qui le traversent. Pour saisir dans leur entièreté les enjeux liés aux GenIA, il faut donc interroger les positions des industries culturelles, de l’industrie de la tech et des artistes vis-à-vis de ces nouvelles technologies.
Le business model des géants de la tech consiste à capter l’attention du public afin de la vendre sous forme d’emplacements publicitaires ultra-ciblés [18]. Dans ces conditions, même si les GenIA provoquaient une explosion de productions indépendantes, sous le régime des géants de la tech ces productions seraient oblitérées par celles d’industries culturelles qui bénéficient d’importants budgets leur permettant d’acheter l’attention du public. C’est ce que le précédent de l’industrie musicale semble indiquer.
S‘il est vrai que les technologies ont le pouvoir de transformer la société, la société imprime réciproquement ses relations de domination et ses valeurs sur les technologies.
En démocratisant la production d’œuvres, les GenIA nous feront probablement entrer dans une nouvelle ère de créativité. Si dans le même temps, la société pouvait se libérer des réseaux sociaux publicitaires et de leur logique de compétition pour la visibilité [19], un nouveau rôle pourrait émerger pour les artistes. Puisque le nombre d’œuvres de qualité équivalente créées grâce aux GenIA serait infini, aucun créateur ne pourrait se démarquer. Il ne s’agirait donc plus de créer, pour être célèbre, vu, lu ou entendu par le plus grand nombre. Il s’agirait avant tout de créer pour sa communauté ou pour son plaisir personnel. Ce pourrait être le début d’une réappropriation de la culture comme instrument de structuration du collectif au lieu d’être, comme elle l’est souvent aujourd’hui, le résultat d’une compétition féroce dans un marché mondial de l’attention qui vante le génie et le mérite individuel.
Comme le remarque David Holz, le créateur de l’application de génération d’images Midjourney, cette vision est déjà partiellement en train de se réaliser. D’après lui, « une immense portion de l’usage [de Midjourney] consiste essentiellement en de l’art-thérapie » [20]. De nombreux utilisateurs se servent de la plateforme à des fins de divertissement comme on peindrait en amateur pendant son temps libre. D’autres s’en servent pour créer des images à usage personnel permettant de matérialiser une pensée profonde, un rêve ou un questionnement, et fonctionnant ainsi comme une forme de soin. Un journaliste rapporte, par exemple, avoir vu des images générées pour représenter le « paradis des animaux », en réponse à la mort d’un animal domestique [21].
Les industries culturelles, quant à elles, s’accrochent à leurs parts de marché, souvent soutenus par les artistes eux-mêmes. L’arrivée des GenIA a ainsi démarré un nouveau mouvement pour la défense des « droits d’auteurs » [22], un outil légal dont le nom suggère qu’il a été inventé dans un esprit de protection des créateurs, attirant donc une sympathie immédiate pour ce qui apparaît comme un instrument au service de la culture. La réalité est en fait à nuancer, les droits d’auteur ont permis, dès le XVIIIe siècle, à de riches éditeurs de l’industrie du livre de criminaliser l’impression de copies moins chères par des maisons d’édition plus petites [23]. Ils sont aussi régulièrement utilisés pour attaquer des organisations qui œuvrent pour la préservation et la dissémination de la culture, comme aux États-Unis, où l’industrie du livre attaque des bibliothèques en justice pour tenter de les empêcher de prêter des copies de livres numériques [24] ; ou encore par l’industrie du disque, pour stopper l’effort de l’ONG The Internet Archive d’archiver des disques 78 tours du début du XXe siècle qui sont autrement voués à disparaître [25].
Produire de l’art est aujourd’hui encore un privilège. Les artistes professionnels sont en écrasante majorité issus des classes supérieures qui seules possèdent un capital culturel, social et économique suffisant pour soutenir la précarité choisie de la vie d’artiste [26]. Les GenIA ont la capacité de décentraliser les outils de production artistique, permettant à chacun de raconter son histoire et de construire une grammaire artistique originale, moins dépendante des usages et des cahiers des charges des industries. Elles portent en elles la possibilité de faire passer notre société d’un modèle de culture commodifiée et verticale, dans lequel artistes et industries culturelles produisent des récits que le public consomme passivement, à un modèle horizontal, plus égalitaire, et dans lequel la frontière entre artiste et public serait devenue plus poreuse.
Le penseur et activiste Noam Chomsky affirmait dans un entretien en 2003 : « un marteau peut être utilisé [pour torturer quelqu’un] mais le [même] marteau peut être aussi utilisé pour construire des maisons » [27]. À contre-courant des oracles catastrophistes sur l’émergence des GenIA – « explosion de fake news », « chômage des artistes », « piratage des œuvres »– il n’est pas inutile de défendre une position moins tranchée, à condition de mener de nouveaux combats et d’en réinvestir d’anciens, pour l’implémentation de GenIA libres et gérées comme des communs, pour la liberté de la culture et pour la liberté des moyens de communication qui permettent de la partager.
Références
[1] Exemples de ces outils : Midjourney ou ChatGPT.
[2] Gbadamassi, Falila. “Meryl Streep, George Clooney et Leonardo DiCaprio : Les superstars ne sont pas sur les piquets de grève à Holliwood” Franceinfo, 4 août 2023, www.francetvinfo.fr/culture/cinema/meryl-streep-george-clooney-et-leonardo-dicaprio-les-superstars-ne-sont-pas-sur-les-piquets-de-greve-a-hollywood-mais-mettent-la-main-a-la-poche_5982314.html.
Avec Agences, Franceinfo Culture. “Hollywood : manifestation de stars qui soutiennent la grève des acteurs sur Times Square à New York.” Franceinfo, 26 juillet 2023, www.francetvinfo.fr/culture/cinema/hollywood-manifestation-de-stars-qui-soutiennent-la-greve-des-acteurs-sur-times-square-a-new-york_5972342.html.
[3] Klein, Naomi. “AI Machines Aren’t ‘Hallucinating’. But Their Makers Are.” The Guardian, 21 Aug. 2023, www.theguardian.com/commentisfree/2023/may/08/ai-machines-hallucinating-naomi-klein.
[4] Ces applications sont constituées de plusieurs parties qui jouent des rôles différents : le code informatique, les données, les modèles … Tout au long de cet article nous utiliserons néanmoins le terme « GenIA » pour qualifier l‘ensemble de ces parties.
[5] Guerrin, Michel. “« Avec l’intelligence artificielle, la peur du grand remplacement agite la musique et les arts visuels ».” Le Monde, 21 avril 2023, www.lemonde.fr/idees/article/2023/04/21/avec-l-intelligence-artificielle-la-peur-du-grand-remplacement-agite-la-musique-et-les-arts-visuels_6170394_3232.html.
[6] Roose, Kevin. “AI-Generated Art Won a Prize. Artists Aren’t Happy.” The New York Times, 2 Sept. 2022, www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html.
[7] Prior, Nick. “New Amateurs Revisited.” Routledge Handbook of Cultural Sociology, 2018, https://doi.org/10.4324/9781315267784-37.
[8] Leyshon, Andrew. “The Software Slump?: Digital Music, the Democratisation of Technology, and the Decline of the Recording Studio Sector Within the Musical Economy.” Environment and Planning A, vol. 41, no. 6, SAGE Publishing, June 2009, pp. 1309–31. https://doi.org/10.1068/a40352.
[9] Boris, and Boris. “Sony World Photography Awards 2023 | Boris Eldagsen.” Boris Eldagsen, Apr. 2023, www.eldagsen.com/sony-world-photography-awards-2023.
[10] Kelly, Kevin. “What AI-Generated Art Really Means for Human Creativity.” WIRED, 17 Nov. 2022, www.wired.com/story/picture-limitless-creativity-ai-image-generators.
[11] Weiss, Dan. “The Unlikely Rise of FL Studio, the Internet’s Favorite Production Software.” VICE, 12 Oct. 2016, www.vice.com/en/article/3de5a9/fl-studio-soulja-boy-porter-robinson-madeon-feature.
[12] Pour l’instant, pour générer des œuvres entièrement localement (sans utiliser de serveur) il faut aussi un GPU.
[13] Beckett, Lois. “‘Those Who Hate AI Are Insecure’: Inside Hollywood’s Battle Over Artificial Intelligence.” The Guardian, 26 May 2023, www.theguardian.com/us-news/2023/may/26/hollywood-writers-strike-artificial-intelligence.
[14] D’après cette étude, il semblerait même que les émissions de CO2 d’une GenIA soient de 130 à 1500 fois plus faibles que celles d’un humain pour l’écriture d’un texte, et de 310 à 2900 fois plus faible pour la création d’une image. Tomlinson, Bill. “The Carbon Emissions of Writing and Illustrating Are Lower for AI than for Humans.” arXiv.org, March 8, 2023. https://arxiv.org/abs/2303.06219.
[15] Cette ligne de pensée avait d’ailleurs inspiré la campagne présidentielle de Benoît Hamon (PS) en 2017, qui avait proposé de répondre aux enjeux de l’automatisation avec des mesures comme la « taxe sur les robots ».
[16] Surman, Mark. “Introducing Mozilla.Ai: Investing in Trustworthy AI.” The Mozilla Blog, August 1, 2023. https://blog.mozilla.org/en/mozilla/introducing-mozilla-ai-investing-in-trustworthy-ai/.
[17] Widder, David Gray, Sarah Myers West, and Meredith Whittaker. “Open (For Business): Big Tech, Concentrated Power, and the Political Economy of Open AI.” Social Science Research Network, January 1, 2023. https://doi.org/10.2139/ssrn.4543807.
[18] En réalité, le business model des géants de la tech dépasse bien largement la seule publicité, comme expliqué par Shoshana Zuboff dans son incontournable livre sur le capitalisme de surveillance. Zuboff, Shoshana. “The Age of Surveillance Capitalism.” Routledge eBooks, 2023, pp. 203–13. https://doi.org/10.4324/9781003320609-27.
[19] Suite à de nombreux scandales, notamment des cas d’ingérence lors d’élections démocratiques (comme dans l’affaire Cambridge Analytica), les États commencent enfin à réguler à grande échelle ces acteurs [19]. En tant qu’utilisateurs, il est possible de recourir à des alternatives solides, qui existent déjà, pour déserter les réseaux sociaux publicitaires. On pourrait citer par exemple Mastodon (https://joinmastodon.org/fr), un réseau social non publicitaire, ouvert et décentralisé. Quant à tous ces outils gratuits de Google et Microsoft qui extraient nos données, il existe de nombreuses alternatives libres (https://degooglisons-internet.org/fr/).
[20] Kelly, Kevin. “What AI-Generated Art Really Means for Human Creativity.” WIRED, 17 Nov. 2022, www.wired.com/story/picture-limitless-creativity-ai-image-generators.
[21] Ibid.
[22] Frenkel, Sheera, and Stuart A. Thompson. “Data Revolts Break Out Against A.I.” The New York Times, 15 July 2023, www.nytimes.com/2023/07/15/technology/artificial-intelligence-models-chat-data.html.
Belanger, Ashley. “Sarah Silverman Sues OpenAI, Meta for Being ‘Industrial-strength Plagiarists.’” Ars Technica, 10 July 2023, arstechnica.com/information-technology/2023/07/book-authors-sue-openai-and-meta-over-text-used-to-train-ai
[23] Rose, Mark. “The Author as Proprietor: Donaldson V. Becket and the Genealogy of Modern Authorship.” Representations, vol. 23, University of California Press, Jan. 1988, pp. 51–85. https://doi.org/10.2307/2928566.
Waldron, Jeremy. “From authors to copiers: individual rights and social values in intellectual property.” Chi.-Kent L. Rev. 68 (1992): 841.
[24] Masnick, Mike. “Book Publishers Won’t Stop Until Libraries Are Dead.” Techdirt, 22 Mar. 2023, www.techdirt.com/2023/03/22/book-publishers-wont-stop-until-libraries-are-dead.
[25] Masnick, Mike. “RIAA Piles on in the Effort to Kill the World’s Greatest Library: Sues Internet Archive for Making It Possible to Hear Old 78s.” Techdirt, 14 Aug. 2023, www.techdirt.com/2023/08/14/riaa-piles-on-in-the-effort-to-kill-the-worlds-greatest-library-sues-internet-archive-for-making-it-possible-to-hear-old-78s.
[26] Piquemal, Sébastien. “L’art nous empêche de construire un monde meilleur.” Mediapart, 7 Dec. 2022, https://blogs.mediapart.fr/sebastien-piquemal/blog/051222/l-art-nous-empeche-de-construire-un-monde-meilleur.
[27] The Dominion and the Intellectuals, Noam Chomsky Interviewed by Antosofia. https://chomsky.info/2003____.