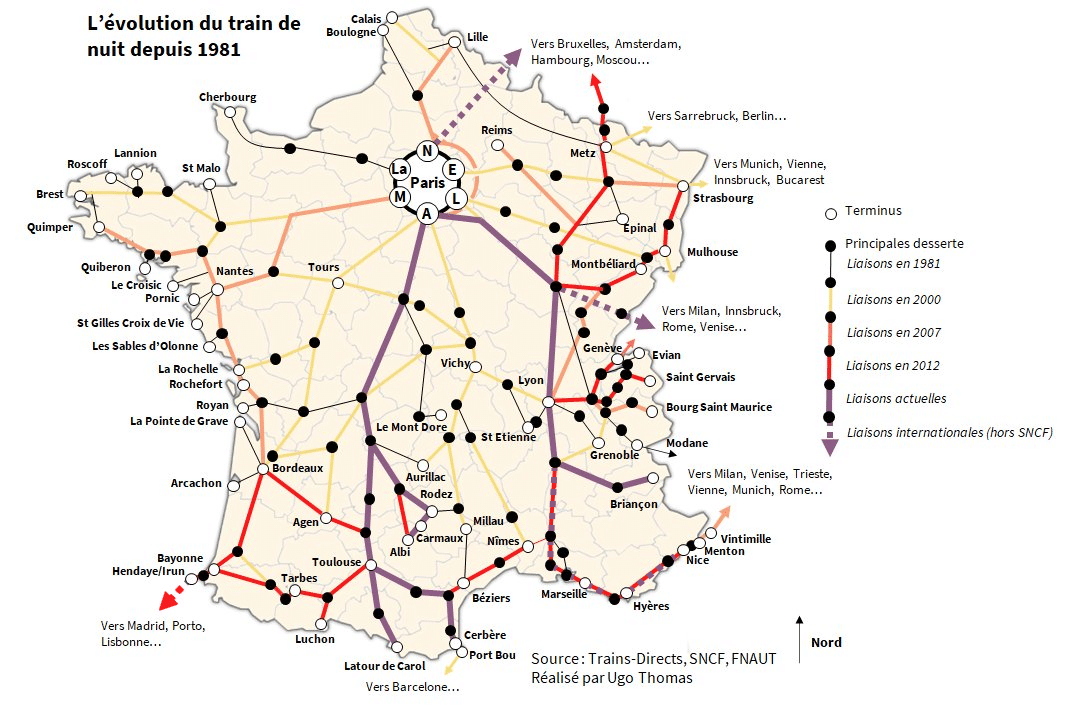Le 27 août dernier, un spectaculaire éboulement dans la vallée de la Maurienne a entraîné la fermeture de la ligne ferroviaire reliant Paris à Milan. Cet incident intervient au cœur des débats entourant la construction du tunnel Lyon-Turin, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les projets ferroviaires d’envergure dans le contexte de la transition écologique.
Le réseau ferroviaire français connaît depuis plusieurs décennies une phase de déclin. Entre 1980 et 2021, le réseau exploité est passé de 34 362 à 27 057 kilomètres soit une diminution de plus de 21%. Dans ce contexte, l’expansion du réseau repose principalement sur la construction de lignes à grande vitesse qui représentent aujourd’hui 8% du réseau ferré. Les dernières lignes mises en service sont les projets Ligne Nouvelle Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL, Le Mans – Rennes) Sud Europe Atlantique (SEA, Tours – Bordeaux) en 2017, et le contournement Nîmes Montpellier en 2019. Cette tendance est toutefois remise en cause par l’abandon ou la modification des projets de grande vitesse sur fond de contestation des grands projets.
Entre 1980 et 2021, le réseau exploité a diminué de plus de 21%.
L’avenir incertain du réseau ferroviaire français
Les anciens plans de développement du réseau ferroviaire ont été très ambitieux. En 1991, le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse prévoyait un développement massif de plus de 3500 kilomètres de lignes nouvelles desservant l’ensemble du territoire pour 180 milliards de francs (49 milliards d’euros actuels). Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l’Environnement prévoyait également un développement important des LGV. Ces projets avaient pour triple objectif de promouvoir des modes de transport plus respectueux de l’environnement, de réduire les temps de trajet vers les régions enclavées et de stimuler l’emploi et l’économie.
Cependant, bon nombre d’entre eux ont été remis en question, que ce soit en raison de leur utilité ou de leurs coûts élevés. Malgré une période de stagnation du ferroviaire, le discours a toutefois connu ces dernières années une importante évolution. Ainsi, alors qu’Emmanuel Macron déclarait en 2017 que « La réponse aux défis de notre territoire n’est pas d’aller promettre des TGV à tous les chefs-lieux de département de France. » allant jusqu’à défendre la liaison aérienne Paris-Toulouse jugée « très pertinente », le président évoquait en 2021 que « la décennie 2020 sera la nouvelle décennie TGV ».
Projets de lignes nouvelles, Rapport de présentation du schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse, mai 1991
Aujourd’hui, le gouvernement semble opter pour une approche plus mesurée du développement de la grande vitesse. Le 24 février 2023, Elisabeth Borne, alors Première ministre et ancienne ministre des transports, déclarait retenir le scénario « planification écologique » du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) comme référence pour les discussions futures. Cette proposition de programmation inscrit l’évolution du réseau sur la longue durée, prévoyant des abandons, des reports et des modifications substantielles des projets existants.
Parmi les projets en cours, seuls trois pourraient voir le jour dans la prochaine décennie : la ligne nouvelle Montpellier-Béziers, la liaison Roissy-Picardie et la ligne Bordeaux-Toulouse. À quinze ans, une partie des nouvelles lignes normandes est prévue, tandis qu’à vingt ans, la section sud du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) menant jusqu’à Dax, la LGV entre Béziers et Perpignan, ainsi que le projet Lyon-Turin pourraient être réalisés.
Plus nombreux sont les projets renvoyés à un horizon lointain, s’étendant au-delà de quatre quinquennats. C’est le cas du prolongement de la LGV de Dax jusqu’à la frontière espagnole, du développement de nouvelles lignes en Normandie, notamment le projet du « Y de l’Eure ». Dans l’ouest, le projet initial de Ligne nouvelle Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL), qui prévoyait plusieurs sections de nouvelles lignes vers Nantes, Brest et Quimper, est remis en question sur fonds d’abandon du projet de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes et est favorisé par les améliorations techniques apportées aux lignes existantes.
Seuls trois pourraient voir le jour dans la prochaine décennie : la ligne nouvelle Montpellier-Béziers, la liaison Roissy-Picardie et la ligne Bordeaux-Toulouse.
De plus, de nombreux projets conçus dans le contexte d’expansion du réseau ont évolué ou ont été annulés, comme le projet Rhin-Rhône, le Poitiers-Limoges ou la nouvelle ligne Paris-Lyon par Orléans et l’Auvergne, en raison de leurs coûts élevés ou des améliorations apportées aux lignes existantes. Ces annulations progressent en raison des défis associés aux lignes à grande vitesse, mettant en évidence les difficultés de réalisation des projets ferroviaires dans le contexte actuel.
La LGV, un transport coûteux mais structurant
Le ferroviaire, en raison de ses caractéristiques techniques, implique en effet une infrastructure lourde et exigeante en termes d’espace. Au-delà des rails, il est nécessaire de prévoir un espace adéquat pour le gabarit des trains, le matériel de signalisation, des caténaires électrifiées et leurs poteaux et d’éventuels talus pour limiter les nuisances sonores. Il en est de même des autres infrastructures gourmandes en surface : gares, aiguillages, centres de contrôle et stations électriques. De plus, il faut tenir compte des contraintes liées au tracé des voies ferrées, en particulier les courbes et les dénivelés, qui ont un impact direct sur la vitesse des déplacements ferroviaires. Enfin, les voies ferrées nécessitent une intégration adéquate avec les cours d’eau, les routes, les espaces naturels et le bâti.
Les Lignes à Grande Vitesse (LGV) imposent des contraintes supplémentaires visant à optimiser leur vitesse maximale. Elles se traduisent par une réduction des inclinaisons et des dénivelés, l’élimination des passages à niveau et une signalisation particulière. En conséquence, les LGV incluent de nombreux ouvrages d’art tels que des ponts et des tunnels pour minimiser l’impact de l’environnement sur la ligne. Tout est mis en œuvre pour garantir des trajets rectilignes et étanches ce qui a un coût significatif. Les 340 kilomètres de la LGV Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux (302 kilomètres de LGV et 38 kilomètres de raccordement) ont coûté 7,7 milliards d’euros, soit 22,6 millions d’euros par kilomètre. De même, les 182 kilomètres de la LGV Bretagne-Pays de la Loire (BPL) entre Le Mans et Rennes ont coûté 3,3 milliards d’euros, soit 18,1 millions d’euros par kilomètre.
L’intérêt des lignes nouvelles, en particulier les Lignes à Grande Vitesse (LGV), n’est pas nouveau. Le développement de la grande vitesse ferroviaire a permis d’obtenir des gains de temps significatifs là où il a été déployé. Il a également contribué à désengorger les axes en voie de saturation comme le Paris-Lyon-Marseille, ouvrant la voie à une augmentation du trafic, notamment fret et régional.
Cependant, la grande vitesse ferroviaire suscite également de nombreuses critiques. En privilégiant des arrêts espacés pour minimiser les périodes de freinage et d’accélération, elle crée un « effet tunnel » qui isole de nombreuses régions, en particulier les zones rurales et les villes intermédiaires, favorisant les phénomènes de métropolisation. De plus, la construction de LGV requiert la mobilisation d’importants espaces, parfois naturels ou agricoles. En période de contraintes budgétaires, les coûts élevés associés à la construction des LGV sont remis en question, notamment en comparaison du manque d’investissement dans les lignes régionales. Les nouveaux projets ferroviaires suscitent donc une opposition significative, en raison d’un coût économique et environnemental élevé.
Lyon-Turin, l’exemple des dilemmes des grands projets ferroviaires
Le projet de ligne nouvelle entre Lyon et Turin cristallise le débat actuel sur les projets de grande vitesse ferroviaire. S’étendant sur 270 kilomètres de l’est de Lyon au nord de Turin, ce projet, dont les prémices remontent aux années 1980, comporte un tunnel de base de 57,5 kilomètres sous les Alpes. Ce projet vise à répondre à deux enjeux : d’une part l’augmentation attendue – et surtout souhaitée – du report modal du trafic de marchandises des camions vers le train et d’autre part une réduction des temps de trajet entre la France et l’Italie.
Actuellement, la majorité des transports de marchandises franco-italiennes à travers les Alpes s’effectuent par voie routière, et le tunnel existant ne pourrait pas assurer un changement de ce paradigme. A ce jour, 93 % des marchandises sont acheminées par camion entre la France et l’Italie contre seulement 25% entre la Suisse et l’Italie, grâce à des infrastructures nouvelles et une politique active de transfert vers le rail de la Suisse. Ainsi, en 2021, 831 000 poids lourds ont emprunté le tunnel actuel du Fréjus, ce qui représente une augmentation de 7,6 % par rapport à 2019, sur un total de près de 3 millions de camions passant par l’un des trois points de passage principaux (Vintimille, Fréjus, Mont-Blanc). Pourtant, le transport ferroviaire est plus économique que le transport routier. Selon la Commission européenne, un trajet de Lille à Turin via le tunnel du Fréjus coûterait moins de 90 centimes par kilomètre, comparé à près de 1,9 euro par camion. Les raisons du choix prédominant du transport routier sont multiples, mais la capacité limitée du tunnel actuel doit également être prise en compte.
L’actuel tunnel ferroviaire, construit en 1871, est le plus ancien tunnel encore en service de l’arc alpin. En raison de sa structure – un tunnel monotube sans sorties de secours – il présente un certain nombre de limitations en termes de sécurité. Dans cette configuration, malgré d’importants travaux de réhabilitation réalisés il y a quelques années, le gestionnaire italien a imposé diverses restrictions qui interdisent, entre autres, le croisement ou la poursuite des trains transportant des marchandises dangereuses. Une note de SNCF Réseau datant de 2018 indique que ces dispositions limitent le nombre de circulations à 62 par jour, 54 si les croisements entre trains de marchandises et de voyageurs sont interdits, et 42 si une restriction de sécurité empêche la présence simultanée de deux trains dans le tunnel. Pour Transportail, si cette limite est fortement impactée par la fermeture du tunnel six heures par jour, une réduction de la durée de fermeture du tunnel pourrait permettre d’atteindre virtuellement 84 circulations par jour en l’absence de toute fermeture. Aujourd’hui , les jours de trafic les plus chargés voient environ 40 circulations, ce qui limite la marge pour une augmentation du trafic. Le projet Lyon-Turin pourrait permettre d’atteindre 162 circulations par jour dans une infrastructure aux normes actuelles.
La question qui se pose n’est pas tant celle de l’utilité du Lyon-Turin que de ses coûts économiques et écologiques potentiels.
Plus généralement, l’ensemble de la ligne atteint ses limites. En raison des fortes pentes, parmi les plus importantes du réseau français, la capacité de chargement des trains est limitée à 1600 tonnes, nécessitant la présence de deux voire trois locomotives supplémentaires De plus, la section en aval, entre Chambéry et Montmélian, est également saturée avec le croisement des circulations nationales, régionales, urbaines et fret. En 2018, lors de sa journée la plus chargée, elle a vu passer 155 trains. Les infrastructures présentent également divers points inadaptés, notamment avec la présence de passages à niveau ou la traversée de villes, ce qui réduit les vitesses et, par conséquent, les capacités. C’est dans ce cadre plus large que doit être pensé l’amélioration du réseau pour penser un report modal massif.
Le projet d’un nouveau tunnel et de voies supplémentaires en aval de la ligne apparaît donc nécessaire pour accroître significativement le trafic ferroviaire et réduire la congestion routière transalpine. Cette ligne permettrait également d’améliorer considérablement les temps de trajet. En ce qui concerne le transport de voyageurs, le gain de temps serait d’une heure à une heure et quart avec un trajet théorique Lyon-Turin en 2h04 au lieu des 3h22 actuelles, plaçant Paris à 4h15 de Milan sans arrêt. Ce gain de temps couplé à une hausse capacitaire ouvrirait la voie à un transfert de passagers de l’avion vers le train pour les déplacements vers le nord de l’Italie. Toutefois, si le projet du nouveau tunnel venait à se concrétiser, il n’est pas garanti qu’il attirerait naturellement une clientèle significative. Comme le soulignait déjà la Cour des comptes en 2012, les prévisions d’augmentation du trafic, sur lesquelles repose le projet Lyon-Turin, ont été révisées à la baisse. Par conséquent, la Cour recommandait alors des mesures contraignantes en faveur du transfert modal vers le train afin de concrétiser les avantages potentiels d’une telle infrastructure.
La question qui se pose n’est pas tant celle de l’utilité de ce projet que de ses coûts économiques et écologiques potentiels. En 2012, la Cour des comptes estimait le coût global du chantier à 26,1 milliards d’euros, soit près de 96,7 millions d’euros par kilomètre. Cependant, ce chiffre est sujet à d’importantes évolutions en raison des incertitudes liées au tracé et à l’évolution des coûts sur une période de plus d’une décennie. Pour mettre cela en perspective, le seul tunnel était estimé à 9,6 milliards d’euros en 2019, tandis que le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, long également de 57 kilomètres, coûtait environ 7,6 milliards d’euros en 2016.
Sur le plan environnemental, le projet de Lyon-Turin entraînerait l’artificialisation d’environ 1.500 hectares selon la Confédération paysanne. Il soulève également des préoccupations concernant l’eau. Le creusement du tunnel et les travaux connexes entraîneraient une consommation d’eau importante et une modification de l’hydrologie des vallées, ce qui nécessiterait de trouver de nouvelles sources d’eau pour approvisionner les villages. Selon les partisans du projet, le drainage aux abords du chantier représenterait de 0,6 à 1 mètre cube d’eau par seconde, soit de 20 à 30 millions de mètres cube par an, des chiffres équivalents à 1 à 2 % du débit de l’Avre, affluent de l’Isère. Enfin, l’empreinte carbone du projet est estimée à 10 millions de tonnes de CO2. Les partisans du projet avancent que cette empreinte carbone pourrait atteindre la neutralité en 15 ans, tandis que la Cour des comptes européenne estime qu’il faudrait entre 25 et 50 ans pour y parvenir.
Le projet Lyon-Turin illustre donc le dilemme écologique entre la volonté de transférer d’importants volumes de trafic routier et aérien de passagers et de marchandises d’une part, et les conséquences environnementales négatives de ce projet. Cependant, si le projet du tunnel était finalement privilégié, il serait essentiel de le construire le plus rapidement possible pour ne pas prolonger davantage la situation actuelle, qui favorise le statu quo du trafic routier, faute de décision politique claire.
La ligne nouvelle Provence Côte d’Azur, de la LGV à l’amélioration de l’infrastructure
Les évolutions du projet de Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LN PCA) illustrent les difficultés de concilier l’amélioration du réseau avec une desserte équilibrée des territoires. Ce projet consiste en une amélioration des infrastructures entre Marseille et Nice. Initialement envisagé dès 1991 en complément de la LGV Méditerranée entre Lyon et Marseille, le projet a été révisé pour répondre aux besoins des zones métropolitaines.
L’infrastructure ferroviaire du littoral sud-est est devenue inadaptée aux besoins de la région. La ligne Marseille-Nice a été construite en 1860 et atteint ses limites avec 50% de trains retardés et une vitesse moyenne de 80 km/h. Les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon et Nice connaissent également une saturation croissante, notamment au niveau de goulets d’étranglement. C’est le cas du nœud marseillais où convergent les trois lignes vers le Nord, l’Occitanie et la Côte d’Azur vers une gare en cul-de-sac. En parallèle, la Côte d’Azur fait partie des territoires les plus éloignés du réseau national. Nice (7e agglomération de France, 963 000 habitants) se situe à 5h33 de Paris, Toulon (9e agglomération, 596 000 habitants) à 4h59. En parallèle, l’offre aérienne permet, à un prix similaire voire inférieur, de desservir plus rapidement Paris (1h20 en moyenne) et les autres agglomérations françaises. Aujourd’hui, la liaison aérienne Paris-Nice est la première liaison au sein de l’hexagone avec 2,9 millions de voyageurs en 2022 auxquels on peut ajouter les plus de 1,4 million de voyageurs se rendant de Nice vers d’autres destinations métropolitaines (Lille, Nantes, Bordeaux, Mulhouse, Lyon, Toulouse principalement).
Pour remédier à ces difficultés, différents projets ont visé à agir sur le gain de temps et l’augmentation capacitaire. Parmi ces deux enjeux, les projets de ligne nouvelle constituent les projets les plus sensibles et cristallisent les débats. La difficulté consiste entre deux choix : d’une part favoriser le gain de temps, au travers un trajet le plus direct possible, composé de nombreux tunnels vers Nice, et d’autre part, un trajet desservant un chapelet de métropoles sur la côte, favorable aux liaisons régionales, au risque de diminuer drastiquement le gain de temps. Deux grandes familles de scénarios en découlent lors du débat public en 2005-2008, : ceux des « Métropoles du Sud » (Nice-Marseille via Toulon, Nice à environ 4h de Paris, Toulon à 3h20) préférés par le Var et ceux « Côte d’Azur » (trajet direct vers Nice, Nice à environ 3h30 de Paris) préférés par les Alpes-Maritimes mais plus destructeurs d’espaces viticoles. En 2009, le projet « Métropoles du Sud » est retenu (Nice à 3h50 de Paris, 180 kilomètres de lignes, 15 milliards d’euros).
Le projet connaît en 2012 une importante évolution à la faveur de la desserte régionale et change de nom de « LGV PACA » à « Ligne nouvelle PCA ». En 2013, la commission Mobilité 21 acte la décision de privilégier les liaisons locales et d’améliorer les infrastructures existantes à la place du projet de ligne nouvelle. Le projet est alors phasé en deux étapes, tout d’abord une désaturation des nœuds (horizon 2030) et ensuite des lignes nouvelles (post-2030) réduites à deux portions, entre Aubagne et Toulon et entre Le Muy et Cannes.
Faut-il favoriser le gain de temps, au travers un trajet le plus direct possible, composé de nombreux tunnels vers Nice, ou desservir un chapelet de métropoles sur la côte ?
En 2018, le comité d’organisation des infrastructures acte la priorité aux transports du quotidien et propose un phasage en 4 étapes privilégiant l’amélioration du réseau existant (nouvelles haltes, réorganisations des voies, augmentation du nombre des voies). Elle prévoit notamment la traversée souterraine de Marseille en phase 2 permettant un gain de temps de 15 à 20 minutes pour les trajets au-delà de Marseille (Paris-Nice en 5h15, Paris-Toulon en 4h45), qui s’intègre dans le projet de développement d’un service express régional métropolitain pour la cité phocéenne. La création de la ligne nouvelle est reléguée à la phase 4 prévue après 2038. En avril 2021, le projet est évalué à 3,5 milliards d’euros pour les deux premières phases, les phases 3 et 4 sont évaluées à 10,8 milliards d’euros. En 2022, le COI prévoit dans son scénario « planification écologique » une nouvelle planification à horizon 2043 de la phase 4.
La complexité de l’opération a orienté le projet à l’origine de LGV jusqu’à Nice vers un projet d’amélioration des trajets régionaux. Cette nouvelle orientation présente de véritables améliorations du réseau – notamment par l’augmentation du nombre des voies et la construction de la gare souterraine de Marseille – permettant, à terme, de désaturer les nœuds marseillais, toulonnais et niçois. Toutefois, les grands projets d’amélioration de la desserte et de lignes nouvelles, fortement restreints ont été renvoyés ad vitam. Cette évolution illustre les difficultés à mettre en place des projets majeurs structurants, dans un domaine aussi complexe et long que le ferroviaire.
Bordeaux-Toulouse, le dernier grand projet ferroviaire ?
Dans le paysage ferroviaire, la LGV Bordeaux-Toulouse apparaît comme le dernier grand projet en cours de réalisation. Au-delà d’une meilleure desserte entre ces deux métropoles, elle s’inscrit dans un projet plus large de desserte du sud-ouest. Sa mise en service est attendue d’ici une dizaine d’années.
La ligne de Bordeaux à Toulouse constitue un axe historique du réseau ferroviaire français. La Loi relative à l’établissement des grandes lignes de chemin de fer en France du 11 juin 1842 qui prévoit l’organisation du réseau ferroviaire selon « L’étoile de Legrand » propose déjà un axe de Bordeaux à Marseille par Toulouse. Cet itinéraire a été préféré pour la grande vitesse à une ligne directe Paris-Limoges-Toulouse du fait du choix de desservir les métropoles de l’Ouest. Envisagé dans le schéma directeur de 1991, ce dernier prévoit une LGV « Grand-Sud » reliant Bordeaux à la Côte d’Azur par Toulouse permettant de desservir Toulouse en 2h48.
Ce projet vise ainsi historiquement à améliorer la desserte de Toulouse depuis le reste du pays. Aujourd’hui, alors que Toulouse se situe à 4h18 de Paris en train, la capitale occitane reste la seconde destination intérieure en avion avec un trajet Paris-Toulouse en 1h15 (2,15 millions de passagers en 2022 et plus d’un million pour les autres destinations intérieures). Il va toutefois connaître un développement autour des enjeux d’amélioration des capacités du réseau. En effet, les projets de réseaux express métropolitains, notamment à Bordeaux et Toulouse, demandent une augmentation importante des capacités du réseau où cohabitent déjà difficilement fret, trains régionaux et grandes lignes.
Les premiers projets de LGV ont permis de réduire drastiquement le temps de trajet de Paris à Toulouse. D’environ 6h depuis la fin des années 1960 (via Limoges), il diminue à 5h30 en 2014 (via Bordeaux) pour atteindre actuellement environ 4h15 avec le prolongement de la LGV jusqu’à Bordeaux. Depuis les années 2000 le projet est régulièrement remis en avant d’être intégré au « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest » (GPSO), un projet plus large comprenant la branche Bordeaux-Toulouse, une branche vers l’Espagne et des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) et au sud de Bordeaux (AFSB). Prévu par le Grenelle de l’environnement en 2009 avec trois branches à partir de la LGV Paris Bordeaux (une pour Toulouse, une pour l’Espagne, une pour Limoges), il est déclaré d’utilité publique en 2016, tandis que les deux autres branches sont remises à plus tard.
Aujourd’hui, le projet est composé de deux phases, la phase 1 prévoit les aménagements toulousains et bordelais ainsi que les LGV vers Dax et Toulouse et la phase 2 prévoit le prolongement de Dax à la frontière espagnole par la côte basque. Alors que les travaux sur les nœuds bordelais et toulousains sont prévus pour 2024, les deux lignes nouvelles sont encore à l’étude. La ligne nouvelle est estimée à 6,6 milliards d’euros sur les 18 milliards d’euros des deux phases du GPSO et prévoit 222 kilomètres de LGV incluant 55 kilomètres communes à Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Il prévoit également la création de deux gares TGV en périphérie d’Agen et de Montauban. Le projet prévoit un gain de temps de 49 minutes avec les arrêts intermédiaires entre Bordeaux et Toulouse soit un trajet Paris-Toulouse en environ 3h25 avec arrêts.
Le projet connaît toutefois de nombreuses critiques tant sur son coût financier et écologique que sur ses prévisions de trafic et de gain de temps, ce qui amène ses opposants à défendre plutôt une modernisation de la ligne actuelle. Aussi, la commission d’enquête d’utilité publique rend en 2015 un avis défavorable en raison d’une faible rentabilité et d’une faible analyse des impacts sur l’environnement. Les études portant sur des alternatives à la ligne nouvelle prévoient la possibilité de gagner une dizaine de minutes sur la ligne actuelle ou d’une vingtaine de minutes avec la création de seulement 50 kilomètres de lignes. Toutefois, ces projets présentent des coûts encore plus importants que le projet actuel comparé à leurs avantages (2,1 milliards d’euros pour l’amélioration de la ligne actuelle, 3,8 à 4,9 milliards d’euros pour les optimisations plus importantes contre 6,6 milliards d’euros pour le projet actuel). Face aux volontés de développer les réseaux urbains et régionaux, l’espoir d’un maintien voire d’une augmentation du trafic fret et surtout les fortes attentes d’une réduction des temps de trajets à partir du Sud-Ouest, ces alternatives n’ont pas été préférées au projet actuel.
Les projets alternatifs à la LGV Bordeaux-Toulouse présentent des coûts encore plus importants que le projet actuel et des avantages plus faibles.
Le GPSO constitue aujourd’hui l’un des derniers grands projets ferroviaires dont la réalisation semble prochaine. Projet emblématique du développement du ferroviaire, il bénéficie d’un portage politique fort. Ainsi, lorsqu’en 2021 le maire de Bordeaux Pierre Hurmic évoquait son souhait de « tout mettre en œuvre pour arrêter ce projet insensé » en soulignant les réticences des élus du Lot-et-Garonne, de la Gironde et du Pays Basque, ce sont les présidents de la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, le maire de Toulouse et le président de Bordeaux Métropole qui ont réaffirmé leur soutien au projet.
Face aux coûts et aux calendriers, la nécessaire planification du réseau
La durée étendue de ces projets – plusieurs décennies – souligne la nécessité de prendre en compte les enjeux de saturation dès le stade de la planification. Le projet Lyon-Turin, conçu dans les années 1980-1990 et prévu entre 2030 et 2050 en fonction des décisions politiques, illustre cet impératif. Par exemple, le laps de temps entre l’approbation du schéma directeur de la ligne Tours-Bordeaux (LGV SEA) en 1992 et l’ouverture de la ligne en 2017 a duré 25 ans. À l’heure où le développement des réseaux de RER métropolitains et la volonté d’accroître le transport de fret exercent une pression sur les infrastructures existantes, il est impératif d’engager une logique de planification, d’autant plus compte tenu des montants financiers engagés.
La construction d’infrastructures ferroviaires ne garantit pas leur utilisation. Seules des normes et des incitations capables de détourner le transport aérien et routier vers le ferroviaire pourront rendre ces nouvelles infrastructures viables.
Sur le plan financier, le coût des projets de grande vitesse apparaît comme un argument en faveur de la réallocation de ces fonds vers des projets de lignes régionales et métropolitaines, qui seront également fortement sollicitées et présentent des masses financières moindres. En pratique, ces projets doivent coexister car la création de nouvelles lignes libère des voies pour le trafic quotidien. Il est toutefois difficile de défendre ce point de vue tant que les investissements dans le ferroviaire restent limités et comptés.
Enfin, il est essentiel de comprendre que la construction d’infrastructures ferroviaires ne garantit pas leur utilisation. Seules des normes et des incitations capables de détourner le transport aérien et routier vers le ferroviaire pourront rendre ces nouvelles infrastructures viables. A ce titre, il est intéressant de rappeler qu’alors que le réseau ferroviaire s’est réduit de plus de 15% en trente ans, le réseau routier a augmenté d’autant, avec plus de 150 000 kilomètres de routes en plus.
Moteurs du développement du réseau ferroviaire depuis un demi-siècle, les grands projets ferroviaires offrent d’importants avantages en termes de gain de temps et d’efficacité du réseau, mais ils ne sont pas exempts de coûts, tant sur le plan environnemental que social. Ils favorisent l’augmentation des déplacements entre les grands pôles d’activités au détriment des espaces traversés ou évités. Cependant, il est crucial de considérer ces projets comme des éléments structurants visant à soulager le réseau existant, et de les évaluer au cas par cas en prenant en compte leur impact sur le long terme, tant en termes de coûts que d’avantages.