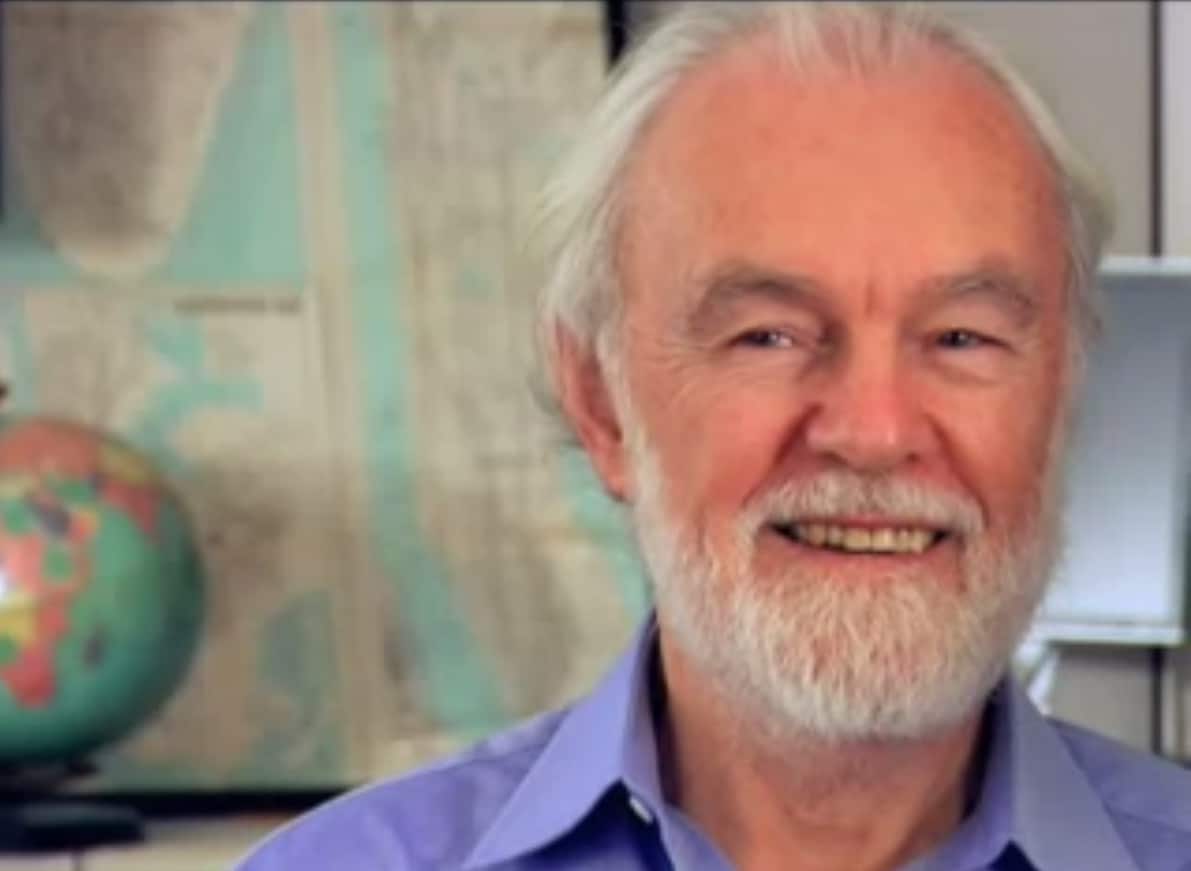En sacrifiant la santé des Américains sur l’autel de Wall Street, Donald Trump a pris le risque d’aggraver une catastrophe sanitaire qui se mue en crise économique et politique. Mais malgré l’explosion des inégalités sociales et la persistance de discriminations massives, le parti démocrate se préoccupe davantage du sauvetage des lobbies et des grandes entreprises que de la protection des ménages et des travailleurs. Ces multiples faillites politiques présagent d’un embrasement historique, dont les manifestations de ces derniers jours semblent un signe avant-coureur.
Fin avril, des kilomètres de bouchons se forment aux abords des centre de distribution d’aide alimentaire. Un mois plus tard, des dizaines d’émeutes frappent de nombreux centre urbains. Ces événements pourraient apparaître déconnectés, le premier étant la conséquence brutale de l’arrêt de l’économie pour contenir la propagation du coronavirus, tandis que le second résulte du décès de Georges Flyod des mains de la police de Minneapolis. L’un témoigne de l’ampleur des inégalités sociales, l’autre de la permanence des discriminations raciales. Mais ces deux phénomènes sociaux sont étroitement liés, comme l’impunité dont semble jouir les forces de l’ordre capables de tuer en se sachant filmées, et celle avec laquelle Wall Street profite du COVID-19 pour organiser le pillage des classes moyennes et populaires. La situation semble explosive, et l’avenir… dystopique.
The unrest in Minnesota’s largest city went largely unchecked. National Guard troops called out by the governor kept a low profile. Four police officers involved in the arrest of Floyd, who was accused of trying to pass counterfeit money at a corner store, were dismissed 2/3 pic.twitter.com/nYeRkch9lw
— Reuters (@Reuters) May 29, 2020
Donald Trump avait défini sa doctrine en deux mots : America First. L’épidémie lui donne raison. Les États-Unis arrivent premiers en nombre de cas (un million huit cent mille), de décès (plus de cent mille), et de chômeurs (quarante et un millions). Ces chiffres alarmants masquent une réalité plus préoccupante. La mortalité serait largement sous-estimée, selon les autorités sanitaires dépendant de la Maison-Blanche. Idem pour les pertes d’emploi. Parce qu’elle a été construite de manière extrêmement bureaucratique afin de décourager les gens d’y avoir recours, l’assurance chômage sous-estime la situation. Le secrétaire au trésor Steven Mnuchin a reconnu que le taux était probablement supérieur de 5 points aux 15 % annoncés pour avril, et devrait rapidement atteindre les 25 %. [1]
Aux chômeurs s’ajoutent les nombreuses personnes payées via les commissions et pourboires, qui ont conservé leurs emplois mais vu leurs revenus chuter. Sans parler des vingt-sept millions d’Américains qui ont perdu leur couverture santé. Un problème en pleine pandémie, en particulier lorsque les hôpitaux et cliniques privées licencient des dizaines de milliers de soignants et docteurs pour répondre à la contraction de la demande de soins provoquée par le report des procédures médicales non-urgentes.[2]
Ce drame social explique les longues files d’attente pour l’aide alimentaire. D’autant plus que la fermeture des écoles publiques, qui assurent normalement la gratuité des repas aux élèves issus des classes défavorisées, a placé un enfant sur cinq en situation de malnutrition. [3]
De même, le risque de crise immobilière devient alarmant. Selon certaines estimations, près d’un tiers des locataires ne sera pas en mesure d’acquitter son loyer, et plus d’un million de mensualités d’emprunts seront suspendues, au point de justifier un plan de sauvetage des courtiers en prêts immobiliers chiffré en milliards de dollars et de mettre en place un moratoire sur les évictions.[4]
Cette fracture sociale s’ajoute aux inégalités sanitaires. Le coronavirus tue majoritairement les plus pauvres, c’est-à-dire les Afro-Américains et les latinos.[5] Loin de s’en émouvoir, Donald Trump assume désormais le sacrifice de dizaines de milliers de personnes au nom du New York Stock Exchange.
« Greed is good » : Trump et les Républicains sacrifient la population sur l’autel de la finance
Comme certains dirigeants européens, Donald Trump a d’abord minimisé l’épidémie et incité la population à « continuer à vivre normalement » avant de se montrer incapable de fournir un nombre suffisant de masques, tests et respirateurs. Mais cet échec patent, qui a permis au virus de se propager dans la population de manière fulgurante, ne s’explique pas seulement par une forme d’incompétence doublée d’impréparation. [6]
Le Financial Time et NPR ont révélé que Donald Trump a volontairement refusé de fournir des tests par crainte des résultats. Selon son gendre et conseiller Jared Kushner, un niveau alarmant de contamination risquait de provoquer la panique des places financières.
Une fois l’épidémie trop sévère pour être ignorée et la bourse de New York en chute libre, Trump a refusé d’endosser la responsabilité de la gestion de la crise, délégant aux gouverneurs des différents États la tâche de mettre en place les mesures de confinement et de se fournir en masques et équipements médicaux. Cela a eu pour conséquence immédiate la mise en concurrence des différents États entre eux, provoquant un cauchemar logistique qui a conduit à une augmentation des prix et des délais d’acheminement.
Les États gérés par des démocrates étant généralement plus densément peuplés et sévèrement touchés par l’épidémie, la gestion de la crise a rapidement pris la forme d’un combat politique partisan. Que ce soit pour obtenir du matériel, des financements ou simplement produire un discours cohérent, l’administration Trump a souvent mis des bâtons dans les roues des gouverneurs qui cherchaient à appliquer les recommandations officielles de la CDC, pourtant rattachée à la Maison-Blanche.
Cela accentue le clivage politique et les logiques partisanes. Les électeurs démocrates, plus exposés au virus, se disent deux à trois fois plus inquiets que les électeurs républicains. Ces derniers s’informent par des médias qui minimisent le risque sanitaire. Moins exposés, ils vivent davantage la crise sur le plan économique. [7]
Face à l’explosion du chômage, des voix se sont élevées dans les sphères financières et les médias conservateurs pour critiquer le confinement, argumentant que le remède était pire que la maladie.
Sensibles à cette curieuse logique qui suppose que la situation économique soit indépendante des choix politiques, des groupuscules financés et recrutés par des milliardaires d’extrême droite et des cercles d’affaires plus ou moins proches du parti républicain ont organisé des manifestations contre le confinement. [8] Elles ont rapidement pris la forme d’actions spectaculaires, que ce soient des opérations escargot menées dans les centres-ville à bord de pick up truck et autres véhicules de luxe, ou dans les parlements de certains états par des miliciens armés de fusils d’assaut. Des voies d’accès aux hôpitaux ont été bloquées et des soignants pris à partie par des manifestants arborant des drapeaux confédérés.
La portée de ces actions a été largement exagérée par les médias conservateurs, qui espéraient rallier davantage de participants, et par les médias démocrates en quête de sensationnel. Deux Américains sur trois affirment craindre un déconfinement trop hâtif et précipité, mais Trump a encouragé ces manifestations, bien qu’elles protestent contre les recommandations de sa propre administration, afin de se servir de ce moment pour entamer un virage stratégique : fini la lutte contre la crise sanitaire, place à la reprise d’activité.
Face au risque de pénurie de viande lié à la contamination de nombreux ouvriers travaillant dans les abattoirs, Trump a ainsi signé un décret obligeant la reprise du travail, quelles que soient les conditions sanitaires, afin de préserver « un service essentiel ».[9]
À l’échelle fédérale, aucune mesure sanitaire sérieuse n’est en place pour accompagner la reprise. L’improvisation et l’amateurisme du gouvernement sont consternants.
Pour éviter de nourrir l’inquiétude des Américains, Trump refuse de porter un masque en public. Même les dirigeants d’entreprises apparaissant à ses côtés sont contraints de le faire à visage découvert, pour rassurer le public et encourager la reprise. Ce faisant, Trump va à l’encontre des recommandations officielles et de l’obligation du port du masque en public instaurée dans de nombreuses juridictions. [10]
Donald Trump sacrifie la santé publique sur l’autel de l’économie, comme si ces deux aspects étaient mutuellement exclusifs. En cela, il est aidé par le Congrès et la banque fédérale, avec la bénédiction quasi incompréhensible de l’opposition démocrate.
Explosion des inégalités : une tragédie politique en quatre actes
Bien qu’imparfaite, la réponse économique des principaux pays développés a consisté à maintenir l’emploi via des mécanismes de chômage technique subventionnés par l’État.
À l’inverse, le Congrès américain a décidé de livrer sa population au chômage sans lui garantir une assurance maladie ni un revenu. Pendant ce temps, la Fed prenait une décision sans précédent : bannir le risque pour les investisseurs en bombardant les marchés d’argent frais. Pour le capitalisme financier, Wall Street est désormais un gigantesque casino où « à tous les coups on gagne ». Les profits sont réels, et les pertes épongées par la maison.
Résultat, la bourse de New York renoue avec les sommets, tandis que 38 millions d’Américains se retrouvent sans emploi. Il s’agit ni plus ni moins du plus grand transfert de richesse jamais orchestré, dont les conséquences sont encore difficiles à appréhender.
Le premier acte législatif, à l’initiative de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, avait pour but de répondre à la crise sanitaire en assurant la gratuité des tests de dépistage et en obligeant les entreprises à offrir quinze jours d’arrêt maladie, pour permettre aux personnes symptomatiques de rester chez elles. Pourtant, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a décidé de son propre chef d’exclure les entreprises de plus de cinq cents employés, laissant de côté près de 50 millions d’Américains. Les Républicains ont approuvé cette décision, que le New York Times dénoncera dans un éditorial au vitriol. [11]
Le deuxième acte législatif, nommé CARES act, doit répondre à l’urgence économique. Cette fois, le Sénat est à la manœuvre, sous la houlette de son président républicain Mitch McConnell. Sa proposition initiale se résume à un chèque en blanc de 500 milliards pour les grandes entreprises, sans aucune contrepartie, et un chèque de 600 dollars pour chaque Américain. Ce projet, initialement estimé à 700 milliards de dollars, est rapidement porté à 1000 milliards, Trump « aimant les chiffres ronds ».
Les démocrates ont négocié de nombreux ajouts et concessions, en particulier la création d’un comité de contrôle pour superviser les prêts accordés aux grandes entreprises, une extension importante de l’assurance chômage (étendue à quatre mois et gonflée de 600 dollars par semaine), 150 milliards de dollars pour les hôpitaux et 360 pour les PME. Le chèque aux Américains a vu son montant doubler (à 1200 dollars par adulte et 500 par enfant), mais est limité aux ménages gagnant moins de 75 000 dollars par an et par adulte. Le coût final du CARES act s’élève à 2300 milliards de dollars, soit l’équivalent du PIB de la France.
Le président de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer s’est félicité d’avoir mis en place une « nouvelle assurance chômage sous stéroïdes » et Bernie Sanders a salué le fait que, contrairement à la crise des subprimes, les trois quarts des financements iront aux ménages et PME.
Mais cette aide temporaire ne traite aucunement sur le fond les pertes d’emploi ou les baisses spectaculaires de revenu, et va priver des millions d’Américains d’assurance maladie. Les chèques aux particuliers et aides aux PME vont mettre deux mois à arriver, du fait des lourdeurs bureaucratiques induites par le mode de distribution retenu. À l’inverse, l’aide octroyée aux grandes entreprises est immédiate. Elle vise à garantir les profits présents et futurs, via un mécanisme qui va redéfinir en profondeur le capitalisme américain.
La Fed a ainsi mis à disposition de Steve Mnuchin, le secrétaire au trésor de Donald Trump et ancien cadre dirigeant de Goldman Sachs, un fonds spécial de 4000 milliards. Cette création monétaire sera utilisée en complément des 500 milliards d’aide aux grandes entreprises pour permettre des « effets de levier » afin d’arroser les marchés d’actions et d’obligations. Le tout à la discrétion de Mnuchin, le comité de contrôle négocié par les démocrates n’ayant qu’un droit de regard ex post. [12]
Wall Street a parfaitement compris le message. Un conseiller financier de JPMorgan écrivait récemment à ses clients qu’ils pouvaient s’attendre « à ce que les marchés retrouvent rapidement les niveaux record pré-Covid, tant que l’outil monétaire restera mobilisé ».
Or, le directeur de la Fed a été on ne peut plus clair en déclarant qu’il « ne tomberait pas à cours de munitions ». Historiquement, la banque centrale intervient après l’éclatement d’une bulle financière. Là, c’est elle qui en gonfle une nouvelle, les investisseurs avertis n’ayant qu’à miser sur les produits et entreprises ayant ses faveurs.
Sous la pression des chiffres alarmants du chômage, l’aile gauche démocrate a voté le CARES act dans l’urgence, malgré ses problèmes évidents. Mitch McConnell a profité d’une procédure exceptionnelle pour imposer un vote expéditif et à l’unanimité au Sénat, sans amendements ni débats. Puis Nancy Pelosi a forcé la chambre des représentants à adopter le texte sans le modifier via un « vote à main levée », procédure permettant d’éviter la présence physique des 435 parlementaires. Justifiée par la crise sanitaire, elle possède l’autre avantage de garantir l’anonymat du vote.
Les vices du CARE act ne sont apparus qu’après. Par exemple, une niche fiscale introduite par les républicains a permis d’offrir 135 milliards de dollars de baisse d’impôts aux personnes gagnant plus d’un demi million de dollars de revenu annuel dans la finance et la spéculation immobilière.[13] De même, l’aide aux PME a été siphonnée par de grandes entreprises organisées selon le modèle de franchise, en particulier dans la restauration, et par des « petites entreprises » gérant des fonds spéculatifs et produits financiers, et mieux équipés pour obtenir les fonds rapidement auprès des grandes banques chargées de l’allocation des prêts. Ces banques ont amassé 10 milliards de dollars de profit dans l’opération, un cadeau indirect supplémentaire du CARES act pour Wall Street. Le plan d’aide aux PME a été un tel fiasco qu’il a justifié un troisième “acte” pour débloquer 450 milliards d’aide supplémentaire dans l’urgence.
Côté démocrate, seule Alexandria Ocasio-Cortez s’y est opposée. Elle s’est justifiée en citant l’absence de nouvelles mesures sociales, dénonçant le fait que les républicains n’avaient fait aucune concession.

Ce qui nous amène au quatrième acte. Proposé par les démocrates à la chambre des représentants, ce texte baptisé « HEROES » doit combler les failles des packs précédents en se concentrant sur les ménages et les PME. Il avait été annoncé à l’aide du mot-dièse #putpeoplefirst (mettre les gens en premier, contrairement aux trois premiers actes) et devait servir de démonstration politique, afin de mettre Trump et les républicains au pied du mur.
Du moins, c’est ce qu’avait annoncé Nancy Pelosi, en affirmant vouloir envoyer un « message ». Dans les faits, elle a ignoré les propositions de son aile gauche, malgré la mobilisation de sénateurs importants et de nombreux groupes de militants et d’ONG. Le résultat est un plan de 3000 milliards au contenu timide et politiquement désastreux.[14]
Au lieu de profiter de la crise pour étendre la couverture santé publique, Pelosi propose de recourir à un système mis en place par Ronald Reagan pour étendre la couverture santé des employés licenciés, nommé COBRA (sic). Ce plan, plus coûteux qu’une extension de l’Obamacare ou du Medicare, comme l’a démontré l’organe d’évaluation interne du Congrès (CBO), couvrira moins bien, et pour plus cher. Comment expliquer une telle ineptie ? Pour Jacobinmag, il s’agit d’empêcher qu’une extension des programmes publics n’agisse comme un cheval de Troie pour la nationalisation de la couverture santé (Medicare for all). D’où cette subvention massive aux compagnies d’assurances (estimée à 330 milliards) pour fournir une couverture santé aux nouveaux chômeurs sans remettre en cause le modèle privé.[15]
Le coronavirus expose les failles du système américain
Nancy Pelosi a refusé à sa minorité progressiste un plan de sauvegarde de l’emploi inspiré des mécanismes de chômage technique existant en Europe, malgré l’appui de sénateurs républicains. À la place, le HEROES act propose d’étendre la fameuse « assurance chômage sous stéroïdes » jusqu’au mois de janvier 2021, faisant officiellement des démocrates le « parti du chômage ». Pelosi a toujours déclaré qu’elle gouvernerait plus à gauche si elle n’avait pas pour impératif la défense des sièges les plus exposés aux républicains dont dépend sa majorité, typiquement défendus par des élus centristes. Mais ces derniers, contestés sur le terrain de l’emploi et débordés sur leur gauche par les républicains, s’allient de plus en plus avec leurs collègues progressistes contre Pelosi. En vain pour l’instant, le HEROES act ayant été adopté à la chambre des représentants. [16]
La cerise sur le gâteau reste le plan de sauvetage des entreprises de lobbyisme. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les dix mille lobbyistes qui travaillent à Washington ont formé une association pour se doter de leur propre lobby, afin de faire pression sur les élus pour obtenir leur propre plan de sauvetage. L’argument étant que sans lobbyistes, les législateurs ne seront plus capables d’écrire les prochains textes de loi.[17]
Officiellement, Nancy Pelosi a inclus cette demande dans le HEROES act pour contraindre les républicains à accepter les autres revendications démocrates. Mais puisque le texte a pour but d’envoyer un « message » et n’a aucune chance d’être voté par le Sénat, pourquoi inclure une telle aberration ? Surtout que ce texte prévoit des financements pour des groupes d’influence dotés d’un budget dépassant le milliard de dollars et s’étant illustrés par leurs attaques contre les démocrates, Medicare for All et Bernie Sanders.[18]
Le coronavirus aura ainsi exposé jusqu’au bout les faillites du système économique, social, mais également politique américain.
Tandis que les inégalités explosent, Donald Trump et le parti républicain, dans une forme de « stratégie du choc », cherchent à supprimer les régulations environnementales et provoquer la faillite des programmes sociaux en refusant d’aider les états. De leur côté, les démocrates condamnent des millions d’Américains au chômage et aux aides sociales « sous conditions de ressources » tout en arrosant d’argent les lobbies, les grandes entreprises et Wall Street, sans contreparties. Depuis le début de la pandémie, un ménage américain sur deux a vu ses revenus diminuer. En même temps, la fortune des milliardaires a progressé de 435 milliards de dollars en deux mois. Vous avez dit dystopie ?
Notes et références :
- https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/10/853505446/unemployment-numbers-will-get-worse-before-they-get-better-mnuchin-says
- https://www.latimes.com/california/story/2020-05-02/coronavirus-california-healthcare-workers-layoffs-furloughs
- https://nymag.com/intelligencer/2020/05/kids-are-going-hungry-because-of-the-coronavirus.html
- https://taibbi.substack.com/p/the-bailout-miscalculation-that-could et https://www.npr.org/2020/05/01/848247228/rent-is-due-today-but-millions-of-americans-wont-be-paying
- https://www.nytimes.com/2020/04/08/nyregion/coronavirus-race-deaths.html
- Lire notre article : https://lvsl.fr/covid-19-les-etats-unis-face-au-desastre-qui-vient/
- https://fivethirtyeight.com/features/democrats-and-republicans-are-increasingly-split-on-the-coronavirus-crisis/
- https://theintercept.com/2020/04/22/coronavirus-and-the-radical-religious-rights-bumbling-messiah/
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/30/trump-executive-order-meat-processing-workers-coronavirus
- https://theintercept.com/2020/05/09/pence-aides-positive-covid-19-test-exposes-folly-white-house-aversion-masks/
- Ibid 6.
- Pour la partie sur le CARES act, se référer à l’article suivant : https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/taibbi-covid-19-bailout-wall-street-997342/ (rolling stone) et celui-ci de The Intercept : https://theintercept.com/2020/05/20/the-jungle-and-the-pandemic-the-meat-industry-coronavirus-and-an-economy-in-crisis/
- https://theintercept.com/2020/04/19/coronavirus-cares-act-millionaire-tax-break
- https://theintercept.com/2020/05/15/coronavirus-relief-house-heroes-act-progressives/
- https://www.jacobinmag.com/2020/05/nancy-pelosi-cobra-medicare-for-all-coronavirus-covid-m4a
- https://theintercept.com/2020/05/19/heroes-act-paycheck-bill-democrats/
- https://theintercept.com/2020/05/05/lobbyists-trade-groups-bailout/
- https://www.jacobinmag.com/2020/05/house-democrats-coronavirus-relief-bill-corporate-lobbyists