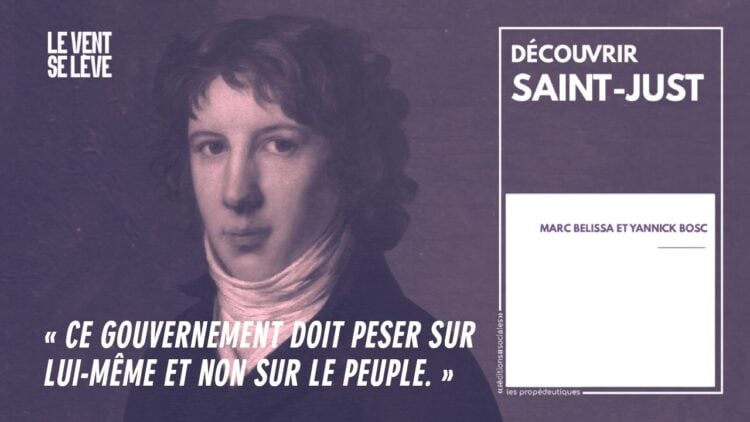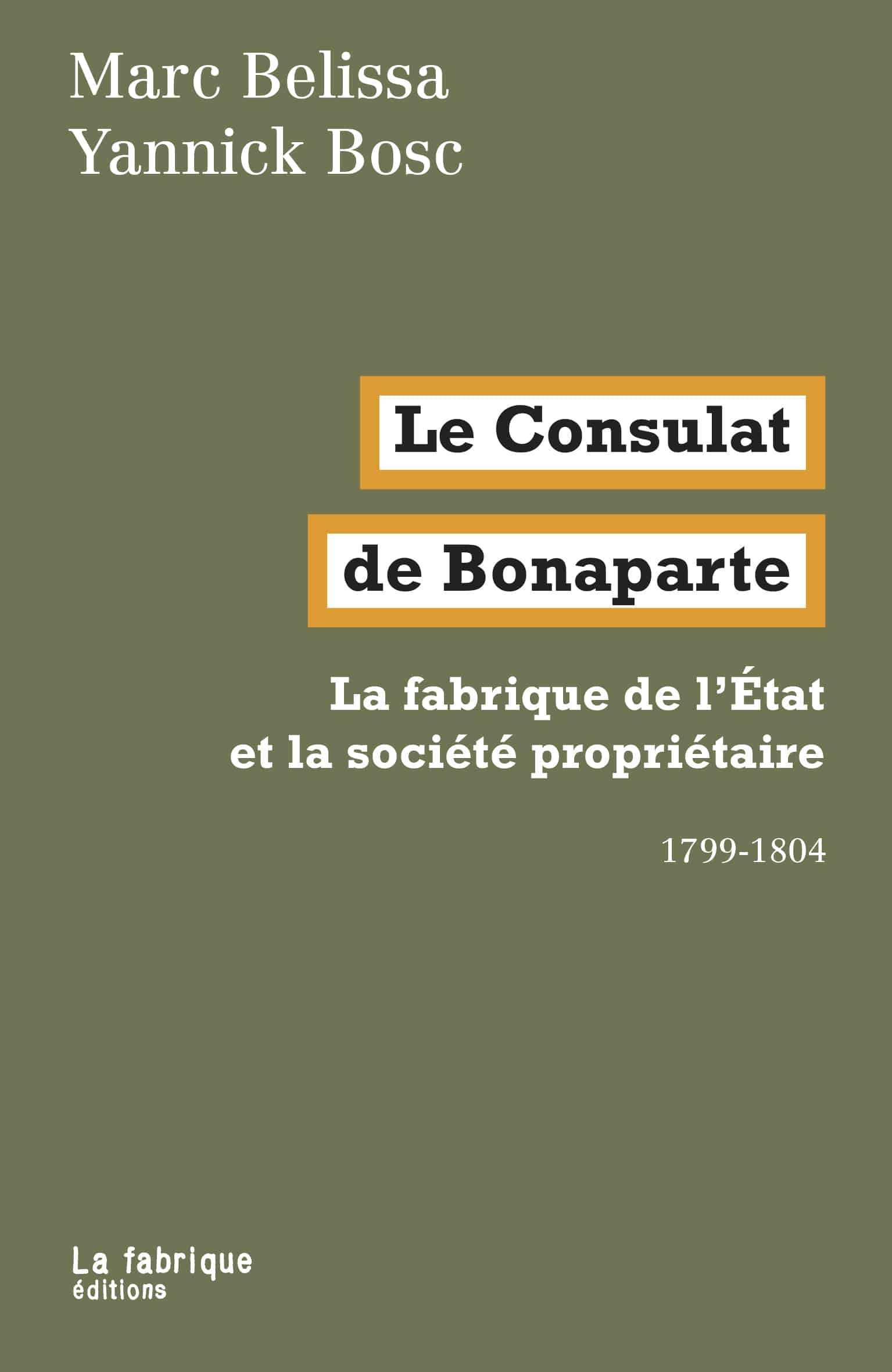Le 20 mars 2025, le député Jocelyn Dessigny (RN) croyait donner une leçon d’histoire à ses collègues parlementaires en déclarant que Saint-Just avait été décapité par Robespierre. En réalité, cette figure éminente de la Révolution française fut arrêtée et guillotinée en même temps que l’Incorruptible, précisément car il en était resté, jusqu’à la fin, l’un des plus proches compagnons. Tournée en dérision sur les réseaux sociaux, cette sortie illustre la méconnaissance qui entoure la vie et l’œuvre de celui que l’on surnomma « l’archange de la Révolution ». Dans un très beau numéro de la désormais incontournable collection « Les propédeutiques », Marc Belissa et Yannick Bosc nous invitent ainsi à Découvrir Saint-Just (Les éditions sociales, 2024). Les deux historiens, spécialistes de la Révolution française, présentent et commentent onze discours de l’intellectuel révolutionnaire, pour qui « les malheureux sont les puissances de la terre » et « ont le droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent ». Accompagnés d’une introduction efficace et d’une chronologie qui permettent de resituer le benjamin de la Convention dans la grande histoire de la Révolution, ces textes étonnent par leur actualité. Extraits.
Rapport au nom du comité de salut public sur le gouvernement, 10 octobre 1793
« Pourquoi faut-il, après tant de lois et tant de soins, appeler encore votre attention sur les abus du gouvernement en général sur l’économie et les subsistances ? Votre sagesse et le juste courroux des patriotes n’ont pas encore vaincu la malignité qui, partout, combat le peuple et la révolution : les lois sont révolutionnaires, ceux qui les exécutent ne le sont pas.
Il est temps d’annoncer une vérité qui, désormais, ne doit plus sortir de la tête de ceux qui gouverneront : la République ne sera fondée que quand la volonté du souverain comprimera la minorité monarchique, et régnera sur elle par droit de conquête. […]
Votre comité de Salut public, placé au centre de tous les résultats, a calculé les causes des malheurs publics; il les a trouvées dans la faiblesse avec laquelle on exécute vos décrets, dans le peu d’économie de l’Administration, dans l’instabilité des vues de l’État, dans la vicissitude des passions qui influent sur le gouvernement. […]
Si les conjurations n’avaient point troublé cet empire, si la patrie n’avait pas été mille fois victime des lois indulgentes, il serait doux de régir par des maximes de paix et de justice naturelle : ces maximes sont bonnes entre les amis de la liberté ; mais entre le peuple et ses ennemis, il n’y a plus rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l’être par la justice : il faut opprimer les tyrans. […]
Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement ; le vôtre vous a fait constamment la guerre avec impunité. […]
Dans les circonstances où se trouve la République, la Constitution ne peut être établie ; on l’immolerait par elle-même. Elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté, parce qu’elle manquerait de la violence nécessaire pour les réprimer. Le gouvernement présent est aussi trop embarrassé. Vous êtes trop loin de tous les attentats ; il faut que le glaive des lois se promène partout avec rapidité, et que votre bras soit partout présent pour arrêter le crime.
Vous devez vous garantir de l’indépendance des administrations, diviser l’autorité, l’identifier au mouvement révolutionnaire et à vous et la multiplier. […]
Vous ne pouvez point espérer de prospérité si vous n’établissez un gouvernement qui doux et modéré envers le peuple, sera terrible envers lui-même par l’énergie de ses rapports ; ce gouvernement doit peser sur lui-même et non sur le peuple. Toute injustice envers les citoyens, toute trahison, tout acte d’indifférence envers la patrie, toute mollesse, y doit être souverainement réprimé.
Il faut y préciser les devoirs, y placer partout le glaive à côté de l’abus, en sorte que tout soit libre dans la République, excepté ceux qui conjurent contre elle et qui gouvernent mal. […]
Il n’est pas inutile non plus que les devoirs des représentants du peuple auprès des armées leur soient sévèrement recommandés. Ils y doivent être les pères et les amis du soldat. Ils doivent coucher sous la tente, ils doivent être présents aux exercices militaires, ils doivent être peu familiers avec les généraux, afin que le soldat ait plus de confiance dans leur justice et leur impartialité, quand il les aborde. Le soldat doit les trouver jour et nuit, prêts à l’entendre. Les représentants doivent manger seuls. Ils doivent être frugals [sic] et se souvenir qu’ils répondent du salut public, et que la chute éternelle des rois est préférable à la mollesse passagère.
Ceux qui font des révolutions dans le monde, ceux qui veulent faire le bien ne doivent dormir que dans le tombeau.
Il nous a manqué jusqu’aujourd’hui des institutions et des lois militaires conformes au système de la République qu’il s’agit de fonder. Tout ce qui n’est point nouveau dans un temps d’innovation est pernicieux. […]
Il est peu d’hommes à la tête de nos établissements, dont les vues soient grandes et de bonne foi ; le service public, tel qu’on le fait, n’est pas vertu, il est métier. »
À la suite de la révolution des 31 mai et 2 juin 1793, 22 députés girondins jugés infidèles au peuple sont rappelés et assignés à domicile. La plupart prennent la fuite et rejoignent la province qu’ils tentent de soulever. Le projet de Constitution qu’ils portaient est écarté et un nouveau texte est adopté par la Convention le 24 juin. Il est ratifié par référendum le 4 août. Son œuvre constituante achevée, la Convention ne se sépare pourtant pas pour laisser place à une nouvelle assemblée. Le territoire français est alors en partie envahi par les armées des monarchies coalisées, la Vendée est en guerre, Lyon et Marseille sont aux mains de la contre-révolution. Les conditions ne permettent pas la tenue d’élections. Face aux périls, la levée en masse est décrétée le 23 août. Les 4 et 5 septembre 1793, les sections parisiennes manifestent devant la Convention pour qu’elle mette « la terreur à l’ordre du jour», un mot d’ordre qui s’est formé dans les sociétés populaires à la suite de l’assassinat de Marat le 13 juillet 1793. Il s’agit de retourner 1a terreur contre les ennemis de la liberté. Le 17 septembre, la loi dite « des suspects » est votée. Les comités de surveillance, élus localement depuis le printemps 1793, sont chargés d’en faire la liste et éventuellement de les arrêter.
Saint-Just est élu au Comité de salut public le 10 juillet 1793. Le rapport qu’il présente à la Convention au nom du comité le 20 octobre expose les raisons pour lesquelles celle-ci doit instituer un mode de gouvernement adapté à une république en guerre contre ses ennemis. Ce rapport est suivi par celui de Billaud-Varenne le 18 novembre, toujours au nom du même comité, et débouche sur la loi du 4 décembre 1793 (14 frimaire an II) qui organise le gouvernement révolutionnaire. Comment révolutionner le pouvoir exécutif afin que les lois votées par l’Assemblée soient effectivement exécutées ? Comment faire face à une guerre civile et étrangère, et cependant mettre en œuvre les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? En d’autres termes, comment fonder la république ?
LES LOIS SONT RÉVOLUTIONNAIRES, CEUX QUI LES EXÉCUTENT NE LE SONT PAS
La « terreur », que le mouvement populaire veut retourner contre les ennemis de la liberté en la mettant « à l’ordre du jour », consiste à réprimer les contre-révolutionnaires. Mais elle réside surtout dans le contrôle de l’exécution des lois et la punition de ceux qui l’entravent. Dans le domaine très sensible de la législation sur les subsistances, on constate par exemple que le « premier maximum » voté sous la pression populaire le 4 mai 1793, afin de limiter le prix du blé et lutter contre la vie chère, n’est pas appliqué par de nombreux directoires de départements qui en avaient la charge. Ces administrations, essentiellement composées de propriétaires aisés, sont favorables aux choix politiques de la Gironde. Une soixantaine d’entre elles se sont en effet rebellées contre la Convention après le 2 juin, les plus engagées allant jusqu’à lever des troupes contre les « oppresseurs » de la Convention et faire arrêter des représentants en mission (la « révolte fédéraliste »). Ce sont souvent les administrations proches des citoyens (les municipalités, les districts) et les sociétés populaires qui ont contraint les directoires départementaux à mettre un terme à leur sédition.
La « mise à l’ordre du jour de la terreur » demandée par la sans-culotterie ne se limite donc pas comme on le croit souvent à la répression. Son volet principal concerne le contrôle démocratique du pouvoir exécutif. Dans le prolongement de cette revendication du mouvement populaire, et en s’appuyant sur elle, Saint-Just fait au nom du Comité de salut public le procès du pouvoir exécutif, qu’il avait déjà engagé dans d’autres interventions. Le contrôle du législatif sur l’exécutif est depuis longtemps au cœur du projet politique montagnard. Il s’inscrit dans la tradition républicaine démocratique selon laquelle le pouvoir législatif est le pouvoir suprême de l’état social auquel « tous les autres doivent être subordonnés » (John Locke, Deuxième traité du gouvernement civil, XIII-149).
Il dénonce donc les ministres et l’inertie de l’administration, le patriotisme de façade, le détournement de l’argent public, l’enrichissement personnel et la corruption. Ceux qui doivent faire respecter les lois contre l’accaparement sont eux-mêmes des accapareurs.
« Les causes des malheurs publics », dit Saint-Just, résident dans « la faiblesse avec laquelle on exécute vos décrets ». Il dénonce donc les ministres et l’inertie de l’administration, le patriotisme de façade, le détournement de l’argent public, l’enrichissement personnel et la corruption. Ceux qui doivent faire respecter les lois contre l’accaparement sont eux-mêmes des accapareurs. Billaud-Varenne le redit le 18 novembre : ces lois ne sont pas appliquées parce qu’elles « frappent sur l’avidité des riches marchands dont la plupart sont aussi administrateurs ». On semble « vouloir dégoûter [le peuple] de sa liberté, en le privant sans cesse des bienfaits de la Révolution ». « L’intérêt particulier continue d’être seul le mobile de l’action civile », comme si la République n’avait pas été proclamée. Les commis du peuple sont supposés exercer une charge et être au service de l’intérêt général. Or, dit Saint-Just, « le service public, tel qu’on le fait, n’est pas vertu, il est métier ».
LE GOUVERNEMENT DOIT PESER SUR LUI-MÊME ET NON SUR LE PEUPLE
Par la voix de Saint-Just et de Billaud-Varenne, le Comité de salut public met en avant le principe de responsabilité des fonctionnaires publics, systématiquement bafoué, ce qui a engendré les « désordres », les « abus » et les « trahisons » au sein des autorités constituées. Il faut donc juger les coupables. À la suite du discours de Saint-Just, la Convention décrète la création d’un tribunal « chargé de poursuivre tous ceux qui ont manié les deniers publics depuis la révolution et de leur demander compte de leur fortune ». Cette lutte contre la vénalité et la corruption fait que les commis du peuple sont à cette époque jugés bien plus sévèrement que les citoyens ordinaires – à l’exception de ceux qui prennent les armes contre la République. Dans son discours sur les principes de morale politique (5 février 1794), également prononcé au nom du Comité de salut public, Robespierre définit la terreur comme « une conséquence du principe général de la démocratie » et la démocratie comme « un état où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu’il peut bien faire, et par des délégués tout ce qu’il ne peut faire lui-même ». La terreur (la crainte du peuple souverain) concerne d’abord ceux qui exercent des fonctions que le souverain leur a déléguées.
Les Comités de salut public et de sûreté générale ne sont pas des ministères. Lorsque certains Conventionnels envisagent d’ériger ces deux comités en pouvoir exécutif, leur proposition est immédiatement contestée et mise en minorité. Leurs membres sont élus par la Convention parmi ses membres ; leur mandat doit être reconduit tous les mois.
Il faut également repenser l’organisation du pouvoir exécutif ; aussi la Convention décrète-t-elle que « le conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués sont placés sous la surveillance du Comité de salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la Convention ». Dans ce rapport de Saint-Just, comme dans celui de Billaud-Varenne, le Comité de salut public présente la réorganisation du pouvoir exécutif comme un impératif républicain, non comme un expédient lié aux circonstances. « Nous avons décrété la République, et nous sommes encore organisés en monarchie », dit Billaud ; « la tête du monstre est abattue, mais le tronc survit toujours avec ses formes défectueuses ». La « centralité législative » exercée par la Convention est au cœur du dispositif. Celle-ci n’a rien de commun avec une centralisation administrative sous contrôle du pouvoir exécutif telle que nous la comprenons aujourd’hui. Les représentants en mission ne sont pas des agents du pouvoir exécutif (ils n’anticipent pas les préfets), mais les envoyés de la Convention dans les départements ou aux armées. Les Comités de salut public et de sûreté générale ne sont pas des ministères. Lorsque certains Conventionnels envisagent d’ériger ces deux comités en pouvoir exécutif, leur proposition est immédiatement contestée et mise en minorité. Leurs membres sont élus par la Convention parmi ses membres ; leur mandat doit être reconduit tous les mois.
CEUX QUI VEULENT FAIRE LE BIEN NE DOIVENT DORMIR QUE DANS LE TOMBEAU
Les rapports de Saint-Just et de Billaud-Varenne débouchent sur la loi du 4 décembre 1793 (14 frimaire an II) qui institue le gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix (« révolutionnaire » est ici entendu au sens d’extraordinaire). Elle encadre également la publicité des décisions de l’Assemblée afin qu’elles soient connues des citoyens qui pourront veiller à leur exécution. À cet effet, le Bulletin des lois de la République est créé. Il est imprimé sur papier spécial pour éviter les contrefaçons. La loi du 14 frimaire distingue les « lois révolutionnaires », qui concernent les mesures de salut public, et les « lois ordinaires ». Dans son rapport Sur les principes du gouvernement révolutionnaire (25 décembre 1793), Robespierre souligne que ces lois révolutionnaires ne sont pas « arbitraires ou tyranniques ». Le gouvernement révolutionnaire doit « se rapprocher des principes ordinaires » lorsque cela ne risque pas de « compromettre la liberté publique » et « s’abstenir des mesures qui gênent la liberté et qui froissent les intérêts privés sans aucun avantage public ». Il doit donc « voguer entre deux écueils : la faiblesse et la témérité ; le modérantisme et l’excès. »
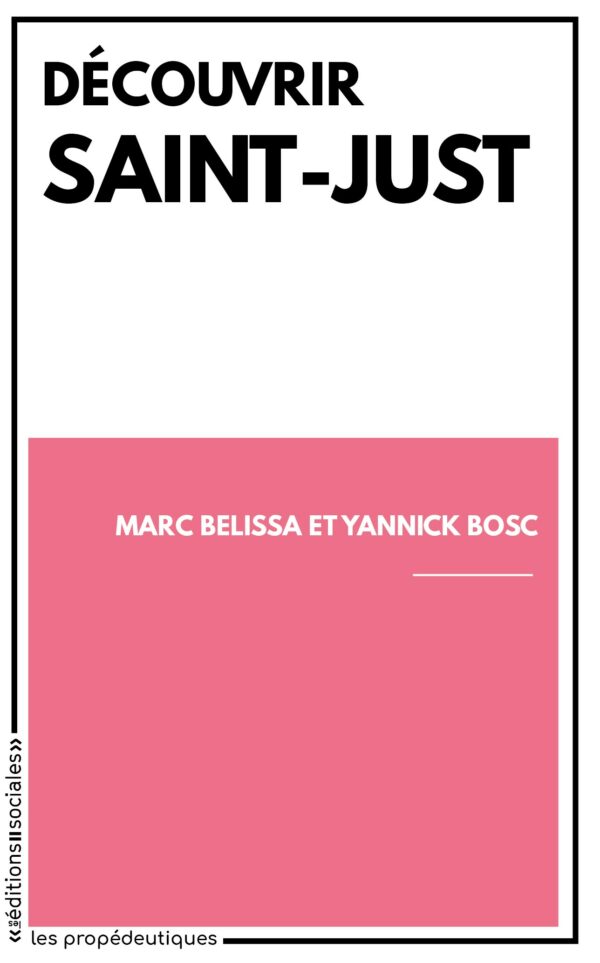
Le conseil exécutif est en charge de surveiller l’application des lois ordinaires et doit rendre compte au Comité de salut public ; cependant il n’est plus responsable des lois révolutionnaires dont l’exécution incombe exclusivement aux districts (l’échelon administratif juste au-dessus des communes). Quant à ces dernières (par exemple celles sur le maximum ou sur les suspects), elles sont mises en œuvre par les municipalités et comités révolutionnaires élus localement ; elles échappent ainsi aux départements. L’organisation repose donc sur une centralisation législative exercée par la Convention tandis que son exécution est décentralisée au niveau des communes – comme le stipulaient Saint-Just ou Robespierre dans leurs projets de Constitution. Les Montagnards, note l’historien Albert Mathiez, « ont compris que leur action gouvernementale, si résolue fût-elle entre leurs mains, serait cependant impuissante à galvaniser durablement les énergies du peuple français, s’ils ne l’associaient pas, ce peuple, directement à l’exécution des lois ». La loi du 14 frimaire permet une limitation du poids politique du pouvoir exécutif bien supérieure à celle qui est organisée par la Constitution du 24 juin 1793. Cette dernière, qui est un compromis, prévoit en effet que les ministres seront élus par les assemblées électorales des départements, chaque département nommant un candidat et l’Assemblée choisissant ensuite parmi eux les 24 membres du Conseil exécutif.