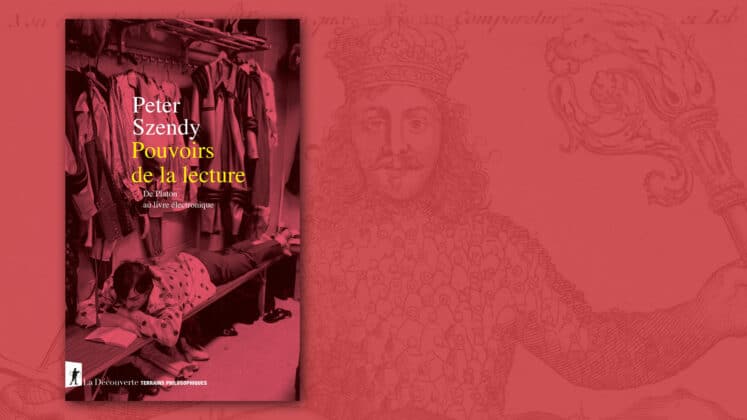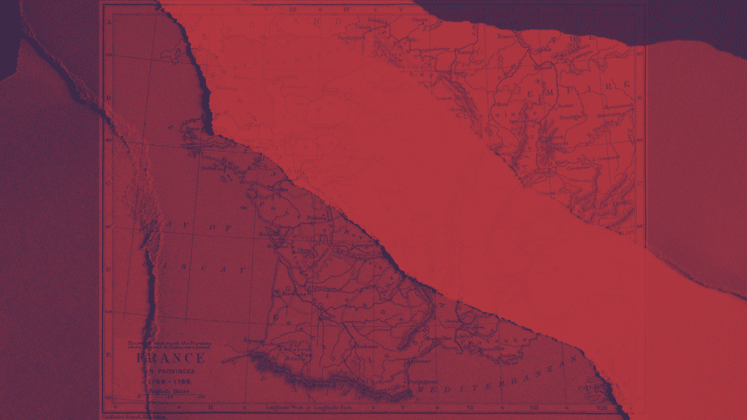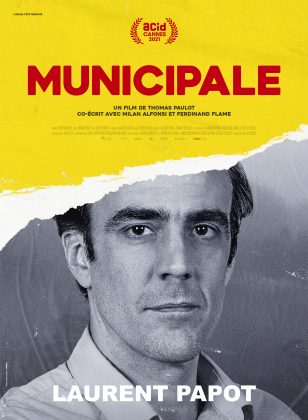Alexandre Langlois, du syndicat Vigi police, a choisi de protester contre la gestion politique violente et délétère des effectifs de police en présentant sa démission de ses fonctions de gardien de la paix. Sous le coup d’une nouvelle procédure administrative lancée en dépit de sa décision, nous l’avons interrogé sur les motivations de son geste, ainsi que sur sa vision des réformes nécessaires à l’amélioration des conditions de vie et de travail des policiers et à la reconstitution des liens entre cette institution et la population, que le pouvoir, par son instrumentalisation de la brutalité, semble avoir rompu.
LVSL – Vous avez récemment décidé de démissionner pour protester contre les manquements de la hiérarchie administrative au devoir de protection des fonctionnaires et de bonne gestion des personnels, accompagné de votre collègue Noam Anouar du syndicat VIGI Police. Vous dénoncez conjointement l’utilisation brutale de la répression en manifestation, ainsi que les conditions de travail poussant vos collègues au suicide. Quels évènements spécifiques vont ont conduit à cette décision ?
Alexandre Langlois – Pour être précis, c’est une rupture conventionnelle, que le ministère, en toute illégalité, à commencer à traiter à partir du 1er janvier 2021. La suite d’événements qui l’a précipité est la concomitance entre l’affaire Michel Zecler, où ce producteur a été tabassé par plusieurs policiers, suivi par des tirs de grenades, et le projet de loi sécurité globale, notamment l’article 24, sur la non-diffusion des visages des policiers, mais pas uniquement. Cela a été accéléré par la rhétorique gouvernementale : conjointement, Monsieur Darmanin et Monsieur Macron ont dit que dans cette affaire, ce qui les a choqué, ce sont les images du tabassage. Ce qui m’a choqué, c’est le tabassage, pas les images. La loi qui est défendue par Gérald Darmanin permettra de ne plus voir ces images, or cela semble être précisément ce qu’ils veulent. Nous sommes sur la négation des valeurs de la République. Nous ne voulons plus protéger les gens, mais cacher les déviances du gouvernement. Cette loi sur la sécurité globale va encore plus loin, parce que de façon générale, elle légalise l’affaire Benalla. Le syndicat VIGI – qui est partie civile au tribunal dans l’affaire Benalla — avait porté plainte pour tous les manquements qui ont été découverts, et nous sommes contents que la procédure commence à avancer avec le procureur de la République. Mais pourquoi disons-nous que cette loi permet la légalisation de ces pratiques dangereuses ?

Demain, les Benalla, les personnels privés pourront se déguiser en policiers, et plus personne ne pourra dire s’il en existe. Il y a une volonté de privatiser les missions régaliennes de l’État, avec le transfert de pouvoirs de police judiciaire à des sociétés privées. Ces entreprises n’ont pas à cœur l’intérêt général, mais faire de l’argent. C’est bien quand on vend une voiture, mais quand on assure une mission de l’État, cela pose un problème, notamment sur la question d’à qui va la fidélité. Dans l’affaire Benalla, Macron voulait privatiser sa sécurité. Nous avions des spécialistes de gendarmerie et de police qui ont assuré la sécurité de tous les présidents de la 5e République, sans jamais faillir à leur mission. Mais Macron voulait une sécurité privée. Pourquoi ? Parce qu’il y en a qui sont pour l’intérêt général, et d’autres dont la loyauté est achetée par l’argent. Comme disait Aristote, « il y a ceux qui dirigent un pays avec une garde de citoyens, et d’autres avec une garde contre les citoyens ». Tout cela fait fond sur un désengagement de l’État vers les polices municipales, qui pose un problème d’égalité des citoyens quant à la sécurité sur le territoire. Chaque commune, en fonction de ses budgets et de ses possibilités, n’aura pas la même police municipale. Toute commune, tout citoyen a un droit constitutionnel à une égale qualité du service public.
LVSL – Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à votre procédure disciplinaire en dépit de votre demande de démission ?
A. L. – J’ai écrit au ministre pour demander ma démission, en précisant que je ne voulais pas que cela prenne trop de temps, pour éviter que cela ne donne prise à une éventuelle sanction en termes de calendrier… La réponse du ministre a été de m’envoyer en conseil de discipline un mois après. Ce qui est assez amusant, c’est qu’après deux mois sans réponse, tout agent peut considérer que son administration accepte le départ, ce qui a d’ailleurs été confirmé par Mr. Darmanin. Une question lui a été posée quand il était ministre des comptes publics, au Sénat, pour connaître la nouvelle réglementation sur le silence de l’administration. Il a alors répondu qu’il n’y a pas de cadre précis, donc cela veut automatiquement dire qu’il y a une acceptation par l’administration dans ce genre de circonstances. Au lieu de quoi, il m’a donc envoyé en conseil de discipline. Ce conseil de discipline s’est bien passé, autant qu’il était possible. Dans la fonction publique, un conseil de discipline rend un avis, c’est au ministre d’avoir le dernier mot. En général, l’avis rendu est conforme à celui du conseil de discipline, pour avoir un paravent si l’une des parties prenantes est en désaccord avec cette décision.
Dans mon cas, tous les syndicats ont décidé de ne pas prendre part au vote, considérant que leur rôle n’est pas de juger la liberté d’expression syndicale. Il y a donc eu un front syndical. J’ai eu la chance d’être accompagné par des personnes ayant des profils totalement différents : un syndicaliste du FPIP qui est également au Rassemblement National, par Gérard Miller, et par David Dufresne. Ce dernier, pour l’anecdote, m’a appelé quelques jours avant ma convocation, parce qu’il veut faire un nouveau documentaire sur la police, et notamment sur ce qu’il se passe en interne, quand un policier dénonce certains agissements. Je l’ai donc rappelé pour qu’il puisse venir voir un cas concret. Il a accepté et il était content de venir. Finalement, aucune décision n’a été prise lors de ce conseil de discipline, c’est au ministre de trancher.
Par rapport à la première affaire et l’expérience que j’ai déjà eu, pour des motifs similaires de liberté d’expression syndicale, le conseil de discipline ne s’était pas non plus prononcé, et Mr. Castaner avait estimé que cela méritait une exclusion de 12 mois de fonction, dont 6 fermes. Mr. Darmanin a le choix, soit de légaliser la rupture conventionnelle qu’il a acceptée par sa non-réponse, soit de me sanctionner, en me renvoyant, me révoquant. C’est entre ses mains, donc je suis toujours en attente. Selon la jurisprudence, il a environ un mois pour se décider, ce qui nous amène aux alentours du 20 février. Le respect de la légalité par le ministère de l’Intérieur n’est cependant pas sa plus grande spécialité.
LVSL – Quelles mesures immédiates dans l’emploi et la gestion des effectifs de police recommanderiez-vous pour renouer le lien de confiance qui semble brisé entre ce corps d’État et la population ?
A. L. – La première chose à faire serait de réformer l’IGPN, l’inspection générale de la police nationale. Toutes les démocraties européennes ont un organisme de contrôle indépendant. En quoi cela recrée-t-il le lien entre police et les citoyens ? Cela a trois effets immédiats. Premièrement, il y a une transparence vis-à-vis de la population. Quand on se reporte à l’interview de la directrice de l’IGPN, Brigitte Julien, par Envoyé Spécial, on constante que quand elle est interrogée sur les plus de 300 affaires de violence sur les Gilets Jaunes, elle n’en considère que 2, avec un sourire narquois. Cela pose quand même un problème. En second lieu, cela pose également un problème sur la gestion en interne des dossiers concernant la discipline. Nous avons également eu un cas récemment, d’intelligence avec un pays étranger, concernant des ventes de fichiers de renseignement français au services de renseignements marocains à l’aéroport d’Orly. L’IGPN, alors sous la responsabilité de l’ancienne directrice, Madame Guillemard, semblerait avoir orienté l’enquête, à tel point que le juge d’instruction s’en est plaint dans les colonnes du Parisien, en effet, le directeur de la police des frontières d’Orly était son mari.
Il fallait donc le couvrir, trouver un responsable sans remonter trop haut. Cela pose des problèmes graves de fonctionnement interne de cette administration. Par ailleurs, cela permet de libérer la parole des policiers. Souvent, on se demande pourquoi les policiers ne dénoncent pas les faits qui se passent, les faits de violence illégale, de racisme, ou la mauvaise gestion. Ils ne le font pas, tout simplement parce que lorsqu’un policier veut le faire, il est envoyé en disciplinaire, pour manque de loyauté envers ses chefs, pour avoir porté atteinte au crédit et renom de la police nationale. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai été sanctionné notamment, pour discrédit et atteinte au renom de la police nationale : pour le directeur, en ayant médiatisé certains manquements et dysfonctionnements graves en interne, c’est de ma faute si l’image de la police a été ternie. A cela, j’ai opposé le fait que si jamais l’ordre avait été rétabli au sein de la police nationale, je n’aurai pas eu besoin de médiatiser. Nos collègues du syndicat avaient déjà averti. Pour nous, c’est eux les fautifs. Cela sera au tribunal administratif de statuer.

Cela libérerait donc la parole, parce que si les policiers n’avaient plus peur d’être envoyés en conseil de discipline pour avoir dénoncé des manquements de leur hiérarchie, et qu’un organe de contrôle indépendant est mis en place, ils pourront décrire plus librement les dysfonctionnements multiples dont ils peuvent être témoins. La hiérarchie sera peut-être plus encline à ne plus donner des ordres illégaux. Enfin, l’IGPN a également un rôle d’audit et d’amélioration du service public. Comment cela se passe-t-il aujourd’hui ? Le commissaire qui est à l’IGPN va échanger avec un commissaire dans un autre service, souvent ami, pour lui demander de bien le noter. C’est ce qui construit le discours officiel suivant lequel « dans la police française, tout va bien, circulez, il n’y a rien à constater ». Si ces évaluations étaient effectuées par un contrôle indépendant, comme en Angleterre, nous n’en serions pas là. Pour avoir discuté avec des collègues anglais, qui m’ont confié avoir agi avec précipitation sur certains sujets lors des émeutes de 2012. Ils ont commis des erreurs, les ont reconnues, et se sont demandés comment faire la prochaine fois pour que cela ne se reproduise pas. Cela permet une amélioration du service public, conjointement avec des personnes qui sont à la fois des professionnels et des usagers. Parce que souvent, notamment avec le Beauveau de la Sécurité, on parle de beaucoup de gens sauf des premiers concernés, sauf des usagers des services publics. Cela serait donc le premier et plus important maillon de la chaîne d’une grande réforme d’amélioration du fonctionnement de l’institution.
LVSL – Quel regard portez-vous sur la récente polémique autour de la Loi de Sécurité globale et son fameux article 24 concernant la captation d’images de policiers en manifestation ?
A. L. – Au sujet de l’article 24, il y a eu une hypocrisie terrible de la part du gouvernement et plus particulièrement de Monsieur Darmanin, qui a instrumentalisé la souffrance des policiers pour faire pleurer dans les chaumières et faire accepter l’inacceptable. Il a dit, par exemple, qu’il y a eu un attentat à Magnanville où deux policiers se sont fait assassiner chez eux par un terroriste, et que c’était à cause des réseaux sociaux et de la circulation numérique des images. C’est complètement faux. La cause principale est une fuite de données RH du ministère de l’Intérieur sur une clé USB. Est-ce que depuis ce problème a été résolu ? Non, donc cela peut se reproduire. Le ministre a également dit qu’il y a des policiers qui se suicident ou qui sont en dépression à cause de tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Faux. Les policiers se suicident et partent en dépression parce qu’il y a un management délétère, une perte de sens de leurs métiers, une destruction de leur vie personnelle par des horaires atypiques et beaucoup d’heures supplémentaires (dont une part considérable mal ou non payée). Une fois de plus, le ministère n’a rien fait pour régler ce problème.
Par ailleurs, avec cette loi, on pourra sanctionner de 12 mois de prison ceux qui filment les policiers avec de mauvaises intentions. La loi ordinaire, pour tout justiciable, permet déjà de protéger contre ce type d’action malveillante. Une collègue policière, à Versailles, a été suivie par un individu qui avait une intention manifeste de lui nuire. Elle a été filmée, a vu certaines de ses informations personnelles être diffusées. La personne qui a commis ces actes a été condamnée à 17 mois de prison ferme, — cinq mois de mieux que la loi de Monsieur Darmanin à son plafond —, si le juge applique la peine maximale.
Enfin, il a dit que, parfois, certains agents peuvent être identifiés sur le net et poursuivis jusque chez eux. La seule fois où des policiers ont reçu des menaces de mort chez eux, avec des courriers, les lettres mentionnaient : « on ne vous connaît pas, on ne vous a jamais vu, par contre, on sait où vous habitez et on peut venir vous tuer ». Comment ces personnes ont pu avoir l’adresse ? Grâce au Journal officiel, parce qu’ils avaient relevé les informations personnelles de tous les régisseurs des CRS, ont regardé leurs lieux d’affectation, ont cherché dans les pages blanches et les ont contactés. C’est une fois plus, une non-sécurisation des données à un niveau administratif, en interne, qui dans certains cas, pour la sécurité des agents ne devraient pas être diffusées au public. Rien n’a été fait non plus de ce côté-là. Nous sommes sur quelque chose d’assez abject : l’instrumentalisation de la souffrance des policiers, leurs suicides, le fait qu’ils peuvent être poursuivis chez eux, pour des motifs de politique politicienne, pour quelque chose qui n’a rien à voir avec la protection des policiers. C’est ce qui est scandaleux avec cet article de loi et sa défense par le gouvernement. Ce qu’il y a d’encore plus scandaleux, et c’est en cela qu’ils sont forts, c’est qu’ils l’ont remis dans la loi sur le séparatisme, dans l’article 18. C’est quasiment le même article reparu dans la loi qui a été votée le mardi 16 février.
LVSL – On assiste depuis plusieurs années à une transformation des doctrines et méthodes de la sécurité intérieure liée à la transformation numérique (reconnaissance faciale, usage des drones…). Il y a une récente décision de mai 2020, du Conseil d’État, d’interdire l’usage des drones pour motif de police administrative notamment sur la surveillance des manifestations. Cela témoigne de la profondeur des clivages liés à cette transformation. Craignez-vous que la technologie, une fois de plus, serve de justification aux dérives sécuritaires, et surtout, austéritaires du gouvernement ?
A. L. – C’est le cas depuis longtemps, même si cela s’est aggravé avec le mandat de Monsieur Macron. J’en veux pour preuve, par exemple, ce qui s’est passé à Viry-Châtillon. Des collègues ont été brûlés dans leur voiture parce qu’ils surveillaient une caméra de surveillance, qui elle-même surveillait un trafic de drogue. Dans un État normal, on se sert plutôt des policiers pour surveiller directement le trafic de drogue et interpeller les gens responsables, plutôt que de surveiller la caméra qui surveille le trafic de drogue… Une fois que cela est arrivé, ils ont renvoyé des CRS, pour continuer de surveiller la caméra de surveillance plutôt que de régler le problème. Pourquoi surveiller une caméra de surveillance plutôt que de régler le problème par des moyens humains traditionnels ? Est-ce que l’on veut surveiller plus largement, est-ce que l’on veut contrôler d’autres types de personnes ? Cet acharnement à défendre l’option technologique contre l’option humaine pose des questions légitimes sur les libertés publiques. Deuxième chose, qui était dans la loi sécurité globale, concernant les drones, il est déjà difficile d’avoir un accès pour rectifier les informations quand on est filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il y a bien des panneaux qui l’indiquent, mais on ne fait pas forcément attention. Avec un drone, il est impossible de savoir quand il va nous filmer. L’idée du gouvernement et de l’administration actuelle est d’enregistrer ce qu’ils veulent où ils veulent. Dans cette loi, sur les drones, c’est le seul article de la loi dans lequel il n’y a pas de sanction. Ils disent comment doivent être conservées les vidéos, comment doivent être utilisées les vidéos, mais ils n’évoquent jamais les procédures si la loi et les libertés constitutionnelles ne sont pas respectées.
Finalement, nous sommes en train de remplacer l’être humain par des moyens technologiques, alors que normalement, le moyen technologique doit être au service de l’humain. Des caméras de surveillance peuvent être utiles dans certains endroits, mais il faut que des patrouilles de police puissent intervenir. Là, nous avons juste des films à des fins de propagande politique, mais qui n’ont rien avoir sur la sécurité des usagers. Nous en revenons à l’affaire Benalla, au cours de laquelle les vidéos de surveillance de la préfecture de Paris ont été utilisés par l’Élysée, par un de ses conseillers spéciaux, et diffusées sur des comptes twitter anonymes. Par ailleurs, le directeur de la DOPC, direction de l’ordre public sur Paris, a conservé les vidéos plus de trois mois, alors que le délai légal est seulement d’un mois. Dans la loi, il est prévu un délai d’un mois, mais il n’y a aucune sanction si cela n’est pas respecté.
Concernant la surveillance faciale, quand c’est arrivé en Chine, de nombreux observateurs avaient dit que cela n’arriverait jamais en France. Et pourtant, c’est ce qui est en train de se développer à présent. Quand on voit ce qu’il se passe en Chine, la prochaine étape pourrait bien être le système de notation sociale numérique si on laisse les idéologues qui nous dirigent avec les mains libres… C’est donc inquiétant sur la dérive sécuritaire et autoritaire de l’État et de la classe politique, qui veut la main mise sur des moyens technologiques, car contrairement à des êtres humains, les technologies ne se rebelleront jamais.
Par ailleurs, nous avons numérisé la plupart des données, des fichiers, des services… Nous avons également crée des outils dont la prise de plainte en ligne. Cela crée aussi une coupure importante avec une partie de la population. Pour donner un exemple très concret, ma grand-mère n’a pas internet et n’a donc pas accès à ce service. Cela permet d’éviter certaines affaires et de faire baisser artificiellement le taux de délinquance parce que les gens n’ont pas accès à ces droits. Il y a un gros problème avec cette numérisation accélérée, on coupe le lien humain, dans un moment où on en aurait besoin, notamment dans l’accompagnement. On met en place une barrière numérique, pour faire de l’austérité sur le lien humain nécessaire au service public. Avec la numérisation des plaintes, il n’y aura pas d’accompagnement des victimes, ce qui est quand même assez dramatique dans les missions de la police…
Sur l’utilisation de matériel, cela ne se limite pas au numérique, on essaie de remplacer les êtres humains qui vont dans les manifestations, par exemple, par de l’armement. L’armement sert, normalement, en cas de problème parce qu’on n’a pas assez d’effectifs humains. On a pris la logique inverse, on a renvoyé des effectifs pour les remplacer par de l’armement et cela conduit à augmenter la quantité des blessures graves, des mutilés, parce que les effectifs humains ne sont plus suffisants pour maîtriser une situation de façon moins violente. Il y a toutes ces dérives, qui mènent à plus de sécuritaire, plus de contrôle, et surtout, avec le moins de gens possible. L’objectif lisible derrière ces choix est une société de surveillance généralisée où tous les fichiers peuvent être pilotés au niveau central, demandant un cercle restreint de personnes de confiance, verrouillé en fonction d’objectifs soustraits à la vue des institutions démocratiques et des citoyens. La CNIL rends certes des avis, mais comme nous l’avons vu dans le cadre du fichage centralisé « Gendnotes » portant sur des opinions politiques, religieuses, syndicales, sexuelles, y compris certaines données de santé normalement protégées par le secret médical, ce genre de décisions liberticides passent tout de même facilement. Ce qui est assez inquiétant quant à l’état de notre système politique.
Un député avait proposé dans le cadre des débats sur la loi contre le séparatisme, que le ministre de l’Intérieur puisse décider tout seul des assignations à résidence, sans contrôle du juge. Heureusement, l’amendement a été écarté, car inconstitutionnel, mais on voit l’idée du projet. La dérive autoritaire est bel et bien installée au cœur de la classe politique actuelle…
LVSL – Allez-vous continuer votre démarche civique autour des questions de sécurité à suite de votre démission ? Quelle forme va prendre votre engagement à présent ?
A. L. – Oui, je vais continuer. J’aimais mon métier, mais il a été dénaturé. J’avais décidé de quitter la police quand il n’y aurait plus de moyen de résister en interne. En interne, à chaque fois que l’on fait quelque chose, nous subissons un conseil de discipline, des sanctions, et même quand on gagne au tribunal, cela prend trois ans. Au bout d’un moment, dans la vie de tous les jours, cela devient compliqué de boucler les fins de mois. J’ai donc décidé de quitter cet endroit anxiogène, délétère et que je peux continuer à suivre de l’extérieur, fort de mon expérience. Il y a un premier projet qui s’est mis en place, l’association « IGPN citoyen », de laquelle je suis président. Nous cherchons à faire tomber ce premier domino. Nous avons imaginé un modèle participatif inspiré des jurys d’assises. Si nous avons deux tiers de citoyens non policiers, tirés au sort et un tiers de policiers, également tirés au sort, nous avons un certain équilibrage. En général, les jurys d’assises donnent des décisions qui sont en adéquation avec l’attente populaire, et cela permet de la transparence. C’est donc un premier combat, et je pense que si ce domino tombe, cela permettra de redonner de la confiance dans la police, et d’aider les gens et les policiers qui sont anonymes, qui résistent à des ordres illégaux et aux pressions qu’ils reçoivent de leurs supérieurs hiérarchiques.

Soit je me résigne à changer complètement de secteur professionnel, soit je trouve un moyen de continuer le combat en en faisant mon activité principale, par exemple par de l’associatif, avec des budgets, ou du conseil politique. Il y a plusieurs options. Et si ce n’est pas possible, je continuerai en trouvant un travail alimentaire en complément tout en continuant le combat. Je n’ai pas envie de laisser la police dans cet état, parce qu’elle est garante des libertés individuelles, celles que nos dirigeants abîment, en permettant l’oppression du peuple plutôt que de permettre son épanouissement, et je n’ai pas envie que mes enfants grandissent dans un monde pareil. Le combat va donc continuer.
Pour qu’il y ait un débat démocratique en France, il faut qu’il y ait des limites, parce qu’on ne peut pas faire usage de violence ou de mensonge, comme l’avait pourtant dit Sibeth Ndiaye, qui assumait le recours au mensonge pour faire passer les réformes pour lesquelles la majorité a été élue. Non seulement ces gens ne vont pas sur le terrain, mais pire encore, les réformes pour lesquelles ils ont été élus ont été savamment camouflées dans une rhétorique creuse autour de l’énergie entrepreneuriale, la « start up nation ». On assiste à une inversion des valeurs.
Je vais quoi qu’il arrive continuer le combat contre ces injustices, mais je ne sais pas définitivement sous quelle forme. La seule corde que j’ai à mon arc, c’est que j’avais prévu une reconversion comme détective privé, au cas où !