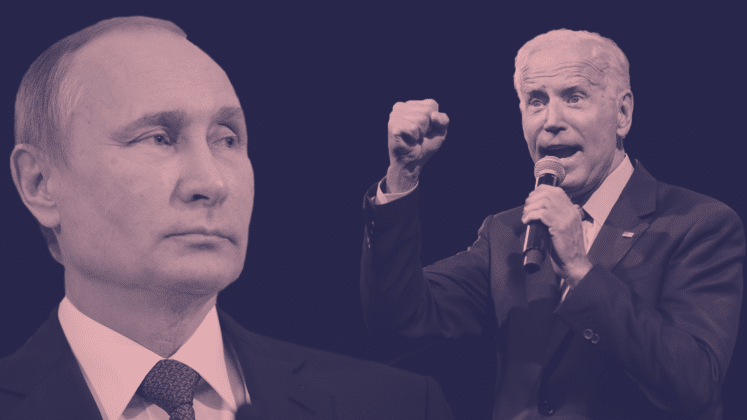Avec les hausses de prix observées dans le sillage de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, le débat sur l’inflation resurgit sur le devant de la scène politique et médiatique. Qui doit en supporter le coût ? Les multinationales qui ont dégagé des profits exceptionnels ou la grande partie de la population dont les revenus nets sont rognés ? On assiste dans ce contexte au grand retour d’une orthodoxie monétaire que l’on pensait remisée au placard, depuis le « quoi qu’il en coûte » et le déversement de torrents de liquidités par les banques centrales. Nous revenons ici sur les origines de cette doxa encore vivace, qui place la lutte contre l’inflation au cœur de la politique économique en appelant à la rigueur salariale, monétaire et budgétaire.
Qu’est-ce que l’inflation ? En théorie, il s’agit d’une hausse globale des prix dans une monnaie. Dans la pratique, les instituts de la statistique mesurent l’inflation par l’intermédiaire d’un indice des prix à la consommation sur un territoire et une période donnés (communément sur les douze derniers mois). En France, l’INSEE mesure son indice des prix à la consommation (IPC) depuis 1914 ; aux Etats-Unis la première mesure du Consumer Price Index (CPI) par le Bureau of Labor date de 1921.
Ces indices rendent compte de l’évolution des prix d’un nombre limité de biens et services de consommation courante (700 pour l’indicateur employé par Eurostat) : pain, vêtements, électroménager, coupe de cheveux… L’objectif d’une telle mesure est autant de rendre compte de l’évolution des prix que de celle du pouvoir d’achat de la monnaie : lorsque les prix augmentent d’une année sur l’autre, une même quantité d’euros permet d’acheter un nombre moindre de produits.
L’impact de cette perte de pouvoir d’achat est variable selon les conditions et les positions économiques. Les acteurs économiques dont les revenus suivent la hausse des prix sont favorisés, les autres subissent l’effet de la baisse du pouvoir d’achat. En outre, l’inflation a l’avantage de réduire le poids de la dette publique : elle gonfle les rentrées fiscales et le PIB, et grignote la valeur des intérêts payés. De même, lorsque les salaires suivent la hausse des prix – par le biais de négociations salariales ou d’une indexation automatique des revenus – elle peut également être avantageuse pour les ménages endettés, en réduisant la valeur réelle de leurs dettes.
Mais l’inflation peut également devenir un « impôt sur les pauvres » lorsque les revenus des catégories populaires ne sont pas indexés et que les prix de l’énergie, du transport et de la nourriture augmentent. Prêteurs et rentiers voient également la valeur de leurs créances et de leur épargne diminuer. Bref, l’inflation opère ainsi une forme de redistribution à géométrie variable, dont la teneur n’est pas définie en soi et dépend des arrangements institutionnels et des rapports de force sociaux.
L’inflation opère une forme de redistribution à géométrie variable, dont la teneur n’est pas définie en soi et dépend des arrangements institutionnels et des rapports de force sociaux.
Depuis plusieurs décennies, la question de l’inflation a été tout particulièrement instrumentalisée dans le discours néolibéral pour réduire le champ des possibles en termes de politique économique et imposer sa doxa. Pour le comprendre, il faut revenir aux années 1970-80. Dans cette période, les Etats-Unis ont été confrontés à des taux d’inflation élevés – à deux chiffres en 1974 et de 1979 à 1981 – ainsi qu’à plusieurs années de stagnation et une hausse importante du chômage. C’est pourquoi cette période est qualifiée de crise de la « stagflation » (stagnation et inflation).
Les perturbations économiques liées à la persistance d’une inflation élevée vont s’avérer une aubaine pour les penseurs du néolibéralisme, dont l’influence était alors grandissante, et une occasion de remettre en cause le rôle de l’Etat et des syndicats dans la politique économique. Pour eux, l’inflation est la résultante de la politique économique d’inspiration keynésienne, et elle doit être combattue de toute urgence. Non pas pour ses conséquences délétères pour le pouvoir d’achat des catégories populaires, mais parce qu’elle serait rien de moins qu’une menace existentielle pour l’économie de marché.
Pour Walter Eucken, chef de file de l’école ordolibérale, l’inflation « détruit le système des prix et donc tous les types d’ordre économique1». Selon James Buchanan et Richard Wagner, figures de l’école de Virginie, elle « sape les anticipations et créé de l’incertitude2 ». Incapables de prévoir leurs coûts de production, prix de vente et bénéfices futurs, les entreprises freineraient leurs investissements. D’autres conséquences de l’inflation sont brandies comme autant de dangers pour l’ordre économique.
Sur le plan commercial, la hausse des coûts de production liée à des prix plus élevés obérerait la compétitivité des entreprises nationales. Sur le plan monétaire, elle viendrait miner la valeur des devises. Sur le plan financier enfin, l’inflation conduirait par ailleurs à rogner la rémunération de l’épargne – donc les revenus des plus riches – au point de favoriser la consommation immédiate et les placements plus risqués. Épargnants et créanciers seraient ainsi lésés, tandis que les emprunteurs dont les revenus sont indexés à l’inflation voient le poids de leur dette diminuer. La revanche de la cigale sur la fourmi ? « Un comportement prudent devient irresponsable et l’imprudence devient raisonnable3 » s’émeut l’économiste Milton Friedman.
Ces condamnations eurent un écho certain dans la période des années 1970-80. Le patronat étatsunien – financier et industriel – est séduit par les imprécations anti-inflationnistes des monétaristes, pointant du doigt l’incurie de l’interventionnisme d’Etat. Les autorités semblent incapables de circonscrire l’inflation, dans un contexte de crise énergétique, de chômage persistant et de croissance atone. Les leviers habituels de politique économique censés réaliser un compromis entre chômage et inflation, lointainement inspirés du keynésianisme, semblent inopérants.
Dès lors, les diagnostics et « remèdes » formulés par les économistes néolibéraux vont occuper le devant de la scène académique et politique. Et vont offrir une place considérable aux mécanismes de marché au détriment de l’intervention publique. On distingue en particulier trois courants dont les contributions continuent encore largement d’irriguer les débats actuels sur l’inflation.
Les trois courants de la refondation néolibérale
Le premier courant est sans doute celui qui a constitué la critique la plus bruyante des politiques d’inspiration keynésienne. Il s’agit du monétarisme de Milton Friedman. Pour ce dernier, « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire4 ». En d’autres termes, les hausses de prix seraient la conséquence de l’augmentation de la masse monétaire et non d’autres facteurs – comme la hausse des prix du pétrole. Dans le viseur : les politiques de relance d’inspiration keynésienne qui articulent dépense publique et expansion monétaire pour stimuler la croissance et réduire le chômage.
Selon Milton Friedman, ces politiques sont intrinsèquement inflationnistes et contre-productives. En cherchant à réduire le chômage en dessous d’un taux d’équilibre, elle serait même responsables de l’accélération de l’inflation, en entraînant notamment les salaires à la hausse. L’orientation qu’il préconise est celle d’une politique monétaire restrictive, ne poursuivant aucun objectif de politique économique sinon celui de fournir seulement la quantité de monnaie nécessaire à l’activité économique.
Aux critiques des monétaristes se sont ajoutées celles d’un second courant : celui de Robert Lucas et des économistes de la « nouvelle école classique ». Pour ces tenants d’une refondation de la théorie néoclassique « pure », les agents économiques sont à même d’anticiper toutes les conséquences des interventions monétaires. Leurs conclusions, obtenues à grand renfort de modèles mathématiques complexes, radicalisent celles des monétaristes : toute politique interventionniste serait vouée à l’échec, face à des agents parfaitement rationnels.
Malgré le succès de ces deux écoles néolibérales, dans un contexte économique et politique favorable, les critiques n’ont pas manqué à leur égard. L’explication monétariste de l’inflation se refuse, malgré l’évidence, à considérer d’autres causes que celle de la quantité de monnaie. Les hypothèses irréalistes retenues par ailleurs par les tenants de la « nouvelle école classique » – qui postulent que les acteurs sont parfaitement rationnels et parfaitement informés – ont par ailleurs jeté le doute sur la pertinence de leurs modélisations et de leurs résultats.
Un troisième courant va proposer de « prendre le meilleur des approches concurrentes qui l’ont précédé » selon les termes d’une de ses figures, Gregory Mankiw. Sur le papier, il s’agirait d’une voie intermédiaire entre le néolibéralisme et la tradition keynésienne. En pratique, les économistes de la « nouvelle synthèse néoclassique » reprennent à leur compte le cadre d’analyse et les outils des nouveaux classiques avec une nuance : sur le long terme, le marché est efficient ; mais sur le court-terme il existe des imperfections qui l’empêchent de s’équilibrer – et donc des opportunités pour certaines interventions publiques.
Parmi ces « nouveaux keynésiens », des noms qui résonnent encore dans les débats actuels sur la résurgence de l’inflation : Joseph Stiglitz, Lawrence Summers, Janet Yellen (présidente de la FED entre 2014 et 2018) ou encore Olivier Blanchard (actuel chef économiste au Fonds monétaire international).
Un nouveau paradigme monétaire
Les trois courants vont contribuer à un aggiornamento de la politique monétaire aux Etats-Unis comme en Europe. Encore aujourd’hui, la grille de lecture de cette nouvelle synthèse néolibérale inspire largement les débats sur l’inflation – ses causes, ses remèdes – et les décisions des banquiers centraux. Les grands principes de cette nouvelle doxa se donnent à lire dans les manuels « orthodoxes » de macro-économie5.
Le premier est l’hypothèse d’un marché autorégulateur : sur le long terme, l’économie tendrait vers des niveaux optimums d’activité, de prix, et de chômage. Mais à court et moyen terme, des « chocs » peuvent l’éloigner de l’équilibre et faire resurgir le spectre de l’inflation. Dès lors – c’est le second principe – l’objectif de la politique économique est de permettre un rétablissement optimal de l’équilibre. En d’autres termes : l’intervention des autorités est tolérée à condition qu’elle vise à garantir des conditions optimales pour le fonctionnement du marché.
Pour les néolibéraux, l’intervention des autorités est tolérée à condition qu’elle vise à garantir des conditions optimales pour le fonctionnement du marché.
Quels sont les chocs qui peuvent perturber l’économie ? La crise de la « stagflation » en donne plusieurs illustrations toujours d’actualité. La plus évidente étant le « choc d’offre » lié à la hausse brutale du coût de l’énergie suite aux chocs pétroliers de 1973 et de 1979. La hausse du prix du pétrole a une importance majeure sur le niveau des prix car elle entraîne la hausse du prix de l’essence, du fioul, mais aussi du gaz naturel et du charbon. Elle augmente le prix du transport aérien et routier, des plastiques et matières premières et donc les coûts de nombreuses entreprises qui peuvent être amenées à augmenter leurs prix en retour.
D’autres chocs d’offre peuvent également expliquer l’inflation élevée et la stagnation des années 1970 aux Etats-Unis : la hausse des prix des produits agricoles, la hausse du prix des produits importés en conséquence de la dépréciation du dollar, ou encore une diminution des gains de productivité.
Comment réagir à de tels « chocs adverses » ? Jusqu’aux années 1970, la réponse consacrée des autorités avait été d’administrer un « choc de demande » à l’économie, sous la forme d’une politique monétaire généreuse (taux d’intérêt bas, injection de liquidités) et d’investissements publics. C’est le principe d’une politique « accommodante », ou encore de la « relance keynésienne ». L’objectif : contrebalancer l’effet d’un choc adverse en stimulant l’activité et l’emploi au prix d’une hausse, censée être temporaire, de l’inflation.
Mais s’il on en croit la doxa néolibérale, une telle politique serait vouée à l’échec : elle conduirait non seulement l’économie à la « surchauffe », mais à une accélération de l’inflation. Celle-ci résulterait d’un cercle vicieux où les hausses de prix alimenteraient les hausses de salaires et réciproquement – salariés et entreprises anticipant une inflation élevée. On dit alors que les anticipations des agents ne sont plus « ancrées » – ces derniers ne croyant plus dans la capacité des autorités à contrôler l’inflation.
L’indexation des salaires, permettant à ces derniers de suivre la hausse des prix, serait par ailleurs un facteur aggravant. Pour l’économiste Robert Gordon, « chocs d’offre, politique accommodante et indexation des salaires est une trinité maudite qui peut mener à l’hyperinflation6 ». La période de la stagflation ne serait donc rien d’autre que l’illustration d’une telle spirale, désignée comme «boucle prix-salaires», menant l’économie tout droit à l’abîme.
Les amers remèdes néolibéraux
Circonscrire le risque inflationniste va devenir, à partir de la fin des années 1970, un impératif de premier plan de la politique monétaire. Quitte à provoquer dégâts sociaux et récession. La hausse drastique du taux directeur de la Fed, mise en œuvre par son président Paul Volcker en 1979, va constituer un événement fondateur de la nouvelle doctrine.
Ce « remède » monétariste se présentait comme un contre-pied au principe de relance keynésienne. Il se donnait pour objectif de réduire l’inflation et d’éteindre la « surchauffe » de l’économie étatsunienne par un violent coup de frein, qu’importe les conséquences sociales. Le résultat ne se fit pas attendre : hausse du coût du crédit, faillites en cascade, récession et chômage ont frappé les Etats-Unis dans les années 1982-1983.
Ce brusque coup de frein poursuivait un second objectif : garantir la « crédibilité » de l’engagement de la Fed à réduire l’inflation. Il répondait à une autre préoccupation mise en avant par les économistes néolibéraux : celle de « ré-ancrer » les anticipations des acteurs économiques, de sorte que ces derniers soient convaincus de la détermination des autorités à prendre des mesures fortes contre l’inflation.
La recherche de crédibilité à l’égard des créanciers et des marchés financiers va ainsi devenir un impératif de la politique économique. Dans l’Union européenne elle prendra la forme de règles adoptées dans le Traité de Maastricht signé en février 1992 : l’interdiction de la monétisation des déficits publics et l’indépendance de la Banque centrale européenne. L’objectif : bannir ex ante des politiques jugées inflationnistes et s’en tenir à des règles explicites de gestion monétaire. Une constitutionnalisation de l’action publique en tous points conforme aux principes de l’ordolibéralisme.
Derrière un vernis de théorie économique néolibérale, cette nouvelle doxa va, à partir des années 1990, graver dans le marbre des traités un choix politique en faveur des intérêts des possédants.
En temps « normal », la nouvelle doctrine de la politique monétaire va consister à surveiller l’inflation comme le lait sur le feu. Garantir « la stabilité des prix » constitue la mission première de la BCE inscrite dans son mandat. Cet objectif est partagé par la Fed, qui doit également favoriser la croissance et l’emploi. En pratique cela se traduit par une politique restrictive visant à augmenter les taux pour réduire le crédit et l’activité lorsque l’économie est considérée en surrégime et le chômage en dessous de son niveau « naturel ».
Face à un choc d’offre adverse, comme la hausse du prix de l’énergie, deux stratégies sont envisagées : « éteindre » l’inflation d’offre en appliquant une politique restrictive, afin d’éviter toute spirale inflationniste qui pourrait la rendre permanente ; ou appliquer une politique neutre – ne rien changer – en considérant que l’inflation est transitoire et que les prix retrouveront leur niveau d’avant le choc.
Derrière un vernis de théorie économique néolibérale, cette nouvelle doxa va, à partir des années 1990, graver dans le marbre des traités un choix politique en faveur des intérêts des possédants. Côté pile, le maintien de l’inflation à un niveau modéré va favoriser les créanciers en rétablissant leurs rentes. Côté face, l’impératif de la modération salariale, la rigueur monétaire et budgétaire vont achever de détruire le pouvoir de négociation des syndicats et des salariés.
Ne plus voir l’inflation comme un mal, mais comme un outil
La crise de 2008 et la « Grande Dépression » qui s’en est suivi vont cependant remettre en cause la doxa monétariste. Face au risque d’une spirale déflationniste entraînant vers le bas les prix et l’activité économique, les banques centrales vont être contraintes de mobiliser des politiques « non conventionnelles » : taux bas, voire négatifs, politiques de rachats de dettes publiques et d’actifs financiers (quantitative easing). Le risque de dépression économique suite à la crise du Covid va amener les gouvernements à recourir à l’arme budgétaire, dépensant sans compter (le fameux « quoi qu’il en coûte ») pour maintenir l’économie à flot.
Pour autant, la remise en cause de la doxa néolibérale a constitué moins une rupture qu’une continuation par d’autres moyens. Car les intérêts sociaux servis par les nouvelles politiques « non conventionnelles » et le surcroît de dépenses publiques sont les mêmes : grandes entreprises et grands intérêts financiers bénéficient d’un filet de sécurité toujours plus généreux, sous la forme d’aides publiques et de politiques fiscales favorables. Bref, une politique inconditionnelle de soutien (si ce n’est « d’assistanat ») en faveur du secteur privé.
La remise en cause sera par ailleurs de courte durée, puisque le retour de l’inflation s’accompagne, depuis 2021, d’une remise au goût du jour de la doxa monétariste professant la modération salariale et la baisse des dépenses publiques. La brutale hausse du taux directeur de la FED, de 0,25% en début d’année à 2,5% aujourd’hui, n’est pas aussi brutale que celle opérée par Paul Volcker il y a quatre décennies, mais elle s’inspire bien des mêmes préceptes.
Les banques centrales doivent être remises sous tutelle démocratique.
Les contradictions du néolibéralisme semblent désormais atteindre leur paroxysme. Comment concilier la politique de mise sous perfusion des entreprises industrielles et financières, engagée depuis la crise de 2008, et la lutte contre l’inflation par des mesures budgétaires et monétaires restrictives ?
Une chose est sûre : une alternative au chaos économique supposerait d’engager une véritable rupture avec la doxa néolibérale. Celle-ci suppose d’engager tous les moyens à la disposition de la puissance publique : une gestion de la monnaie et de la fiscalité au service d’investissements publics massifs, à même de répondre aux urgences sociales et écologiques. Pour ce faire, les banques centrales doivent être remises sous tutelle démocratique.
Dans une telle configuration, l’inflation ne doit pas être considérée comme un bien ou un mal en soi, mais comme un indicateur parmi d’autres. En réinstaurant une indexation des revenus des catégories moyennes et populaires, elle peut même se transformer en outil de redistribution et contribuer à une « euthanasie des rentiers », pour paraphraser la formule attribuée à Keynes.
Notes :
[1] Walter Eucken, This Unsuccessful Age or The Pains of Economic Progress, Oxford University Press, 1952.
[2] James M. Buchanan et Richard E. Wagner, Democracy in Deficit, Academic Press, 1977.
[3] Milton Friedman, Monetarist economics, Basil Blackwell, 1991.
[4] Milton Friedman, Inflation et système monétaire, Calmann-Lévy, 1968.
[5] Les paragraphes suivants sont une synthèse des propos développés dans les manuels de macroéconomie d’Olivier Blanchard (2020) et de Robert Gordon (2014).
[6] Robert J. Gordon, Macroeconomics (12th edition), Pearson, 2014.