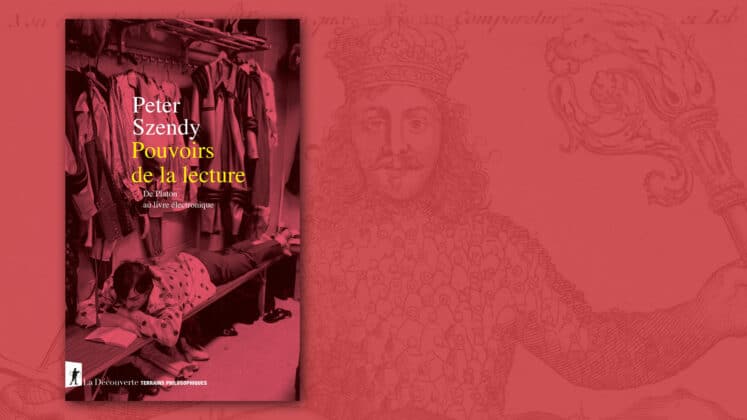Michel Valensi dirige depuis trente-sept ans les Éditions de l’éclat, créées avec Patricia Farazzi en 1985, et qui arpentent les marges de la philosophie et de la littérature. On leur doit par exemple la collection « Premier Secours », pensée pour un siècle accidenté à qui manque une respiration utopique. Il y a plus de vingt ans, en mars 2000, Michel Valensi s’est aussi promis de « faire l’impossible » en donnant naissance au premier livre libre, baptisé « lyber ». L’ambition annonçait la couleur possible du siècle : entre démocratisation de la consultation en ligne et chance de diffuser plus largement des textes confidentiels. Les logiques de l’industrie culturelle en ont décidé autrement, creusant encore davantage l’écart entre grands groupes éditoriaux et maisons artisanales, impératif de rentabilité et promesses de la gratuité, ciblage publicitaire et constitution imprévisible des lectorats. Reste à compter sur la génération suivante d’éditeurs, à qui Michel Valensi transmet volontiers le flambeau. Entretien réalisé par Laëtitia Riss.
LVSL – Les Éditions de l’éclat ont été fondées en 1985 et abritent aujourd’hui près d’une dizaine de collections et quelques centaines de titres. C’est un catalogue majoritairement philosophique, que vous avez choisi de construire, à la croisée d’héritages intellectuels hétérodoxes (pragmatisme, opéraïsme, messianisme…). Pourriez-vous nous les présenter et préciser ce qui constitue leur cohérence d’ensemble, selon vous ?
Michel Valensi – L’éclat a été créé avec Patricia Farazzi, qui se consacre plus aujourd’hui à l’écriture et suscite certains projets éditoriaux, comme le récent volume d’essais d’Ursula K. Le Guin, et qui a traduit pour L’éclat le philosophe italien Giorgio Colli (1917-1979). On doit à ce dernier, entre autres choses, l’édition en allemand des œuvres complètes de Nietzsche (qui servira de base aux autres éditions en français, anglais, espagnol etc.). Colli fait partie de ces quelques auteurs, avec Carlo Michelstaedter, Yona Friedman, Jules Lequier, auxquels nous revenons sans cesse quand il s’agit de décider d’une orientation nouvelle, de faire un choix de fond quant à la ligne éditoriale, et là encore nous suivons Colli quand il écrit : « Choisir à temps ses maîtres et qu’ils soient peu nombreux. Les serrer, les presser, les épuiser, les tourmenter, les mettre en pièces et les remettre ensemble sans céder au charme de la polymathie. » (ndlr : la polymathie désigne la prétention à un savoir encyclopédique). De même que nous nous sommes inspirés de Michelstaedter pour le lyber quand il écrit : « donner, c’est faire l’impossible ».
Mais par-delà cette origine, je dirais que ce qui est au centre du projet de L’éclat, ce qui fait la cohérence du catalogue, ce sont les marges, sa « marginalité » vissée au corps. C’est-à-dire que nous nous tenons toujours aux marges de ce qui se publie, et non seulement aux marges de ce qui se fait dans les « institutions » quelles qu’elles soient – et même quelquefois aux marges de ce qui peut se faire ou se dire aux marges « établies », ce qui réduit encore l’espace dans lequel nous nous faufilons – mais procure malgré tout un sentiment de liberté qui n’est pas désagréable. Le souci de L’éclat a toujours été en ce sens de refuser les cadres disciplinaires et nous avons cherché à concilier publications philosophiques et ouvertures multiples vers la littérature, la poésie, l’architecture, la mystique etc. Les deux collections, dont nous sommes initialement partis, et qui existent toujours, illustrent ce choix : la première s’appelle « Philosophie imaginaire », et la deuxième « Paraboles », intitulés qui signalent d’emblée cette porosité entre les genres, cette androgynie des sens.
En complément de ces deux collections, il reste aujourd’hui trois collections actives et une moins active consacrée à la pensée grecque et intitulée « Polemos », « père de toutes choses », comme vous savez. Les trois collections sont : « Premier secours », créée en 1996, dédiée à la pensée critique et aux utopies, « L’Éclat/poche », créé en 2015, qui reprend au format poche et au prix poche des titres de notre propre fonds, auxquels viennent maintenant s’ajouter des ouvrages publiés chez des amis ou des confrères, et les « éclats », une collection de plaisir éditorial née en 2012, où l’on s’amuse à mélanger les genres et surtout à faire se côtoyer les univers et les auteurs les plus divers : Michelet et sa Jeanne d’Arc avec Mieux vaut moins, mais mieux de Lénine, la tauromachie de José Bergamín avec le jazz de John Coltrane, ou des textes classiques et contemporains comme Le dialogue des Méliens et des Athéniens de Thucydide avec L’animal d’expérience de Patricia Farazzi, où, en forme d’hommage, il est question d’une souris nommée Joséphine.
Parallèlement à ce catalogue hétéroclite, la philosophie analytique, qui a donné naissance à certains courants du pragmatisme, a un statut à part et a eu une collection « à part », baptisée précisément « Tiré à part » et qui s’est arrêté en 2009, même si les titres sont toujours disponibles ou réimprimés dans la mesure du possible. « Tiré à part » a été à l’image de ce que peut être le métier d’éditeur : une rencontre avec l’inconnu. J’ai connu en effet Jean-Pierre Cometti en 1987, à l’occasion d’une traduction du philosophe italien Aldo Gargani, trop tôt disparu et trop vite oublié, et il m’a proposé de développer une collection consacrée à ce pan de la philosophie dont on était, à l’époque, encore très peu familiers en France, à l’exception de quelques rares philosophes comme Jacques Bouveresse ou François Recanati pour ne citer que ceux-là et qui n’avaient pas vraiment, c’est le moins qu’on puisse dire, les faveurs ni de l’institution philosophique ni des médias.
« Tiré à part » a été à l’image de ce que peut être le métier d’éditeur : une rencontre avec l’inconnu.
J’en étais moi-même à des milliers de kilomètres ; mais c’est paradoxalement cet éloignement qui m’a fait m’en rapprocher d’un point de vue éditorial et qui a permis la naissance de « Tiré à part ». J’ai laissé à Jean-Pierre Cometti toute latitude quant aux choix éditoriaux et nous nous sommes associés pendant plus de vingt ans pour donner accès à des textes et des auteurs de cette tradition, en privilégiant des écrits les plus récents possibles qui paraissaient en revue, et qui témoignaient des différents « travaux en cours » de cette philosophie. D’où le titre « Tiré à part ». Plus d’une cinquantaine de volumes ont paru entre 1989 et 2009, même si le projet initial a évolué vers des livres de plus gros formats, comme le beau livre de Bouveresse sur Robert Musil, ou le très étrange Sur la pluralité des mondes de David Lewis. Stanley Cavell, Richard Rorty, Nelson Goodman, Donald Davidson, Hilary Putnam, ont ainsi été traduits en français dans des volumes inédits, élaborés le plus souvent conjointement avec les auteurs et les traducteurs. On s’est beaucoup battus avec Jean-Pierre pour cette philosophie, même si, rétrospectivement, on se rend compte qu’elle a assez vite intégré dans certains cas les travers de ce qu’a pu être la philosophie dominante en France et qui n’a pas manqué, en son temps, d’ostraciser cette pensée différente, mais qui n’était pas pour autant pensée de la différance. « Tiré à Part » a duré vingt ans : c’était le temps de faire notre travail, de donner à lire pour que les jeunes générations puissent disposer d’un panel le plus large possible de ce qui s’écrivait et se faisait en philosophie. Le reste, finalement, ne nous regardait plus éditorialement, pas plus que les avatars que cette philosophie a elle-même engendrés, mais ce sont les risques, toujours, de l’institution. Nous l’avons interrompu d’un commun accord en 2009 et Jean-Pierre Cometti a poursuivi d’autres pistes de son côté. Il est mort brutalement en 2016.
« Tiré à part » a été le seul apport « externe » au catalogue. Pour le reste – messianisme ou/et opéraïsme, judaïsme et/ou pensée grecque, méditerranée ou territoires incertains de la philosophie, etc. – ce sont les traditions dont Patricia Farazzi et moi étions spontanément plus proches pour des raisons diverses et surtout variées, qui relèvent plus des affinités électives ou de quelque atavisme coriace que d’études universitaires que, pour des questions de ‘calendrier’, nous n’avons pas suivi aussi sérieusement que nous aurions dû le faire (ou ne pas le faire). Quand on a demandé à Giorgio Colli pourquoi il ne parlait pas de Heidegger dans ses écrits sur Nietzsche, il a répondu, avec cet accent piémontais inimitable : Non mi sento attrato. « Je ne me sens pas attiré ». Peut-être ne nous sentions-nous pas « attirés » par les études universitaires…
Un point de passage, toutefois, entre ce qui pouvait être nos intérêts propres et ceux de Cometti se retrouve peut-être dans les livres de Paolo Virno, où l’on mesurait à l’origine la cohérence entre pensée politique et linguistique, entre l’opéraïsme italien et la philosophie du langage, et si cette interdépendance est moins perceptible aujourd’hui, elle n’en a pas moins constitué un exemple de syncrétisme entre différents héritages intellectuels. En Italie, l’œuvre de Virno continue d’être très lue par ses premiers lecteurs, au contraire de la France, où les clivages idéologiques (et de lectorat) sont plus forts, entre un Virno « philosophe politique » et un Virno « philosophe du langage ». C’est extrêmement dommage, je crois, mais cela vient aussi peut-être d’une approche typiquement française de la pensée, qui a dû mal à faire deux choses en même temps, et c’est peut-être aussi pourquoi Bouveresse en est-il venu à écrire ce texte si savoureux, publié d’abord en anglais sous le titre : « Why I am so very unFrench », qu’Agone a finalement repris dans un de ses volumes d’essais.
Toujours est-il que je trouve extrêmement juste l’affirmation de Thierry Discepolo, dans un précédent entretien de votre série, selon laquelle « la ligne politique d’une maison d’édition c’est sa ligne éditoriale ». J’espère que c’est comme ça que les éditeurs pensent leur catalogue et qu’ils font avancer, avec les moyens dont ils disposent, les textes qu’ils jugent indispensables pour « penser, comprendre et créer » pour reprendre la formule du philosophe Jules Lequier qui a inauguré notre catalogue.
LVSL – Il est d’usage de distinguer l’édition indépendante des grands groupes d’édition, ou les éditeurs des vendeurs de papier, pour le dire trivialement. Vous avez néanmoins formulé des réserves à l’égard de cette opposition, en suggérant d’envisager plutôt une « édition pauvre » en écho à l’art pauvre défiant les industries culturelles. Quel nouveau partage opère cette revendication de la pauvreté ? Les livres pauvres pourraient-ils répondre au mépris, à peine masqué, des livres pour les pauvres ?
M. V. – Ce texte sur l’édition pauvre a été rédigé à l’occasion des Rencontres de l’édition indépendante à Marseille, qu’on m’avait demandé de présider en 2012. Je crois que c’est la seule fois de ma vie où j’ai été « président », même si le terme est bien galvaudé aujourd’hui. Et évidemment il ne faut pas le prendre seulement au pied de la lettre. Quelques jours auparavant, comme je l’explique dans ce texte, je reçois un courrier à l’en-tête des « Éditions indépendantes », pensant qu’il y avait là un lien avec les rencontres en question. Erreur de taille : « Les Nouvelles Éditions indépendantes » est le nom d’une holding de Matthieu Pigasse, pour regrouper ses parts dans le secteur médiatique, culturel et événementiel. Inutile de préciser « qu’indépendant », ça sonnait donc plutôt faux et ne me satisfaisait pas.
Cette idée d’indépendance recouvre des réalités économiques trop différentes ; je cherchais une définition plus proche des éditeurs qui étaient réunis dans cette salle marseillaise, Agone, L’échappée, Anacharsis… pour ne citer que ceux-là et si ma mémoire est bonne. La caractéristique commune qui m’est apparue d’emblée, c’était que nous étions pauvres, avant même d’être indépendants. D’une part, bien sûr, pour désigner la réalité économique depuis laquelle ces maisons fonctionnaient et les conduisait à vivre et éditer de manière le plus souvent précaire. Mais aussi comme revendication d’un mode de fonctionnement qui, sans aller jusqu’à parler d’éthique de la pauvreté (même si c’est tentant et si ça sonne comme un titre de Levinas sur saint François !), rapprochait notre pratique éditoriale de quelque chose qui relève de la décroissance. Cela décrivait à la fois ce que nous faisions et ce que nous voulions faire. S’appauvrir, continuer de revendiquer la pauvreté comme mode de fonctionnement, à la fois pour échapper aux logiques marchandes de l’enrichissement et de l’agrandissement forcés, mais aussi parce que c’est là que se pense le dépassement d’un progrès délétère. « Appauvrissez-vous » comme forme économique de l’« abêtissez-vous » de Pascal qui, dans un autre contexte, voulait ainsi faire « plier la machine ». La formule qui avait aussi déclencher ce petit discours, c’est une phrase de Yona Friedman, autre figure du catalogue, qui écrivait dans son Architecture de survie : « L’argent rend pauvre », que je vous laisse méditer, parce qu’elle fait tourner dans tous les sens tous les éléments d’une même question.
La pauvreté, cela signifie maîtriser la production et la penser pour des lecteurs qui sont « à notre image et ressemblance ». L’édition telle que nous la pratiquons aujourd’hui n’a rien à voir avec la manière dont ce métier s’exerce dans les grands conglomérats éditoriaux. Nous ne faisons pas ou plus le même métier. Et je suis tombé de ma chaise quand j’ai lu dans un grand journal du soir, que le patron du groupe Madrigall (ndlr : holding du groupe Gallimard, troisième groupe éditorial français qui vient de racheter les Éditions de Minuit, nées de la résistance au nazisme), se lamentait de la récente OPA de Vincent Bolloré sur le groupe Hachette, au prétexte qu’elle allait laminer l’édition indépendante ! Ce que ce monsieur ne sait pas c’est que cette édition indépendante ne se lamine pas plus qu’il ne l’a laminé lui-même en son temps, mais qu’heureusement qu’elle est maintenant si laminée et fine qu’elle parvient à se glisser dans les plus petits interstices du monde du livre et renaît à chaque instant de ses laminages. Preuve en est la richesse et l’inventivité des catalogues.
L’édition telle que nous la pratiquons aujourd’hui n’a rien à voir avec la manière dont ce métier s’exerce dans les grands conglomérats éditoriaux.
Quant à savoir à qui s’adresse l’édition pauvre, notre public est assez difficile à cerner et nous avons, en réalité, peu de données. Nos lecteurs sont presque aussi invisibles que nous, ils sont clandestins. Pour l’anecdote néanmoins, lorsqu’on a célébré les trente ans de L’éclat en 2015, j’étais arrivé à convaincre quelques libraires de faire des tables à partir de notre fond, avec, en particulier, les formats poche qui renvoyaient vers des constellations d’autres ouvrages du catalogue. Au début, les libraires n’étaient pas très favorables : on me demandait si j’avais un business-plan, un budget publicitaire, si l’anniversaire allait être annoncé dans la presse… Évidemment, rien de tout cela n’était prévu, on comptait simplement sur nos livres. Onze libraires ont accepté de jouer le jeu. À la surprise générale et dans tous les cas, ils ont vendu quasiment tous les livres présentés, sans se rendre vraiment compte que les stocks s’écoulaient progressivement. L’un d’eux a même eu l’honnêteté de me dire qu’il avait accepté l’opération par amitié, mais qu’il n’y croyait pas du tout ! Comme s’il y avait eu une ribambelle de lecteurs clandestins qui entraient dans sa librairie, achetaient des livres clandestins, et sortaient sans que le libraire perçoive le mouvement de va-et-vient ! Quelles conclusions en tirer ensuite ? C’est difficile, mais il est au moins certain que nos lecteurs ne doivent pas grand-chose au ciblage marketing ou à la couverture presse dont bénéficient (ou, le plus souvent, ne bénéficient pas) les livres de notre catalogue. Ce qui expliquerait peut-être notre longévité, contre toute raison, et la croissance timide mais régulière de notre chiffre d’affaires, puisque la maison ne vit que de ses ventes en librairie et ne peux compter sur aucun financement externe, hormis des demandes classiques de subvention pour des projets éditoriaux lourds.
LVSL – Au tournant des années 2000, vous avez été un pionnier pour penser le rapport entre livre papier et livre numérique, démentant à l’avance le refrain que l’on connaît encore aujourd’hui – le livre n’a pas d’avenir, le web l’emportera… Vous avez lancé le lyber en affirmant qu’il s’agissait de « faire l’impossible ». Vingt ans plus tard, quel regard portez-vous sur ce pari, qui continue de réunir auteurs, éditeurs, libraires et internautes ?
M. V. – Il faut rappeler les différents éléments qui ont déterminé la naissance du lyber : d’abord, la fameuse bataille au sujet du prêt en bibliothèque. Un certain nombre d’éditeurs réclamaient le prêt payant en bibliothèque, parce qu’ils estimaient qu’il y avait là un manque à gagner pour leurs maisons. Très curieusement, c’est Jérôme Lindon des Editions de Minuit, qui était à l’origine de cette revendication du prêt payant, alors que c’était aussi lui qui avait imposé le prix unique du livre. Or, autant le prix unique du livre me semblait une évidence – il a sauvé l’édition ‘pauvre’ et la librairie – mais le prêt payant me paraissait une aberration. Rien ne devait entraver la lecture publique et je ne transigeais pas sur cette idée selon laquelle la lecture appelle la lecture.
Au même moment, l’internet se mettait en place et Florent Latrive et Olivier Blondeau m’ont proposé une anthologie sur la question du logiciel libre, qui sortira en mars 2000 sous le titre : Libres enfants du savoir numérique. Lorsque nous avons terminé le livre, après avoir abordé toutes les questions du « libre » dans le domaine des logiciels, de la musique, de l’art, de l’écriture etc., je me suis demandé ce que l’on pourrait inventer pour passer du B au V (qui est la même lettre en hébreu) et adapter l’idée du « liBre » à l’objet « liVre ». C’est comme ça qu’est né le lyber – version numérique, intégrale, « libre et gratuite » d’un livre de papier vendu en librairie. Après Libres enfants du savoir numérique le premier lyber fut la reprise d’un classique de Pic de la Mirandole, De la dignité de l’homme, manifeste de l’humanisme de la Renaissance, traduit et présenté par Yves Hersant, dans sa version bilingue latin et français, paru pour la première fois à L’éclat en 1993. Il fallait marquer le coup. Depuis plus d’une centaine de titres ont leur version lyber.
Je précise toutefois que l’idée de lyber n’a rien à voir avec ce que peut être aujourd’hui l’open-source car, paradoxalement, avec le lyber, mon objectif était de défendre le livre papier. Il ne s’agissait pas de penser le numérique comme un mécanisme qui allait effacer l’objet livre, mais, au contraire, comme un dispositif qui allait le compléter, l’accompagner. Le livre reste une technologie, en termes de maniabilité et de sociabilité, qui n’a pas d’équivalent, y compris pour les nouvelles générations. Cela n’empêche pas d’étendre ses ramifications. Avec le lyber, j’ai expérimenté la première association du numérique et du livre, avec l’objectif clair que le premier devait mener au second. Le projet, à l’origine, a été pourtant mal compris : certains pensaient que j’étais « fou » de mettre en ligne des « contenus » gratuits (comme l’a écrit mon ami François Gèze dans un entretien du défunt Monde des débats), et certains libraires ont même boycotté L’éclat et ont retourné nos livres. Dans un autre « camp », celui de la « marge établie », dont j’ai parlé tout à l’heure, on m’a accusé de développer une stratégie commerciale cachée : faire des livres numériques gratuits pour vendre plus de livres papier ! Plus de livres et donc plus de lecture ? Mais que demande le peuple !
Le lyber était, en réalité, simplement un projet très enthousiaste – optimiste, sans aucun doute, crâneur probablement – mais n’a jamais été pensé comme un projet commercial. Il est vrai, en revanche, qu’il a eu des effets que je ne soupçonnais pas : les chiffres de vente des ouvrages en librairie m’ont donné raison. Certains ouvrages ont vu leur vente se multiplier par dix dès lors que j’ajoutais une version lyber. La disponibilité libre et gratuite d’un texte en ligne rendait paradoxalement plus « désirable » sa version papier. J’étais heureux de cette réussite et cela a été un grand moment de développement économique et de diffusion pour la maison. Cela m’a aussi permis de démontrer que la consultation numérique pouvait être un appui et non un frein à la lecture et que le livre continuait d’être « irremplaçable » (ce qui est toujours le cas).
La disponibilité libre et gratuite d’un texte en ligne rendait paradoxalement plus « désirable » sa version papier.
Un des dangers tient à ce que les projets associant le livre et le numérique ont toujours été plutôt rares et qu’il n’y a pas de réflexion de fond sur cette articulation. Deux anecdotes : en parallèle du lyber, l’entreprise Cytale®, où l’on trouvait notamment Jacques Attali et Erik Orsenna, avait lancé un peu à la même époque le Cybook®, un appareil de lecture numérique. Je me souviens du flyer de présentation : sur le premier cadre, on voyait la chaîne classique du livre (auteur, éditeur, diffuseur, distributeur, libraire, lecteur) et sur le second, la même liste avec de grandes croix sur le diffuseur, le distributeur et le libraire, qui étaient exclus de la chaîne du livre comme autant de parasites. En sous-texte, le message était clair, il fallait gagner du temps et de l’argent. Jacques Attali avait accepté de débattre avec moi sur France Culture pour discuter de ces deux options : lyber ou Cybook® ? Manque de chance, la veille de l’émission, il a été mis en examen pour trafic d’armes en Angola (ndlr : Jacques Attali a finalement été relaxé) et n’a pas pu venir… La partie ne fut pas remise.
Autre tendance que je mentionnais brièvement au début, celle de l’open-source, qui a connu une postérité plus heureuse que le Cybook®. C’est une pratique qui, à mes yeux, ressemble davantage à du « déversement » de contenus sur internet qu’à une réflexion sur ce que peut être un monde du numérique. Je crains que le jour où nous arriverons à une lecture exclusivement en ligne, sera le jour où l’on ne lira plus. On consultera peut-être des « contenus », mais on ne lira plus.
La plateforme que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’OpenEdition, pilotée par le CNRS, a d’ailleurs une genèse qui n’est pas souvent évoquée. À l’époque, ce projet ne concernait pas seulement les publications universitaires, mais aussi les livres d’éditeurs indépendants (et quelques ‘pauvres’, dont L’éclat, Agone, etc.). Plusieurs éditeurs avaient été contactés pour une numérisation de leurs fonds. L’idée, si je me souviens bien, c’était de mettre à disposition 20% de nos livres gratuitement et de garder 80% de livres payants, que l’on pouvait acheter sous forme de fichiers. Nous n’étions pas très enthousiastes, mais nous étions prêts à jouer le jeu pour voir. En examinant le projet, nous avons rappelé à nos interlocuteurs que le papier était le grand oublié de cette affaire. Si la plate-forme permettait le téléchargement gratuit de fichiers et l’achat de ebooks, on ne pouvait pas acheter de livres papier. « Mais qu’à cela ne tienne ! nous a-t-on répondu, nous allons associer un libraire à la plate-forme ». Le choix n’a pas fait de doute pour les chefs du projet : Amazon ! Premier désenchantement….
Mais le plus drôle, c’est la suite de l’histoire : la numérisation des fonds était rendue possible par des financements publics, et par conséquent, on nous a expliqué que certains ouvrages n’entraient pas dans les critères de la recherche en sciences humaines et sociales. Les livres de poésie, par exemple, ne pouvaient faire l’objet du protocole au prétexte qu’ils n’étaient pas considérés comme des ouvrages qui faisaient « avancer la pensée » (je cite). Puis ce fut le tour des livres jugés trop politiques qui faisaient que des fonds publics ne pouvaient financer la numérisation de livre « insurrectionnels » comme, par ex. L’insurrection qui vient du Comité invisible. Pas de poésie, pas de politique pas-correcte, nous n’avions plus notre place dans un tel projet et avons refusé de signer les protocoles. Le portail existe encore aujourd’hui quelque part sur la toile, mais témoigne bien d’une absence de réflexion réelle sur tous les acteurs de la chaîne du livre et d’une focalisation sur la technologie conçue comme progrès alors qu’elle est, dans ce cas de figure et paradoxalement, régression.
Le lyber a continué de faire son chemin, et je poursuis aujourd’hui la mise en ligne sur le site des éditions de l’éclat de nouveaux titres quand j’ai l’accord des auteurs, des traducteurs etc. L’idée avait même été jusqu’à séduire un éditeur du groupe Editis (ndlr : deuxième groupe d’édition français derrière Hachette [qu’il vient pourtant de racheter pour ne former probablement qu’une seule et même entité] et Madrigall), qui m’a contacté – c’était en plein mois d’août – pour racheter les droits de la marque « Lyber® » au moment de la création de Zones, label autonome des éditions de La Découverte. Bien entendu, il n’y avait pas de marque « Lyber® » et que je n’avais pas déposé le nom, qui est, selon la définition qu’en donne l’encyclopédie en ligne Wikipedia, un « nom commun » (et ne porte donc pas de majuscule), mais il y avait une sorte d’antériorité d’usage. Zones a toutefois eu l’élégance de signaler l’origine du terme sur leur site en renvoyant à L’éclat quand ils ont commencé à développer leurs propres Lyber-zones…
LVSL – Diriez-vous qu’être éditeur, c’est contribuer à la fabrication d’utopies réalisables, pour reprendre le titre d’un ouvrage Yona Friedman (Éclat, 2000) ? Puisqu’il s’agit à la fois d’assumer des choix éditoriaux à contre-courant et de permettre la circulation d’idées neuves…
M. V. – Oui, je crois que c’est l’enjeu et l’un des paris de l’édition telle que certains d’entre nous la conçoivent. Ce que Yona Friedman appelle « utopies réalisable » correspond exactement à nos structures, à nos modes de fonctionnement, parce que nous sommes aussi inscrits dans une logique de réalité économique. Friedman développe parallèlement aux utopies réalisables le concept de « groupe critique », qui soutient que l’on manipule plus d’objets qu’on ne peut en saisir, et que l’on est en contact avec plus de personnes qu’on ne peut en supporter. La question qu’il soulève est alors celle de savoir quelle est la taille, la mesure qui peut rendre les choses possibles. C’est notre défi : trouver la taille et la forme adéquates, qui ne correspondent pas un modèle à dupliquer, mais à une configuration qui peut inspirer des modèles différents. Ça n’est pas nouveau et c’était déjà inscrit au fronton du temple de Delphes : « Rien de trop » ! C’est comme ça que nous concevons notre travail éditorial, comme autant de « groupes critiques » qui se cherchent et s’inventent en fonction des lignes à défendre.
Il y avait dans le manuscrit « Constellations » du collectif Mauvaise Troupe un souffle qui nous disait que ce n’était pas terminé et qu’il était encore possible de compter sur des livres d’action.
Depuis 37 ans, les Éditions de l’éclat ont fait leur part et je me réjouis de constater qu’une nouvelle génération d’éditeurs (La Tempête, Libertalia, Mondes à faire, Divergences, Hors d’atteinte, pour n’en citer que quelques-uns), prend la relève depuis ces dix dernières années, avec la volonté de penser ‘politiquement’ le travail éditorial. Des manuscrits peuvent aussi rebattre les cartes et redonner confiance lorsque des doutes s’installent pour l’avenir. C’est ce nous est arrivé, par exemple, en 2013 avec le manuscrit « Constellations » du collectif Mauvaise Troupe. Parvenu par la poste (électronique), nous avons immédiatement su que nous devions le publier : à un sommaire, un ton, un style qui renouvelaient entièrement ce que nous avions pu lire jusqu’à présent. Il y avait là un souffle qui nous disait que ce n’était pas terminé et qu’il était encore possible de compter sur des livres d’action. Dans un de ses premiers livres, La porte peinte, Patricia Farazzi avait choisi cet exergue tiré de la Recherche du temps perdu : « Mais c’est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l’avertissement arrive qui peut nous sauver, on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, et la seule par où on peut entrer et qu’on aurait cherchée en vain pendant cent ans, on y heurte sans le savoir, et elle s’ouvre ». Les livres que nous choisissons s’ouvrent comme autant de portes au moment où nous nous y attendons le moins, et chaque découverte renouvelle l’espoir, si infime soit-il, qu’elles ouvrent sur une autre vision du monde.