Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron multiplie les dérapages verbaux à l’encontre des perdants de la mondialisation. Dernière en date : dans un entretien accordé au quotidien allemand Der Spiegel, il explique l’opposition à sa réforme de l’ISF par une forme de “jalousie typiquement française”. Il en profite pour réaffirmer sa volonté de “réformer” le système social français… et son admiration pour le “modèle” allemand.
Dans cet entretien, l’Allemagne est présentée comme l’archétype des pays qui ont été “gagnants dans la mondialisation”. La France, de son côté, pâtit encore de ses pudeurs à l’égard de la réussite et de la richesse. Ce sont les réflexes de “jalousie” des Français qui expliquent que l’économie de la France se porte aussi mal. Un discours tristement classique.
La rhétorique macronienne se caractérise par trois leitmotivs. L’apologie du “mérite”, de la prise de risque, de la mobilité sociale, bref, de la souplesse et de la réussite (comprendre : la souplesse pour les salariés et la réussite pour les autres). Le “rapprochement franco-allemand”, c’est-à-dire le rapprochement du système social français vis-à-vis de l’exemple allemand. Enfin, la réalisation de “l’intégration européenne”. Ces trois thématiques sont en réalité les trois facettes d’un même projet, d’une même vision du monde. Il s’agit d’en finir avec le modèle égalitariste de protection sociale à la française, qui entretient la paresse, punit la réussite et sanctionne la richesse. C’est Denis Kessler, ex-numéro 2 du Medef, qui a défini ce projet avec le plus de clarté : il s’agit de ”défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance”, c’est-à-dire les réformes sociales mises en place par les communistes et les gaullistes à la Libération.
Bien sûr, tout le monde n’en bénéficiera pas. Emmanuel Macron le sait très bien ; en Macronie, “tout le monde ne réussira pas de la même manière“, avait-il prévenu le 21 novembre 2015. Les “fainéants” qui ne trouvent pas de travail, les chauffeurs de taxi confrontés à l’ubérisation, les ouvriers licenciés qui refusent de retrouver un emploi à 200km de chez eux : tous ceux-là feront de la résistance. Il s’agira de la briser. Pour cela, un moyen : les structures d’acier de l’Union Européenne ; et un modèle : l’Allemagne.
La fascination pour le modèle allemand
Cette fascination pour le modèle allemand n’est pas propre à Emmanuel Macron ; elle irrigue le discours et la pensée de la majorité des élus, des éditorialistes et des journalistes. On connaît la passion illimitée de certains quotidiens pour le modèle allemand, qui atteint des proportions souvent délirantes.


La classe politique n’est pas en reste. Les deux candidats de la dernière campagne présidentielle pressentis comme les vainqueurs les plus probables (François Fillon et Emmanuel Macron) se sont rendus à Berlin pour recevoir l’adoubement d’Angela Merkel. Les deux présentaient l’Allemagne comme un modèle, dont il conviendrait de s’inspirer.
Que cache cette germanophilie ?
A première vue, le modèle allemand n’est pas des plus attrayants. Selon l’institut Eurostat, dirigé par la Commission Européenne, le taux de pauvreté y atteint 17,5%, contre 13,5% en France. Il est en constante augmentation depuis l’élection d’Angela Merkel : en 2006, 11 millions d’Allemands étaient considérés comme pauvres, c’est-à-dire touchant moins de 60% du revenu médian ; aujourd’hui, ce sont 13,5 millions d’Allemands qui sont concernés par cette situation. Soit une augmentation du taux de pauvreté de 22% en une décennie.
Le taux de chômage est a priori extrêmement faible, puisqu’il est officiellement de 5,2%. Ce chiffre est trompeur, puisqu’il ne prend pas en compte le très grand nombre de travailleurs à temps partiel. Or, 27% des emplois allemands sont des emplois à temps partiels ; cela signifie que les salariés ne sont pas payés au salaire minimum, et souvent qu’ils ne bénéficient pas des cotisations sociales. Parmi les 95% d’Allemands qui travaillent, il y en a donc 73% qui travaillent à temps plein et 27% à temps partiel. Le chiffre de 5,2% de chômeurs allemands est pourtant repris sans distance critique aucune dans la majorité des articles que l’on peut lire et des discours que l’on peut entendre…
La germanophilie des dirigeants français est d’autant plus étonnante que l’expansion du modèle allemand s’effectue au détriment des économies frontalières. L’industrie italienne, par exemple, est laminée par la concurrence allemande ; au point que la Confindustria, l’équivalent italien du Medef, multiplie les critiques de l’Union Européenne et de l’Allemagne, plaide pour la mise en place de barrières protectionnistes et discute ouvertement d’une sortie de l’euro. En France, il ne se passe pas un mois sans qu’une entreprise française ne soit rachetée par des capitaux allemands ; on apprenait récemment que les actionnaires d’Alstom envisageaient un rachat partiel par l’entreprise allemande Siemens. Pourtant, les représentants des grandes entreprises françaises, dont on aurait pu penser que cette concurrence sauvage inquiéterait, ne tarissent pas d’éloges sur le système économique et social d’Outre-Rhin, et ne cessent de se prononcer pour une Europe plus intégrée, un assouplissement des frontières économiques et un alignement des normes françaises sur les critères allemands.
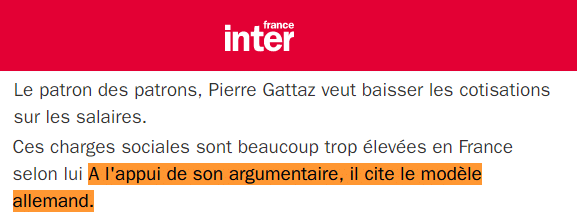
Il faut dire que le “modèle allemand” ne manque pas d’attrait pour les grandes fortunes françaises, surtout depuis le vote des fameuses Lois Hartz. Celles-ci ont été conçues par Peter Hartz, l’un des dirigeants de Volkswagen, que le chancelier social-démocrate Gerard Schröder avait chargé de diriger une commission pour la réforme du droit du travail allemand. Les Lois Hartz ont brisé toutes les normes qui encadraient le travail des salariés : les conditions de licenciement ont été facilitées, la limitation du temps de travail a été assoupli, les allocations chômage ont été amoindries et conditionnées à la recherche active d’un travail… Elles ont permis la multiplication de micro-emplois non soumis aux cotisations sociales. Angela Merkel a poursuivi et approfondi ce travail de libéralisation du marché du travail. C’est la raison pour laquelle les puissances économiques françaises regardent d’un oeil bienveillant le “modèle” économique allemand malgré la concurrence déloyale qu’il leur impose : il est parvenu à réaliser ce qu’elles souhaitent pour la France. L’assouplissement des lois sociales vaut bien la perte de quelques entreprises. Cet échange de bons procédés (l’ouverture des frontières économiques françaises en échange de l’importation du savoir-faire allemand en matière de droit du travail) s’effectue via une superstructure transnationale qui cristallise les revendications de l’industrie allemande et des grandes fortunes françaises : l’Union Européenne.
L’Union Européenne contre l’Union des peuples
Dans son discours prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017 (qu’Emmanuel Macron avait fait soigneusement relire par Angela Merkel), le Président a présenté l’Union Européenne comme un moyen de mettre fin aux tensions multiséculaires qui ont opposé la France et l’Allemagne. L’union des capitaux entraînera l’union des peuples, et la fusion des économies la fusion des consciences. Cette téléologie libérale fait totalement l’impasse sur les rapports de force qui structurent l’Union Européenne. Elle occulte ainsi l’une de ses dimensions essentielles : l’Union Européenne perpétue des rapports de domination et une relation de concurrence entre ses membres ; celle-ci s’effectue souvent au profit de l’Allemagne, qui possède l’industrie la plus puissante de toute l’Europe, et qui, par conséquent, bénéficie considérablement du libre-échange imposé par les traités européens.

Cette relation de domination fragilise les efforts de réconciliations entre les peuples entrepris depuis la Libération. On se souvient de l’intransigeance d’Angela Merkel et de Wolfgang Schaüble à l’égard de la Grèce. Plus encore que le FMI ou la Commission Européenne, c’est le gouvernement allemand qui a poussé la Grèce à mettre en place des plans d’ajustement structurel dont l’inhumanité rappelle ceux qui ont été imposés à l’Afrique et à l’Amérique latine par le passé : baisse des salaires de 30%, libéralisation du système de santé et des logements, privatisations sauvages effectuées au profit de l’Allemagne… En conséquence, le taux de chômage et de pauvreté ont doublé, le taux de suicide a triplé et la mortalité infantile a augmenté en Grèce de 43% depuis 2008. C’est encore Angela Merkel qui, en Espagne, a plaidé pour les réformes libérales les plus dures : ainsi, en 2013, le gouvernement espagnol garantissait un revenu minimal pour les familles indigentes. Alors que 26% des mineurs espagnols étaient, selon un rapport de l’UNICEF, “gravement et en permanence sous-alimentés”, Angela Merkel, avec l’appui de la Commission Européenne, a imposé au gouvernement de Mariano Rajoy la suppression de ce revenu minimum. En France, les gouvernants ne cessent d’osciller entre l’hostilité majoritaire de leur population aux réformes libérales et les pressions issues du gouvernement allemand et de la Commission Européenne pour qu’ils les adoptent – soutenant en cela les revendications des secteurs les plus fortunés de la société française.
Emmanuel Macron ne cesse d’évoquer l’Europe de Goethe, de Victor Hugo, de Schiller et de Dante. C’est pourtant un tout autre imaginaire historique qu’il réactive. Suite à sa dernière provocation, on a pu voir sur les réseaux sociaux la relation franco-allemande actuelle être comparée à la coalition entre les nobles émigrés de Coblentz et les monarchies européennes unies contre la France révolutionnaire de Valmy, ou encore à l’alliance de circonstances entre Adolphe Thiers et Bismarck dirigée contre la Commune de Paris. L’hégémonie de l’Allemagne sur l’Europe suscite des réactions violemment eurocritiques, de natures très différentes. Elle crée un besoin croissant de protection nationale et de reconquête de souveraineté face aux assauts de l’eurocratie et du gouvernement allemand, qui s’exprime souvent de manière opposée. Elle réactive un patriotisme civique et républicain en France, ou en Espagne, qui se construit en opposition aux “oligarques”, c’est-à-dire aux multinationales, aux banques et à la classe politique, accusée d’avoir livré leur pays à ces dernières ; elle favorise, à l’inverse, un nationalisme ethno-culturel (en Grèce et dans un certain nombre de pays d’Europe de l’Est) qui prospère sur le rejet des “parasites” : immigrés, minorités culturelles ou ethniques, accusés de mettre en danger la pureté de la communauté majoritaire. On pense au parti Aube Dorée en Grèce, qui arbore une symbolique très proche de celle du NSDAP ; au Jobbik hongrois, qui entretient des milices para-militaires et organise des pogroms dirigés contre les Roms (ce parti avait totalisé 20% des voix aux élections législatives de 2014) ; au LSNS (Parti Populaire – Notre Slovaquie), parti néo-nazi slovaque qui contrôle 10% des députés du parlement.

Emmanuel Macron ne cesse de brandir le spectre du retour des nationalismes ethniques et des haines entre les peuples comme justification à sa politique européenne et libérale ; c’est précisément celle-là qui jette les peuples désespérés et brutalisés, lorsqu’aucune alternative républicaine ne se présente, dans les bras des extrêmes-droites ethnicistes et racialistes.
Crédits :
© http://en.kremlin.ru/ (http://en.kremlin.ru/events/president/news/55015)
© EU2016 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:INFORMAL_LUNCH-BOAT_REGINA_DANUBIA-BRATISLAVA_SUMMIT_16._SEPTEMBER_2016_(29093223144).jpg
© DTRocks (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Dawn_members_at_rally_in_Athens_2015.jpg)










