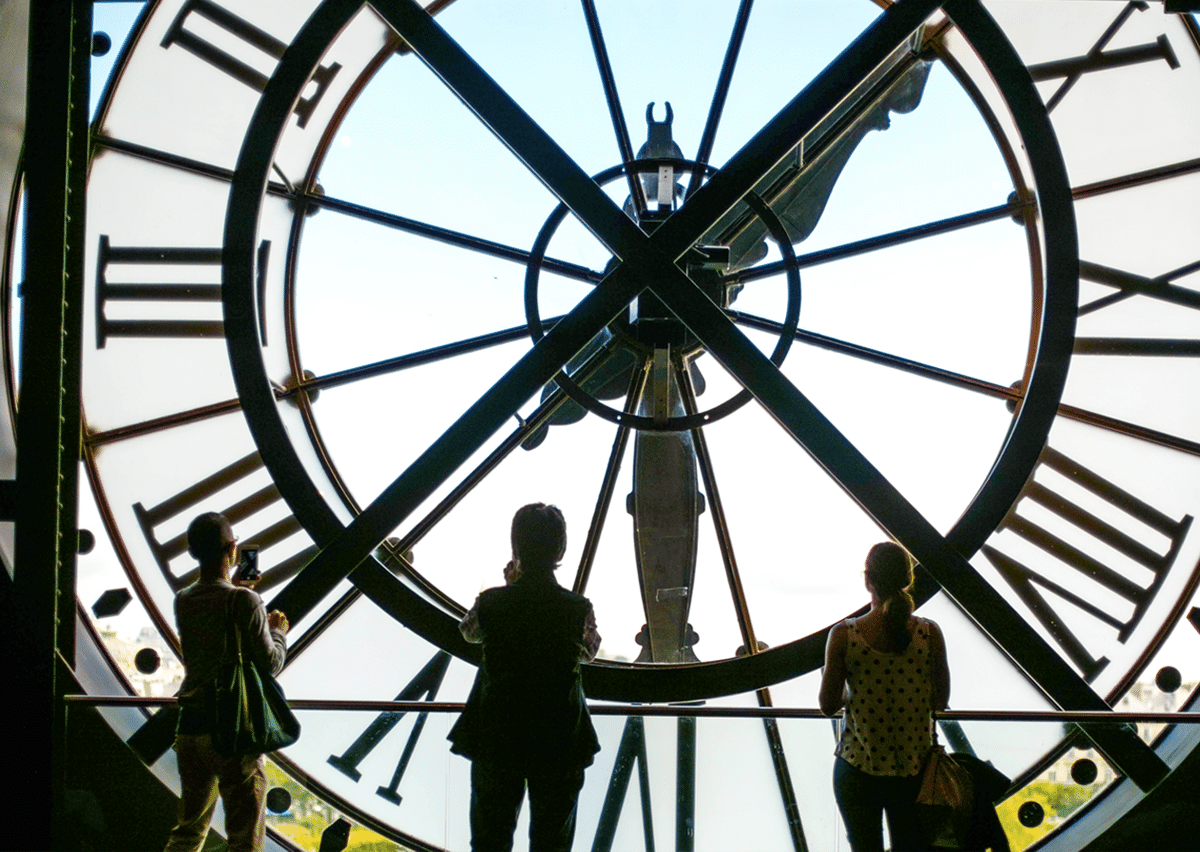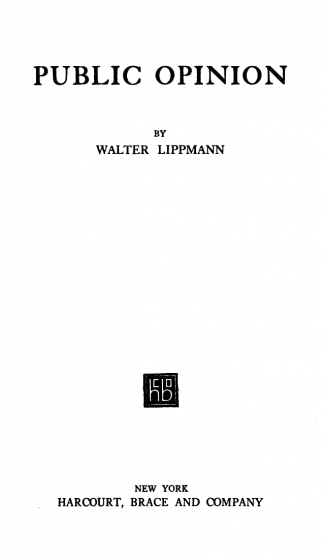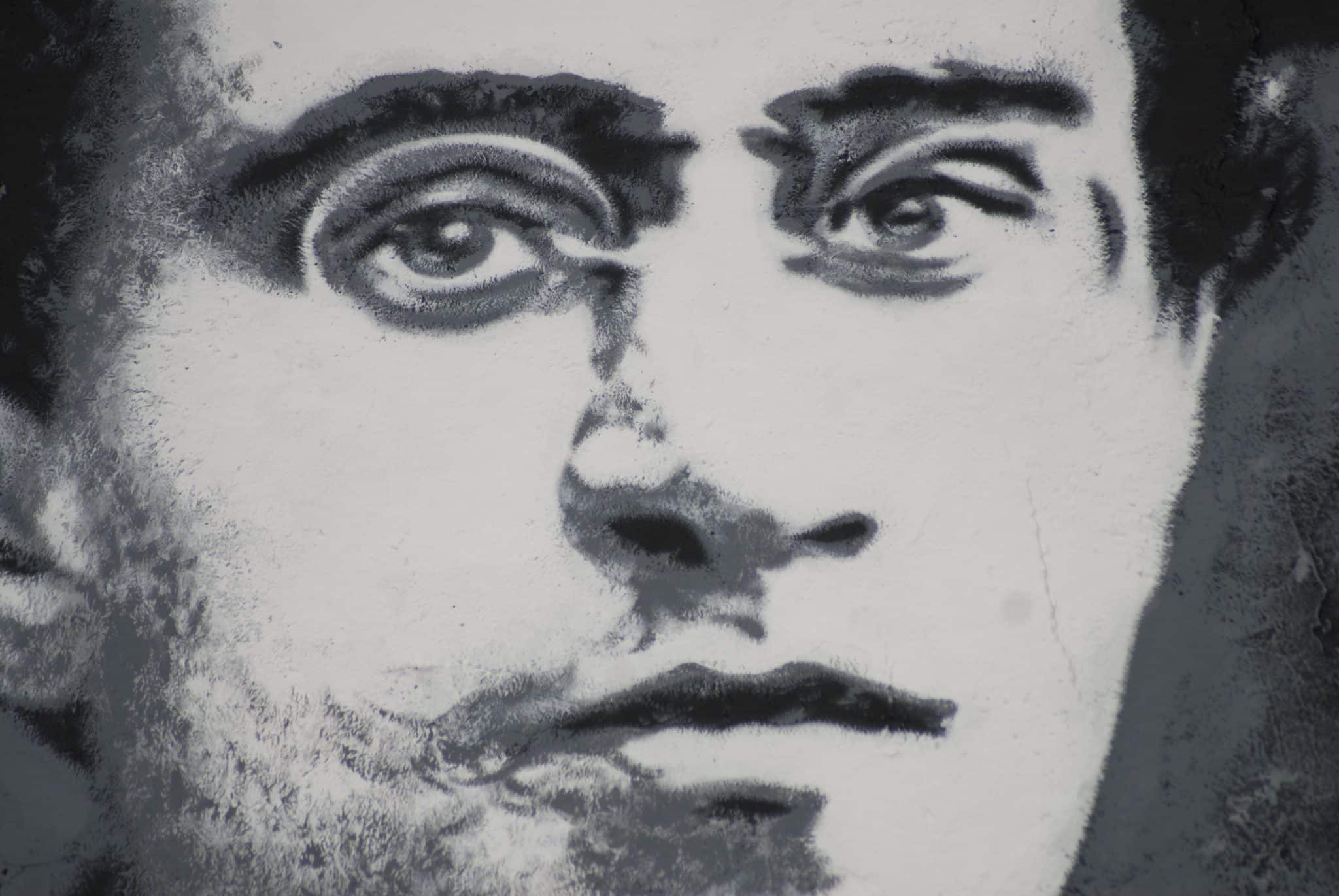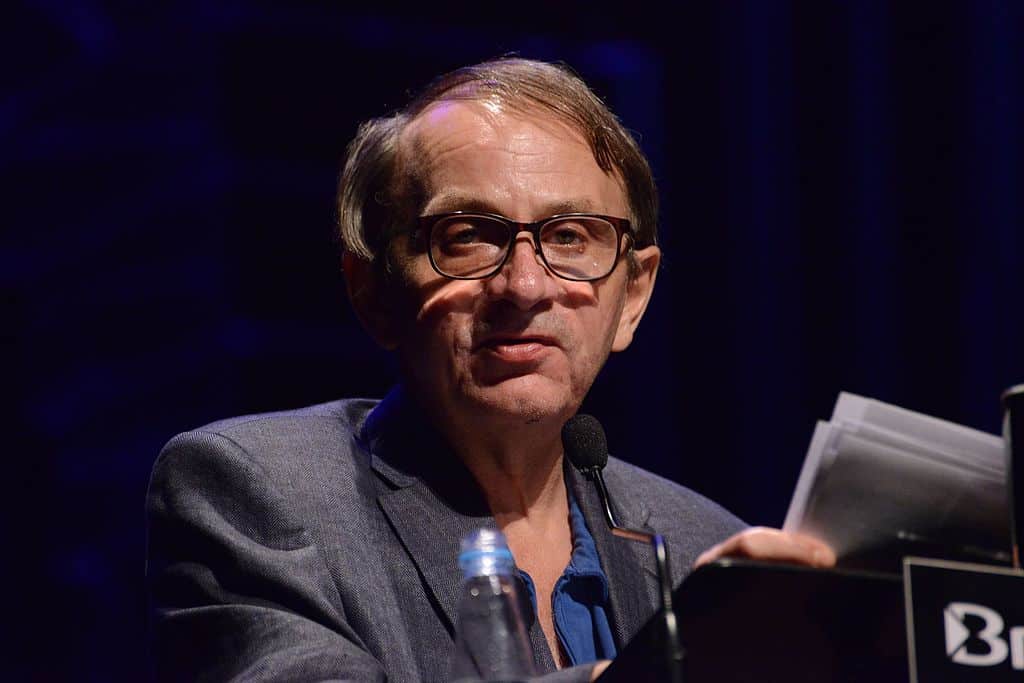André Tosel nous a quitté il y a un an. Il a porté seul sur ses épaules pendant trois decennies la recherche sur Gramsci pendant les années d’apathie libérale. Il fut respecté comme un maître par beaucoup de jeunes chercheurs de tous les continents, estimé comme un pair éminent par les plus grands chercheurs gramsciologues réunis dans l’International Gramsci society (IGS) dans le bulletin duquel cet article fut initialement publié. Il a laissé son livre Étudier Gramsci comme un testament politico-philosophique pour les jeunes générations, en pleine renaissance gramscienne. Anthony Crézégut, doctorant à Sciences-po travaillant sur la réception de Gramsci en France au XX ème siècle, nous propose un article exigeant mais accessible, qui fournit des clés de lecture de ce dernier ouvrage fondamental, un retour sur le parcours courageux de Tosel dans la prison d’oubli qu’a subi le gramscisme français depuis les années 1980, enfin des éléments de son travail pionnier sur Gramsci et le gramscisme. Pour Étudier Gramsci, il faut suivre le guide, donc lire Tosel.
Sortir Gramsci de sa prison d’ignorance
Liberté vespérale et prisons imaginaires
Un doux morceau de « liberté vespérale », telle est la formule de Kundera qui nous vient[1] lorsqu’on referme le dernier livre d’André Tosel ainsi que nos yeux, pour retrouver les impressions d’un monde perdu et recoller ses morceaux pour y trouver les traces d’un monde qui peine à voir le jour. Il nous laisse une scène sur laquelle le rideau est tombé, où ne restent qu’un enchaînement de répliques d’un acteur de son temps, de masques à terre encore frémissants, et de didascalies en italiques. « Il faut sortir Gramsci de sa prison d’ignorance » (p. 14) : la mission que s’est fixée André Tosel est de le sortir des prisons imaginaires, le carceri d’invenzione, ces « architectures effondrées » où il agonise[2]. En ce quatre-vingtième anniversaire de la mort de Gramsci, son plus fidèle veilleur sur les marches italiennes, a voulu nous éclairer une dernière fois dans ce labyrinthe français de cachots souterrains, où le penseur révolutionnaire sarde subit les supplices d’une pièce mainte fois rejouée, articulée aux rouages de machines de tortures intellectuelles, d’appareillages infernaux, de cordes sans dénouement où se pendent et se suspendent ses cadavres exquis. Que ce soient la machinerie bien huilée des « Appareils idéologiques d’Etat », le « bloc historique » tout en pierre polie, jusqu’au son métallique de l’appel vivifiant à la « praxis », s’est consolidé dans des massifs granitiques le cours d’eau gramscien qui a laissé en France des traces dans quelques sillons sinueux, irriguant des vallées abandonnées. Tosel a connu l’âge d’abondance, ses oasis et ses mirages. La prudence accumulée lui fait troquer le fanal pour la veilleuse. Pour notre génération plongée dans le clair-obscur, l’accueil au seuil de cette « selva oscura » soulève la peur dans la pensée, la forêt gramscienne semble en effet « sauvage, épaisse et âpre »[3]. Après l’effroi devant les créatures les plus morbides qui se dressent sur notre chemin, notre guide nous met en garde contre certains fantômes du passé, ceux qu’il a connus. On s’était parés à une psychomachie dans ce monde que l’esprit a quitté, Tosel nous prépare à une sciomachie, en dévoilant les fantasmagories. Toute voie droite à Gramsci est perdue, alors André Tosel veut d’abord que nous apprenions à le connaître, ce célèbre inconnu, par les chemins de traverse. Le connaître pour nous apprenions à nous connaître, à reconnaître ceux qui nous sont si familiers, ceux qui commandent nos pensées, celle des nôtres, mais aussi ceux qui sont nos adversaires, nos ennemis et qui dirigent la grande « révolution passive capitaliste ». Mais aussi apprendre à ne plus méconnaître l’infinie peuplade de cette forêt hostile, ceux que nous pouvons appeler nos étrangers, ces autres que nous connaissons si mal, nos alliés réels et nos amis potentiels.
Primum studiare, deinde agire
Etudier Gramsci. A l’ère du fast thinking, des intellectuels pressés, de la rienologie expertisée, de la rumeur qui court sur les réseaux sociaux, la réflexion est intempestive. Sortir de cette collection de « maximes ou des versets à citer » à partir de Gramsci, alibi nouveau d’une « vieille paresse » (vecchia pigrizia) intellectuelle que dénonçait l’intellectuel libéral Norberto Bobbio en 1954 chez les intellectuels du Parti communiste italien qui réduisaient Gramsci à un argumentum ad potentiam[13]. Derrière son apparence scolastique, cette mise en garde est une boussole pour apprendre à se déprendre de l’autorité des tuteurs avec leurs savoirs de seconde main. André Tosel a mis sa vie au service d’un Gramsci sans légende, le titre qu’avait choisi son ami François Ricci pour préfacer le recueil de textes publié par les Editions sociales en 1975. Ricci était lui aussi un philosophe niçois, fin connaisseur de Gramsci, désormais oublié. Il avait entamé sa thèse sur Gramsci en 1964 sur recommandation d’Althusser[14] et André Tosel suit cet éclaireur. Ricci, dans son introduction à ce qui constitue encore l’anthologie la plus accessible et complète sur Gramsci en langue française comparait l’écriture de Gramsci à celle de Pascal, par son style fragmentaire, sa composition posthume et son caractère problématique.
André Tosel était sceptique envers les lectures clés en main, les introductions se substituant à l’étude, quand l’esprit de géométrie l’emporte sur l’esprit de finesse, la raison analytique dévitalise la pensée dialogique. Son style épousait son but. Ne jamais arrêter la pensée dans des catégories figées, suivre son rythme chemin écrivant. On ne peut s’empêcher, dans cette pensée en mouvement, de penser à celui dont il fut le plus proche parmi les intellectuels du PCI, et qu’il a contribué à faire connaître en France, l’ancien maire de Livourne, partigiano et intime de l’œuvre de Gramsci, Nicola Badaloni. On peut entrer dans ce travail de l’œuvre sans connaître le parcours scientifique d’André Tosel, ni l’homme, et pourtant dans ses tournures reconnaissables parmi toutes, qui a appris à le lire apprendra à le connaître. Dans ce Passagenwerk devenu par la force des choses testament théorique, sans que jamais cela ne se manifeste de façon ostentatoire ni que cela devienne un titre de gloire, fidèle à son humilité et sa générosité, ce sont les conquêtes de sa trajectoire d’introducteur, de passeur et créateur d’un marxisme transalpin qui se font jour. Page après page, chapitre après chapitre, se dessinent sur le fronton de son édifice intellectuel les ponts et arcades dressées par-delà les années et les frontières.
Le cheminement d’un croyant sans Église, d’un fidèle sans dogme
André Tosel fut avant tout un passeur du marxisme italien, dont le prestige symbolique éluda sa richesse théorique. Il assura pendant quatre décennies la traductibilité dans le langage historique, philosophique et politique propre aux intellectuels français. Son dernier livre est ainsi en filigrane un dialogue entamé avec les cimes de la gramsciologie contemporaine, italienne pour l’essentiel, qui reste dans une large mesure terra incognita pour le lecteur français. Cette médiation a commencé par la publication en 1974 du chapitre sur le développement du marxisme en Europe occidentale au XXème siècle, dans l’Histoire de la philosophie destinée à la Pléiade, dirigée par Yvon Belaval, qui avait confié toutefois initialement le chapitre à Etienne Balibar[15]. Les cent-quarante pages ouvrent un dialogue entre Gramsci et Althusser – à l’heure où la réponse à John Lewis marque un sommet de la ligne de démarcation qu’avait tracée en 1965 le philosophe d’Ulm entre l’historicisme et l’humanisme gramsciens et l’a-humanisme et l’antihistoricisme althussériens – de clarification sur la genèse et la postérité de la proposition de philosophie de la praxis ainsi que de présentation synthétique de diverses tentatives de concilier philosophie et sciences dans les rivages du marxisme italien, ce qu’il appelle l’historicisme radical de Della Volpe et Colletti, le matérialisme dialectique nourri de la confrontation avec le positivisme logique chez Geymonat, ou encore le dépassement du néo-positivisme comme du marxisme par Antonio Banfi.
En relisant ce texte de 1974, on se demande si ce dialogue n’est pas aussi un dialogue avec lui-même, un retour réflexif sur son propre cheminement. André Tosel venait de la jeunesse chrétienne de gauche, radicalisée dans les combats contre la guerre d’Algérie, pour le développement du Tiers-monde, l’option préférentielle pour les damnés de la terre. Il intègre à partir de 1962 le Comité de rédaction de l’Action catholique étudiante (ACE), publication de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC). Son premier article, rédigé à l’âge de vingt ans[16], se propose de penser quelle politique culturelle de la part de la JEC permettrait d’emporter le consentement des masses étudiantes – au-delà de la routine des meetings ou des fêtes étudiantes inconséquentes. Son but, son idéal est alors de permettre à « tous les étudiants de vivre l’amour et la justice dans leur vie de tous les jours », de transformer cette « masse en une communauté », communauté organique, précise-t-il, non seulement recevant mais vivant le message évangélique. Le moyen serait l’encouragement à la mise en action des « groupes intermédiaires, organiques » chargés d’animer conférences, tables rondes, groupes de réflexion, mais aussi d’aider les étudiants dans leurs TP, à organiser des sorties culturelles, ou encore à développer une autre conception du syndicalisme, en « rendant une corpo plus vivante » mais surtout en révolutionnant les pratiques dans l’université. L’utopie de cette JEC radicalisée ne survit guère mieux et plus longtemps que celle d’une Union des étudiants communistes (UEC) où cohabitèrent un temps les maoïstes de la rue d’Ulm influencés par Althusser, les trotskistes-guévaristes de la Sorbonne-Lettres, futur noyau de la LCR sous la direction pro-italienne, elle-même partagée entre modérés modernistes et radicaux spontanéistes. En 1965, la JEC comme l’UEC sont purgées par leurs Eglises respectives, et toute une génération se retrouve « chrétiens sans Eglise », projetée hors des sentiers battus, chargée de se frayer sa route qui passa par mai 1968, à l’université de Nice pour Tosel.
Il y eut alors la tentation maoïste après 1966 et la Révolution culturelle, qui attira tant d’autres esprits brillants. Ils venaient parfois du christianisme laïcisé, ou de l’existentialisme, cherchant et ne trouvant pas leur chemin théorique dans ce qu’avait initié Roger Garaudy dans le PCF, les voies d’un humanisme sans rivages, dans le prolongement du dialogue entre chrétiens et marxistes, entre le marxisme et la pensée moderne. L’effort théorique amorcé à partir de 1974 par André Tosel pose dans une certaine mesure les jalons d’une critique, qui est aussi autocritique, des limites de cet élan, avec tous les risques encourus, ceux du dogmatisme, du sectarisme, de l’activisme, du spontanéisme comme du théoricisme. Et pourtant, il reçut l’avertissement d’Althusser qui critiquait en fait dans l’équation « économisme + humanisme », au-delà de Garaudy une tentation au sein de la gauche révolutionnaire de rechercher l’adaptation à la modernité capitaliste, de facto capitulation devant un libéralisme archaïque, fut-ce teintée de vernis social, d’un opium de bonne conscience humaniste, d’une théodicée laïcisée. Il adhère au PCF en pleine Union de la gauche et se sent proche de ceux qui regardent le Parti communiste italien (PCI) comme un modèle politique pour la transformation du PCF, ce qu’on a appela un temps du nom d’eurocommunisme. On y trouve la revue Dialectiques, fondée en 1973, animée par une bande d’étudiants de l’ENS de Saint- Cloud, issu d’un milieu culturel proche de l’extrême-gauche, avec Danielle et David Kaisergruber, Marc Abelès, Yannick Blanc, Christian Lazzeri, épaulés par Christine Buci-Glucksmann. Une revue jeune, universitaire, ouverte sur les sciences sociales, althusséro-gramscienne disaient certains, et surtout de plus en plus manifestement en discordance avec la direction du PCF, plus en syntonie avec une ligne italienne. Dans le second, la Nouvelle Critique, revue toujours au premier poste de la bataille idéologique depuis sa fondation en pleine guerre froide en 1948, censée connecter les intellectuels communistes avec les avant-gardes culturelles, prise dans un jeu d’obéissance politique et d’autonomie culturelle[17].
On y retrouve des anciens, André Gisselbrecht, Francis Cohen, Claude Prévost, François Hincker, Jean Rony, Jacques Texier conscients de la nécessité d’élever le niveau culturel, avec Lukacs ou Gramsci, et une jeune génération où on retrouve notamment Buci-Glucksmann. Quant à André Tosel, il lui arrive d’écrire dans ces revues et pourtant trois de ses cinq articles sur Gramsci et le marxisme italien sont publiés dans la Pensée, que vient de reprendre Antoine Casanova, le responsable du PCF dans le dialogue avec les chrétiens, et dans laquelle écrivait dans les années 1960 Louis Althusser. La Pensée est une revue à l’histoire sensiblement différente. Sans exprimer de désaccords avec la direction du parti, elle a maintenu une ligne inspirée par le rationalisme ouvert sur les sciences et le savoir académique. Au milieu des années 1970, la ligne de l’humanisme scientifique, théorisée par Lucien Sève fait consensus relatif et Sève, partisan d’une orthodoxie ouverte, encourage Tosel à écrire dans la revue comme dans la maison d’édition qu’il dirige depuis 1970. Cette série d’articles permet aux intellectuels communistes de mesurer la richesse, la diversité du marxisme italien, ce qui leur fait ressentir le retard accumulé depuis 1956 sur la place des intellectuels dans le mouvement révolutionnaire, la négligence de la dimension culturelle de la lutte pour l’hégémonie à gauche, dans la société et dans la conquête de l’Etat. André Tosel, tout en partageant une bonne partie des critiques faites tant par les althussériens que les italiens en 1978-1979, ne quitte pas dans l’immédiat le PCF, comme le firent Etienne Balibar, Christine Buci-Glucksmann, Jacques Texier, Jean Rony. La dissolution ou l’abandon des revues Dialectiques, la Nouvelle Critique, de l’hebdomadaire France nouvelle et du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) tournent une page qui annonce une défaite culturelle au moment où même semble se dessiner une victoire politique de la gauche en 1981. Tosel quitte finalement ce parti sur la pointe des pieds en 1984, suivant l’opposition interne, des refondateurs, menée par Pierre Juquin, année où il publie sa collection d’articles sous le titre gramscien Praxis, sous-titré précisément Pour une refondation de la philosophie marxiste.
Tosel avait depuis vingt ans toujours concilié recherche scientifique et activité militante, dans la formation politique au niveau fédéral dans le PCF des Alpes-Maritimes, l’activité syndicale dans le Syndicat national de l’Enseignement supérieur (SNESUP), traduit l’un dans et avec l’autre. Commence une autre vie marquée par le deuil impossible de la communauté militante, mais où dans la passion de l’enseignement, la coordination de la recherche collective, la défense et le développement de l’université publique, cette expérience vit dans cet interrègne suspendu au-dessus de l’abîme que furent les années d’apathie libérale, de 1984 à 2008. Ce recul, il ne voulait pas le vivre comme un repli, lui permit de produire ce qui reste un des meilleurs travaux au monde sur les origines de la philosophie de Gramsci, replacées avec minutie et finesse dans les débats italiens de la fin du XIXème siècle, entre Gentile, Croce et Labriola[18]. Marx en Italiques permet de comprendre la dette de Gramsci envers cette « philosophie de la praxis » dont il a hérité, mais aussi en quoi celle qu’il esquisse lui est propre et constitue un dépassement original, irréductible aux simplifications. Cette recherche invalide les essais de ceux qui, avec plus ou moins de profondeur, cherchent à assimiler la pensée de Gramsci à l’actualisme de Gentile[19], ou sa conception du marxisme à celle d’une religion laïque, d’un canon d’interprétation historique, soit une variante de la philosophie de Croce comme le présente Althusser dans Lire le Capital en 1965. En réalité, Gramsci redécouvrirait, sans s’y réduire, par des chemins détournés sur lequel il retourna tardivement, les pistes défrichées par Antonio Labriola, le plus célèbre inconnu dans le panorama du marxisme européen, tout du moins en France[20].
Contrairement à d’autres, André Tosel ne fut jamais un pentito du communisme, ni un renégat du marxisme, il dut s’accommoder d’un certain isolement loin des modes parisiennes, de publications dans les presses universitaires bisontines ou dans la maison d’édition toulousaine de Gérard Granel. Il n’y eut guère d’illusions dans son cas devant l’hypothèse d’une mondialisation heureuse et d’une humanité réconciliée, les allées lumineuses que certains imaginaient après la chute du mur. Symbole fort l’année de la dissolution de l’URSS, avec la fin de la division du monde en blocs, il prône l’Esprit de scission[21], une volonté affichée jusque dans le titre de garder ses distances avec l’idéologie dominante. Un pas de côté avec Gramsci, avec le dernier Lukacs, celui de l’Ontologie de l’être social – un quasi inconnu en France, sauf pour l’itinéraire singulier de Nicolas Tertulian, et qu’on commence à peine à publier[22] – pour penser les impensés du marxisme tel qu’il se développa au XXème siècle : la question du droit et des droits, de la démocratie, de l’Etat moderne d’une part, celle de la nature dans son rapport au travail humain d’autre part. A contre-courant, en 1991, il organise un colloque sur Gramsci, pas tout à fait le premier mais sans nul doute le plus riche, sous le titre Modernité de Gramsci réunissant quelques-uns des meilleurs spécialistes italiens et français de l’œuvre de Gramsci, comme Jacques Texier, Giorgio Baratta, Giuseppe Vacca, et certains qui purent être en polémique avec ses héritiers, comme Etienne Balibar ou Costanzo Preve. On y discute franchement du défi de la modernité américaine, des limites du stalinisme soviétique, de la place des intellectuels dans le mouvement révolutionnaire.
Un système mis en mouvement
Dans Etudier Gramsci, en 2016, on retrouve le passeur du marxisme italien, avec les progrès de la recherche philologique autour de l’œuvre de Gramsci. Tosel entame, concept par concept, une reprise personnelle de plusieurs entrées du Dizionario gramsciano coordonné par Guido Liguori et Pasquale Voza, et dont il admirait la somme collective et regrettait qu’elle n’ait pas été traduite en français[23]. Il noue le dialogue (le terme italien « dialettica » convient ici parfaitement), au fil des pages, avec les travaux dont il se sentait le plus proche philosophiquement, ceux de Fabio Frosini, comme à quelques recherches pionnières de jeunes chercheurs italiens. Dans son style d’écriture, et par là même en quelque sorte dans son interprétation de la pensée de Gramsci, André Tosel semble dans cette somme tiraillée entre deux voies. Celle du « fragment », de la pensée dialogique, suivant le rythme de la pensée[24], privilégiant le contrepoint et la fugue, qu’on pourrait rapprocher de Walter Benjamin, où il retrouverait celle de son ami Giorgio Baratta[25]. Et celle du « système » en mouvement[26], un socratisme marxiste mis en cohérence, un « connais-toi toi-même » du mouvement révolutionnaire, laissant ouverts les questionnements, posant problème mais offrant une cohérence conceptuelle derrière l’apparente forme décousue de ses écrits, où on retrouve des thèmes majeurs et ses infinies variations. On pourrait oser parler d’un « stoicismo storicista », qui passe non par l’édification de la construction mentale la plus ingénieuse, ou élégante, mais par l’étude de la « realtà effettuale ». Dans ce livre, se condense et se réécrit cet itinéraire, comme se révèle quelque chose de son être profond : on retrouve l’homme de dialogue avec toutes les croyances qui n’abdique ni la rigueur scientifique ni la conviction laïque, l’ami fidèle de la cause du peuple, comme du savoir, qui refuse de la confondre avec une foi aveugle. En un mot l’humaniste et le rationaliste, désireux de trouver la voie d’un réalisme qui n’abandonne pas les aspirations utopiques.
Amicus Gramsci, sed magis amica veritas
Gramsci a connu, en France, nombre d’amants volages, des entichements passagers, et bien peu de fidèles. André Tosel, comme Robert Paris ou Jacques Texier, fut de ceux qui dans la solitude des années néfastes, maintinrent la flamme de la pensée critique et de l’intelligence collective. Dans ce dernier ouvrage, Gramsci est aussi poussé jusque dans ses limites, il n’est pas caché au lecteur certaines dimensions problématiques de la philosophie de Gramsci, en particulier ce que Tosel nomme son « productivisme » (p. 144) ou encore de son « eurocentrisme » (p. 240). Et si finalement, André Tosel propose un continuel retour à Gramsci, c’est parce qu’il est non seulement utile mais indispensable, plus actuel que jamais pour penser le capitalisme avancé et dépasser la défaite des subalternes. Tosel est un amoureux de Gramsci, mais encore plus de la vérité, du savoir, de la sagesse, et parce qu’il les aime sans défaillir, il l’aime fidèlement. Avant de nous plonger dans ce dernier morceau, il nous faut bien dire qu’il y aurait des textes à redécouvrir, à exhumer. Nous pensons à son article publié en 1984 dans la Pensée[27] – non intégré au volume Praxis, à notre connaissance, ni ailleurs – mettant en évidence l’originalité de la conception de la dialectique chez Gramsci mais aussi éventuellement certaines de ses limites en la comparant avec celle, souvent décriée, d’Engels dont la Dialectique de la nature qui ne se réduit pas aux schématismes de l’ère stalinienne ni aux caricatures de certains adversaires, miroir de la même incompréhension, et dont l’urgence écologique tend à reconsidérer les thèses de manière moins unilatérale[28]. C’est un mérite rare que d’offrir à ceux qui le lisent, et l’écoutent, les références qui permettent d’élargir ses horizons, ne pas s’enfermer dans une chapelle idéologique, même dorée et ornée.
Une rigueur obstinée
Un combat pour la culture
Etudier Gramsci est d’abord un appel à mener le combat pour la défense de la culture. Non simplement un Kulturkampf laïc contre la religion ou les cléricalismes ni en aucune manière un Kampf der Kulturen (p. 36), mais un Kampf für Kultur dans une nouvelle Krisis de la conscience européenne. Une crise qui commence par une immense destruction de valeurs économiques comme culturelles. Toutes ne sont pas à jeter par-dessus bord, d’autres sont à refonder après le terrible vingtième siècle, il faut mettre en abime ce monde à construire au bord du gouffre[29]. La première partie de l’ouvrage propose ainsi l’itinéraire d’un « intellectuel militant pour le socialisme et la culture » (p. 17) qui culmine dans l’expérience d’intellectuel organique à la tête de l’Ordine Nuovo, revue hebdomadaire de culture socialiste dont la devise résume l’esprit de Gramsci comme celui de Tosel (p. 45) : « Instruisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre intelligence. Mobilisez-vous parce que nous aurons besoin de tout notre enthousiasme. Organisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre force ». André Tosel retrace en quelques traits ce jeune Gramsci, si méconnu en France pour les années 1914-1918[30], attentif tant aux avant-gardes italiennes, méridionales comme Pirandello ou septentrionales avec les futuristes et Marinetti (p. 19-20) connectées aux pointes de la culture européenne qu’à l’Alltag und Lebenswelt des gens simples, dans leur pratique sensée, même dans l’apparente irrationnalité de leurs jeux de hasard codifiés, de leur folklore particulariste, de leurs pratiques religieuses syncrétiques, de leur sens commun fataliste. Gramsci les restitue sans condescendance ni jugement au-dessus de la mêlée, et sans épargner les grands noms, les replace dans la totalité, celle de la structure sociale actuelle et de sa genèse.
Il élève les humbles dont la pratique quotidienne est considérée avec autant de sérieux que celle des intellectuels de profession. Et il abaisse les puissants, dans sa critique du sens commun des intellectuels de profession. C’est ce qu’il appelle le lorianisme du nom de l’économiste Achille Loria, et dans lequel il perçoit la base sociale de l’adhésion, ou de la non-résistance, ou encore de l’impuissance à organiser une culture élevée et populaire, qui permit la victoire du fascisme en Italie, plus tard de l’hitlérisme en Allemagne. Pour un penseur que l’on présente souvent comme un apologue des intellectuels, et une façon pour les intellectuels d’affirmer leur droit à l’existence, voire à la prééminence, dans le mouvement ouvrier, le paradoxe est saisissant. Une partie importante de ses Quaderni est consacrée à la dénonciation de ses sophismes érigés en savoir d’autorité, de cette absence d’analyse paré derrière les facilités d’un langage commun à une caste intellectuelle, de cette marchandise nationale frauduleuse qui ne circule en Italie que par absence de libre-échange avec les sommets de la pensée européenne et de marché commun avec les classes subalternes de son propre pays. Le lorianisme fait couple avec le brescianisme (p. 124), cette littérature de clercs jésuites qui se nourrit des préjugés paternalistes sur le bon peuple conservateur, d’une profonde méconnaissance de la vie quotidienne des subalternes et s’épuisant à dépeindre la folie des foules révolutionnaires, colportant rumeurs infondées issues de la projection des auteurs.
Cette double tare, selon Gramsci marque l’intellettualità italienne, elle s’enracine dans deux tendances culturelles, au sens d’une organisation ou d’un refus d’organisation de la culture des simples, celle du maçonnisme et du jésuitisme (p. 31-33), qu’il analyse dans ses écrits de jeunesse. La maçonnerie est de facto dans l’Italie de la fin du XIXème siècle le mode d’organisation de la culture des élites laïques, libérales et « progressistes ». Par son culte du secret, son refus d’organiser un mouvement d’éducation populaire, sa réalité de milieu de sociabilité des élites politiques, économiques et intellectuelles, elle représente l’échec des libéraux italiennes à diriger un mouvement national-populaire, à l’image du jacobinisme français jusque dans son descendant modéré, le mouvement républicain radical qui va emporter la bataille de l’éducation et de la laïcisation des institutions. Elle laisse l’organisation de la culture populaire aux cléricaux, conservateurs, voire « réactionnaires », dont le jésuitisme constitue une des formes – entre celle des modernes et des intégristes – la plus subtile dans son entreprise contre-révolutionnaire car partisane d’un aggiornamento permanent, d’une liaison organique avec les masses non pour les élever à la culture supérieure mais pour les maintenir à un niveau de semi-ignorance, guère supérieur au folklore et au sens commun, avec ses superstitions et ses préjugés fondues dans l’obéissance aux puissants et la peur de la vengeance divine. C’est de cette double caractérisation de l’encadrement de la culture italienne – qui recouvre en fait dans le vide de l’un moderne rempli par le plein arriéré de l’autre, une multiplicité de sous-cultures locales, corporatives, traditionnelles – que se constitue le terreau favorable au mouvement fasciste.
Comment ne pas voir, dans ces doublets lorianisme/brescianisme, maçonnisme/jésuitisme, un possible avertissement pour le mouvement socialiste ou communiste face aux risques de pédantisme intellectuel et de doctrinarisme sûr du triomphe de sa raison, ou au contraire de compromissions sociales et surtout culturelles avec l’idéologie dominante. L’écueil du mépris pour le sens commun des simples, ou au contraire de populisme qui conduit à un maintien dans la subalternité, aux désillusions politiques et au renversement dans la rancœur envers les masses réactionnaires. Comment ne pas voir une leçon des expériences vécues, dans les Eglises, le Parti, les associations laïques qu’a connues de l’intérieur André Tosel. Ces dangers circonscrits, l’alternative pour le mouvement révolutionnaire tient sur un fil ténu : organiser une renaissance culturelle, un Rinascimento (p 24-25) que Gramsci appelle de ses vœux en septembre 1917 « une nouvelle Renaissance pour l’Italie, la renaissance de sa Plèbe ». Organiser la culture, en repoussant l’étroitesse de vues de Bordiga comme l’alignement d’un Tasca sur la culture libérale (p. 39 et 46), et fournir un travail d’éducation militant qui fut celui de l’Ordine Nuovo, de ses cours pour l’école du nouveau Parti communiste après 1923 (p. 63), de ses discussions avec des intellectuels de profession, ouvriers syndiqués, cadres politiques.
Dire la vérité face à la tentation de la double vérité
Le « fil rouge de l’hégémonie » tel qu’André Tosel caractérisait dans les années 1980 la problématique longtemps mûrie de Gramsci est tissée dans l’étoffe de la pédagogie. « Tout rapport d’hégémonie est un rapport pédagogique », la force dirigeante politique, l’hegemon, est comme un bon enseignant (p. 305-306), il façonne une forma mentis capable de saisir la complexité de la réalité, de se construire une conception du monde cohérente et expansive pour agir, le tout à partir du noyau de bon sens de chacun de ses élèves. Il leur apprend non pas à être autonome, mais libre, sans maître absolu ni autorité suprême. Le conseil, le parti, l’Etat sont trois formes différentes d’organisation politique nécessaires mais transitoires, centralisées sous des modalités les plus démocratiques possibles, trois instruments d’émancipation qui peuvent devenir d’oppression, devant dépérir non dans une utopie mais dans la « società civile », ou plus exactement la « società regolata » (p. 171 puis p. 209, selon André Tosel, il s’agit d’une transfiguration du terme même de « communisme »). Ces concepts sont rarement compris dans la reformulation qu’opère Gramsci, dans un retour à Hegel traduit dans la prose réaliste de Machiavel. La « société civile » de Gramsci n’est pas l’infrastructure économique des libéraux ni celle de certains marxistes, elle se compose d’un réseau d’associations – Eglises, médias, partis, syndicats, associations civiles ou ONG dirions-nous aujourd’hui, écoles – autonomes mais de plus en plus intriquées avec l’Etat élargi et où la lutte entre conceptions du monde rivales portent sur la construction de l’hégémonie sociale solidifiant la conquête du pouvoir politique, stricto sensu, l’Appareil d’Etat dans sa dimension administrative. Le terme « civile » en italien se rapporte directement à celui de civiltà (culture/civilisation), ancré lui-même dans l’histoire de longue durée des città, de la civitas romaine aux communes médiévales puis à la Florence de la Renaissance, fondement du cittadino, le citoyen-bourgeois, donc de la formation de l’idéal républicain et démocratique moderne.
La fin de ce processus d’incivilmento, de civilisation des mœurs[31], est la disparition de l’Etat absorbée non par l’utopie anarchiste, toujours prégnante chez Marx et Lénine même, mais dans une « société réglée » qui se sera non seulement donnée ses propres lois mais dont les citoyens auront intériorisé dans leurs pratiques, leurs rapports aux êtres humains et au monde, comme habitus acquis, éthique réfléchie et lois civiles. Cet incivilmento rendu possible par un long travail pédagogique ne sera pas atteint par l’utopie de la communication transparente, de l’argumentation rationnelle, ce sera une éducation militante, un combat culturel, une lutte contre la conception du monde des classes dominantes qui font tout pour entraver la mobilisation des classes subalternes. Nous faisions allusions à Hussserl pour la Krisis, c’est l’année 1935, celle aussi du Kehre d’Heidegger, celle enfin de la mort de celui qui avait inspiré Gramsci pour penser l’intellectuel organique de type nouveau, Henri Barbusse. En cette année 1935, Gramsci interrompt la publication de ses Quaderni, au bout de ses forces, devenu icône planétaire après l’appel humaniste et militant du Prix Nobel de littérature, combattant pacifiste, Romain Rolland pour sa libération[32]. Cette même année est marquée par l’organisation du Congrès pour la Défense de la Culture à Paris, réunissant un panel sans égal pour réfléchir sur le pourquoi de la défaite face aux fascismes et le comment de la contre-offensive humaniste : Bertolt Brecht et Thomas Mann, André Gide et Louis Aragon, André Malraux et Boris Pasternak, Ernst Bloch et Robert Musil, John dos Passos et Ilya Ehrenbourg[33].
Certes la revue Clarté de Barbusse qui avait tant inspiré Gramsci après la guerre n’existe plus, mais Europe de Romain Rolland continue à porter la flamme, tandis que nait la Pensée animée par les physiciens Jacques Solomon et Paul Langevin, les biologistes Jacques Monod et Marcel Prenant, les philosophes Georges Politzer et Henri Wallon. On ne pourrait manquer la vitalité de ce mouvement intellectuel, parallèle aux fronts populaires, des universités populaires et nouvelles animées par Politzer, les pamphlets mordants de Nizan, les brochures A la Lumière du marxisme avec Georges Friedmann, Jean Baby, René Maublanc, Marcel Cohen ou Auguste Cornu. Le communiste français, et l’intelligence française de gauche, courra longtemps après cette effervescence culturelle, dont elle ne trouva une suite souvent que dans le communisme italien à la lumière du gramscisme, dans les revues Società, Rinascita ou les colloques de l’Institut Gramsci. Il eût fallu que la bataille culturelle ne soit pas que lutte idéologique, sur le front politique, tactique de pouvoir, ruse de la raison bureaucratique, non pas un instrument dans le machiavélisme de « la fin justifie les moyens » mais un mouvement froid de compréhension de la « realtà effettuale »[34]. Il eût été possible de poser la question morale, non de façon jésuitique, mais pour répondre au défi de la crise des valeurs. Il était imaginable de trouver une issue au nihilisme et la réduction de toute valeur à la force brute, à la victoire militaire ou au pragmatisme, à l’action efficace, à la technique et la raison instrumentale triomphante. « Dire la vérité est révolutionnaire », la formule aux accents jauressiens, empruntée directement à Barbusse sonne cruellement quand on repense à 1935. Le défi de Heidegger, Scheler et Husserl était aussi celui de Brecht, Bloch et Aragon sur de toutes autres bases. Il eût pu être relevé en 1935, il fut bien vite abaissé dans la pratique institutionnalisée de la « doppia verità ».
« Fare i conti con Althusser » : sur un demi-siècle de malentendus
Restituer la complexité de l’opération théorique gramscienne face au jugement althussérien sur la nature idéologique de la philosophie de Gramsci. Car le fil rouge dans le labyrinthe dans lequel nous conduit André Tosel, est la réouverture du spartiacque, la ligne de partage des eaux, tracée par Althusser en 1965, dans son fameux chapitre « Le marxisme n’est pas un historicisme », qu’Etienne Balibar disait récemment relire avec effroi, comme cas d’école de la pensée stalinienne[35]. André Tosel revient sur le cas Althusser en faisant, à l’instar du disciple de Geymonat, Silvano Tagliagambe, un défi majeur posé à la conception gramscienne du marxisme, autour de leur conception de la science[36]. Il y revient à deux reprises, sur le même point de rupture, la contestation de la scientificité de la théorie gramscienne, sa réduction à une idéologie de la praxis, dans un monde unidimensionnel saisi par la conscience d’un acteur transformant un monde dont la totalité serait appropriée comme « totalité expressive », articulation de la théorie du reflet, d’une spiritualisation du monde et de son centrement, dont la transformation serait le produit d’une idéologie qui serait religion séculière, mythe efficace. André Tosel a décidé de fare i conti con Althusser non sur le terrain de la polémologie mais sur celui de la philologie. Les assertions péremptoires, déjà contestées par les scrupules qu’Althusser instillaient dans son texte même, entamées par ces jugements paradoxaux voire ambivalents, sont méthodiquement démontées. Face au gramscisme unidimensionnel sur le tableau noir d’Althusser, Tosel rétablit un Gramsci en couleurs et en trois dimensions. Althusser dénonçait l’historicisme absolu de Gramsci, Tosel le rétablit dans la complexité d’une théorie de l’histoire, une « théorie de la relativité générale » pour conjurer le spectre honni du relativisme par un philosophe à la recherche de l’absolu. Il repense l’espace présent non plus sous la modalité appauvrissante d’une « totalité expressive » mais une, nous citons Tosel ici, « théorie structurelle du tout social finalisée par la perspective politique de l’hégémonie ». Il se replace dans le temps dans une « théorie généalogique de l’histoire moderne » qui n’est pas justification ou acceptation de l’étant mais « périodisation ouverte sur le présent des luttes » et ouverture sur des « récits partiels » (p. 88).
On retrouve dans l’exposition de Tosel sa largeur de vues, aux horizons sans cesse élargis, tournés vers l’infiniment petit des micro-relations humaines, de la singularité des situations, de leur mise en relation concrète dans des rapports de force et des rapports de séduction à échelle humaine, et des « transformations moléculaires » (p.295-296) et vers l’infiniment grand des relations settentrione/mezzogiorno en Italie, Orient/Occident et Europe/Amérique, puis Nord/Sud dans le monde (pp. 226 à 236), des macro-relations entre classes sociales, nations, blocs historiques. On retrouve sa hauteur d’analyse, attentive aux sommets de la pensée européenne voire mondiale, la philosophie de Croce, Bergson et James, l’économie politique et le tournant planiste autour d’Henri de Man, Keynes, la science politique italienne de Michels, Mosca, Pareto, la sociologie de Weber, Durkheim, l’histoire avec Mathiez, la littérature bien entendu au contact de Balzac, Zola, Pirandello, Svevo, Tolstoï, Chesterton. Une hauteur qui ne délaisse ni la critique historique des pics locaux, provincialisés par le regard gramscien mais aussi déracinés de leur faible enracinement national, dans sa déconstruction du romantisme italien manzonien, de la philosophie gentilienne, de la poésie de D ’Annunzio, tous en partie responsables de la catastrophe italienne. Des hauteurs enracinées qui lui permettent d’arpenter les sentiers traversiers, les dénivelés pour redescendre dans les vallées où vivent les italiens, les producteurs, les humbles. Loin d’être réductible à une « idéologie » uniforme, unidimensionnelle, Gramsci tel que Tosel nous le reconstitue analyse progressivement les divers niveaux de l’idéologie, ciment du bloc historique et source tant de conscience partielle que facteur d’unification du vécu historique.
On peut partir du haut en bas, comme dans la théorie des Appareils idéologiques d’Etat, pour voir comment l’Idéologie se diffuse comme une force immatérielle matérialisée de domestication sociale, par un ensemble d’appareils dont le centre est partout et la circonférence nulle part. On peut aussi partir de bas en haut, pour s’éduquer à résister à une idéologie dominante, qui a su se développer de façon moléculaire. Une construction, elle aussi moléculaire d’une nouvelle hégémonie des subalternes, à partir du vécu, du sentir, du particulier singulier, pour s’élever à une rationalité réelle, au comprendre, à une universalité concrète. C’est le chemin de Gramsci : partir du folklore, force matérielle de résistance, quasi intemporelle, religion fossilisée, porteuse d’irrationnel mais aussi d’une raison d’être dans la compréhension du monde. Puis la religion, les religions, elles-mêmes progressivement déplacées de la transcendance vers l’immanence, du polythéisme vers le monothéisme, qu’il ne s’agit pas de mépriser car elle a sa fonction d’unification d’une conception du monde et de mise en adéquation avec une morale permettant l’action. Elle est une phase durable, nécessaire de l’humanité, son défaut mortel par rapport à la philosophie est son absence de réflexivité, ses horizons néanmoins limités face à la percée de la rationalité moderne, sa force par rapport à elle est sa foi qui pousse à l’action, à l’espérance, à l’utopie (pp. 274 à 276). Vient alors la dialectique du sens commun et du bon sens (pp. 269 à 272), que Gramsci tend à confondre dans un premier temps, avant de les dissocier tout en identifiant dans cet amalgame d’idées reçues, de pratiques inconscientes, de conformisme de masse, le noyau du vrai contenu dans le sens commun des subalternes. Au sommet de la construction, la philosophie comme ordre rationnel et réfléchi de l’existence, dont la philosophie de la praxis représente le projet le plus abouti de ne pas s’enfermer dans les constructions arbitraires d’un philosophe génial mais de penser la pratique humaine, l’histoire passée, présente et future. Nous entrons ici dans la troisième dimension avec la profondeur de la conception qui esquive les attaques de Croce sur le réductionnisme du matérialisme historique au facteur économique, sans tomber dans le subjectivisme de l’acteur porteur d’une conception du monde par son projet ou l’actualisation d’une utopie, comme dans le messianisme du jeune Lukacs ou de Bloch (p. 283), d’une gnose moderne ou la liberté absolue de Sartre.
Gramsci réintroduit les « distincts » de Croce, ce que Bourdieu appellerait les « champs autonomes », dans une totalité historique, complexe et articulée, en mouvement perpétuel mais dans une généalogie déterminée, animée par un ensemble de relations tantôt de distinction, tantôt d’opposition, et dans certains cas d’antagonismes, à préciser dans l’analyse concrète de la situation concrète : ce que Gramsci appelle le bloc historique. La conception de la totalité esquissée, sans cesse retravaillée au fusain, se rapproche moins de la totalité expressive leibnizienne que d’un univers qui contient une infinité de multivers (p. 80), plus proche de Giordano Bruno ou Pascal, un « complesso » selon le terme judicieusement choisi par Labriola pour caractériser cet ensemble de faits historiques restitué dans la multiplicité de leurs relations et combinaisons. Ce qui tombe, grâce à la restitution patiente d’André Tosel, c’est l’accusation, sous-jacente chez Althusser explicite chez d’autres[38], de totalitarisme de la pensée gramscienne (p. 172), indifférent à la pluralité des formes de la représentation de la volonté populaire comme à la spécificité des champs de l’action humaine, une sorte de gentilianisme inversé. Althusser avait affirmé de façon tranchante son anti-humanisme et un anti-historicisme, quitte à revenir sur les malentendus que cela ouvrait, Tosel lui oppose un humanisme et un historicisme absolus qu’il reconstruit dans sa complexité, loin de tout schématisme, en évoquant à juste titre ce que ces concepts d’humanisme et d’historicisme charrient d’équivoques (p. 83). Des ambiguïtés qui permettent à Althusser de condenser dans une même attaque une multiplicité de charges symboliques, qui ne touchent pas Gramsci au cœur et qui, pour partie d’entre elles, ratent leurs cibles.
André Tosel défend la méthode historiciste de Gramsci, et la philosophie de l’immanentisme absolu qui la sous-tend, comme elle supporte son humanisme absolu qui devient aussi un projet culturel alternatif à la modernité déshumanisante, fasciste italienne ou allemande, libérale américaine ou stalinienne russe. L’ostinato harmonique de Tosel offre, avec une obstinée rigueur, un prélude au symbole de cette utopie concrète humaniste est l’alternative au gorille apprivoisé, l’ouvrier à la chaîne de Taylor, auquel Gramsci – comme le Marx de l’Idéologie allemande, mais avec une image plus historiquement concrète, mais aussi plus intellectuelle – oppose l’idéal de l’Homme universel à la Leonardo de Vinci (p. 121), ingénieur, philosophe, artiste, artisan, l’homme idéal de Gramsci est celui qui réalise progressivement dans l’histoire son essence d’être humain. Celui qui s’extrait de sa condition d’homme du commun soumis à un conformisme subi, d’individu, banal ou exceptionnel, pour s’élever dans la formation de sa personnalité, singulière et universelle, dans l’élaboration active d’un nouveau conformisme émancipateur par « en bas », par le Parti/Prince Moderne qui laisse à chacun la possibilité de développer toutes ces potentialités (p. 179).
L’exposition d’une « philosophie de la libération »
La darstellung de Tosel nous dévoile progressivement ce qui pourrait constituer le noyau de la philosophie de Gramsci, qu’Alberto Burgio et Fabio Frosini ont récemment éclairé de leurs reconstructions philologiques[39]. Le nœud de cette nouvelle conception de la philosophie pourrait, c’est une hypothèse que Tosel développait déjà au début des années 1980[40], se trouver dans le concept de traductibilité (pp. 249-250). Il a souvent été reproché les ambigüités, les équivoques, les antinomies des équations gramsciennes : « philosophie = politique = histoire », ou encore « hégémonie = consentement + coercition », tour à tour biffées, inversées, déplacées. Ces équations ont été falsifiées par la logique formelle althussérienne, peut-être est-ce que cette métaphore mathématique est peu à même de symboliser la profondeur de l’opération linguistique gramscienne, d’une linguistique qui a peu à voir avec le rêve structuraliste d’une mathesis universalis dans et par le langage, et beaucoup avec l’influence tant de la philologie que de la pragmatique, deux sources dont Gramsci s’est nourri dans sa courte formation académique. Cette philologie pragmatique lui permet de réaliser son opération théorique : un dialogue entre l’idéalisme critique allemand de Kant et Hegel construit dans la traduction philosophique de l’expérience des Lumières françaises, du pragmatisme anglais et du romantisme allemand, et d’autre part précisément l’expérience concrète des Révolutions françaises depuis 1789, rencontre entre une pensée rationaliste forgée par des intellectuels, l’action d’un peuple et une force hégémonique jacobine (p. 284). L’opérateur pratique se trouve potentiellement dans l’empirio-pragmatisme anglo-saxon (p. 248), avec l’attention renouvelée au sens commun, à l’expérience, aux faits, dont on trouve un autre versant tant dans les thèses sur Feuerbach que dans le dernier Lénine. Le génie de Gramsci, renouvelant les trois sources du matérialisme historique non en trois piliers mais en théorie allemande/pratique française médiatisée par l’opérateur anglo-saxon, est de trouver malgré tout un filon de pensée authentiquement italien, et pourtant universel, de Dante à Croce, passant par Campanella, Bruno, Galilée, Machiavel, Vico, Labriola. Cela nous ramène à quelques-unes des pages les plus passionnantes du volume, celle sur la dialectique entre nation et internationalisme, soit du particulier et de l’universel, où Tosel nous livre un aperçu éclairant de ce combat sur deux fronts que mène Gramsci, et de la voie étroite qu’il ouvre au mouvement révolutionnaire.
Le rejet du nationalisme (p. 218), négation des réalités locales ou corporatives vivantes par une entité abstraite, exaltée dans sa spécificité, fétichisée. Pourtant, la naissance d’une communauté humaine porteuse des utopies de justice et de fraternité ne peut passer que, suivant l’exemple de la révolution française et par-delà aussi de la réforme protestante, par le cadre national. Elle est impossible, utopique dans le mauvais sens du terme, sans la construction volontaire d’un Etat éthique et d’une société civile, enracinée dans ce que la tradition nationale porte de démocratique, d’émancipateur, et dans un contrat social avec le peuple et les subalternes dans un bloc social qui s’inscrit, pour un temps indéterminé, encore au niveau national. Ce qui conduit Gramsci à une critique impitoyable de ce qu’il appelle le cosmopolitisme[41] (pp. 220-221), dont l’envers est le nationalisme dans l’ère moderne des impérialismes, et qu’il perçoit comme le mal italien depuis l’époque médiévale, entre guelfes et gibelins, entre Eglise et Empire, les deux formes historiques du cosmopolitisme en Occident entre lesquels les intellectuels italiens n’ont pas su « farsi stato » et « farsi nazione ». Ce cosmopolitisme aux atours séduisants est vivement pris à parti par le jeune Gramsci dans sa polémique contre l’espéranto (p. 21) qui, derrière les bons sentiments affichés, n’incarne qu’une utopie trompeuse, une abstraction intellectuelle là où une langue universelle ne peut être que traduction de multiplicités de formes de vie et d’histoires, un manifeste pour le multilinguisme (p. 219). Le véritable espéranto risque d’être un langage technique appauvri, celui de l’américanisation à sens unique face auquel doit émerger un parler universel, celui d’un multivers à sens pluriel. L’acharnement de Gramsci contre le cosmopolitisme s’enracine dans son manifeste pour qu’enfin les intellectuels italiens remplissent leur fonction de médiateurs, d’organisateurs, de traducteurs de la volonté populaire, leur fonction national-populaire. L’horizon reste pourtant celui du cosmopolitisme, la communauté universelle. Tosel parle de sa catholicité (pp. 210-211), ce qui peut sembler paradoxal, tant Gramsci semble protestant, et a été interprété comme tel[42]. Il est le réconciliateur de ces deux traditions religieuses, ne tente-t-il pas d’introduire un peu d’esprit protestant, soit national, critique, moderne, dans l’Eglise laïque qu’est le Parti communiste ?
Avec le cosmopolitisme comme horizon, Gramsci apparaît, comme Tosel le remarque à plusieurs reprises, remarquablement stoïcien. Cela peut relever de la trivialité pour son combat contre la souffrance physique et psychologique en prison, pour ne pas sombrer dans le naufrage de sa personnalité, ce que Tosel nous expose sobrement avec une bouleversante touche personnelle (pp. 291-293). Cette hypothèse, que l’auteur qualifie de « stoïcisme de la rationalisation industrielle » (p. 179) nous est parue lumineuse : cette tension entre liberté et nécessité, actif et passif, raison et passion, lois et nature humaines comment ne pas y voir le dépassement des tensions que les maîtres du stoïcisme nous ont légués ? La place centrale qu’occupe l’hégémonie dans la théorie de Gramsci, quels philosophes, si ce ne sont les stoïciens, lui ont accordé une place analogue, poussant Tosel à parler d’une « version moderne de l’éthique stoïcienne » (p. 319) ? André Tosel pointe avec clairvoyance que la philosophie de la praxis comme immanentisme absolu, refusant toute transcendance, permet de dessiner une tradition philosophique originale depuis la pensée antique d’Aristote, Socrate, des stoïciens, à l’humanisme rationaliste et réaliste, de Machiavel, Bruno, Spinoza aux Lumières plurielles et marginales, avec Vico, Rousseau, Goethe jusqu’au néo-idéalisme de Kant et Hegel, dont Marx est le dernier élève turbulent, et enfin au pragmatisme de James, Dewey. Tosel l’évoque à un moment donné, sans approfondir l’allusion, il s’agit d’une autre tradition, bien que voisine de celle qu’Althusser amorce dans ses écrits tardifs sur le matérialisme aléatoire (p. 88), de Démocrite et Epicure jusqu’à Heidegger, en passant par Machiavel, Spinoza, Nietzsche.
On pourrait dire que Gramsci et Althusser sont deux faces de la modernité, cherchant l’espoir jusque dans l’abîme. L’une lumineuse, l’autre ténébreuse, l’une essayant dans les ténèbres de trouver la lumière d’une nouvelle civilisation qui serait un progrès pour l’humanité, l’autre choisissant d’enfoncer l’homme dans sa nuit pour qu’il ne puisse plus s’illusionner sur sa civilisation de mort. Dans sa réélaboration en prison, Gramsci mûrit son projet culturel, qui va au-delà de la Renaissance, qui fait vivre l’Humanisme, dans ce qu’il appelle la « réforme intellectuelle et morale ». Cette dualité Réforme et Renaissance est encore une façon de critiquer dans cette dernière les intellectuels traditionnels, et leur dédain pour les subalternes et l’histoire de leur pays, et le savoir érudit déconnecté de la vie. Son appel à la Réforme intellectuelle et morale dépasse, en la réalisant, l’appel à la Révolution culturelle (pp. 201 à 204) qui, comprise partiellement, pourrait signifier une tabula rasa douteuse, celle qu’avait lancé certains intellectuels soviétiques au début des années 1920, tel le Proletkult pour lequel Gramsci avait des sympathies, ou celle que plus tard expérimenta la Chine maoïste, conduisant par ces excès d’idéologisme ou de politisme, son déficit national-populaire compensé parfois par le populisme, à un nécessaire retour de bâton, comme lors de la Révolution française, qui prend la forme d’une Révolution passive, ou révolution conservatrice, révolution-restauration. Le but que se fixe Gramsci dans les années 1930, dans la plus grande crise que le capitalisme ait connue, alors que le fascisme, le colonialisme prennent possession du globe, qu’américanisme libéral et le césarisme progressif stalinien incarnent les alternatives, c’est de réaliser une anti-révolution passive.
Il s’agit de remettre les subalternes en mouvement, non pour quelques révoltes inorganiques, pour être instrumentalisées dans tel ou tel bloc historique, dans un pays, une région ou une période donnés. Il s’agit bien de devenir force hégémonique, maître de leur destin et pouvant décider de celui du monde, porteur d’une conception du monde intégrale et complexe, cohérente et en expansion, dialogique et antagoniste à celle des forces hégémoniques du vieux monde. Pour les forces qui incarnent cette alternative inexistante actuellement, mais potentielle dans le mouvement ouvrier de l’après-guerre, il incombe de réaliser un exercice d’humilité, d’abord en apprenant de la défaite, en reprenant la pensée pas à pas grâce à la dimension opératoire – operare, le mot est sans doute celui qui convient le mieux à la méthode de Gramsci, terme longtemps gommé derrière agir dans les traductions françaises et que Tosel nous permet d’exhumer (p. 260) – de ses textes. Lorsqu’il s’agit de trouver une formule pour marquer cette philosophie, nous serions tentés, interprétant l’intention de Tosel de dire une « philosophie de la libération », non pas une théologie mais, là nous reprenons l’expression que Tosel tire de Gramsci, non pas une religion de la liberté mais une « hérésie de la religion de la liberté » (p. 280).
L’artisan et son ouvrage
Déchiffrer la légende de notre guide
Le premier obstacle sur les sentiers gramsciens, c’est que notre guide nous laisse avec une carte minutieuse mais dont la légende est elle-même à déchiffrer. Il était nécessaire de se détourner d’un esprit exagérément analytique, découpant mécaniquement la pensée de Gramsci en morceaux conceptuels, thématiques, ou en bornes chronologiques figées, mais l’écriture dialogique à la Diderot, sous la forme somme toute classique d’un livre de nature universitaire, est le style le plus difficile qui soit. Il comporte sa part de détours salutaires et de voies sans issue, d’abandon dans des sentiers touffus et d’escapades dans des vallons fertiles, de retour sur les sentiers battus et d’explorations sur des sentes inconnues. Il n’y a pas lieu à le regretter, il est possible de prendre le livre d’André Tosel par différents bouts, comme Althusser nous proposait d’éviter le chapitre 1 du Capital – ce que nous déconseillons pour étudier le Capital autant que pour Etudier Gramsci ! – comme Cortazar nous fournit deux feuilles de route pour lire sa Marelle. On peut choisir la lecture traversière ou décider de commencer par le commencement, et se plonger dans le travail de l’œuvre, le tout est d’éprouver de la joie de lire et de vouloir faire l’effort de l’éprouver jusqu’au bout. Car l’effort intense provoqué par une écriture dense peut parfois décourager. Sa lecture intégrale est nécessaire, elle est aussi laborieuse, au sens qu’elle nous contraint à un travail intense, elle nous oblige à suivre un travailleur, rompu au dur labeur, qui prit le parti du labor, des travailleurs jusque dans sa méthode d’artisan, travaillant et retravaillant l’ouvrage sur le métier. Il faut des efforts pour parvenir aux premières étincelles, mais le premier obstacle épistémologique passé, cet ouvrage est de ceux qui nous aident à nous orienter dans la pensée et dans l’action.
Un débat inachevé avec le gramscisme diffus post-moderne
On peut également noter une certaine frustration quant à une tendance à un style allusif, non pas pour l’étude de Gramsci même, référencée avec méticulosité, ni pour la discussion avec la gramsciologie contemporaine, mais plus avec les courants modernes et post-modernes se revendiquant de Gramsci, ou avec certains penseurs que l’on rapproche fréquemment de Gramsci. Tosel tourne le dos au style tranchant d’Althusser, fermant une longue parenthèse où les affirmations lapidaires, stimulantes mais simplificatrices, ont beaucoup obscurci la connaissance de Gramsci en France. Il est à craindre un œcuménisme excessif, pourtant contredit par la rigueur de la démonstration d’André Tosel. Le fil rouge d’une philosophie de la libération est bien éloigné de ce qu’Althusser fustigeait dans un gramscisme de seconde main, l’embrouillamini personnaliste de Garaudy, qui proposait un ersatz de Paul Ricoeur, du Gabriel Marcel de contrebande, adapté aux milieux marxistes. Il en est aussi de conflits non résolus, ni même posés clairement, si ce n’est dans quelques lignes perdues laissées en chemin. A plusieurs reprises, la formule « on a souvent reproché à Gramsci… » (p. 179 par exemple) revient, elle laisser supposer au lecteur qu’il lui sera possible de retracer ce qui vient de Lefort, Lefebvre, Althusser mais aussi d’Anderson, Bobbio, Del Noce, Jocteau, Mondolfo, Pellicani, Perlini, Salvadori. On eût apprécié que l’appareil de notes de bas de page, très complet pour la première partie, le soit tout autant pour les chapitres suivants, laissant le lecteur novice dans les études gramsciennes, et plus largement dans les débats du marxisme français et européen, désarmé face à ces allusions d’initiés.
Plus fondamentalement, on aurait aimé que soient développés les passages sur les liens explicites ou implicites avec les œuvres de Deleuze (pp. 297-301), Foucault (p. 179) ou Bourdieu, que le fil rouge avec l’œuvre althussérien ne se limite pas ouvertement à 4 ou 5 pages mais se poursuivre quelque peu, y compris dans ses reformulations entre 1965 et 1978[43]. Existe-t-il une incompatibilité fondamentale entre les conceptions philosophiques de Gramsci et celles d’Althusser ou des possibilités de syncrétisme tels qu’elles se sont manifestées chez Christine Buci-Glucksmann puis dans les milieux académiques engagés anglo-américains des Cultural studies ou dans le néo-populisme de Mouffe et Laclau ? Est-il possible de croiser, sans risquer des incompatibilités logiques, les œuvres de Foucault, Deleuze avec celle de Gramsci, ou est-ce, comme certains le suggèrent pour Marx[44], s’exposer à formuler sans le savoir des théories contradictoires in se ? Si on prend le cas des subaltern studies, la lecture partielle qui est faite des manuscrits tardifs de Gramsci est-elle une reprise créative d’intuitions gramsciennes (p. 101)[45], ou est-il possible d’y voir un renversement de la « finalité hégémonique » qui reste le but de Gramsci, comme Tosel nous l’expose ? Tosel a visiblement choisi, sans doute pour ne pas alourdir son propos ou considérant que ce n’était pas son objet, d’esquiver ces questions ou de ne pas les traiter de manière frontale. Il laisse son lecteur de charger de se former sa propre pensée, en confrontant le gramscisme de Gramsci avec ce qu’en firent ces exégètes. Il met à notre disposition tous les outils pour construire notre propre édifice théorique, à partir du bricolage rigoureux qu’il ne cessa d’entreprendre et de reprendre.
Une œuvre inclassable
Car le principal écueil de ce volume, tel que nous le voyons se dessiner des remarques précédentes, c’est la difficulté à le classer, à trouver à quel public il s’adresse spécifiquement : est-ce un manuel d’introduction ou une somme pour érudits ? Est-ce un ouvrage scientifique d’étude ou un essai aux effets idéologiques pesés ? André Tosel refuserait de se définir dans ce kierkegaardien « ou bien, ou bien » mais il faut bien dire qu’il prit le risque de rester au milieu du gué. Un nouveau venu dans l’étude de l’œuvre de Gramsci, rebuté par le monument philologique que constitue l’édition Gallimard, risque d’éprouver un autre vertige face à cet ouvrage, et se tournera vers les utiles introductions disponibles à la Découverte ou la Fabrique. L’érudit tire un grand profit de l’ouvrage, décode les allusions, et retrouve une réélaboration théorique de la matière première existant en langue italienne. Dans une période de mode, d’engouement pour Gramsci qui ouvre des créneaux éditoriaux sans précédent depuis les années 1970 à l’œuvre de ce « célèbre inconnu », le premier public est de très loin le plus nombreux, il risque, hélas de ne pas y trouver son compte. Le livre reste difficile d’accès, nous ne parlons pas à un travailleur d’exécution ou un étudiant en difficulté, mais même à un public aguerri à la lecture, connaisseur des théories critiques, engagé dans l’action militante : que ce soit un ouvrier syndiqué, un professeur qui introduit ses élèves à la science politique ou un étudiant qui s’engage dans le monde associatif, un élu local curieux de penser les institutions, pour ce public-ci, ce livre constitue difficilement une première introduction à l’œuvre de Gramsci. Il sera par contre la lecture la plus conseillée, et la plus précieuse, après une première introduction à Gramsci qui devrait passer, si possible, par une lecture de Gramsci dans le texte. Les éditions anthologiques publiées par les Editions sociales, maison d’édition communiste aujourd’hui disparue bien que dernièrement refondée, sont alors le meilleur tremplin. Le novice peut retrouver l’édition de poche de 1983 dirigée par André Tosel, ou celle republiée par les Temps de cerises dont Tosel fut à nouveau le coordinateur[46]. Etudier Gramsci sera est le meilleur des livres de chevet tant sa pensée nous aide à penser, sans se substituer à notre raison critique, elle représente un exercice d’assouplissement de notre entendement, une gymnastique intellectuelle, une hygiène de vie intellectuelle et morale.
Enfin, le dernier défaut concernerait la forme de cette édition, à laquelle semble avoir manqué le nécessaire travail de relecture. C’est un défaut fâcheux, agaçant par moments, hélas de plus en plus banal dans le monde de l’édition, y compris chez ceux qu’on a coutume d’appeler les grands éditeurs. On note d’ores et déjà l’absence d’un index, a minima des noms, sans parler des concepts principaux, fort utile pour se repérer dans un tel dédale intellectuel. Sans effort particulier sur la question de l’orthographe ou de la grammaire, il a été possible de noter une trentaine de coquilles, d’erreurs, la plupart du temps heureusement sans incidence, mais aussi des datations erronées pour ce qui est des références à des publications françaises notamment. L’éditeur réalise un travail remarquable de diffusion de la pensée critique dans le champ national, et il ne peut qu’être félicité d’avoir accepté un livre que les grands éditeurs auraient publié il y a trente ans et tendent aujourd’hui à dédaigner. Cela ne dispense pas du travail de relecture, certes coûteux, fastidieux, mais qui permet de rendre hommage à un ouvrage d’une telle qualité artisanale de fond et que le caractère artisanal de la forme dessert.
Conclusions : Un éclaireur en des temps obscurs
André Tosel, un Aufklärer dans les Holzwege gramsciens ? Par holzwege, entendons-nous bien, non pas ces « chemins qui ne mènent nulle part » selon la traduction française qui a obsédé Althusser jusqu’à sa mort, ni même ce cheminement « off the beaten track » quand bien même Tosel nous porte souvent hors des sentiers battus mais ces « sentieri interrotti », en fait au sens littéral ses « sentiers forestiers », ou ces « sentiers escarpés »[47] si on choisit de bousculer l’étymologie. Les cahiers gramsciens ne sont pas le Livre de sable qui n’a « ni commencement, ni fin »[48] ni un labyrinthe, avec ces « droites galeries qui se courbent en cercles secrets au fil des ans »[49], soumis aux lois du cercle, avec un centre introuvable et à l’issue perdue, soumis à l’infinité des possibilités et au vide du sens. Dans les sentiers forestiers gramsciens, il n’y a pas de galeries de droites, ni cercles secrets, mais on peut y trouver une issue, si on dispose du « fil rouge » déployé par André Tosel. La force de putréfaction, qui transforme la libération du dédale en course contre-la-montre, est celui qui ronge nos sociétés post-modernes, qui hantait Althusser, le nihilisme, ces « chemins qui ne mènent nulle part » et qui ne proviennent de nul lieu. Reconquérir son passé est la première étape à la conquête du sens dans le présent, et à l’édification d’un projet d’avenir. André Tosel avait une conscience aigüe des dangers du nouveau monde né à la fin des années 1970 avec les débuts de l’offensive néo-libérale et de la mondialisation, l’épuisement des formules de la gauche historique, du mouvement ouvrier et sa traduction dans le champ philosophique, le passage d’une génération du marxisme à la pensée post-moderne. Le lent avènement du « pensiero debole »[50], acceptant ou se réjouissant du triomphe de la « raison cynique »[51] qui se nourrissait d’Heidegger, Nietzsche, Schmitt, ne l’a pas emporté. Le bilan après trois décennies d’hégémonie intellectuelle, n’a finalement produit qu’impuissance politique, désertification du terrain de l’éducation populaire, avec un apport douteux par rapport aux sommets de la pensée marxiste, tels Gramsci, Lukacs, l’Ecole de Francfort, quant à l’enrichissement de la réflexion sur l’esthétique, la politique ou la langue. L’abandon du marxisme comme horizon indépassable de la pensée alternative, au lieu de son enrichissement, de sa mise en débat, de sa confrontation avec d’autres traditions de pensée et d’action, a conduit à accompagner le « There is no alternative » des années 1980-1990, sur le terrain philosophique. Ce que Tosel n’accepta jamais, cherchant avec Gramsci à emprunter de nouveau les « sentiers interrompus ». Dans ces sentiers, Tosel fut un Aufklärer, un éclaireur qui avança seul parmi la végétation luxuriante des concepts gramsciens pour mûrir une réflexion buissonnière, un homo viator qui se fit gardien de ce jardin secret, quand le temple fut détruit.
Il fallait être amoureux de Gramsci, et aimer encore plus la sagesse, pour arpenter jusqu’au bout ces traverses sans certitude d’éclairer les promeneurs égarés, à mille lieux de ce chemin solitaire. Robert Musil parlait, à propos de la première passion amoureuse, comme d’une « fuite où être deux ne signifie qu’une solitude redoublée »[52]. Solitude de Gramsci, qui en prison s’étonnait qu’enfin quelqu’un puisse l’aimer et qu’il puisse aimer quelqu’un comme sa femme, effrayé qu’il était d’embrasser toute l’humanité, de sentir son cœur battre pour la cause des damnés de la terre sans jamais éprouver d’affection unique pour un être de chair[53]. Solitude de Tosel où comme dans la phrase de Musil, « le sentiment de n’être pas compris du monde …loin d’accompagner la première passion, en est l’unique et nécessaire cause ». André Tosel est un éclaireur, Aufklärer et non un Erklärer, un docte porteur de la sagesse universelle, mais il nous illumine, donne quelque lumière et puis s’en va, une lueur révélatrice, extralucide quoiqu’intermittente, et il nous laisse trouver le cheminement qui nous conduit à faire lumière sur une œuvre toute en clair-obscur. Tosel était définitivement un Auflkärer, un homme des Lumières convaincu avec Merleau-Ponty que le « marxisme avait besoin d’une théorie de la conscience »[54] et que Gramsci permettait de lui apporter, dans le sillage d’un Jaurès dans le socialisme français. Ces derniers temps, André Tosel aimait à rappeler le souvenir de l’un de ses premiers maîtres, Eric Weil, monument d’érudition, toujours une référence pour l’étude de Kant et Hegel, qui lorsque Tosel avait commencé à Nice à élaborer sa propre philosophie du marxisme lui avait soufflé qu’il ne tarderait pas à rencontrer Gramsci sur son chemin[55]. Pour le théoricien de l’Etat de droit, le philosophe est avant tout un éducateur dont la « tâche est de discerner dans le monde, c’est-à-dire de déceler les structures du monde en vue de la réalisation de la liberté raisonnable »[56]. C’est sur une note analogue que Tosel conclut le dernier chapitre de son grand livre, il nous laisse en héritage un bel ouvrage comme jalon vers la « réalisation de la liberté raisonnable ».
[1] Milan Kundera, Le rideau : essai en sept parties (Paris, France : Gallimard, impr. 2005, 2005) qui caractérise ainsi le dernier Picasso.
[2] C’est en ces termes que Théophile Gautier commentait les gravures de Piranesi, Théophile Gautier, Émaux et camées (Paris, France: E. Didier, 1852).
[3] Dante Alighieri, La Divine comédie, 2 vol. (Paris, France : C. Marpon : E. Flammarion, 1883).
[4] Empruntant à Guy Debord dans la Société du spectacle, cette matérialisation dans le spectacle d’une conception du monde (Weltanschauung) devenue effective, in Guy Debord, Alice Debord, et Vincent Kaufmann, Oeuvres, éd. par Jean-Louis Rançon (Paris, France : Gallimard, impr. 2006, 2006), 767.Guy Debord, Alice Debord, and Vincent Kaufmann, Oeuvres, ed. Jean-Louis Rançon (Paris, France : Gallimard, impr. 2006, 2006), 767.
[5] Nicolas Sarkozy, ‘Le Vrai Sujet Ce Sont Les Valeurs’, Le Figaro, 17 April 2007.
[6] LE PEN Jean-Marie, « Déclaration de M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, sur l’actualité de Jeanne D’Arc, la fête du travail, le revers subi lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2007, la consigne d’abstention pour le deuxième tour ainsi que sur la préparation des élections législatives, Paris le 1er mai 2007. », text, http://frontnational.com, le 2 mai 2007, (1 mai 2007), http://discours.vie-publique.fr/notices/073001631.html.LE PEN Jean-Marie, ‘Déclaration de M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, sur l’actualité de Jeanne D’Arc, la fête du travail, le revers subi lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2007, la consigne d’abstention pour le deuxième tour ainsi que sur la préparation des élections législatives, Paris le 1er mai 2007.’, text, http://frontnational.com, le 2 mai 2007, (1 May 2007), http://discours.vie-publique.fr/notices/073001631.html.
[7] Jacques Attali, « Marx malgré tout », Le Nouvel observateur, 30 janvier 1978.Jacques Attali, ‘Marx Malgré Tout’, Le Nouvel Observateur, 30 January 1978.
[8] Propos de Philippe Doucet rapportés par le Monde du 7 octobre 2016
[9] Etienne Gernelle Mahrane Saïd, « Emmanuel Macron : “La Révolution française est née d’un ferment libéral” », Le Point, 22 novembre 2016, http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-macron-la-revolution-francaise-est-nee-d-un-ferment-liberal-22-11-2016-2084962_20.php.Etienne Gernelle Mahrane Saïd, ‘Emmanuel Macron : “La Révolution Française Est Née d’un Ferment Libéral”’, Le Point, 22 November 2016
[10] Madeleine Bazin de Jessey, ‘Quand Les Veilleurs Faisaient Des Nuits Debout’, Le Figaro, 11 April 2016 ; Paul-Marie Couteaux, ‘François Fillon Doit Lire Gramsci’, Le Figaro, 6 February 2017.
[11] François Ruffin et Antonio Gramsci, « Remporter la bataille des idées » : entretiens avec Antonio Gramsci (Amiens, France : Fakir éd., 2015). François Ruffin and Antonio Gramsci, ‘Remporter la bataille des idées’ : entretiens avec Antonio Gramsci (Amiens, France : Fakir éd., 2015).
[12] Gaël Brustier et Eugénie Bastié, « Macron est l’intellectuel organique du nouveau capitalisme », Le Figaro, avril 2017.Gaël Brustier and Eugénie Bastié, ‘Macron Est l’intellectuel Organique Du Nouveau Capitalisme’, Le Figaro, avril 2017.Gaël Brustier and Eugénie Bastié, ‘Macron Est l’intellectuel Organique Du Nouveau Capitalisme’, Le Figaro, 24 April 2017.
[13] Norberto Bobbio, « Intellettuali e vita politica », Nuovi Argomenti, no 7 (mars 1954): 103‑19.
[14] Lettre de Louis Althusser à François Ricci, 19 janvier 1964, Fonds Althusser, correspondance privée, IMEC (Caen)
[15] Entretien avec André Tosel, 10 décembre 2016, Paris
[16] André Tosel, « Communauté et masse. L’action de masse en milieu étudiant », Action catholique étudiante, no 5 (mars 1962) : 16‑17. André Tosel, ‘Communauté et Masse. L’action de Masse En Milieu Étudiant’, Action Catholique Étudiante, no. 5 (March 1962) : 16–17.
[17] Frédérique Matonti, Intellectuels communistes : essai sur l’obéissance politique (Paris, France : Éd. la Découverte, 2005).
[18] André Tosel, Marx en italiques (Mauvezin, France : Trans-Europ-Repress, 1991). André Tosel, Marx en italiques (Mauvezin, France : Trans-Europ-Repress, 1991).
[19] Le premier, en langue française, à faire ce lien explicitement est le théoricien dominicain suisse, de sensibilité plutôt progressiste Georges Cottier, qui devient ultérieurement cardinal : Georges Cottier, Du romantisme au marxisme (Paris, France: Alsatia, 1961); Robert Paris, « La première expérience de Gramsci (1914-1915) », Le Mouvement social, no 42 (janvier 1963): 31‑58; Augusto Del Noce, Il suicidio della Rivoluzione (Milano, Italie: Rusconi libri, 1978); Augusto Del Noce et Hugues Portelli, Gramsci ou Le « suicide de la révolution », trad. par Philippe Baillet (Paris, France: les éds. du Cerf, 2010, 2010); Diego Fusaro, Antonio Gramsci: la passione di essere nel mondo (Milano, Italie: Feltrinelli, 2015).Georges Cottier, Du romantisme au marxisme (Paris, France: Alsatia, 1961); Paradoxalement, cette critique lui fut adressé aussi à partir d’une extrême-gauche aux sensibilités bordiguistes, voir l’article de Robert Paris, insistant sur les affinités théoriques entre la pensée du jeune Gramsci et celle de Mussolini ‘La Première Expérience de Gramsci (1914-1915)’, Le Mouvement Social, no. 42 (January 1963): 31–58; Cette ligne d’attaque fut adoptée par le philosophe chrétien Augusto Del Noce qui voit dans cet immanentisme absolu une impossibilité à dépasser le nihilisme, tant dans le fascisme que dans le communisme le plus subtil: Il suicidio della Rivoluzione (Milano, Italie: Rusconi libri, 1978); Le livre vient d’être traduit en français avec une préface d’Hugues Portelli qui fut un des meilleurs connaisseurs de Gramsci dans les années 1970, alors militant socialiste, devenu par la suite centriste puis parlementaire de droite: Augusto Del Noce and Hugues Portelli, Gramsci ou Le ‘suicide de la révolution’, trans. Philippe Baillet (Paris, France : les éds. du Cerf, 2010, 2010) ; Ces dernières années, un jeune intellectuel, élève de Costanzo Preve semble redécouvrir ce couple, avec une signification curieusement positive, Diego Fusaro, Antonio Gramsci: la passione di essere nel mondo (Milano, Italie : Feltrinelli, 2015).
[20] Je me permets de renvoyer à l’étude que je viens de transmettre à la Revue Itinerari di ricerca storica: « Doppia incognita di un’equazione ellittica : la non ricezione di Labriola in Francia », 2017
[21] André Tosel, L’esprit de scission : études sur Marx, Gramsci, Lukács (Besançon, France : Université de Besançon, 1991).
[22] György Lukács, Nicolas Tertulian, et Didier Renault, Ontologie de l’être social. Le travail, la reproduction, trad. par Jean-Pierre Morbois (Paris, France : Éditions Delga, 2011) ; György Lukács et Nicolas Tertulian, Ontologie de l’être social. I’idéologie, l’aliénation, trad. par Jean-Pierre Morbois et Didier Renault (Paris, France : Éditions Delga, 2012).
[23] Guido Liguori et Pasquale Voza, éd., Dizionario gramsciano: 1926-1937 (Roma, Italie: Carocci, 2009, 2009)..
[24] Giuseppe Cospito, Il ritmo del pensiero in isviluppo: per una lettura diacronica dei Quaderni del carcere di Gramsci, Ed. provvisoria (Pavia: Cooperativa libraria universitaria, 2004).
[25] Giorgio Baratta, Le rose e i quaderni: il pensiero dialogico di Antonio Gramsci (Roma: Carocci, 2003); Giorgio Baratta, Antonio Gramsci in contrappunto: dialoghi col presente (Roma, Italie: Carocci, 2007).
[26] Alberto Burgio, Gramsci: il sistema in movimento (Roma, Italie: DeriveApprodi, 2014, 2014).
[27] André Tosel, « Philosophie de la praxis et dialectique », La Pensée, no 237 (1984) : 100‑120.
[28] John Bellamy Foster, « The Return of Engels », Monthly Review 68, no 10 (mars 2017).
[29] André Tosel, Un monde en abîme ? essai sur la mondialisation capitaliste (Paris, France : Kimé, 2008).
[30] Nous nous permettons ici de renvoyer au mémoire de maîtrise de Pia Bou Acar dirigé par Jean Salem, L’action journalistique d’Antonio Gramsci au cœur du combat révolutionnaire italien du début du XXe siècle (Paris, France: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2014).
[31] Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 vol. (Frankfurt, Allemagne: Suhrkamp, 1976).
[32] Romain Rolland, « Ceux qui meurent dans les prisons de Mussolini », L’Humanité, 27 octobre 1934.
[33] Sandra Teroni, Wolfgang Klein, Pour la défense de la culture : les textes du Congrès international des écrivains, Paris, juin 1935 (Dijon, France : Éditions universitaires de Dijon, 2005).
[34] André Tosel retrouve ici la mise au point de l’éminent linguiste, et un des premiers à connaître l’œuvre de Gramsci en France, Georges Mounin, Machiavel (Paris, France: Ed. du Seuil, 1958).
[35] Étienne Balibar et al., « Althusser : une nouvelle pratique de la philosophie entre politique et idéologie. Conversation avec Étienne Balibar et Yves Duroux (Partie I) », Cahiers du GRM. publiés par le Groupe de Recherches Matérialistes – Association, no 7 (1 juin 2015).
[36] Le chapitre sur Louis Althusser, rédigé par Silvano Tagliagambe in Ludovico Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico. Vol. 7, Il Novecento (2) (Milano, Italie: Garzanti, 1976), 78‑126.
Nous renvoyons à l’étude fondatrice d’Alberto Maria Cirese, « Concezione del mondo, filosofia spontanea, folclore » dont Louis Althusser a connaissance, et a étudié avant de rédiger son fameux article sur les Appareils idéologiques d’Etat Fondazione Istituto Antonio Gramsci, Studi gramsciani (Roma, Italie: Editori riuniti, 1969), 299‑328.
[38] En France, voir Claude Lefort, Le travail de l’œuvre, Machiavel (Paris, France : Gallimard, impr. 1972, 1972) ; Henri Lefebvre, De l’État. 2, De Hegel à Mao par Staline (la théorie « marxiste » de l’État) (Paris, France : Union générale d’éditions, impr. 1976, 1976) ; En Italie, voir Gian Carlo Jocteau, Leggere Gramsci: una guida alle interpretazioni (Milano, Italie : Feltrinelli, 1975) ; Norberto Bobbio, « Che cosè il pluralismo », La Stampa, 21 septembre 1976 ; Massimo Salvadori, « Gramsci e il PCI. Due concezioni dell’egemonia », Mondoperaio, no 11 (novembre 1976); Luciano Pellicani, Gramsci e la questione comunista (Firenze, Italie: Vallecchi, 1976).
[39] Burgio, Gramsci; Fabio Frosini, Gramsci e la filosofia: saggio sui Quaderni del carcere (Roma: Carocci, 2003)..
[40] André Tosel, « Philosophie marxiste et traductibilité des languages et des pratiques », La Pensée, no 223 (octobre 1981) : 110‑26 ; Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, « De la traduction à la traductibilité : un outil d’émancipation théorique », Laboratoire italien. Politique et société, no 18 (25 novembre 2016).
[41] Nous renvoyons le lecteur ici aux travaux les plus aboutis sur la question, ceux de Francesca Izzo, Democrazia e cosmopolitismo in Antonio Gramsci (Roma, Italie: Carocci, 2009, 2009).
[42] C’est ainsi que le perçoivent après la guerre l’écrivain italien Elio Vittorini et l’intellectuel français Dionys Mascolo Elio Vittorini, Gli anni del « Politecnico » : lettere 1945-1951, éd. par Carlo Minoia (Torino, Italie : Einaudi, 1977) ; Dionys Mascolo et Robert Antelme, Autour d’un effort de mémoire : sur une lettre de Robert Antelme (Paris, France : M. Nadeau, 1987).
[43] Vittorio Morfino, « Althusser lecteur de Gramsci, Althusser as a Reader of Gramsci », Actuel Marx n° 57, no 1 (4 mai 2015) : 62‑81 ; Anthony Crezegut, « Althusser, étrange lecteur de Gramsci. Lire « Le marxisme n’est pas un historicisme » : 1965-2015 », Décalages 2, no 1 (2016) : 2.
[44] Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser & Marx : la politique dans la philosophie (Paris, France : Demopolis, impr. 2011, 2011).
[45] Cette question est d’autant plus vitale qu’elle correspond aujourd’hui à un sens commun académique aux dimensions planétaires. Je me permets de renvoyer au travail en phase de finalisation sur cette question réalisé par l’étudiante italienne Claudia Pede à l’EHESS, à Paris, sur Un héritage actif : Folklore et subalternité chez Gramsci, septembre 2017
[46] Antonio Gramsci, Textes, éd. par André Tosel, trad. par Jean Bramont, Gilbert Moget, et Armand Monjo (Paris, France : Éditions sociales, 1983) ; Antonio Gramsci, Textes choisis, éd. par André Tosel, trad. par Jean Bramant, Gilbert Moget, et François Ricci (Paris, France :, impr. 2014, 2014). Antonio Gramsci, Textes, ed. André Tosel, trans. Jean Bramont, Gilbert Moget, and Armand Monjo (Paris, France : Éditions sociales, 1983) ; Antonio Gramsci, Textes choisis, ed. André Tosel, trans. Jean Bramant, Gilbert Moget, and François Ricci (Paris, France :, impr. 2014, 2014).
[47] Karl Marx, Henri Joseph Chambre, et Paul-Dominique Dognin, Les Sentiers escarpés de Karl Marx : le chapitre I du Capital traduit et commenté dans trois rédactions successives, 2 vol. (Paris, France : les ed. du Cerf, 1977).
[48] Jorge Luis Borges, Le livre de sable, trad. par Françoise Rosset (Paris, France : Gallimard, 1978), 140.Jorge Luis Borges, Le livre de sable, trans. Françoise Rosset (Paris, France : Gallimard, 1978), 140.
[49] Nous avons choisi une traduction plutôt littérale de Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra (Buenos Aires, Argentine : Emecé Editores, 1969). Ibarra a changé radicalement la forme du poème in Jorge Luis Borges, L’Or des tigres ; L’Autre, le même II ; Éloge de l’ombre ; Ferveur de Buenos Aires, éd. par Nestor Ibarra (Paris, France : Gallimard, 1976). Ibarra a changé radicalement la forme du poème in Jorge Luis Borges, L’Or des tigres ; L’Autre, le même II ; Éloge de l’ombre ; Ferveur de Buenos Aires, ed. Nestor Ibarra (Paris, France : Gallimard, 1976) ; « Aveugles carrefours, couloirs que mon regard déformant interprète, comme une lente circonférence secrète ».
[50] André Tosel commence ainsi son étude sur les origines italiennes de la philosophie de la praxis par son refus d’adhérer à la mode de la pensée faible de Gianni Vattimo, qui commence à installer son hégémonie sur la gauche désillusionnée Tosel, Marx en italiques.
[51] Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme (Paris, France : les Éd. de Minuit, impr. 1985, 1985) ; Peter Sloterdijk, Critique de la raison cynique, trad. par Hans Hildenbrand (Paris, France : C. Bourgois éd., impr. 1987, 1987).
[52] Robert Musil, Les désarrois de l’élève Törless : roman, trad. par Philippe Jaccottet (Paris, France : Ed. du Seuil, 1960), 47.
[53] Voir le beau récit qu’en fait Angelo d’Orsi, Gramsci : Una nuova biografia (Feltrinelli Editore, 2017).
[54] Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique (Paris, France : Gallimard, impr. 1955, 1955), 55.
[55] Entretien avec André Tosel, op.cit. Voir aussi l’entretien avec Gianfranco Rebucini, dans la revue Période publiée le 30 mai 2016
[56] Éric Weil, Philosophie politique (Paris, France : J. Vrin, 1956), 57.
Io eliminerei questa frase…
Sei proprio sicuro ? A me sembra invece che Tosel stia nel mezzo fra i due « estremi » rappresentati da Cospito e Burgio… e comunque non direi che Burgio è un fautore di una lettura filologica dei testi gramsciani (anzi, nel suo ultimo libro si scaglia contro la filologia, e più segnatamente – seppure in maniera indiretta – proprio contro Cospito…)
In italiano la D’ davanti ai nomi si scrive maiuscola