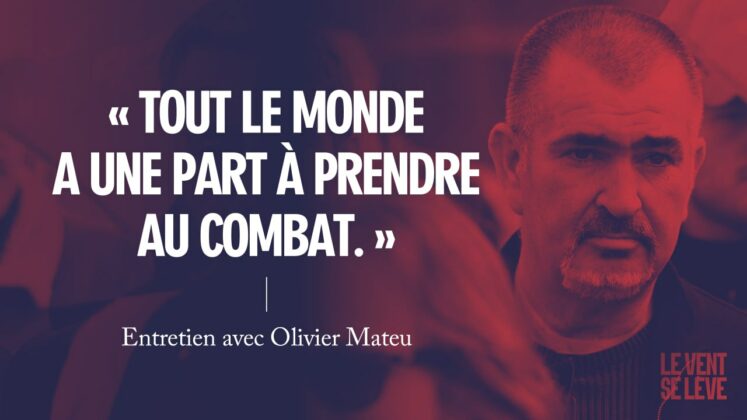La grande mobilisation autour de la grève du 5 décembre a été l’occasion d’une période de grâce relative dans le paysage audiovisuel français : les représentants médiatiques des classes supérieures hésitent face à l’ampleur du mouvement social, face au « spectre de 1995 », et traduisent à leur tour dans leurs argumentaires décousus, les atermoiements du gouvernement au sujet de ce mauvais pas de mi-mandat que constitue pour lui cette réforme totale du système de retraite français. Une petite musique s’installe de façon lancinante : et si le gouvernement d’Édouard Philippe, « à moitié droit dans ses bottes », était en voie de juppéisation ?
La force de la mobilisation accompagnant le mouvement de grève initié le 5 décembre s’identifie à plusieurs aspects : nombre de participants aux manifestations (800 000 et 225 000 sur l’ensemble du pays selon les sources officielles du Ministère de l’Intérieur; 1,5 million et 880 000 selon la CGT pour le 5 décembre et le 10 décembre respectivement) ; ancrage territorial ample (mobilisations très fortes aussi bien dans les grands centres urbains que dans les villes moyennes et petites) ; la transversalité des professions et classes sociales concernées (cheminots, pompiers, enseignants, étudiants en passant par les avocats, les cadres et les professions libérales). Mais l’un des autres faits marquant la réussite actuelle de cette grève, c’est le spectacle saisissant que nous offre la combinaison entre les reculades successives des membres du gouvernement sur plusieurs points de la réforme, et la déconfiture des arguments libéraux sur les plateaux télés, face à la coalescence des mécontentements. Essayons d’analyser les raisons de cette crise de la parole néolibérale, gouvernementale, et médiatique.
Petite remise en contexte, tout d’abord, au cours de l’après-midi, les chaînes d’information en continu diffusant le live de la mobilisation se sont focalisées quasi-exclusivement sur les images des cortèges parisiens (BFM TV, CNEWS), lesquels semblaient pris dans les mailles d’une tactique de guerre de l’image employée précédemment par le dispositif politico-médiatique libéral. Le 1er mai dernier en effet, le cortège syndical s’était vu bloqué en milieu de parcours, au niveau du boulevard de l’Hôpital, obligeant les manifestants à reculer en créant des mouvements de foules, au motif de la difficulté d’assurer le maintien de l’ordre face aux casseurs en tête de la marche, alors que les services d’ordre de la CGT dénonçaient, le soir même, une technique violente de provocation à l’émeute de la part du gouvernement. L’épisode médiatique suivant cette journée fut mémorable : la scène choquante des manifestants cherchant à se réfugier dans les locaux de la Salpêtrière, et l’imbroglio du gouvernement et des principales chaînes d’information, pendant 48h sur le thème casseurs/pas casseurs ?

Face à la mauvaise foi gouvernementale, et aux mises en garde des services d’ordre des cortèges syndicaux, frappés par la police, on était déjà en droit de s’interroger sur l’existence d’une stratégie de l’image élaborée consciemment ou non par la préfecture, qui consiste à empêcher le déroulé traditionnel des images d’un cortège défilant normalement et d’un simple cortège de tête émaillé de violences. L’empreinte télévisuelle du mouvement devient alors exclusivement violente, des scènes de désordre, de confusion, réparties sur l’ensemble du cortège, oblitérant toute image ne serait-ce que neutre du déroulé normal d’une manifestation sociale. La bataille de l’opinion semblait ainsi en partie gagnée pour le gouvernement et les médias néolibéraux, du fait de la confusion perçue par les téléspectateurs, effet compensé en partie par la piteuse communication de Castaner sur les «violents» intrus de la Salpêtrière.
Malgré la teneur sensationnaliste de leurs lives de la mobilisation parisienne, ces chaînes ne sont pas parvenues cette fois à oblitérer la légitimité du mouvement national de grève, car la profondeur de l’encrage territorial plaidait trop fort, trop bruyamment pour l’interprétation inverse : le corps social français dans sa variété et dans sa profondeur rejette la réforme par points du système de retraite.
Le 5 décembre dernier, tout semblait parti pour nous offrir les mêmes images et les mêmes commentaires sur les violences ainsi que France 24, BFM et CNEWS nous l’indiquaient déjà dans leur couverture du départ de la manifestation. Malgré la teneur sensationnaliste de leurs lives de la mobilisation parisienne, ces chaînes ne sont pas parvenues cette fois à oblitérer la légitimité du mouvement national de grève, car la profondeur de l’encrage territorial plaidait trop fort, trop bruyamment pour l’interprétation inverse : le corps social français dans sa variété et dans sa profondeur rejette la réforme par points du système de retraite, et le mouvement, par son ampleur ne peut être réduit à des revendications corporatistes. D’autre part, l’aggravation constante de la politique répressive a cristallisé un certain nombre de réserves dans la presse traditionnelle depuis la mort de Steve Maia Caniço cet été. L’une des manifestations principales de ces réserves quant à la politique répressive est la reconnaissance par le principal quotidien de presse nationale Le Monde, de l’emploi délibéré de la violence dans la doctrine de maintien de l’ordre actuel.
La stratégie de défense de la réforme se repositionne : le gouvernement tente de mettre un coin entre les syndicats et les gilets jaunes en saluant leur capacité d’organisation et de contrôle des débordements, les commentateurs reprenant en cadence cette rhétorique en insistant sur le lien entre manifestation gilets jaunes et violences, puis entre manifestation sociales tout court et violences.
La stratégie de défense de la réforme se repositionne : le gouvernement tente de mettre un coin entre les syndicats et les gilets jaunes en saluant leur capacité d’organisation et de contrôle des débordements, les commentateurs reprenant en cadence cette rhétorique en insistant sur le lien entre manifestation gilets jaunes et violences, puis entre manifestations sociales tout court et violences (par opposition aux manifestations écologistes et féministes). Dans un deuxième temps, la tactique se déploie sur le thème de la dissociation entre manifestants corporatistes défendant les régimes spéciaux, et manifestants perdants apparents de la réforme.
Les enseignants sont alors segmentés des autres professions mobilisées et leurs inquiétudes légitimées, ce qui permet aux éditorialistes de soutenir la parole gouvernementale en relayant les concessions salariales importantes annoncées par Blanquer avant même le début de la mobilisation. Puis vient le tour des agriculteurs, dont on rappelle que, raisonnables, adossés à la parole de la FNSEA, et donc pas dans les rues ce 5 décembre, ils bénéficieront (comme les artisans) de leur intégration dans le régime général de cotisation, et de fait profiteront d’un minimum retraite de 1000 euros. Sauf qu’il s’agit en réalité d’un minimum contributif, c’est-à-dire un minimum pour un départ à taux plein, à 40 annuités cotisées. Donc tout sauf un minimum effectif, hors durée de cotisation. Il n’y a donc aucune garantie d’un minimum retraite à 1000 euros pour ces professions en cas de carrières hachées justement, et en-dessous des seuils complets de cotisation.
Une autre composante de la mécanique argumentaire néolibérale, partagée cette fois entre la rhétorique LaRem et les éléments de pensée et de langage propres aux éditorialistes réformistes, tient à la défense de “l’écoute” du gouvernement, au découplage entre réforme systémique et réforme paramétrique pour rallier la CFDT, et insister sur la clause du grand-père pour les régimes spéciaux.
« Pas de brutalité » nous dit Édouard Philippe, abandonnant ainsi la rhétorique de l’universalité initialement adoptée. La retraite à points, qui, sans augmenter tout de suite l’âge de départ, va fonctionner par phases (y compris et surtout en ce qui concerne les augmentations de salaires compensatoires des enseignants plafonnées à 510 millions d’euros en l’état), voilà la solution ! La preuve : on s’attendait de façon imminente à ce que Laurent Berger, représentant du premier syndicat de France, en retrait des négociations, bien qu’il n’ait pas appelé à manifester, rallie le camp du soutien à la réforme en cas de report des négociations sur l’âge pivot à 64 ans… Pas de pot, la stratégie de passage en force d’Edouard Philippe vient fracasser cet espoir.
Rappelons ici que le soutien des cheminots à la grève de 1995 ne s’est pas arrêté une fois obtenues les principales revendications, en soutien au reste des professions concernées.
Dernière chance pour le camp pro-réforme : jouer sur l’immonde tentative de division inter-générationnelle, baptisée « clause du grand-père ». Cette idée témoignant d’un mépris pour l’argumentaire initial sur la pseudo-égalité du système, et d’un mépris pour les français ramenés à un bloc de bœufs égoïstes uniquement consacrés à leur jouissance immédiate, et incapables de se projeter en soutien aux générations futures. Rappelons ici que le soutien des cheminots à la grève de 1995 ne s’est pas arrêté une fois les principales revendications obtenues mais s’est maintenu dans la durée, en soutien au reste des professions concernées.
Pour résumer, le camp politico-médiatique libéral attendait donc que ceux qui sont déjà partisans du principe de la réforme systémique par points, et qui ne se sont pas mobilisés jusqu’à présent (exception faite des routiers), c’est-à-dire les cadres du secteur privé, et la partie aisée du secteur public, et les économistes socio-libéraux (Jean Pisani Ferry, Philippe Aghion) réaffirment un soutien de plus en plus incertain au gouvernement. Cet état de fait illustre la parfaite déconfiture du camp libéral, et donne à voir la profondeur du rapport de force engagé contre le gouvernement par les syndicats et que même l’éditorialiste des Echos semble reconnaître avec une pointe d’admiration dans la voix :
Et de fait, ce discours implicite, pernicieux, qui naturalise, impose la réforme structurelle par points (au nom d’une universalité dont le gouvernement s’est précisément séparée) aboutit par exemple à l’invitation de Daniel Cohen sur LCI le soir du 5 décembre. Présenté par David Pujadas comme « un des économistes les plus respectés au monde » (sic), et bien que critique du gouvernement en apparence, il sert dans le dispositif politico-médiatique libéral à naturaliser la légitimité du système par points jugé structurellement plus adapté à la correction des inégalités de traitement face aux carrières hachées. Ces fameuses carrières hachées, dont tous ces commentateurs semblent entériner l’existence plutôt que de se soucier de les considérer comme symptômes de la flexibilisation du droit du travail. Pas de réforme paramétrique immédiate donc, nous disent les libéraux, mais une nécessaire réforme systémique, plus juste car détruisant les régimes spéciaux liés à la pénibilité, et surtout plus juste car plus individualiste, comme nous le rappelle ce plombier militant macronien.
Avant même le 5 et le 10 décembre, la racine du mal était identifiée : les hésitations gouvernementales, les discussions depuis 18 mois et toujours pas de projet de loi, en un mot : le manque d’efficacité crée de l’angoisse. Un argument qui infantilise une fois de plus la population, renvoyée métaphoriquement à un enfant attendant sa punition, et que l’angoisse de la claque inquiète plus que la douleur physique en elle-même. Plus à droite (si c’est encore possible…), et depuis plusieurs semaines, un créneau de démarcation a été tout trouvé : la réforme par points est malsaine car visant le développement des fonds de pensions, complexe et inégalitaire (rejoignant la critique de gauche), mais en revanche, c’est à la réforme paramétrique que le gouvernement doit s’atteler sachant que le COR donne pour objectif immédiat de rétablissement des équilibres du système actuel une demi-année de travail en plus pour stabiliser les comptes sociaux à échéance 2025.
À droite donc, on critique le gouvernement pour son aveuglement idéologique et son impréparation, tout en soutenant la nécessité d’allonger la durée de cotisation. À aucun moment l’idée d’équilibrer le système par la hausse des cotisations via la hausse des salaires (des fonctionnaires directement, du secteur privé par l’investissement public dans les secteurs industriels et technologiques de pointe) n’est discutée, car renvoyée aux marécages d’un keynésianisme de mauvaise augure pour une croissance et un monde de l’entreprise pour lequel l’investissement est exclusivement corrélé aux seuls indicateurs actionnariaux.
À ces erreurs politiques, idéologiques, de confiance aveugle dans « le retour des investisseurs » qu’espère le gouvernement via cette privatisation progressive des ressources du système de retraite actuel (300 milliards d’euros environ) s’ajoute la naïveté budgétaire et l’inefficacité de la baisse des cotisations, qui orientent les entreprises vers la concurrence par les prix, via la baisse de la masse salariale, alors que la France n’a pas les moyens de lutter sur les prix, et doit se positionner par l’investissement de masse, dans les transitions technologiques nécessaires à l’industrie écologique du futur.
Au contraire, garantir pérennité du contrat de travail et du système de retraite, c’est offrir une possibilité au système productif français, via la stabilisation de la consommation intérieure, de se projeter sur la compétitivité hors-prix, l’investissement dans l’innovation technologique et les processus de production de pointe face aux Chinois et aux Américains positionnés sur les technologies de la communication et insuffisamment (même en Chine) sur la transition énergétique et industrielle nécessaire pour répondre au réchauffement climatique.
Les journalistes de télévision semblent ainsi pris en étau entre la droite LR et LREM, ne sachant à quel saint se vouer. Reprenant tout d’abord en cadence la proposition de service minimum dans les transports de Bruno Retaillau pour commencer (nouvelle occasion de remettre en cause la légitimité du droit de grève inscrit dans la constitution en renvoyant abusivement cette liberté dos à dos avec la liberté de circulation). Puis voyant la forte mobilisation, ils se rabattent sur la critique apparente des hésitations gouvernementales, tout en soutenant la stratégie gouvernementale de division corporatiste de la mobilisation comme si les Français ne se mobilisaient qu’au nom de leur égoïsme individuel et que la réforme systémique à points était hors des revendications…
L’ultime pièce du mécanisme de défense de l’argumentaire réformiste se trouve dans cette assertion répétée à longueur de plateaux ou d’interviews – en particulier face à un syndicaliste ou un opposant politique à la réforme : « le retrait de cette réforme signerait la fin du mandat de Macron ». Ce dernier étant tout entier légitimé non par la force des urnes, mais en définitive par sa capacité à réformer, c’est-à-dire détruire le programme du CNR, le modèle de la République sociale française. Demander le retrait de la réforme selon ce cadre éditorial, c’est donc formuler une demande irréaliste, et en définitive politique et non syndicale, puisqu’il s’agirait de « faire tomber Macron » au lieu de défendre les salariés, considérés comme intrinsèquement individualistes et consuméristes.
Le « parti pris » d’Arlette Chabot sur LCI lors de l’émission 24h Pujadas, le 5 décembre nous a paru particulièrement représentatif de ce cynisme réformiste propre aux élites de la télévision, convaincues encore des lois néolibérales thatchériennes, et convaincues de la mauvaise foi démagogique de toutes les forces politiques de transformation sociale dans ce pays, puisque un extrait vidéo de François Hollande, manifestant en 1995 contre la réforme des retraites, alors qu’il initiera la réforme Touraine sous sa propre mandature, est cité en modèle de cette « nécessaire » trahison libérale qui colle à la gauche depuis Mitterand.
On en appelle encore au « cercle de la raison » en 2019, alors qu’il faudrait peut-être en appeler à la Cour des comptes, pour établir un rapport sur la prévention des conflits d’intérêts au sujet du système des retraites. Jean-Paul Delevoye, fragilisé par un conflit d’intérêt non-déclaré avait en effet allumé une torche de plus à côté du baril de poudre du 10 décembre, et participé à éloigner le ralliement tant attendu de la CFDT (définitivement enterré depuis le 11 décembre et l’annonce du maintien de l’âge d’équilibre à 64 ans par Edouard Philippe). Le gouvernement lui-même voit sa crédibilité renforcée après les révélations de Mediapart sur les conseils directs prodigués par Black Rock à l’exécutif au sujet de la réforme des retraites. Rappelons au passage que ce fond d’investissement, le plus puissant au monde, lorgne depuis un moment déjà sur les systèmes sociaux européens comme l’indique cet autre article de Mediapart de mai 2019.
Ces derniers participent même à la pédagogie du gouvernement quand ils nous indiquent directement sur leur site, que la loi Pacte anticipait la réforme par points, en défiscalisant les cotisations aux systèmes de retraites complémentaires. Ce qui constitue en soi un rapt fiscal de la majorité des citoyens, étant donné que ceux qui ne cotiseront pas à un système de complémentaire retraite privée, la majorité du peuple, sera donc contraint de financer ce système indirectement du fait des défiscalisations accordées par la majorité LREM. Les Macron Leaks contenaient eux-mêmes dans un échange de mail entre techniciens de la campagne sur le sujet des retraites, qu’il fallait impérativement éviter que des contradicteurs ne se penchent sur ce sujet des défiscalisations des produits de complémentaire retraite ou assurance vie.
Aujourd’hui, la juppéisation du gouvernement est en marche, le Premier Ministre « droit dans ses bottes », paraît vouloir tenter l’épreuve de force en se mettant à dos y compris les syndicats réformistes pour le 17 décembre. Cependant, avec un soutien érodé de la part des médias traditionnels qui plaidaient depuis plusieurs semaines pour le découplage de la réforme systémique et de la réforme paramétrique (condition du ralliement total de la CFDT comme le rappelait Jean-Michel Apathie sur LCI), voire pour certains le retrait de la réforme par points et la seule adoption de mesures paramétriques.
Difficile de croire que le gouvernement dispose de marges de manœuvre politique suffisantes pour enrayer sa descente aux enfers avant les municipales. Et nous n’allons pas contredire Jacques Attali, pour une fois, quand il expose que le gouvernement aurait dû faire passer cette réforme dès le départ, avec la destruction du Code du Travail, quand les Français dormaient encore.