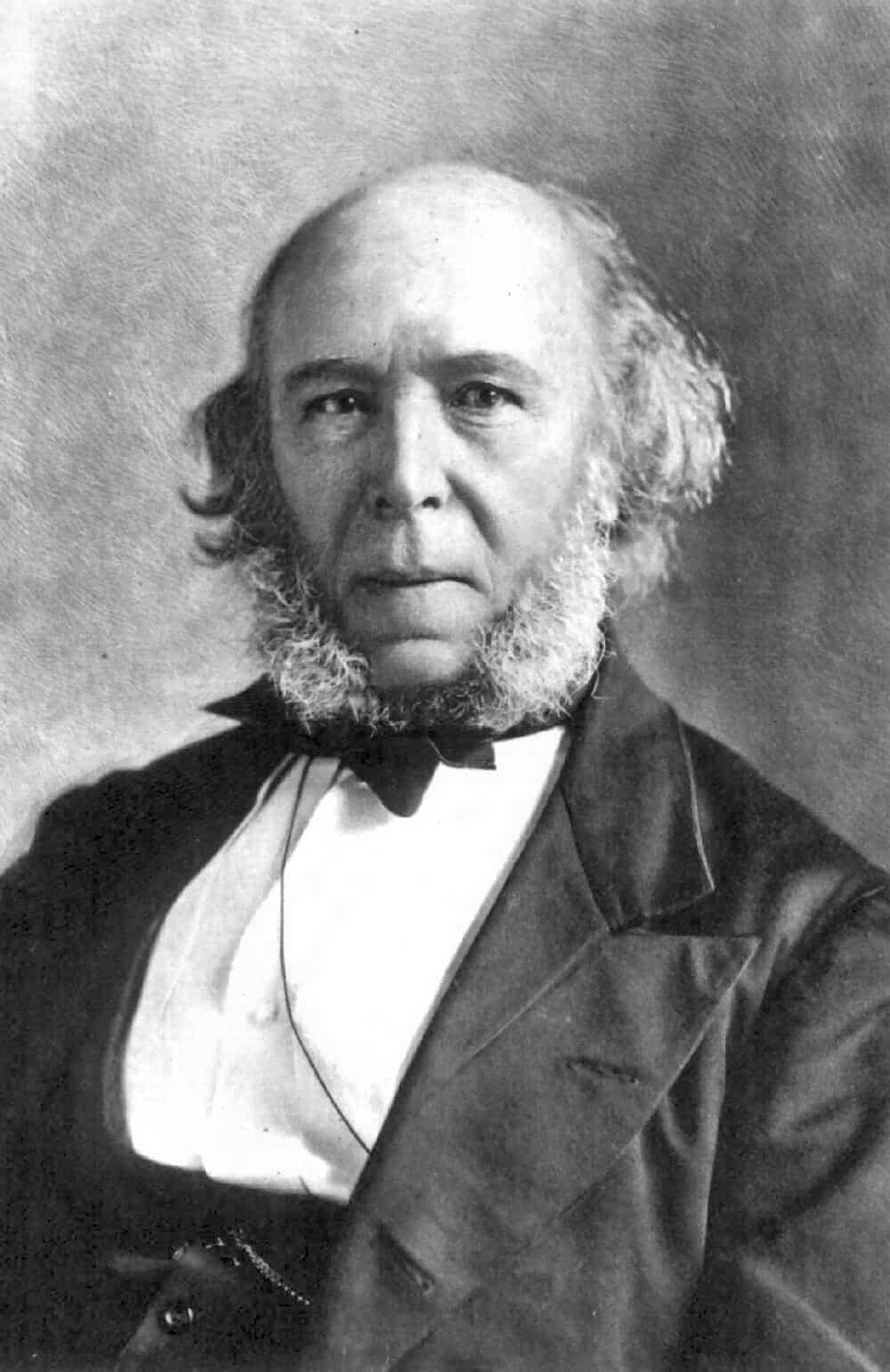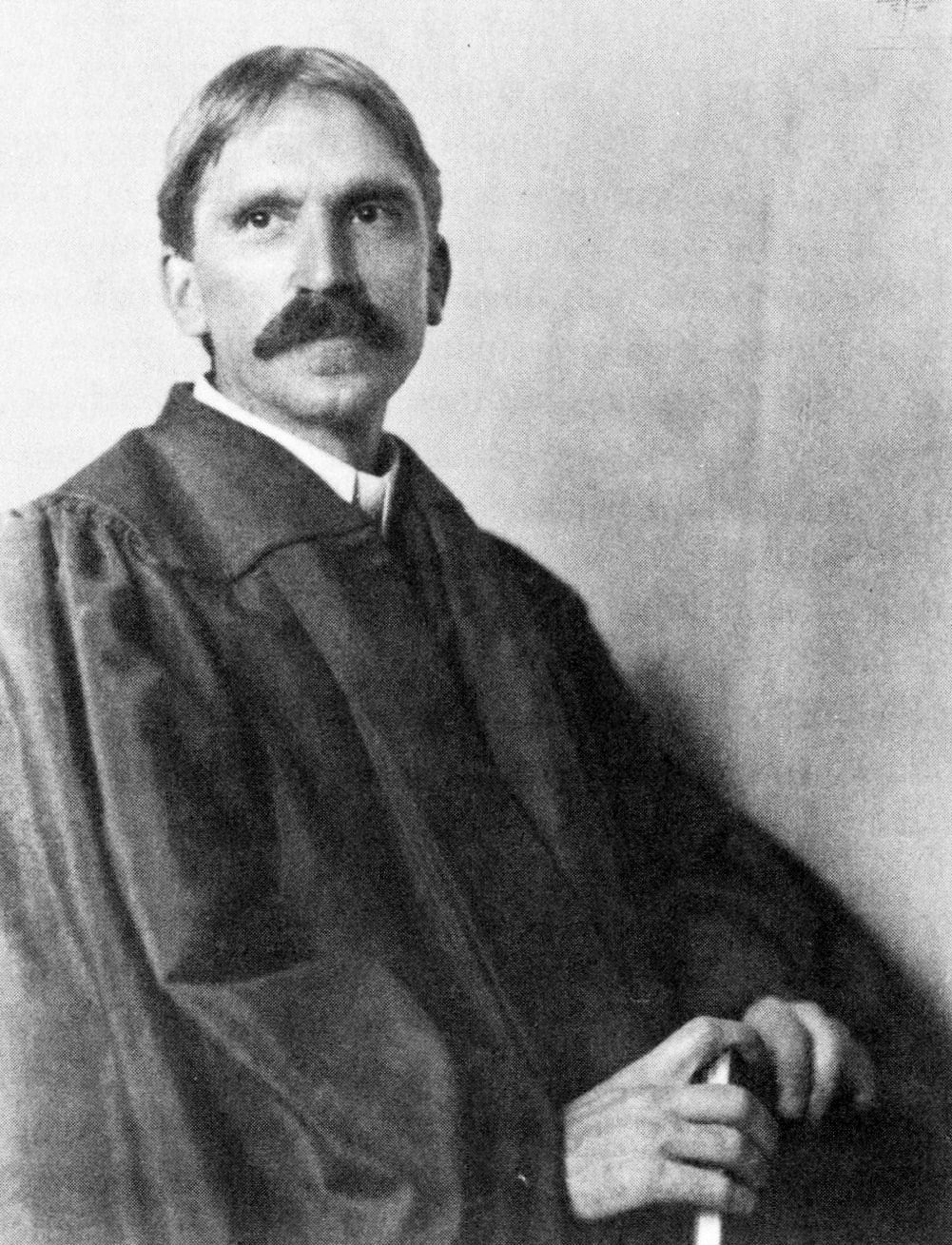Ne doit-on retenir de Darwin que la concurrence entre les espèces ? C’est la grille de lecture qui nous est proposée par le penseur Herbert Spencer, figure clef du « darwinisme social », doctrine justifiant la concurrence comme caractéristique primordiale des rapports sociaux. Spencer a volontairement distordu à son avantage le corpus darwinien pour le faire correspondre à son projet politique, celui d’un ordre inégalitaire et libéral. D’où l’importance de l’œuvre de Pierre Kropotkine, L’entraide, un facteur de l’évolution, qui s’appuie sur la théorie de Darwin pour défendre des conclusions politiques inverses. Elle relativise l’importance de la concurrence dans le processus évolutif, privilégiant davantage l’entraide comme rapport fondamental des relations sociales. Tout en donnant une lecture paradoxale de Darwin comme critique de la loi de la survie des plus aptes, Kropotkine le réhabilite comme un théoricien de l’altruisme. Si cette démarche est salutaire à bien des égards, d’autres aspects du socialisme de Kropotkine (son anti-étatisme, sa méconnaissance des rapports de production) sont cependant plus désuets.
L’entraide comme facteur d’évolution : une conception socialisante de la nature
La réception de l’Origine des espèces de Charles Darwin a été l’objet d’un grand intérêt en Russie, notamment pour Pierre Kropotkine. Promis à une grande carrière, il décide de démissionner de son poste d’officier dans l’armée russe. S’ensuivent des expéditions scientifiques en Sibérie Orientale (1862-1866) qui seront l’occasion pour lui d’observer les sociétés humaines, tout comme les espèces animales dans des conditions climatiques rudes. Ce n’est qu’en 1902, que le « prince anarchiste » publie son œuvre majeure l’Entraide, un facteur de l’évolution.
L’occasion pour le penseur russe de développer les thèses exposées par Darwin dans ses deux œuvres majeures [1] mais aussi de s’opposer farouchement aux tenants du « darwinisme social » – lesquels entendent appliquer le principe d’élimination des moins aptes aux sociétés humaines. Si les comportements compétitifs peuvent exister, ils sont restreints à des formes interspécifiques (entre différentes espèces). Selon Kropotkine « nous constations quantité d’adaptations pour la lutte – très souvent la lutte en commun – contre les circonstances adverses du climat, ou contre des ennemis variés [2] ».
Alors que Darwin réduit les « instincts sociaux » à des formes d’amour et de sympathie, Kropotkine les étend à un degré d’intelligence supérieure. C’est ainsi qu’il caractérise l’entraide : « un sentiment infiniment plus large que l’amour ou la sympathie [3] », qui dépasse la sphère de l’instinct. Ainsi, les comportements coopératifs atteindraient un niveau de conscience plus élevé chez les espèces animales que ce que Darwin estimait. Ce dernier affirmait en effet que dans les cas où il y aurait un nombre d’espèces trop important dans un espace donné, une grande concurrence structurerait les rapports entre animaux car chacun aurait le souci de se nourrir.
Lors de ses expéditions en Sibérie Orientale, Kropotkine atteste pourtant que les nombreuses pertes d’animaux ne sont pas la cause d’une compétition généralisée. Elles s’expliquent en fait par des conditions géographiques initiales austères. En effet, les peuplements d’animaux les plus abondants se situent dans des zones où les espèces font preuve de comportements coopératifs les plus évolués. En reprenant la thèse du zoologiste Kessler, Kropotkine affirme que « nous voyons que les mieux adaptés sont incontestablement les animaux qui ont acquis des habitudes d’entraide. Ils ont plus de chances de survivre [3] ». C’est à partir de ces observations que Kropotkine tire cette conclusion subversive : l’entraide serait le principal facteur de l’évolution des espèces.
Ses observations des espèces animales ne sont qu’un point de départ en vue de théoriser une véritable anthropologie anarchiste. L’instinct d’entraide serait inné chez les espèces puis se serait développé au fil de l’évolution pour gagner en complexité. Les animaux, pour garantir leur chance de survie, font d’autrui leur égal. À l’inverse des caricatures qui lui sont souvent attribuées, la lutte n’est pas à comprendre comme une guerre de tous contre tous mais comme « une association de lutte » [4] contre des conditions climatiques hostiles. Il en résulte une « conception socialiste de la nature [5] ».
Spencer, l’anti-Kropotkine : aux sources du néo-libéralisme ?
Si Kropotkine a le souci de prolonger et de discuter les thèses de Darwin, la publication de son œuvre L’entraide, un facteur de l’évolution, est également le moyen de s’attaquer au « darwinisme social » théorisé par le penseur libéral Herbert Spencer. Alors que Kropotkine, dans une perspective socialiste, affirme que l’entraide est le facteur principal de l’évolution, Spencer théorise la prédominance de la lutte entre les espèces.
L’évolution, dans sa version spencérienne est un processus qui se complexifie progressivement, et n’admet pas de saut qualitatif entre nature et culture. Ce raisonnement ouvre la voie à une forme de sociobiologisme [grille de lecture selon laquelle les caractéristiques sociales sont déterminées par des facteurs biologiques NDLR] : les comportements observés chez les espèces animales peuvent s’appliquer aux sociétés humaines. C’est sur cette base argumentative que Spencer parvient à naturaliser le capitalisme : selon lui, les dynamiques concurrentielles observées chez les espèces animales doivent s’appliquer aux hommes.
Les sociétés humaines, dans la pensée de Spencer, sont réduites à des organismes géants, soumis aux lois de l’évolution. Ce réductionnisme biologique fait de la concurrence interindividuelle généralisée le ciment des rapports sociaux. Ainsi, la survie des plus aptes règne en maître dans l’ordre social, de la même manière que dans le règne biologique : les individus les moins adaptés à la société contemporaine sont éliminés, de la même manière que les individus les plus faibles d’une espèce animale. Ainsi, Spencer a poussé à son paroxysme les tentatives visant à naturaliser l’ordre capitaliste grâce à la sélection naturelle ; raison pour laquelle Patrick Tort, spécialiste de Darwin, voit en Spencer le porte-parole idéologique le plus pur de la bourgeoisie britannique du XIXème siècle.
Central dans le libéralisme classique du XIXème siècle, le « darwinisme social » de Herbert Spencer serait-il également l’une des matrices intellectuelles du néolibéralisme du XXème siècle ? C’est la thèse que défend Barbara Stiegler dans « Il faut s’adapter ». Elle retrace les tentatives de Walter Lippmann – l’un des penseurs canoniques de l’école néolibérale – visant à réinventer le libéralisme en acceptant une certaine dose d’interventionnisme étatique et juridique. Walter Lippmann, qui s’appuie sur une théorie évolutionniste pour justifier ses thèses, reconduit de nombreux aspects de celle de Herbert Spencer. En réduisant l’organisme social à un corps amorphe, soumis aux lois de l’évolution, il affirme que l’espèce humaine doit « s’adapter passivement aux conditions de son environnement ». Ce réductionnisme s’accompagne d’une justification du capitalisme fondée sur l’inégalité naturelle et la loi de la survie des plus aptes observées dans la nature. Autant de points communs avec la démarche de Spencer…
« L’effet réversif de l’évolution » contre le « darwinisme social »
On doit à Patrick Tort une réhabilitation de Darwin comme un penseur de l’altruisme. Selon Tort, Darwin aurait perçu ce qu’il nomme « l’effet réversif de l’évolution » : « la transition progressive entre ce que l’on nommera par commodité la sphère de la nature, régie par une loi stricte de la sélection, et l’état d’une société civilisée, à l’intérieur de laquelle s’institutionnalisent des conduites qui s’opposent au libre jeu de cette loi » [7]. Comment s’opère cette transition ? Par le développement immanent des « instincts sociaux » comme l’altruisme, mais aussi l’émergence progressive de l’intelligence – qui permet à l’humanité de transformer la biosphère plutôt que d’être passivement déterminé par celle-ci. Ainsi, la sélection naturelle fait émerger une espèce dominante (l’homme) qui fait triompher les valeurs d’altruisme et abolit progressivement les effets de la sélection naturelle.
Cet « effet réversif » a tout d’un paradoxe : issu du processus de survie des plus aptes, l’humanité finit par le remettre en question. Ce dépassement dialectique de la nature par la culture s’inscrit en faux avec le « darwinisme social » de Herbert Spencer, qui affirme que les sociétés humaines sont, au même titre que les espèces animales, soumises au principe d’élimination des plus faibles.
Ainsi, pour Patrick Tort, le processus évolutif de Darwin induit une « marche vers la civilisation » qui n’est pas celle d’un concurrentialisme croissant (comme c’est le cas chez Spencer) mais d’une amplification des comportements coopératifs.
Si « l’effet réversif » de l’évolution invalide le « darwinisme social » de Spencer, ne permet-il pas également de jeter un regard critique sur la théorie de Kropotkine ? Celle-ci, en effet, porte encore le sceau de la sociobiologie. Selon Patrick Tort, « Darwin rend possible l’idée d’un continuisme matérialiste imposant la représentation d’un renversement progressif » [8]. Alors que Spencer et Kropotkine réduisent les faits sociaux aux phénomènes naturels, Tort affirme la singularité de la culture en l’opposant à la nature sans tomber dans le piège d’une rupture entre celles-ci. La transition entre nature et culture est progressive car induite par le développement progressif des instincts sociaux. Cet « effet de rupture » permet d’éviter les écueils du réductionnisme biologique selon lequel le social ne serait que la traduction de faits naturels. Tort permet de pointer les limites du projet kropotkinien, en cela que le penseur russe entend dans une perspective sociobiologique expliquer les faits sociaux par le moyen de considérations morales.
L’humanisme naturaliste de Kropotkine, un rejet de la lutte des classes comme moteur de l’histoire ?
Kropotkine transpose dans l’ordre social des considérations morales dont il croit voir la manifestation dans la nature. Comme il croit l’avoir observé lors de ses expéditions, la lutte au sein d’une même espèce est une exception. En minimisant les violences intraspécifiques – entre êtres du même espèce -, n’en vient-il pas à nier celles des rapports sociaux ?
Ce que le penseur anarchiste perçoit comme des comportements de domination seraient le fruit d’une exception de l’évolution, qui sont réduites chez lui à des « tendances individuelles ». Kropotkine explique l’assujettissement politique des hommes par un antagonisme historique entre une minorité assoiffée de pouvoir et une majorité d’individus, inclinés vers un mode de société plus coopératif. Ainsi, Kropotkine rejette une analyse de la société fondée sur un rapport de force entre classes sociales – en la réduisant à des faits moraux.
On ne peut s’empêcher de trouver son rejet de l’étatisme d’une simplicité désarmante. « Pour conquérir la liberté, passez par-dessus l’État, démolissez-le[9] » : ainsi, il suffirait à la majorité opprimée de soulever la chape de plomb qui l’écrase pour consacrer l’émancipation. La dimension coercitive des rapports de production, les mécanismes par lesquels la domination économique pourrait être renversée de manière durable, constituent des impensés chez Kropotkine.
Ainsi, si la démarche de Kropotkine est salutaire, permettant le rejet de celle de Spencer, elle semble impuissante à analyser les causes de la domination politique contemporaine – et les moyens de la dépasser. Sa focalisation sur les qualités morales des êtres vivants ne le conduit-il pas à ignorer le caractère systémique des rapports de domination à l’œuvre ? S’il est nécessaire de rétablir l’entraide comme un rapport social fondamental, oublier le caractère structurel des rapports de concurrence, qui découlent de l’ordre économique dominant, a pour implications d’oblitérer les causes de la violence sociale.
Spencer et Kropotkine posent une controverse sur la nature humaine, l’un théorisant la compétition comme mode fondamental de l’être, l’autre l’entraide. L’un et l’autre tendent cependant à essentialiser des caractéristiques présentées comme naturelles, et à réduire les phénomènes sociaux à des déterminants biologiques, niant l’autonomie du social (en cela, ils peuvent tous deux être qualifiés de sociobiologistes). Faire de l’entraide une qualité humaine fondamentale ouvre bel et bien des perspectives de critique de l’ordre dominant. Mais à trop insister sur celle-ci, on finit par n’être plus capable d’en comprendre la pérennité. En d’autres termes, on gagnerait certainement à compléter la lecture de Kropotkine par celle de Karl Marx.
Notes :
[1] Il s’agit de L’origine des espèces publié en 1859 et de La filiation de l’homme en 1871.
[2] L’entraide comme facteur d’évolution, Pierre Kropotkine, éditions Écosociété, 2001, p. 31
[3] Ibid, p. 44
[4] R. Garcia, La nature de l’entraide…, op. cit., p. 27 et s.
[5] I. Pereira, Pierre Kropotkine et Élisée Reclus. Aux sources des théories anarcho-communiste de la nature », La nature du socialisme…, op. cit., p. 402.
[7] Ibid
[7] Tort, Patrick. « Le darwinisme dénaturé : darwinisme social, sociobiologie, eugénisme », Patrick Tort éd., Darwin et le darwinisme. Presses Universitaires de France, 2009, pp. 67-86.
[8] Ibid
[9] Kropotkine, Pierre, L’État, son rôle historique, Éditions de Londres, 2011, p. 52.