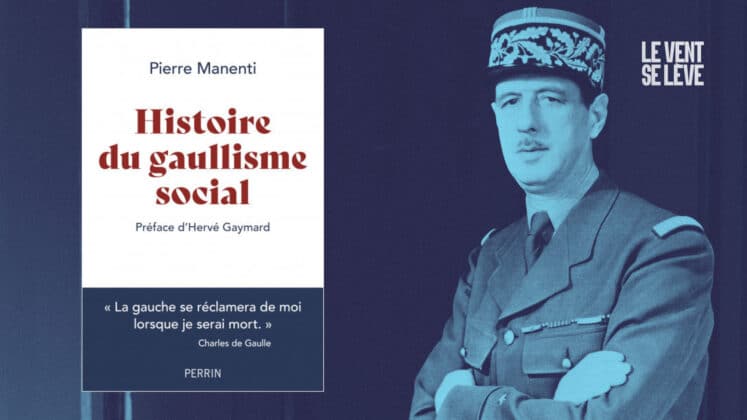À l’heure du bilan du quinquennat, il est difficile de ne pas évoquer la question de la santé publique. Tandis que les hôpitaux français déclenchaient leurs plans blancs pour faire face aux vagues de contaminations et que les déprogrammations de soins se multipliaient, le gouvernement n’avait qu’une obsession : soigner sa communication « de guerre » et mandater des cabinets de conseils privés – au lieu de donner à l’expertise médicale, aux spécialistes et aux citoyens leur juste place dans la prise de décision. Niant toute forme de responsabilité dans le manque de moyens, dans la mise en difficulté des soignants et dans les nombreux dysfonctionnements du système de santé, le président s’est appliqué à entretenir un climat de tension sociale par un discours de culpabilisation et par des mesures arbitraires, au détriment des plus précaires. Ainsi, ces deux dernières années ont rendu d’autant plus tragiques le mépris du chef de l’État pour les principes fondamentaux de la santé publique et son projet de démanteler coûte que coûte ce qu’il restait encore de l’hôpital public.
La santé sous Macron : un bilan catastrophique, qui ne se résume pas à la période de la crise sanitaire
Force est de constater que les deux premières années du dernier quinquennat ont contribué à affaiblir notre système de santé publique. Ce bilan repose sur trois principales défaillances : la poursuite du démantèlement de l’hôpital public, la détérioration des conditions de travail des soignants, ainsi que les difficultés accrues d’accès aux soins pour les citoyens.
Devenue obsessionnelle depuis le tournant de la rigueur en 1983, l’austérité budgétaire soumet chaque année un peu plus l’hôpital public à la concurrence féroce des établissements privés de santé. Les hôpitaux ont ainsi subi 11,7 milliards d’euros de coupes budgétaires dans la dernière décennie. Dans ce sens, les trois projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) précédant la pandémie prévoyaient des économies sur les dépenses d’assurance-maladie dans les hôpitaux de 1,67, 1,61 et 1 milliards d’euros entre 2017 et 2019. Des moyens qui ont, par la suite, cruellement manqué.
Fin 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, lançait le plan « Ma santé 2022 ». Une réforme « qui fai[sai]t la part belle au privé » comme le titrait l’Humanité, et qui prévoyait notamment de transformer les petits établissements hospitaliers en « hôpitaux de proximité », sans maternité, ni chirurgie, ni urgence. Dans le même temps, les déserts médicaux n’ont cessé de progresser sur notre territoire. Selon le géographe de la santé Emmanuel Vigneron, la diminution du nombre de médecins généralistes s’est accélérée entre 2017 et 2021. La densité médicale par département, c’est-à-dire le nombre de médecins généralistes rapporté à la population, a diminué de 1 % par an en France sur cette période, contre 0,77 % en moyenne sous le quinquennat de François Hollande. Comme le relevait alors un article du Monde, « les trois quarts des 100 départements français voient leur situation se dégrader, seuls dix-sept se trouvent en stagnation, huit en amélioration ». Or, la densité médicale est selon la Drees un « facteur aggravant » du non-recours aux soins, dans la mesure où les personnes pauvres ont huit fois plus de risques de renoncer à des soins dans les déserts médicaux. Une enquête de novembre 2019 révélait déjà que 59 % des Français ont dû renoncer à des soins, la majorité pour des raisons financières.
Face à cette situation dégradée, les dirigeants politiques se sont rendus coupables de négligence et d’irresponsabilité, en faisant la sourde oreille aux revendications des soignants qui rappelaient une évidence : l’hôpital public ne remplit plus sa mission d’accueil inconditionnel depuis des années. En janvier 2018, une grande grève dans les Ehpad de toute la France réclamait déjà « davantage de moyens humains pour plus de dignité ». En avril 2018, des personnels d’hôpitaux psychiatriques, au Rouvray, menaient une grève de la faim pendant trois semaines. Leurs collègues de l’hôpital psychiatrique du Havre ont dans la foulée occupé le toit d’un bâtiment pendant trois semaines. À l’hôpital psychiatrique d’Amiens, un campement de protestation a duré pendant près de cinq mois. En avril 2019, des services d’urgences des hôpitaux parisiens se sont mis à leur tour en grève. Un mouvement s’est structuré à travers le Collectif inter-urgences (CIU) qui a rapidement essaimé à travers le pays de telle sorte qu’en juin, 120 services étaient en grève. En août, ils étaient 200. Toujours sans que l’exécutif ne prenne au sérieux les revendications de ces soignants qui ont pourtant tiré, à de maintes reprises, le signal d’alarme.
En janvier 2020, à l’aube de la crise du Covid-19, Agnès Hartemann, chef du service de diabétologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait ému les Français en déclarant que, faute de moyens, elle était obligée de jouer le jeu de l’économie de moyens et du rationnement des soins. Avec des centaines d’autres médecins du Collectif inter-hôpitaux (CIH), elle démissionnait de ses fonctions administratives. Cette décision était symbolique du malaise de certains soignants forcés de rompre avec leur éthique médicale pour des raisons de rentabilité et de perte d’humanité au sein de leur profession. Des enjeux qui s’annonçaient d’autant plus problématiques à mesure que la pandémie devenait une réalité concrète dans les services hospitaliers.
Face à la crise, un « chef de guerre » qui continue de désarmer ses soldats
Emmanuel Macron nous l’a répété ad nauseam : face au virus, nous étions « en guerre ». Et pour mener cette guerre à ses côtés, en pleine crise hospitalière, il a fait le choix de nommer Jean Castex comme Premier ministre, à la suite de la démission d’Édouard Philippe. Si les médias se sont empressés – sans doute à raison – d’y voir l’influence de Nicolas Sarkozy sur l’actuel locataire de l’Élysée, ce choix était également révélateur du programme macronien en matière d’hôpital public. Ancien directeur de l’hospitalisation et de l’offre de soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, de 2005 à 2006, Jean Castex a été le maître-d’œuvre de la réforme de la tarification à l’activité – la funeste T2A –, pilier de la transformation de l’hôpital en entreprise et des soignants en experts-comptables.
La suppression de 5 700 lits d’hospitalisation en pleine épidémie […] invite à relativiser « l’effort de guerre » et le « quoiqu’il en coûte ».
L’indicateur le plus frappant de cette fuite en avant du gouvernement reste le scandale provoqué par la suppression de lits d’hospitalisation au plus fort de la crise. Fin 2016, la France comptait plus de 404 000 lits d’hospitalisation à temps complet. Fin 2020, le chiffre était tombé à 386 835, soit plus de 17 000 lits supprimés en quatre ans. La suppression de 5 700 lits d’hospitalisation en pleine épidémie, selon la Drees, invite à relativiser « l’effort de guerre » et le « quoiqu’il en coûte » dont se sont gargarisé le chef de l’État et ses équipes gouvernementales.
Pendant que plans blancs et déprogrammations de soins se multipliaient pour faire face à la cinquième vague, une étonnante bataille de chiffres agita les autorités sanitaires en décembre 2021. En effet, alors qu’une étude du Conseil scientifique faisait état de « 20 % de lits publics fermés sur le territoire » depuis 2019, faute de soignants pour s’en occuper, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) publiait quant à elle, le 16 décembre 2021, une enquête sur les ressources humaines commandée par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui avançait le chiffre de 2%.
Au-delà de ces éléments de langage qui visaient à rassurer les Français sur l’état de leur hôpital public, de telles stratégies de communication semblaient bien vaines face aux remontées « du terrain ». Dans un article de Marianne, Arnaud Chiche, médecin anesthésiste-réanimateur dans les Hauts-de-France et président du collectif Santé en danger, alertait sur le fait que « ces déprogrammations sont moins la conséquence d’un afflux massif de patients Covid à l’hôpital, que d’une pénurie de soignants médicaux et paramédicaux ». Contrairement à ce que nous assurait le gouvernement, la cause de l’engorgement des hôpitaux n’était pas conjoncturelle, c’est-à-dire liée à la crise du Covid, mais bien structurelle, en raison d’une aggravation des conditions de travail et d’un épuisement des personnels soignants. « Ces réorganisations incessantes ont en outre accéléré l’effondrement du système sanitaire, en désorganisant le travail du soin et en poussant les soignants, déjà épuisés par des décennies d’austérité, au découragement et à la démission », notent quant à eux Barbara Stiegler et François Alla, auteurs du tract Santé publique année zéro paru chez Gallimard.
Le ministère de la Santé a ainsi déserté la bataille pour l’hôpital public et laissé s’aggraver la santé générale des Français. Avec une baisse de 13% de séjours hospitaliers hors Covid en 2020, de nombreux Français souffrant de maladies chroniques, de cancers, d’AVC ou d’infarctus, n’ont pas pu être pris en charge. Dans une tribune parue dans Le Monde, un collectif de médecins de l’AP-HP déplore la normalisation de ces ruptures de soin et estime qu’« en imposant aux soignants de décider quel patient doit vivre, le gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite ».
Ce hiatus entre le discours et la réalité concrète de l’action du gouvernement fut particulièrement flagrant lorsque Emmanuel Macron décida de placer le 14 juillet 2020 sous le signe de la « reconnaissance » envers les personnels soignants, alors même que ces derniers manifestaient le même jour pour dénoncer un Ségur de la santé qualifié d’« imposture » par les syndicats. Christophe Le Tallec, vice-président du Collectif inter-urgences, dénonçait en ce sens un « hommage bling-bling » et réclamait « un soutien matériel et financier, pas juste un jeu de communication raté ». Dans le même article de Libération, Murielle, cadre en Ehpad, témoigne : « Tant que l’on continuera à faire des Ségur avec des gens qui n’y connaissent rien, sans demander directement aux soignants ce qu’ils en pensent, on ne changera jamais rien ! » Une nouvelle occasion manquée.
Un reniement historique des principes de santé publique, au détriment de celle des Français
Par-delà le démantèlement de l’hôpital, c’est le principe même de santé publique qui a été sérieusement ébranlé par la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. S’il était presque impossible, en mars 2020, de mettre sérieusement en cause les décisions prises par l’Élysée, dans un contexte d’urgence sanitaire inédit, nul ne peut ignorer la dimension idéologique de celles-ci. Des choix politiques ont été faits. L’application uniforme des restrictions sanitaires sur l’ensemble de la population, d’une part, sans prise en compte des inégalités géographiques, économiques et de santé préexistantes. Une enquête publiée par la Drees en juillet 2020 permettait déjà d’identifier les principaux facteurs de vulnérabilité face au virus : présence de comorbidités aggravantes (obésité et diabète entre autres), forte exposition à la contamination (sur le lieu de vie ou de travail), difficultés d’accès aux soins.
À cette vulnérabilité sanitaire se sont ajoutées de nouvelles problématiques, liées au confinement et aux restrictions sanitaires : dégradation de la santé mentale, de la sécurité matérielle et physique, des conditions de logement, difficultés à maintenir une activité scolaire ou professionnelle. Refusant de reconnaître le caractère cumulatif des inégalités sociales et niant toute forme de responsabilité dans la mise en difficulté des populations les plus vulnérables, le gouvernement s’est contenté d’appliquer de façon arbitraire et selon des principes prétendument « universels » une feuille de route dictée par une poignée de proches conseillers. Se rêvant héros de guerre, le chef de l’État a laissé une partie considérable de la population basculer dans la grande précarité. En octobre 2020, un article du Monde comptait ainsi un million de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté, par rapport aux 9,3 millions d’avant crise.
Après avoir savamment dilapidé l’hôpital et poussé une grande partie du pays dans la précarité, Macron faisait, malgré lui, le constat de son impuissance politique.
La mise au ban des réfractaires à la politique sanitaire a, d’autre part, constitué un autre point fort de cette « gestion de crise ». Accusées indistinctement de complotisme, les personnes émettant parfois de simples doutes sur le bien fondé de la stratégie du « tout vaccinal », ou hésitant à se faire vacciner, quelle qu’en soit la raison, ont enfin été qualifiées d’« irresponsables » par le président.
Cette déclaration, volontairement polémique, a permis de révéler un tournant dans la stratégie macronienne. Dépassé par l’augmentation continue des cas graves à l’hôpital et ne parvenant pas à répondre aux appels à l’aide du personnel soignant, le gouvernement a surfé sur le climat de méfiance latent, accusant lui-même les non-vaccinés d’être à l’origine de l’effondrement du système de santé. Un discours d’autant plus contre-productif qu’il a suffi à radicaliser les positionnements de chacun.
Créant ainsi un lien de causalité entre la « seule » attitude civique qui vaille – aller se faire vacciner – et le sauvetage de l’hôpital public – et, par-là, la remise en marche de la société tout entière –, le discours gouvernemental a rigoureusement établi une inversion des responsabilités. Nos responsables politiques n’étaient plus condamnables, puisqu’ils se plaçaient eux-mêmes du côté des victimes. Ils n’étaient plus tributaires de l’engorgement des hôpitaux, de l’épuisement du personnel soignant, ni même du tri des patients en réanimation. Après avoir savamment dilapidé l’hôpital et poussé une grande partie du pays dans la précarité, Emmanuel Macron faisait, malgré lui, le constat de son impuissance politique.
Pour y remédier, et en déclarant vouloir « emmerder » les non-vaccinés, Emmanuel Macron est passé du « paternalisme soft » (d’après la formule d’Henri Bergeron) à la guerre ouverte contre tous les ennemis de l’intérieur. S’il est évident que, derrière la fracturation du pays et la désignation d’un adversaire politique commun, se cachait une stratégie rhétorique rondement menée, on peut également y voir le triomphe du libéralisme autoritaire, version restaurée du libéralisme thatchérien visant à évincer du système collectif les individus inadaptés.
C’est donc une interprétation pervertie des principes républicains qui sert au gouvernement à justifier l’application indifférenciée des politiques sanitaires sur l’ensemble de la population et à imposer un schéma ami/ennemi en éliminant les seconds. À travers cette distinction entre citoyens exemplaires et citoyens de seconde zone, au cœur du dispositif du « passe sanitaire » bien que contraire aux principes les plus élémentaires de notre pacte social, Emmanuel Macron enterre définitivement toute conception d’une santé publique démocratique et inconditionnelle.
Une gestion de crise confiée aux cabinets de conseil privés au détriment de l’expertise médicale
La révélation récente de la place donnée aux cabinets de conseil privés – notamment l’américain McKinsey – dans la gestion de crise, et de l’instrumentalisation de l’expertise médicale à des fins politiques, illustre bien le cynisme du gouvernement, dont la principale bataille a été celle de l’opinion. Ainsi émancipé des avis du Conseil scientifique avec une décomplexion désarmante, Emmanuel Macron pouvait laisser libre cours à sa posture de savant et de politique. Les médias eux-mêmes ne pouvaient que souligner « comment l’entourage d’Emmanuel Macron met[tait] en scène un président qui serait devenu épidémiologiste ».
Le faible crédit accordé à l’expertise médicale témoigne ainsi d’un éloignement des enjeux de santé publique au bénéfice d’un jeu de double légitimation entre le pouvoir politique et les instances sanitaires. Après avoir démontré que dans la stratégie du gouvernement, le calcul coût/bénéfice, censé orienter toute politique de santé publique, ne relevait plus d’un raisonnement médical mais d’un calcul politique, Barbara Stiegler et François Alla expliquent que « les structures d’expertises en étaient dorénavant réduites à assurer le service après-vente d’une série de décisions déjà prises par le président de la République ou par les membres de son gouvernement ». Autrement dit, le rôle des autorités sanitaires était limité à justifier les décisions prises par Macron et une poignée de conseillers en communication, a posteriori, au lieu de les précéder. Les « recommandations » n’étaient plus que des alibis au cœur d’une « légitimation réciproque » : l’exécutif justifiait ses mesures par des avis d’experts qui justifiaient eux-mêmes leur utilité par la prise de décision politique dont ils prenaient acte.
Une telle phrase permet de percer à jour le logiciel de gouvernance d’Emmanuel Macron, pour qui les limites de la démocratie sanitaire commencent là où la prétendue rationalité du chiffre s’impose.
La mise en conflit permanente des disciplines entre elles a également conduit à l’isolement et à l’atomisation des véritables experts médicaux. L’Académie des technologies, dans un rapport intitulé « Covid-19 : modélisations et données pour la gestion des crises sanitaires », rappelait les limites de la modélisation en santé puisque « les humains ne sont ni des plantes, ni des animaux, mais des êtres sociaux ». Une vision purement biomédicale de la crise s’est pourtant imposée, focalisée sur la légitimité du chiffre, sur les courbes d’incidence et sur les taux d’occupation des lits.
Dès lors, on ne peut que s’interroger sur le bien-fondé d’une vision aussi biaisée, d’autant plus lorsqu’elle s’exprime à renfort de slogans simplistes tel celui du ministère de la Santé d’Olivier Véran qui décrétait en août dernier qu’« on peut débattre de tout sauf des chiffres ». Une telle phrase suffit à révéler le logiciel de gouvernance sous Emmanuel Macron, pour qui les limites de la démocratie sanitaire commencent là où la prétendue rationalité du chiffre s’impose.
#Vaccination | Aujourd’hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause de la #COVID19 ne sont pas vaccinées. On peut débattre de tout, sauf des chiffres.
— Gouvernement (@gouvernementFR) August 19, 2021
Tous vaccinés, tous protégés ✅
📲 Prenez rendez-vous sur https://t.co/UDtiaHJSyt@sante_gouv pic.twitter.com/Ii6rS5YmK8
Le recours aux cabinets de conseil a évidemment joué un rôle clé dans cette religion du chiffre qui a dicté la gestion comptable de la pandémie. La place qu’ils ont prise dans la gestion de crise, de même que leur rémunération exorbitante avec de l’argent public, quand les soignants se voyaient toujours refuser des moyens nécessaires, constituent à ce titre un grave scandale d’État. Une plainte contre les cabinets McKinsey, JLL France et Citwell pour « détournement de fonds publics, favoritisme, corruption et prise illégale d’intérêts » a d’ailleurs été déposée début avril 2022 par l’association Coeur vide 19. Par exemple, ne serait-ce qu’entre décembre 2020 et mai 2021, le ministère de la Santé a rémunéré le cabinet américain McKinsey pour près de 10 millions d’euros, pour avoir participé à l’élaboration de la stratégie vaccinale du gouvernement.
Il est dès lors compliqué de déterminer la frontière entre les fondements idéologiques et purement médicaux dans le discours gouvernemental en matière de vaccination, comme le montrent Barbara Stiegler et François Alla qui dénoncent à ce titre la « rhétorique de la promesse largement entretenue par les services de marketing des laboratoires ».
Une telle stratégie conduit in fine à un appauvrissement regrettable du débat public, qui contraint les citoyens, spectateurs de querelles entre experts et non-experts, à se positionner au sein d’un clivage artificiel : « pour » – le masque, le confinement, et finalement le vaccin, de façon indifférenciée – ou « contre », sur des enjeux politiques et non sanitaires. À l’occasion d’une campagne de communication en partenariat avec la ministère de la Santé, la radio Skyrock allait jusqu’à inciter ses jeunes auditeurs à dénoncer leurs amis « pro-virus ».
Mentionne un ami à toi provirus 👀 #çavaçavax pic.twitter.com/1mF6lxP7bw
— Skyrock FM (@SkyrockFM) August 24, 2021
Alors qu’une lutte contre toute pandémie nécessite d’avoir recours à l’intelligence collective pour être efficace, le gouvernement condamnait délibérément le débat public à une opposition manichéenne, qui n’a fait que renforcer la défiance d’une partie croissante de la population envers les autorités politiques, médicales et scientifiques. Ainsi, il abimait définitivement la possibilité d’un consentement éclairé des citoyens et, par là même, le fonctionnement démocratique de notre société, à la veille d’une échéance électorale primordiale.
Tirer les conséquences du mandat passé, pour éviter le pire
Faire le bilan de ces cinq années de mandat, et s’efforcer de voir une cohérence politique entre toutes les décisions prises avant et pendant la crise sanitaire, permet d’esquisser quelques hypothèses sur l’évolution de notre système de santé, en cas de réélection du président Macron. À ce titre, la question de la prise en charge de nos aînés est particulièrement éloquente. Celui qui promettait, en 2017, une loi Grand âge destinée à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie, l’a finalement abandonnée, au plus fort de la crise sanitaire. À la place, il a condamné les personnes âgées à l’isolement social pendant plusieurs mois, entraînant, pour beaucoup, une perte définitive de leurs capacités physiques et cognitives. Comme si les nombreux témoignages en ce sens ne suffisaient pas, la série de scandales sur les conditions de vie et de travail dans les Ehpad, montre avec violence les conséquences de la négligence du gouvernement en matière de réglementation et de contrôle des établissements de soin privés.
Comment est-il possible, alors que deux ans de crise sanitaire avaient enfin mis en lumière l’urgence de repenser la prise en charge de nos aînés, qu’il ait fallu attendre la parution d’un livre – Les Fossoyeurs, en janvier 2022 – pour « découvrir » la maltraitance des résidents, les dérives bureaucratiques et les pratiques frauduleuses normalisées dans l’un des plus gros groupes d’Ehpad français ? Comment peut-on expliquer que Brigitte Bourguignon, nommée par Emmanuel Macron en juillet 2020 pour travailler sur les questions d’autonomie en fin de vie, n’ait pas jugé utile de s’assurer elle-même du bon fonctionnement de ces établissements ? Comment ne pas s’interroger, enfin, sur les réticences de cette dernière à rendre public le rapport du gouvernement sur Orpea ; une décision qualifiée de « choquante » par le sénateur LR Bernard Bonne, co-rapporteur de la commission d’enquête du Sénat, qui a dû faire preuve d’« obstination » pour se le procurer ?
Ainsi la santé n’aura plus rien de « public », puisque seules les personnes suffisamment aisées, ou ne souffrant pas de pathologies impliquant une prise en charge trop onéreuse, pourront y avoir accès.
Une chose est sûre, la réélection d’Emmanuel Macron à l’Élysée sera, pour ce dernier, la garantie de ne pas être inquiété pour la gestion douteuse de ces affaires. Il pourra donc poursuivre en toute liberté son entreprise de privatisation du service public, renforçant la mainmise des grands groupes hospitaliers sur le système de santé et faisant fi des scandales politiques et sanitaires encore brûlants. À titre d’exemple, la signature en avril 2021 d’un « protocole de coopération » entre l’hôpital public et Clinéa, une filiale d’Orpea, permettra au groupe de s’étendre encore davantage, voire de se rendre indispensable en répondant à la problématique des déserts médicaux français.
Cette extension du privé dans de nombreux territoires rendra le transfert des patients inévitable, malgré l’augmentation des frais de prise en charge. Ainsi la santé n’aura plus rien de « public », puisque seules les personnes suffisamment aisées, ou ne souffrant pas de pathologies impliquant une prise en charge trop onéreuse, pourront y avoir accès. Les soignants aussi devront s’adapter, car comme l’indiquait Philippe Gallais, ancien salarié de Clinéa et délégué à la CGT Santé privée, « là où le privé se fait le plus de marge, c’est sur la masse salariale ». Cela implique, entre autres, des évolutions de salaire et de carrière négociées au cas par cas (comme c’est déjà le cas dans la plupart des établissements privés), l’obligation de se plier aux injonctions budgétaires et de combler, continuellement, le manque d’effectifs.
Certes, l’épidémie de Covid-19, comme toutes les autres avant elle, a mis nos sociétés, partout dans le monde, en grande difficulté. Nul ne peut nier les conséquences dévastatrices engendrées par un simple virus, et probablement que nul n’aurait su apporter une réponse idéale à l’urgence sanitaire. Néanmoins, il s’agit maintenant de tirer les leçons de cet épisode, qui a eu pour – seul – mérite de mettre en lumière la fragilité de notre système de santé. Désormais, il est non seulement urgent de remettre nos dirigeants face à leurs responsabilités, mais également de retrouver nos droits et d’exercer notre devoir de citoyens en conséquence.