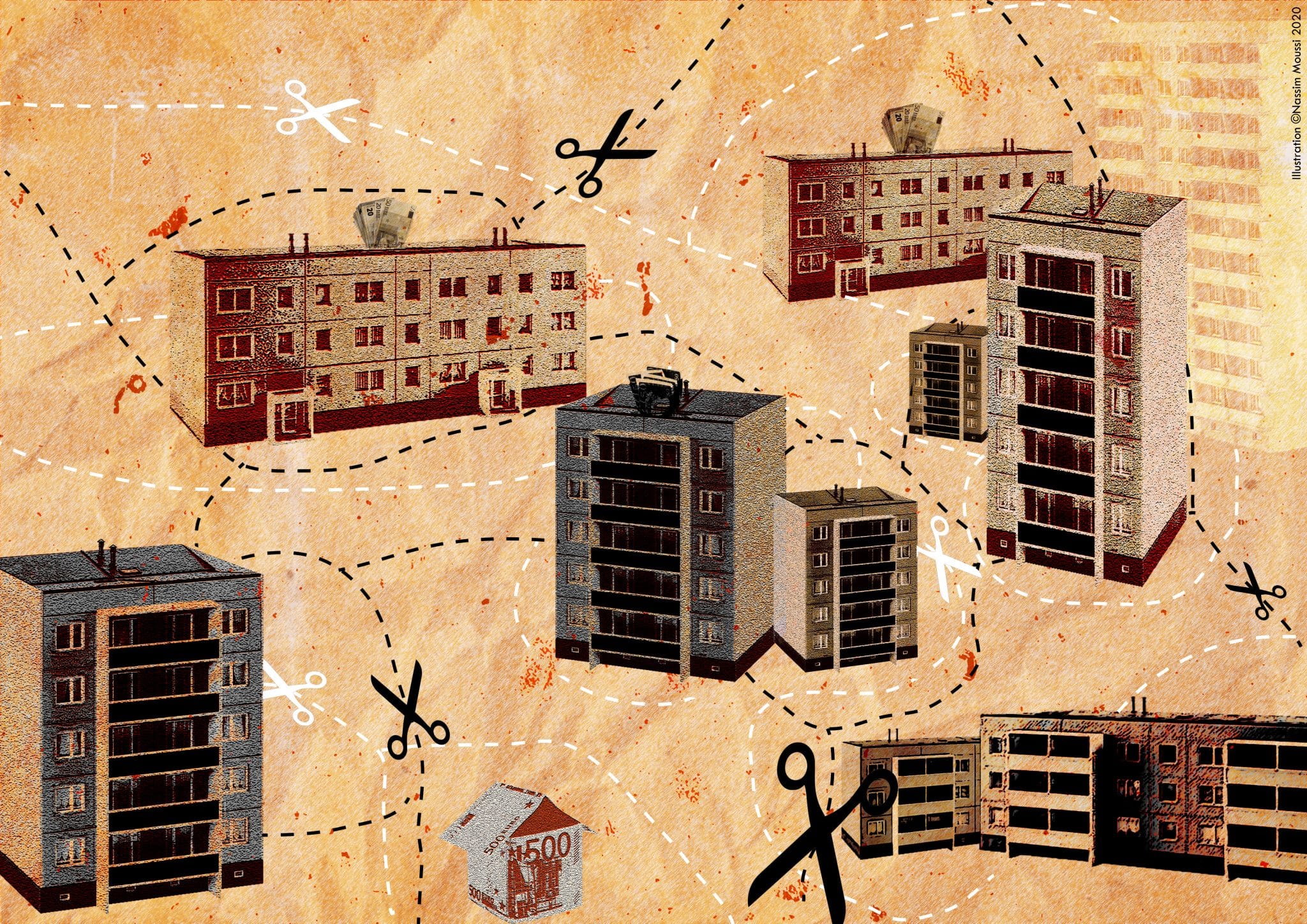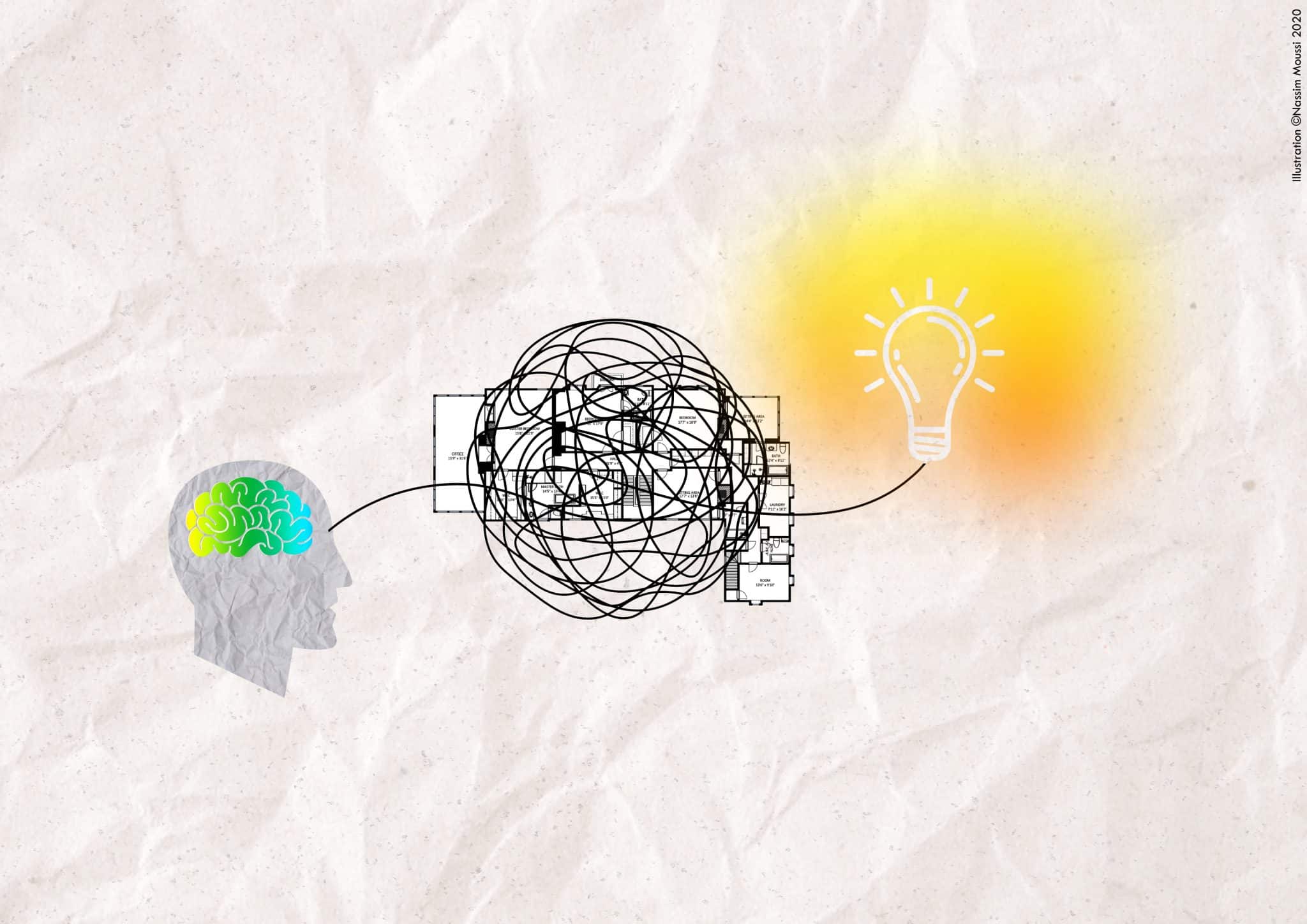Le 26 septembre 2016, il y a cinq ans jour pour jour, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC signaient un accord de paix historique. Premier point de cet accord : la réforme agraire. Celle-ci était censée entamer un cycle de réformes visant à une répartition plus juste et équitable de la terre. Aujourd’hui, force est de constater que ces ambitions sont restées lettre morte. À l’occasion de cet anniversaire, nous publions une réflexion élargie sur l’incapacité, dans l’horizon capitaliste, des politiques post-conflit à remettre en question les inégalités héritées de la violence. Un article autour de l’ouvrage de Jacobo Grajales, Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia. Beyond Dispossession (Routledge, 2021).
Les liens entre conflits fonciers et violence armée font l’objet d’une abondante littérature, qu’elle étudie les inégalités foncières aux racines de la guerre ou qu’il s’agisse d’exposer les formes d’accumulation engendrées par la violence.
NDLR : pour une analyse des tensions sociales autour de la terre en Amérique centrale, lire sur LVSL l’article de Keïsha Corantin : « Généalogie de la violence en Amérique centrale : les conflits fonciers comme cause d’instabilité politique »
Contre une division binaire entre temps de guerre et temps de paix, qui circonscrit les manifestations de la violence au premier, Jacobo Grajales veut dresser des continuités. Au-delà d’un retour sur le rôle de la violence dans la concentration foncière, son ouvrage insiste sur la capacité du modèle capitaliste, prôné en temps de paix, à légitimer des accumulations violentes, mais aussi, plus généralement, à justifier les inégalités post-conflit par les impératifs du développement économique et du marché libre.
LE LIEN ORGANIQUE ENTRE PARAMILITARISME ET CAPITALISME AGRAIRE
L’auteur guide sa réflexion autour d’un acteur clé du processus d’accumulation des terres en Colombie : les paramilitaires. Naissant des milices de sécurité des grands propriétaires fonciers, les paramilitaires sont, dès leur origine, des forces conservatrices de l’ordre social. Dans les années 1980, l’expansion du trafic de drogue et les disputes territoriales pour le contrôle des routes clandestines favorisent l’émergence « d’entrepreneurs de la violence ». Ces derniers ont vocation à sécuriser les intérêts économiques et territoriaux des réseaux de narcotrafic.
Sous couvert d’une loi de 1968 qui légalise la constitution de groupe armés d’autodéfense pour contrer l’insurrection marxiste, les paramilitaires s’imposent comme un partenaire incontournable de l’État dans la guerre contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Intrinsèquement liées aux élites locales, à l’armée et aux narcotrafiquants, les milices paramilitaires deviennent une force politique à part entière au tournant des années 2000. Bien qu’animées d’intérêts parfois concurrents avec la bourgeoisie locale, les dissensions au sein de celle-ci et leur supériorité militaire et économique placent les groupes paramilitaires en arbitre, et leur permettent de s’affirmer comme les régulateurs du pouvoir local.
Le propos essentiel de l’auteur est d’aller au-delà des cas les plus violents de dépossession des terres pour interroger la séparation entre l’inégalité illicite – parce qu’obtenue par la violence armée – et l’inégalité légitime produite par la libre concurrence.
S’appuyant sur leurs liens étroits avec les élites politiques locales, les cercles d’affaires et la corruption d’officiers publics à des postes clés, le réseau des paramilitaires joue un rôle pivot dans le blanchiment des terres acquises par la violence.
Jusqu’à une récente réforme, la plupart des notaires étaient nommés par décrets grâce au soutien de relais politiques, notamment des députés. Chargés de certifier au nom de l’État la légalité d’une transaction, les notaires sont un maillon essentiel à la sécurisation des droits de propriétés. En contrôlant les élus – à travers pots-de-vin et financements de campagne – les paramilitaires s’assuraient la nomination de fantoches acquis à leur ordre.
Un autre exemple, qui ne fait pas figure d’exception, est fourni par les faux enregistrements d’abandon de terre. Si les guérillas y ont aussi recours, les paramilitaires systématisent le massacre comme mode d’opération. Il s’agit d’une stratégie de terreur redoutablement efficace pour s’étendre territorialement. En effet, les massacres entraînent la fuite des populations avoisinantes. Ainsi, des milliers d’hectares de terres désertés tombent entre les mains des groupes armés. C’est là qu’intervient INCORA, institut créé par la réforme agraire de 1961. Cet institut est chargé de distribuer des terres aux petits paysans. Maquillé sous la plume corrompue des institutions publiques, l’exil forcé des paysans est enregistré par INCORA en abandon de terre, autorisant ainsi légalement la cession des exploitations à un nouveau propriétaire. En 2011, cinq fonctionnaires d’INCORA ont reconnu leur complicité dans cette manœuvre.
Comme l’indique le titre de l’ouvrage, le propos essentiel de l’auteur est d’aller au-delà des cas les plus violents de dépossession des terres pour interroger la séparation entre l’inégalité illicite – parce qu’obtenue par la violence armée – et l’inégalité légitime produite par la libre concurrence.
Aujourd’hui comme hier, l’obstacle à une refondation des discours et des programmes politiques demeure inchangé : l’ordre social propriétariste, défini par Thomas Piketty comme « un ordre social fondé sur la défense quasi religieuse des droits de propriété comme condition sine qua non de la stabilité sociale et politique. » (Piketty, 2020).
L’ILLUSION DES POLITIQUES REDISTRIBUTIVES
Jacobo Grajales remonte ainsi aux années 1960, qui ont vu naître l’espoir de changements à partir notamment de la réforme agraire de 1961. Si elle prévoyait des mécanismes d’expropriation des grands propriétaires, ces dispositions furent très rarement appliquées. Les réformes se sont surtout traduites par la privatisation de terres publiques, à travers la reconnaissance de situations d’occupation des propriétés de l’État ou à travers l’extension de fronts pionniers. Ces mesures profitèrent autant à la petite paysannerie qu’à l’accumulation des grands propriétaires. Puiser dans les réserves publiques plutôt qu’exproprier, distribution donc, mais pas redistribution. En privatisant les réserves foncières qui lui appartiennent, l’État se dispense de toucher aux grandes propriétés privées et achète la paix sociale.
Autre illusion dénoncée par l’auteur, les politiques communautaires des années 1990. Celles-ci accordent des droits territoriaux aux communautés ethniques minoritaires, indigènes et afro-descendantes. On observe ce tournant dans différents pays du continent : Colombie, Pérou, Bolivie, Equateur. Le fondement de ce régime particulier ? Le lien culturel qui unit la terre aux communautés ethniques. Alors que ces dernières – dans un discours teinté d’exotisme et d’essentialisation – sont présentées comme « gardienne » de la nature, les paysans et leur vision utilitariste du sol seraient une menace pour l’environnement.
D’apparence progressiste, l’ethnicisation des droits territoriaux se révèle un levier de choix pour balayer les revendications de la majorité paysanne. Légitimant les droits de quelques-uns pour mieux écarter ceux des autres, l’agenda néolibéral est consacré comme la règle, les minorités ethniques relevant alors de l’exception. Rappelons que la Banque mondiale et le Fond monétaire international comptent parmi les principaux soutiens de ces politiques ; des appuis qui forcent au regard critique vis-à-vis de réformes pourtant portées par des gouvernements de gauche.
DES RAPPORTS DE POUVOIRS ACCENTUÉS PAR LA VIOLENCE ET CONSOLIDÉS PAR LA PAIX, L’HÉGÉMONIE DE L’AGRO-INDUSTRIE
Les récits qui animent les périodes de sortie de guerre s’articulent sur une base fondamentale : celle de la délimitation entre un avant et un après. Le discours des institutions impliquées dans la gestion post-conflit (gouvernement et agences publiques, ONG, instances internationales…) diffusent cette idée de rupture, un cadre conceptuel qui, de fait, guident leurs actions concrètes.
De fait, les procédures de justice pour la récupération des terres furent centrées sur les acteurs armés paramilitaires, faisant fi de leurs liens étroits avec les milieux d’affaires.
D’une part, cela contribue à masquer la permanence de la violence armée, qui n’a pas disparu mais s’est transformée. Si la démobilisation des paramilitaires entre 2003 et 2006 marque une réduction drastique du nombre d’homicides, la violence est aujourd’hui plus dirigée. La stratégie a évolué vers l’assassinat ciblé et systématique de leaders sociaux, muselant ainsi toute contestation. En dépit des récents accords de 2016, la Colombie se hisse aujourd’hui au sommet d’un podium mortifère, avec 255 victimes de massacres et l’assassinat de 120 leaders sociaux en 2020 [1].

Mais plus encore, le mur temporel dressé entre guerre et post-conflit se concentre sur la réparation des cas de spoliation violente sans s’intéresser aux structures qu’elle a bâties et qui persistent aujourd’hui. De quelles structures parle-t-on ? Le conflit armé en Colombie a façonné la conjoncture contemporaine des campagnes : la destruction du tissu communautaire et l’accaparement des terres ont creusé encore davantage les inégalités et consacré l’hégémonie de l’agro-business. Dans un tel contexte, les règles du marché suffisent désormais à évincer les petits paysans, renforçant toujours plus la domination des géants agricoles.
Dans les cas peu nombreux où les paysans retrouvent leur terre, il ne faut que peu de temps pour que le manque de moyens techniques, de formation, et l’accumulation de dettes ne les conduisent à revendre leur parcelle à bas prix à la grande plantation voisine, et ceci heureux de s’être déchargés d’un fardeau. La libre concurrence légitime l’inégalité entre agricultures paysanne et industrielle, entérinant la reproduction d’un capital produit par la violence.
La transformation économique et écologique du paysage rural colombien, héritière de l’action conjointe de la violence paramilitaire et de l’investissement capitaliste, contraint aujourd’hui les paysans à quitter leur terre.
Un cas d’école est fourni par Jacobo Grajales dans son livre à travers l’enjeu de la ressource en eau. Dans le bassin versant du fleuve Rio Frio, à une quarantaine de kilomètres au sud de Santa Marta à l’extrême nord du pays, les plantations bananières ont prospéré et se sont étendues à partir des années 2000 à la faveur de l’opacité créée par le conflit armé. Concentrée à l’est de la région, en amont du fleuve, l’extension des plantations s’est accompagnée de la multiplication des infrastructures d’irrigation (pompes, canaux, réservoirs, etc.) captant ainsi l’essentiel de la ressource en eau avant qu’elle ne parvienne aux fermes en aval. Aujourd’hui endettées car incapables de produire à cause de la sécheresse, les paysans de l’ouest vendent peu à peu leurs terres à de plus grands exploitants qui disposent des ressources nécessaires aux travaux d’irrigation. Ainsi s’uniformise le paysage rural au profit de l’agro-industrie.
RENDRE JUSTICE EN PERIODE POST-CONFLIT : SURTOUT, NE PAS FAIRE FUIR LES INVESTISSEURS !
Au milieu des années 2000, la justice transitionnelle devient la doctrine dominante des politiques de peace-building. Elle est consacrée en Colombie par la loi 975 de 2005 dite « Justice et Paix » qui prévoit des politiques de démobilisation des paramilitaires et de réparation des victimes. En 2011, un cap est franchi avec l’adoption de la « Loi sur les victimes et la restitution de terres ». Le texte est une victoire idéologique : la question agraire est enfin considérée comme un sujet central dans l’agenda post-conflit. En même temps que le texte reconnait une corrélation entre foncier et conflit armé, il la réduit à sa dimension la plus criante : la spoliation violente. Il s’agit de restituer leurs terres aux paysans dépossédés afin de réparer le crime. Les responsabilités profondes de ces accaparements et des inégalités historiques du système agraire sont ignorées.
De fait, les procédures de justice pour la récupération des terres furent centrées sur les acteurs armés paramilitaires, faisant fi de leurs liens étroits avec les milieux d’affaires. À deux égards, les multinationales agricoles sont restées relativement à l’abri de la justice.
D’une part, les unités de procureurs créées par la loi Justice et Paix de 2005 et chargées de recevoir les témoignages des paramilitaires n’étaient pas compétentes à l’égard des tierces parties. Ces informations étaient alors transférées aux bureaux des procureurs locaux. Evalués au chiffre – par le nombre d’affaires qui aboutissent –, disposant de faibles moyens pour enquêter et vulnérables aux intimidations, ces bureaux sont peu enclins à s’attaquer à ces affaires sensibles.
Selon les dernières enquêtes, à peine 0,2 % des producteurs possèdent des domaines de plus de 1 000 hectares, couvrant au total 32,8 % des terres agricoles du pays.
D’autre part, si la procédure civile de restitution des terres a parfois permis de démasquer les acquisitions illégales d’entreprises, la question de leur complicité avec les paramilitaires relève de la juridiction pénale, et requiert des niveaux de preuves supérieurs, réitérant les questions du manque de ressources et d’indépendance.
L’ACCORD DE PAIX DE LA HAVANE, UNE LENTE AGONIE
L’accord de paix de 2016 fit naître les espoirs d’une justice plus accomplie, avec la création de la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP). Aux origines, l’institution était compétente non seulement sur les crimes commis par les FARC mais aussi pour instruire tous crimes commis dans le contexte du conflit interne, incluant les entreprises privées ayant bénéficié des réseaux et des agissements criminels des acteurs armés. La lutte féroce des partis de droite et d’extrême-droite contre cette nouvelle juridiction eut raison de son impertinence : non sans ironie, une loi prévit que les hommes d’affaires ne seraient jugés par la JEP que s’ils se soumettaient volontairement à sa compétence. L’espoir éphémère d’une justice démocratique gisait là.
Bien qu’il marque un tournant dans l’histoire de la Colombie, les faiblesses de l’accord de La Havane étaient décelables dès sa conclusion. Particulièrement sur la question agraire, que les FARC avaient hissée en priorité, l’accord put s’établir non pas par consensus politique des différentes parties, mais grâce à l’ambiguïté de ses énoncés. Lors de l’arrivée au pouvoir, en 2018, d’un gouvernement hostile aux négociations avec les FARC, les mesures mises en place par l’accord afin d’appuyer un agenda redistributif purent sans difficultés être privées de cet esprit. Le recul des ambitions se notait déjà en fin de mandat de l’administration Santos (centre-droit), trop affaiblie politiquement pour obtenir le vote de lois à la hauteur des engagements pris à La Havane.
Par exemple, alors qu’une réserve foncière devait être créée et alimentée par des terres du domaine de l’État et des terres expropriées (propriétés des criminels de guerre, acquisitions frauduleuses) afin d’être redistribuées, le « Fond Foncier » fût transformé en simple plateforme de transit dans le processus de formalisation de la propriété. Les terres en cours de régularisation étaient transférées à cette réserve jusqu’à ce que la procédure de formalisation du titre de propriété soit achevée. Il ne s’agissait donc en rien d’allouer une terre à de nouveaux occupants, mais de sécuriser des droits de propriétés en formalisant une situation de fait déjà existante.
De la même manière, la réforme du cadastre introduite par l’accord de paix devait fournir une analyse territoriale des droits de propriétés et des usages du sol, accompagnant en parallèle des mesures de régularisation ou de redistribution pour résoudre les conflits fonciers. L’orientation techniciste soutenue par le nouveau gouvernement et les institutions internationales qui financent le programme (Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement), conduisit à une dépolitisation des enjeux et à l’effacement de sa dimension intégrale. Loin de remettre en question les inégalités foncières, la réforme du cadastre – toujours en cours – est en fait une actualisation des registres de propriétés grâces aux outils modernes : une simple cartographie de l’état de fait.
Selon les dernières enquêtes, à peine 0,2 % des producteurs possèdent des domaines de plus de 1 000 hectares, couvrant au total 32,8 % des terres agricoles du pays. À l’inverse, 69,5 % des producteurs cultivent des parcelles de 5 hectares ou moins, des propriétés qui ne couvrent que 5,2 % des terres agricoles disponibles.
L’immobilisme vis-à-vis des transformations agraires est à l’image des autres points de l’accord. Une fois l’objectif de démobilisation des guérilleros atteint, les dirigeants n’ont pas respecté leur part du marché. Autre contradiction avec les négociations de La Havane, la substitution volontaire à la culture de coca prévue par l’accord fût remplacée par son éradication obligatoire sous le nouveau gouvernement. De plus, les garanties de sécurité pour les ex-guérilleros font défaut : depuis la signature, au moins 271 combattants démobilisés ont été assassinés [2].
En 2018, beaucoup craignaient que l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite ne fasse voler en éclat l’accord de paix. Plutôt qu’un coup d’arrêt brutal, les cinq dernières années montrent – selon les mots de Jacobo Grajales – que « si le gouvernement actuel n’a pas tué l’accord, il l’a laissé mourir ».
Notes :
[1] Commission des droits de l’Homme de l’ONU, 2020
[2] Chiffres d’avril 2021 par le Parti des Communs, parti politique des FARC issu de l’accord de paix.