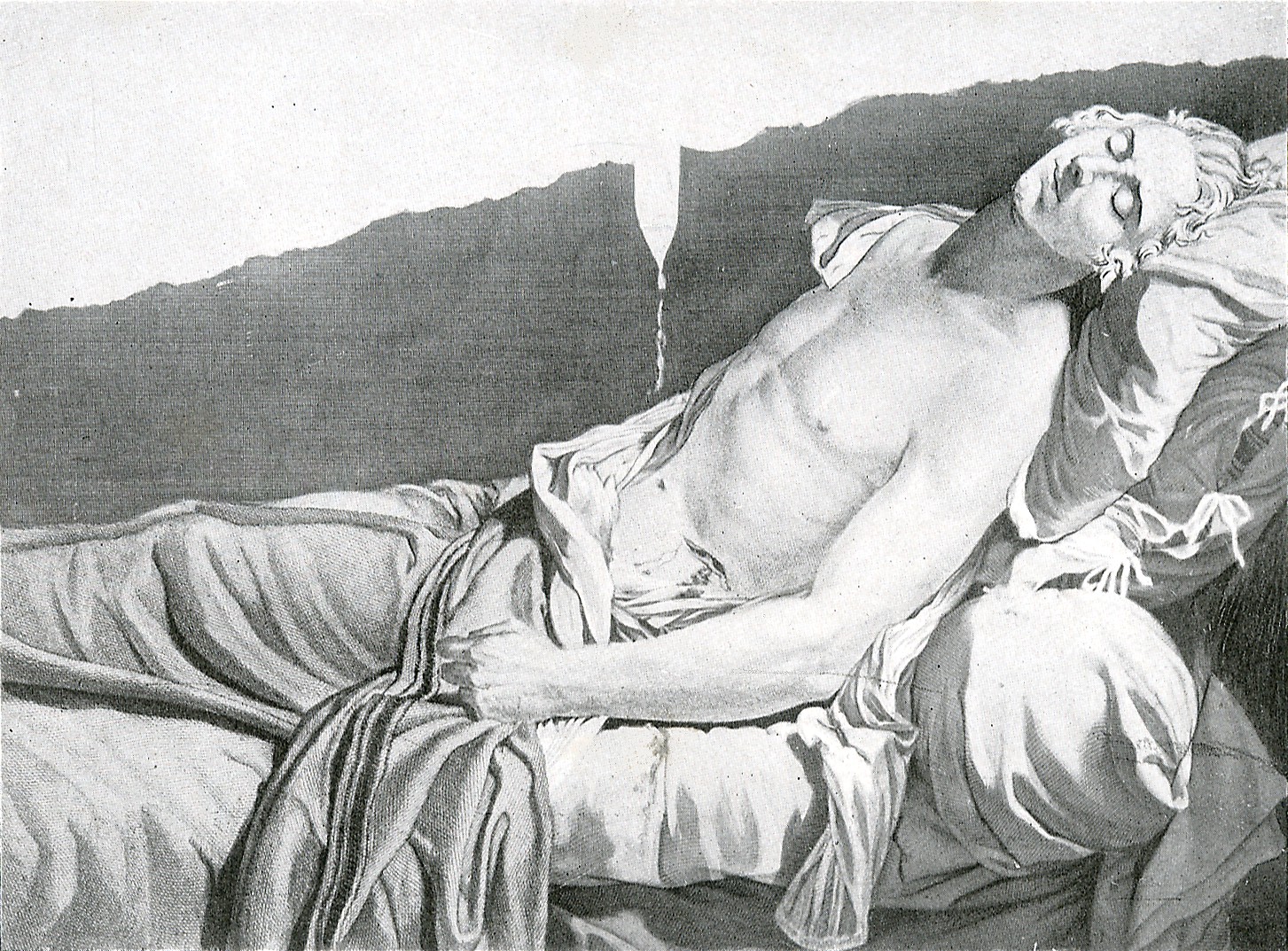Dans un long entretien, l’historien Grey Anderson, docteur de l’université de Yale, revient avec nous sur son ouvrage La Guerre civile en France : 1958-1962, du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, paru en 2018 aux éditions La Fabrique, dont la version anglaise aux éditions Verso est en cours d’élaboration. Comprendre la fondation de la cinquième République implique de revenir en profondeur sur le rôle de l’institution militaire française durant les évènements qui scandèrent la période ouverte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est à cette tâche que s’est attelé Grey Anderson, renouvelant ainsi l’approche habituelle de nombreux historiens pour envisager cette séquence majeure de l’histoire politique française contemporaine. Entretien réalisé par Victor Woillet et François Gaüzère. Retranscription réalisée par Dany Meyniel.
LVSL – Vous avez soutenu votre thèse de doctorat à l’origine de votre livre La guerre civile en France de 1958 à 1962 en 2016. Pouvez-vous revenir brièvement sur le contexte historiographique dans lequel vous avez débuté vos travaux de recherche ?
Grey Anderson – Au moment où j’ai commencé mon doctorat, il y avait eu une grande effervescence en histoire sur la guerre d’Algérie — je pense aux thèses de Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault, publiées au début des années 2000 — ainsi qu’une fascination particulière pour le sujet aux États-Unis, de la part d’universitaires mais aussi de militaires ou de certains dirigeants politiques, qui l’interprétaient à l’aune des contre-insurrections menées par l’armée américaine en Afghanistan et en Irak. En revanche, ce renouveau des recherches sur le conflit algérien ne s’est pas accompagné d’un intérêt comparable pour la crise politique qu’il a déclenchée en France. Lors d’un colloque qui s’est tenu à Sciences Po en 2008, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Ve République, un intervenant avait fait observer qu’il n’existait pas à proprement parler d’historiographie du 13 mai 1958. Pourtant un changement de régime, ce n’est pas rien ! On trouvera peut-être mon propos excessif, mais j’ai été frappé de la place relativement modeste occupée par cet épisode dans l’histoire de l’Europe après 1945. On en donne le plus souvent l’image d’un continent apaisé, pacifié, qui s’ennuie… Les principaux thèmes traités sont ceux de la croissance économique et de l’idée d’une restauration conservatrice après le choc des deux guerres mondiales. Or, pour quelqu’un qui s’intéresse au cas français, on voit combien ce récit s’éloigne de la réalité, malgré l’omniprésence de la notion de « Trente Glorieuses » proposée par Jean Fourastié à la fin des années 1970. Déjà, parler de la « France de l’après-guerre » n’a pas grand sens avant 1962 au plus tôt, étant donné que le pays est en guerre presque sans discontinuer de 1939 aux accords d’Évian. Je me souviens bien de la publication d’un ouvrage de synthèse sur l’Europe contemporaine par l’historien américain James Sheehan, intitulé Where Have All the Soldiers Gone ( James John Sheehan, Where Have All the Soldiers Gone?: The Transformation of Modern Europe, Boston, Houghton Mifflin, 2009) en référence à une célèbre chanson interprétée entre autres par Marlène Dietrich. Pour ma part, il me semblait évident que les soldats n’étaient jamais vraiment partis et qu’ils ont continué à jouer un rôle de grande importance, en France comme ailleurs.
« Parler de la “France de l’après-guerre” n’a pas grand sens avant 1962 au plus tôt, étant donné que le pays est en guerre presque sans discontinuer de 1939 aux accords d’Évian. »
À propos d’historiographie, il y aussi dans ces débats une dimension plus franco-française. Depuis les années 1980 s’est imposée une forme de révisionnisme dans les discours sur la IVe République. On l’a longtemps perçue en termes gaulliens, comme un régime irrémédiablement dysfonctionnel, inféodé aux puissances étrangères, inadapté aux besoins d’une société moderne et technique. Puis s’est développée une lecture toute différente, insistant sur les continuités entre la IVe et ce qui la suit. C’est la thèse reprise récemment par Herrick Chapman, qui parle d’une « longue reconstruction » englobant toute la période allant de la Libération à la fin de la guerre d’Algérie (Herrick Chapman, France’s Long Reconstruction : In Search of the Modern Republic, Cambridge, Harvard University Press, 2018). Sur de nombreux points, comme la politique économique et sociale, la quête d’une certaine autonomie dans les relations étrangères, ou encore les projets de « réforme de l’État », cette perspective est plutôt convaincante. Cependant, si l’on la suit jusqu’au bout, la crise de 1958 devient assez énigmatique — l’excellent livre de Chapman ne l’évoque qu’en passant — et la naissance de la Ve République, aussi mouvementée soit-elle, est considérée comme le simple aboutissement d’un processus en gestation. Sans être tout à fait faux, ce point de vue ne rend pas à mon sens suffisamment compte du caractère exceptionnel de la conjoncture qui a conduit à l’émergence de la Ve République.
Pour parler plus spécifiquement du 13 mai, il y a bien une littérature là-dessus, des historiens qui ont travaillé le sujet. Mais je me souviens d’avoir été saisi par le caractère manichéen de cette historiographie. On a d’un côté un récit « orthodoxe », consensuel, selon lequel, malgré certains aspects louches, et l’existence de divers complots au printemps 1958, de Gaulle a été le sauveur de « l’ordre républicain ». Dans cette veine, je pense à un ouvrage au demeurant très riche d’Odile Rudelle publié en 1988 avec l’appui de la Fondation Charles de Gaulle (Mai 1958. De Gaulle et la République, Paris, Plon, 1988), visant à associer de Gaulle à une lignée de penseurs démocratiques et libéraux du XIXe siècle. De l’autre côté, il y a la production journalistique, héritière des livres écrits à chaud par des reporters tels que les frères Bromberger, qui font grand cas des machinations et autres manœuvres dont la presse de l’époque fit ses choux gras. Certains travaux dans le genre, notamment l’ouvrage de Christophe Nick (Résurrection. Naissance de la Ve République, un coup d’État démocratique, Paris, Fayard, 1998), relèvent des éclaircissements précieux. Il n’empêche que la vue globale y est un peu déformée par cette insistance sur les aspects les plus sulfureux, attribuant ainsi aux acteurs un pouvoir et une clairvoyance démesurés.
En fait il y a un intérêt à lire ensemble ces deux pôles historiographiques. Les deux courants apportent une contribution utile à la compréhension de cette crise, mais ils ont tous les deux tendance — je généralise — à accepter comme monnaie courante les interprétations, les concepts et problématiques produits par les contemporains eux-mêmes. S’agissait-il d’un coup d’État, d’un coup d’État de velours, d’une transition ou d’une alternance politique ? La IVe République est morte ; faut-il parler d’un meurtre, d’un suicide ou d’une « euthanasie » comme l’a suggéré René Rémond ? En ce qui me concerne, je me suis plutôt intéressé au processus par lequel ces adaptations et ces concepts ont été forgés. À cet égard, ma plus grande inspiration vient de la sociologie politique française, et notamment des travaux de Brigitte Gaïti et Delphine Dulong (Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, Paris, L’Harmattan, 1997 ; Brigitte Gaïti, De Gaulle, prophète de la Cinquième République, Paris, Presses de Sciences Po, 1998). Ces travaux portent un regard critique sur le récit dominant de l’avènement de la Ve République, en se penchant sur le rôle qu’ont joué les notions de modernité et de modernisation dans la dissimulation d’autres enjeux, et la construction d’un consensus politique autour de l’idée d’appartenance à une ère nouvelle. Ce qui a eu pour effet, et qui en quelque sorte a toujours pour effet, d’effacer ou de neutraliser la rupture et le choc de 1958.
Dans ma thèse j’ai voulu prolonger la ligne de recherche de Gaïti et Dulong en me focalisant sur l’armée, institution au centre de la crise de 1958 et dont la « modernisation », conçue comme le moyen de sa dépolitisation, était une préoccupation centrale pour le régime gaulliste dans ses premières années.
LVSL – Pour rentrer dans l’analyse de la naissance de la Ve République, vous mentionnez un correspondant de Die Zeit, qui écrit que le 13 mai 1958 est un 6 février 1934 qui a réussi. Pouvez-vous expliciter cette lecture du 13 mai ?
G.A. – Il s’agit d’une citation d’André Siegfried, reprise ensuite par des historiens tels que Serge Berstein. Mais en effet la référence à février 1934 était omniprésente à l’époque. De manière générale, dans les moments de grands bouleversements politiques, l’analogie historique revêt une importance particulière : elle sert à la fois à comprendre une situation inédite, en la faisant rentrer dans un cadre familier, et à faire comprendre en imposant sa propre interprétation aux autres. Ainsi les Kampfbegriffe, les mots polémiques, qui alimentent les débats en 1958 sont très souvent des analogies. Qu’on pense seulement au vocabulaire qui nous est parvenu, « salut public », « putsch », « guerre civile »… Le symbole des journées de février 1934, que la plupart des acteurs de l’époque ont vécu, est particulièrement évocateur. Elles sont dans toutes les têtes dès la journée du 13 mai, à commencer par celles des militants d’extrême-droite qui, comme le jeune Jean-Marie Le Pen, descendent les Champs-Élysées jusqu’à la place de la Concorde, d’où ils sont repoussés avant de prendre la direction du Palais Bourbon. Le soir, pendant le débat d’investiture, Paul Ramadier invoque le soutien, un quart de siècle en amont, de Blum à Daladier et implore les députés de s’unir autour de Pflimlin afin de rétablir l’ordre à Alger. Ce à quoi les bancs de la droite rétorquent que c’était Gaston Doumergue, rappelé pour former un gouvernement d’union nationale, et non pas Daladier, qui avait mis fin au désordre des ligues. L’allusion était limpide.

Si les comparaisons avec 1934 s’imposent plus ou moins spontanément à toutes les forces politiques, c’est le Parti communiste qui en fait l’usage le plus intensif et le plus conséquent. Le coup de force manqué du 6 février et la manifestation de gauche qui l’a suivi, le 12, occupent alors une place centrale dans la mémoire du parti. C’est le grand moment de « fraternisation » entre communistes et socialistes, ouvrant la voie au Front populaire. C’est sur cette base que le PCF se positionne dans les deux dernières semaines de mai 1958, tant au sein des instances dirigeantes que dans sa propagande. Le mot d’ordre était celui de la « défense républicaine » face à la menace fasciste dans un effort concerté avec la SFIO, au nom de la vieille tradition anti-bonapartiste et de l’antifascisme de l’entre-deux-guerres. L’échec de cette stratégie, avec la fin de non-recevoir opposée par le parti de Guy Mollet, est sans doute une cause majeure de la chute de la IVe République. L’épisode aura d’ailleurs des retombées sur la ligne du PCF dans les années suivantes. Les dirigeants communistes ayant vu en de Gaulle, sinon un fasciste, au moins une espèce de pente vers le fascisme, leur capacité à interpréter le nouveau pouvoir et les péripéties de sa politique algérienne demeureront assez limitées.
Alors, si le 13 mai a pu être considéré comme un « 6 février qui a réussi », c’est d’abord parce qu’en 1958, la conjonction de l’anticommunisme virulent et le contexte international de la guerre froide a écarté toute possibilité de front commun de la gauche. La formule du très libéral doyen de Sciences Po André Siegfried, père de la sociologie électorale et phrénologue distingué par Vichy, ne dit pas autre chose. Ce qu’affirme Siegfried, au fond, c’est qu’on ne défend pas la République avec les communistes. En même temps, la suite de l’histoire allait évidemment contrarier les espoirs (ou les craintes) de ceux qui voyaient dans les événements de mai une revanche des déçus de 1934 : une fois installé à Matignon puis à l’Élysée, de Gaulle s’est employé avec fermeté à faire rentrer dans le rang ses soutiens les plus agités, une partie desquels se lancera par la suite dans la sanglante aventure de l’OAS.
Sur ce point, j’aimerais revenir brièvement sur la trajectoire d’Armin Mohler, ce correspondant de presse de Die Zeit dont vous avez parlé tout à l’heure. C’est un personnage sulfureux, Suisse d’origine ; il aurait tenté de rejoindre la Waffen-SS en 1942 mais en aurait été recalé pour critères physiques. Après la guerre il a fait une thèse sur la « révolution conservatrice » sous la République de Weimar, et il a travaillé pendant un temps comme secrétaire privé d’Ernst Jünger. Devenu plus tard journaliste, il était un fin connaisseur de l’extrême droite française qu’il n’hésitait pas à qualifier de fasciste ; dans les années 1950, il exprime même l’idée que la France serait devenue la capitale mondiale du fascisme, et c’est à cette aune qu’il a vu dans les événements du 13 mai 1958 une tentative de refaire le coup manqué de février 1934.
En dépit de ses affinités, Armin Mohler s’est très vite rendu compte que l’ambition des groupuscules fascisants en Algérie comme en métropole était vouée à l’échec. Le combat de rue faisait déjà vieux jeu, tout comme la cause de l’Algérie française. Je n’en parle pas beaucoup dans le livre mais il y a un échange intéressant entre Mohler et son vieil ami Carl Schmitt (Carl Schmitt, Briefwechsel mit einem seiner Schüler, Berlin, Akademie Verlag, 1995). Tandis que Mohler suivait avec admiration le retour de De Gaulle et les prémisses d’une politique étrangère indépendante, qu’il opposait à la soumission de la RFA au protecteur américain, Schmitt était plus réservé ; il partageait l’antigaullisme de ses amis et correspondants français, tels qu’Alfred Fabre-Luce, et répandait des ragots vichystes selon lesquels de Gaulle aurait été juif et franc-maçon… On en perçoit les traces dans le livre de Schmitt sur la théorie du partisan (Carl Schmitt, Théorie du partisan, trad. Marie-Louise Steinhauser, Paris, Flammarion, 1992) lorsqu’il fait l’éloge de Raoul Salan, commandant en chef des forces françaises en Algérie au moment du 13 mai, membre du fameux « quarteron de généraux » à la tête du putsch d’avril 1961, qui finira patron de l’OAS. Tandis que Mohler plaçait ses espoirs dans le renouveau, sous la houlette de De Gaulle, d’un nationalisme autoritaire, modernisé et affranchi des étiquettes idéologiques surannées, Schmitt mettait en question la viabilité de toute politique étroitement nationale dans l’Europe d’après 1945 et se livrait à une appréciation indulgente de ce jusqu’au-boutiste du colonialisme français. Si je m’attarde sur cette anecdote de l’histoire intellectuelle, c’est parce qu’elle me semble révélatrice des dilemmes qui traversent la droite et a fortiori l’extrême droite de l’époque. On retrouve des thèmes voisins dans le premier ouvrage d’Alain de Benoist, consacré à Salan, mais cela est une autre histoire.
LVSL – Vous considérez la naissance de la Ve République comme émanant d’un coup d’État gaulliste, pouvez-vous revenir sur ce concept et le détailler pour nos lecteurs ?
G.A. – Dans mon livre, j’emploie ce concept de coup d’État, mais j’essaie aussi de m’interroger sur la façon dont cette définition a été construite et contestée par les acteurs de l’époque. Qu’est-ce qui s’est passé en mai 1958 ? D’abord, une manifestation à Alger se transforme en émeute quasi-insurrectionnelle, les militaires prennent le contrôle, et — sous la pression des militants gaullistes sur le terrain — ils mettent Paris devant le fait accompli. C’est le scénario type du pronunciamento, qui se répète une dizaine de jours plus tard en Corse. Entre-temps, le gouvernement constate des défections alarmantes au sein des appareils répressifs de l’État. Jusqu’au moment où le parlement vote l’investiture de De Gaulle, le 1er juin, le spectre d’une intervention des forces armées venues de Corse ou d’Afrique du Nord ne cesse de planer sur la vie publique du pays. On est bien en présence d’une forme d’action politique violente avec la possibilité réelle d’un recours aux armes. On a beaucoup discuté de l’implication personnelle du Général dans cette affaire ; on s’est demandé s’il était au courant de toutes les manœuvres faites par ses partisans en son nom, s’il connaissait les grandes lignes de l’ « Opération Résurrection », et cætera. Cette question me paraît finalement assez secondaire. Car ce qu’il faut souligner, c’est que de Gaulle — avec la complicité d’une majorité des parlementaires — a réussi à donner à sa prise du pouvoir une façade de légalité. Et ça a fonctionné. On peut s’interroger sur la complicité des dirigeants des partis bourgeois de l’époque dans la subversion du pouvoir législatif, ce que le sociologue franco-américain Ivan Ermakoff appelle « ruling oneself out » (Ruling Oneself Out : A Theory of Collective Abdications, Chapel Hill, Duke University Press, 2008), et qui n’est pas sans rappeler, comme l’affirment certaines voix dans l’hémicycle, le vote du 10 juillet 1940. En tout cas, cette onction démocratique n’enlève rien au caractère exceptionnel de la séquence ; au contraire, c’est même à mon sens le gage de son succès. Et si l’histoire a surtout retenu l’habileté de De Gaulle chef d’État au sortir de la crise, et qu’il n’y a pas eu à proprement parler de légende noire de la fondation de la Ve République, il n’empêche que c’est un peu de cela dont il s’agit : d’un coup d’État. Un lecteur m’a appris que les meneurs du golpe espagnol de février 1981, le 23F, dont un des chefs — le général Armada — aurait réalisé un stage à Paris à l’École militaire peu de temps après mai 1958, prenaient l’exemple français pour modèle. Leur tentative avait d’ailleurs été baptisée « Opération de Gaulle »…
LVSL – À propos du fait militaire, on voit très bien la connexion entre ce dernier et l’affirmation du nouveau régime républicain. Est-ce que ce coup d’État, du moins cette prise de pouvoir, marquée par la place du fait militaire, a en quelque sorte modelé la forme du régime actuel ?
G.A. – L’Allemagne a longtemps fait figure d’archétype de la nation militariste. De nos jours, ce sont probablement les États-Unis qui incarnent cette tendance aux yeux du monde. Mais cela n’est pas rendre tout à fait justice à la France ! Pour ne remonter qu’au dix-neuvième siècle, l’armée a joué un rôle clef dans la répression de tous les grands soulèvements populaires qu’a connu le pays, de la révolte des Canuts à la fusillade de Fourmies (en 1891, la troupe tire sur des grévistes, elle fait 9 morts et plusieurs dizaines de blessés, NDLR). Marx avait d’ailleurs proposé que la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » soit remplacée par celle d’« Infanterie, Cavalerie, Artillerie ». À part la gendarmerie, l’institution militaire s’est éloignée des tâches de maintien de l’ordre au cours du vingtième-siècle, au moins en France métropolitaine — à quelques exceptions près, par exemple l’appel du ministre de l’Intérieur Jules Moch au 11e choc pour briser la grève des mineurs lorrains en 1948. Pour autant, le rapport entre la République et son armée est demeuré tendu ; les faits accomplis coloniaux qui ont jalonné l’histoire de la IVe République en témoignent. Sa chute en est en quelque sorte le résultat. Le sujet est en tout cas plus complexe qu’on veut bien souvent le croire. Dans la série de crises qui agitent les dernières années de la IVe, c’est plus souvent la collusion que la désobéissance ouverte qui caractérise les rapports civils-militaires. Il n’en reste pas moins que Moch, de retour place Beauvau au moment du putsch d’Alger, ne pouvait plus compter sur la troupe. Pour beaucoup de ceux qui se sont ralliés, bon gré mal gré, à de Gaulle, il était le seul capable d’imposer son autorité aux soldats factieux. C’est ce qui a fini par se produire, non sans difficulté. Pour ce faire de Gaulle s’est appuyé sur deux récits, celui de la modernisation et celui de l’indépendance nationale. L’acquisition de l’arme nucléaire, engagée sous la IVe, associait les deux ; la force de frappe a été pensée à la fois comme garant d’une certaine autonomie sur la scène internationale et, accessoirement, comme prime à une armée qui faisait le deuil de ses gloires coloniales. Sur les deux plans, le bilan a été mitigé, pour dire le moins ; quoi qu’il en soit, au terme d’une série d’épurations, d’amnisties et d’ajustements, le nouveau régime est parvenu à reprendre le contrôle de son bras armé. Bien entendu, ni la fin de la guerre d’Algérie ni le départ du général de Gaulle n’ont mis fin à l’interventionnisme des forces armées françaises, qui a connu une croissance continue depuis le début des années 1970, notamment sous les gouvernements socialistes. Au regard de l’état du débat politique, on peut dire que la prérogative « régalienne » en matière militaire, inaugurée par de Gaulle, est restée intacte sinon s’est renforcée jusqu’à nos jours.

Pour ce qui est des aspects institutionnels, on se retrouve devant un constat quelque peu paradoxal. Car si de Gaulle est arrivé à rétablir la prééminence de l’autorité civile sur l’armée, il n’a pu le faire qu’au prix d’une militarisation importante de l’État et des modes de gouvernance. Le domaine le plus significatif est sans doute celui du pouvoir exécutif. Dans son ouvrage sur le sujet, Nicolas Roussellier (La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015) démontre comment la Ve République a instauré une transformation qualitative de la fonction présidentielle, fonction qui serait désormais calquée sur le commandement militaire. Le style de De Gaulle, son habitude dans les heures décisives d’endosser l’uniforme, sa manière d’incarner et pour ainsi dire « personnaliser » la présidence y sont clairement pour quelque chose. Nicolas Roussellier insiste à juste titre sur le poids de la soi-disant crédibilité de la dissuasion nucléaire dans le raisonnement qui a conduit à la très controversée révision constitutionnelle de 1962, laquelle a introduit l’élection du président au suffrage universel direct. Il faut aussi regarder le fonctionnement de l’Élysée, l’ascendant de son état-major particulier et le fait qu’il préside les Conseils de défense. Je signale ici une tribune parue récemment dans Le Monde, à l’initiative de Brigitte Gaïti et Delphine Dulong que j’évoquais précédemment, soulignant l’importance accrue des Conseils de défense pendant la période actuelle de pandémie.
Une dernière dynamique mérite à mon avis d’être discutée. La fin des années 1950 et le début des années 1960 marquent une profonde transformation dans la manière de concevoir la sécurité nationale, dans un contexte doublement marqué par la contre-insurrection en Algérie et la Guerre froide. En 1960, une commission de juristes chargée de réviser le code pénal a proposé d’éliminer la distinction entre la sûreté intérieure et la sûreté extérieure de l’État, principe fondamental du droit républicain depuis un siècle. L’année précédente, le gouvernement avait reformulé par ordonnance la définition de la défense nationale, reconnaissant désormais des degrés intermédiaires entre la guerre et la paix. Ces tendances existaient déjà au début de la Ve République et participaient d’un mouvement plus large, pas du tout limité à la France. En même temps, l’avènement d’un pouvoir fort, à un moment d’intense violence tant en métropole que de l’autre côté de la Méditerranée, a donné une impulsion nouvelle aux changements en cours. C’est ce climat qui en outre a justifié le recours croissant aux mesures d’exception : l’Article 16 de la Constitution, appliqué pour l’unique fois jusqu’à présent pendant le « putsch des généraux » d’avril 1961, en est probablement l’illustration la plus connue. Mais on peut citer aussi la loi sur l’état d’urgence, certes promulguée sous la IVe mais qui s’est étendue à la France métropolitaine pour la première fois en mai 1958, avec la postérité que les militants de notre génération connaissent. Je termine ma réponse en notant que si cette nouvelle législation a été rédigée, au lieu de recourir à la jurisprudence existante sur l’état de siège, c’était justement parce qu’on ne faisait pas confiance aux militaires pour gérer la situation. Cette défiance perdure bien après le retour de De Gaulle.
LVSL – Est-il possible de voir ainsi une forme de continuité dans la structuration du fait militaire par rapport au fait politique, en prenant notamment en compte les mutations du régime républicain depuis la Première Guerre mondiale avec le fameux schisme entre le GQG (Grand Quartier général) et la Chambre des députés comme le suggère Nicolas Roussellier ? En d’autres termes, peut-on observer dans la période que vous avez étudiée une simple mutation du régime et du modèle républicain qui n’intègrent pas initialement le fait militaire à l’exécutif, ou bien s’agit-il, avec 1958, d’un véritable changement de paradigme en la matière ?
G.A. – Effectivement, il serait erroné de faire de 1958 une rupture nette avec le passé. Il y a eu d’autres cas d’exercice d’un pouvoir exécutif fort dans l’histoire de la République française, notamment en temps de guerre ; la mainmise de Clemenceau sur l’état-major en est un exemple, la gestion de la guerre d’Indochine par Auriol en est peut-être un autre. Comme vous dites, on peut tout à fait expliquer cette histoire en la rattachant à une succession de tentatives de la part des dirigeants politiques pour réaffirmer leur prédominance sur le haut commandement — tentatives de réintégration du militaire et du politique, si vous voulez — qui ne se trouveraient réalisées qu’avec l’arrivée de la Ve République. Cependant, et là-dessus je trouve l’argumentation de Roussellier fort convaincante, on peut admettre ces éléments de continuité sans pour autant perdre de vue le décalage radical entre la pratique de gouvernement gaullienne et la tradition républicaine, dans la mesure où cette dernière s’est définie avant tout par la souveraineté parlementaire. Le « modèle républicain » français est issu précisément du rejet du pouvoir personnel, qu’il soit monarchiste ou bonapartiste. Et si la difficulté à maîtriser le fait militaire faisait incontestablement partie des faiblesses de la IVe République, il n’y avait rien d’inévitable dans la forme de solution finalement adoptée.
« Le « modèle républicain » français est issu précisément du rejet du pouvoir personnel, qu’il soit monarchiste ou bonapartiste. »
C’est un point capital, car il existe des divergences dans l’appréciation qu’on peut avoir de l’effondrement du régime né en 1946. Certains perçoivent cet effondrement comme relevant d’une nécessité historique, au sens où le parlementarisme à l’ancienne aurait été incompatible avec les exigences de la guerre totale et de la gouvernance d’une économie technologique moderne et mondialisée ; d’autres font plutôt ressortir le caractère contingent et aléatoire de la solution offerte par de Gaulle et ses collaborateurs. Ainsi on peut très bien penser et que la IVe République était sur certains fronts à bout de souffle, et que le nouveau régime aurait pu prendre une toute autre tournure. À cet égard, il est intéressant de retracer comment plusieurs fractions de la gauche non-communiste ont interprété l’avènement de la Ve, et l’accommodement précoce de certains aux nouvelles institutions au moment même où François Mitterrand dénonçait avec verve le « coup d’État permanent ». On peut dire, si l’on suit l’évolution de la nouvelle gauche, de la gauche modernisatrice souvent associée à l’expérience du mendésisme, que le chemin des socialistes vers le pouvoir a été préparé bien en amont. Si vous feuilletez des revues comme France-Observateur ou L’Express à l’époque vous constaterez l’omniprésence de cet impératif de « modernisation », qui était également central dans les réflexions de milieux à l’origine antigaullistes comme le « Club Jean Moulin » qui finiront par se rallier au nouveau régime. Rappelons tout de même que le « Club Jean Moulin », fondé en mai 1958 par Daniel Cordier et d’autres, avait pour but d’organiser la résistance armée en cas de coup de force des parachutistes à l’Assemblée nationale. Il est impressionnant de voir comment, en un temps relativement court, ce réseau est passé de la défense paramilitaire de la République et de l’antigaullisme forcené, aux missions beaucoup plus paisibles d’une espèce de boîte à idées technocratique. Au bout du compte cette constellation aura joué un rôle non négligeable dans la conversion de la gauche au présidentialisme. L’historienne Claire Andrieu a fait de tout cela un exposé passionnant (Pour l’amour de la République. Le Club Jean Moulin, 1958-1970, Paris, Fayard, 2002.).
LVSL – Quel est selon vous le rôle de l’antiaméricanisme dans la naissance de la Ve République, et dans les réseaux politiques qui ont forgé les institutions gaullistes ?
G.A. – Il faut d’abord distinguer deux variétés d’antiaméricanisme : d’une part une espèce de chauvinisme franchouillard qui remonte au moins aux années 1930 et a le plus souvent pris des connotations droitières ; d’autre part un refus de l’impérialisme américain, c’est-à-dire de l’ingérence des États-Unis en France mais aussi dans le reste du monde. Cela dit, certains ont interprété les événements du 13 mai 1958 comme une révolte antiaméricaine : cette interprétation a été avancée dans un premier temps par le journaliste russo-britannique Alexander Werth, puis reprise par l’historien américain Matthew Connelly (L’arme secrète du FLN. Comment de Gaulle a perdu la guerre d’Algérie, trad. Françoise Bouillot, Paris, Payot, 2014 [2002]). La thèse a du sens lorsqu’on prend en compte la politique extérieure des États-Unis sous la présidence Eisenhower (1953-1961, NDLR). On voit alors de la part de Washington une tendance à favoriser certains mouvements de libération nationale non-communistes dans les pays du Sud, dans l’idée, en gros, de construire des « remparts contre le bolchévisme ». C’est sur ce fondement, et non comme on a pu le prétendre sur une quelconque tradition anticolonialiste américaine, que les États-Unis ont effectivement exercé une influence prononcée dans la lutte indépendantiste des anciens protectorats français du Maroc et de la Tunisie, par leur diplomatie mais aussi par la voie de leurs services de renseignement et de syndicats vassaux. Cela intervient dans un contexte de forte dépendance économique de la France à l’égard des États-Unis. Auparavant le Trésor américain avait largement financé la guerre d’Indochine, et malgré le taux de croissance impressionnant de l’économie française, le déficit de la balance des paiements extérieurs nécessitait que les Français sollicitent des prêts auprès des Américains tout au long des années 1950.
On peut donc commencer le récit de la crise terminale de la IVe République au début de l’année 1958, quand Jean Monnet se rend à Washington pour demander encore un nouveau prêt au gouvernement américain et au FMI. En contrepartie, les Américains lui demandent d’engager la France dans des coupes budgétaires importantes, notamment de son budget militaire, ainsi que le redéploiement d’environ cent mille soldats stationnés en Algérie. Matthew Connelly considère que cet épisode constitue un des premiers programmes d’ « ajustement structurel » imposés par le FMI à un pays débiteur. C’est dans ce climat tendu que survient l’affaire de Sakiet Sidi Youssef (le bombardement conduit le 8 février 1958 par l’armée française sur un village tunisien, visant des combattants du FLN, qui causa 70 victimes civiles et environ 150 blessés, NDLR). L’affaire donne lieu à une plainte portée par la Tunisie devant l’ONU, suite à laquelle le conseil de sécurité confie une mission de « bons offices » à deux diplomates, l’un britannique et l’autre américain. Cette nouvelle ingérence anglo-américaine dans la politique française, intolérable d’après la majorité des élus, conduit à la chute du gouvernement de Félix Gaillard et déclenche la crise terminale du régime. Fait significatif, avant de prendre d’assaut le Gouvernement général à Alger, le 13 mai, les manifestants ont saccagé un centre culturel américain dans la ville. Néanmoins, la communauté pied-noir, et la droite française de manière plus générale, ne sont pas foncièrement antiaméricaines dans le sens anti-impérialiste du terme — ou du moins elles ne l’étaient que très peu. En effet, la plupart des fervents partisans de l’Algérie française étaient aussi de fervents partisans de l’OTAN ; ils voulaient convaincre les dirigeants américains que leur combat était celui du monde libre. Ils n’avaient pas totalement tort, étant donné que, comme on le sait, les départements français d’Algérie faisaient partie à la fois de la communauté européenne établie par le traité de Rome et de l’OTAN.
« La plupart des fervents partisans de l’Algérie française étaient aussi de fervents partisans de l’OTAN ; ils voulaient convaincre les dirigeants américains que leur combat était celui du monde libre. »
D’ailleurs, lorsque de Gaulle commence à se prononcer de plus en plus nettement en faveur d’une solution d’autodétermination en Algérie, on voit que l’atlantisme de ses opposants de droite devient de plus en plus farouche. Ces positions s’expriment notamment lors des débats parlementaires autour de la force de frappe. On trouve des défenseurs zélés de l’Alliance atlantique à la SFIO, chez les radicaux, à la démocratie chrétienne mais aussi dans l’extrême droite de François Valentin ou Jean-Marie Le Pen.
Cet atlantisme se manifeste en outre dans le putsch manqué d’avril 1961 durant lequel les généraux factieux — le « quarteron » selon le mot de De Gaulle — croyaient sincèrement, paraît-il, que Washington allait leur apporter de l’aide. A l’époque, on parlait de possibles liens avec la CIA — qui ont été bien sûr niés formellement par le gouvernement de Kennedy. Tout cet épisode reste nébuleux ; il est difficile de croire que JFK, qui avait fait sa carrière au Sénat américain en prônant l’indépendance de l’Algérie, aurait pactisé avec les généraux félons, bien qu’on puisse toutefois imaginer des contacts plus ou moins officieux avec des agents de renseignement ou des officiers américains. De Gaulle disait ne pas croire à cette hypothèse, ce qui ne l’empêchait pas de voir dans le commandement intégré de l’OTAN — commandement que la France quittera cinq ans plus tard — une cause de l’insubordination militaire.
On rejoint un autre sujet, l’indépendance nationale telle que de Gaulle la concevait, et sa dénonciation de la puissance démesurée des États-Unis. En dépit de la conjoncture et des rapports pour le moins houleux qu’ils ont entretenu avec de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ne se sont pas élevés contre son retour aux affaires en 1958. Au contraire, ils ont activement soutenu la « solution de Gaulle », seule capable à leurs yeux d’éviter un Front populaire et un gouvernement avec les communistes. Malgré des frustrations considérables, et des divergences au sein des différentes administrations américaines, cette position est toujours demeurée la leur. En fin de compte, mieux vaut un allié grognard mais sûr au cœur du système de sécurité de l’Europe occidentale qu’un régime plus complaisant mais exposé aux crises ministérielles en série. Pour autant, je n’accepte pas l’opinion de certains historiens anglo-saxons, articulée au départ par Henry Kissinger et véhiculée en France par Raymond Aron et d’autres mandataires des services américains, que la politique étrangère de De Gaulle n’aurait été que du cabotinage. S’il convient de nuancer l’autonomie réelle dont le Général a pu disposer sur la scène mondiale, il n’en reste pas moins qu’il est allé plus loin dans la critique de l’hégémonie américaine que n’importe quel autre chef d’État européen. Là-dessus, on ne peut qu’être ébahi par le contraste avec ses successeurs. Au risque d’une généralisation abusive, on est tenté de dire que la Ve République actuelle cumule les pires aspects de l’héritage gaullien, conservant son autoritarisme et renonçant à ce qui était supposé faire sa « grandeur » : une présidence aux pouvoirs hypertrophiés sur le plan intérieur mais d’une impuissance manifeste sur la scène internationale.
LVSL – Notre dernière question porte sur la mémoire. Le 13 mai 1958 est une mémoire dont on ne parle jamais ou très rarement. Comment expliquez-vous cette occultation d’une date pourtant si proche de l’avènement de la Ve République ? Pour compléter, est-ce l’effet rétrospectif de Mai 68, dont l’esprit, si on suit les analyses de Pierre Nora, serait plus à même de représenter ce qu’est la France aujourd’hui, ou bien s’agit-il d’autre chose, d’un ensemble de phénomènes divers qui expliquent cet état de fait ?
G.A. – Il est vrai que l’occultation, l’oubli, le silence, le refoulement sont des concepts clés dans l’historiographie de la France au XXe siècle, en particulier dans l’historiographie de la droite française. On pense à l’affaire Dreyfus, le questionnement autour du fascisme dans les années 1920 et 1930, le « syndrome de Vichy », la sale guerre d’Indochine, l’Algérie et ainsi de suite. Cependant je me méfie un peu de cette manière de voir les choses… Ce que je peux dire c’est qu’au lieu de comprendre le refoulement comme simple occultation, négation ou oubli, il faudrait sans doute plutôt l’entendre au sens lacanien, comme un mécanisme caractérisé par le retour du refoulé — au sens où il arrive qu’un trauma ne soit pas, dans l’instant même, reconnu comme tel. Le refoulement se présente après-coup, si vous voulez, sous la forme d’un souvenir de cette expérience traumatisante. Naturellement il ne s’agit là que d’une analogie, sûrement douteuse, avec la situation clinique. Toutefois, on voit bien que la mémoire elle-même, à plus forte raison la commémoration, arrive parfois à refouler des épisodes peu glorieux voire inquiétants ; c’est ainsi que d’autres ont interprété les échos de juillet 1940 en mai 1958. En 1962, durant le procès Salan et surtout lors du référendum constitutionnel, moment décisif de l’histoire politique de la France, il y a déjà eu des efforts pour minorer la portée du 13 mai, pour faire en sorte qu’il disparaisse. Suivant Brigitte Gaïti, je cite des discours du général de Gaulle d’automne 1962 dans lesquels il définit le régime contre ses propres origines, affirmant que lui, de Gaulle, serait revenu sur le devant de la scène pour faire précisément échouer un coup d’État. Il me semble que c’est dans cette même visée qu’il faut comprendre ce qui se passe en 1968. Dans l’historiographie maintenant monumentale sur Mai 68, objet commémoratif par excellence — sans pour autant aller aussi loin que Pierre Nora pour qui son seul sens aurait été commémoratif — on parle très peu du fait que ce mois marquait aussi l’anniversaire de la conception de la Ve, autrement dit du régime actuel. Il suffit de regarder les images du boulevard Saint-Michel, les banderoles et pancartes où l’on pouvait lire « Dix ans déjà, mon Général ! » etc. Et le gouvernement était extrêmement conscient de ce lien mémoriel et historique. Ce que je veux dire c’est que cette crise a été aussi l’occasion d’un retour du refoulé de 1958, retour qui culmine dans un nouveau refoulement, la soi-disant fuite à Baden-Baden et la grande manifestation gaulliste du 30 mai sur les Champs-Élysées, marquant le rassemblement de la droite après les fractures et les luttes fratricides des années algériennes. Avec la fin de cette séquence et des amnisties qui allaient bientôt suivre, on voit encore une fois la mécanique d’une neutralisation dont les effets d’une certaine manière persistent jusqu’à aujourd’hui.