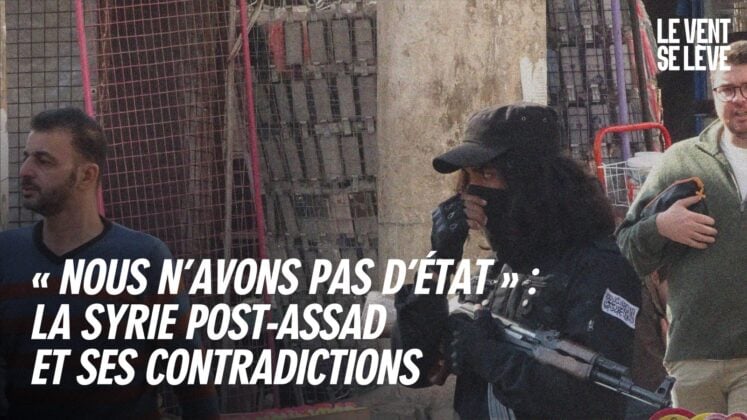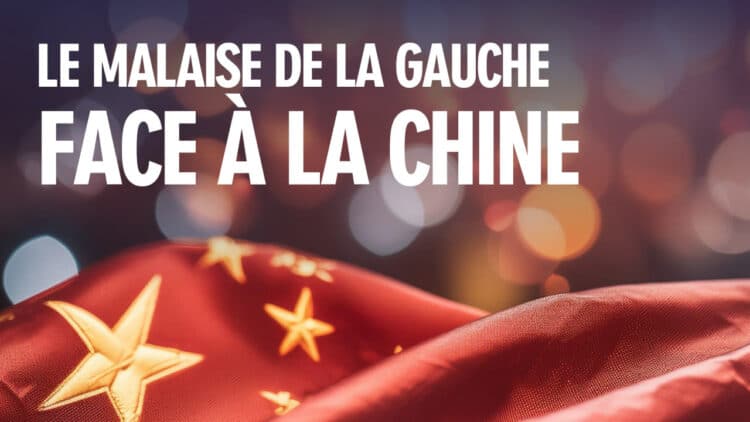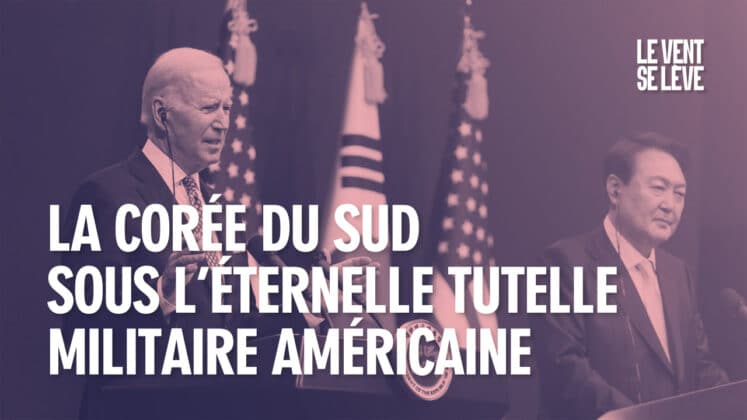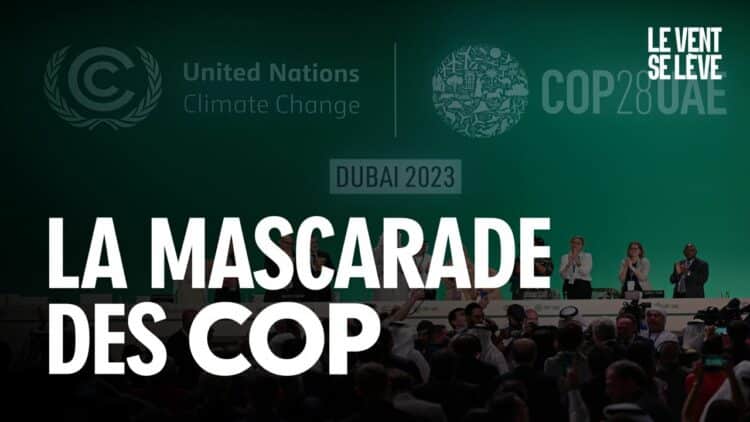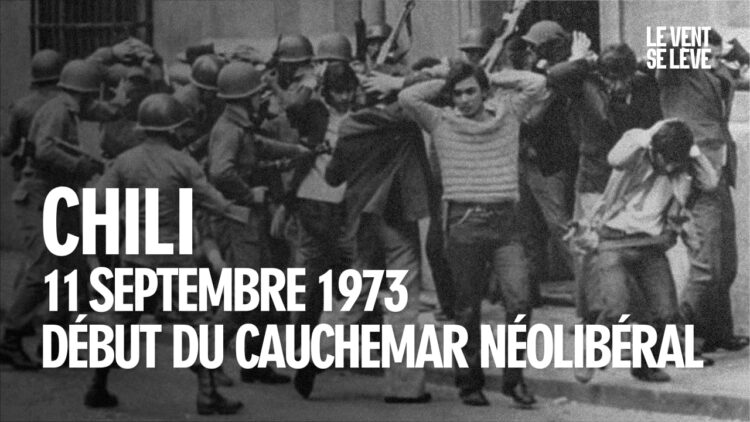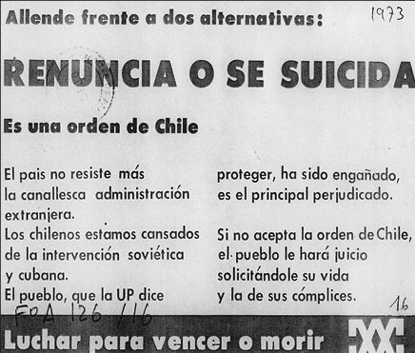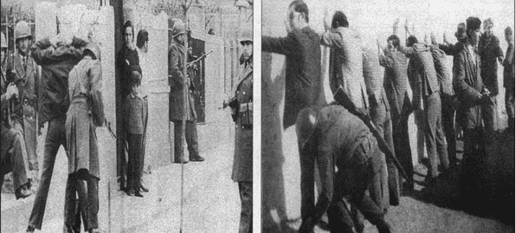Suite à l’humiliation infligée à Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, de nombreux commentateurs ont ressuscité une vieille théorie disqualifiée comme conspirationniste, selon laquelle Donald Trump serait un agent russe. La réalité est bien plus prosaïque. Loin d’être téléguidé par le Kremlin, il agit en vertu d’une impitoyable Realpolitik. À bien des égards, la guerre d’Ukraine est un cas d’école d’impérialisme contemporain. Russe d’abord, sous la forme de l’invasion brutale du pays, américain ensuite, avec un plan de mise sous tutelle économique. Elle constitue également une leçon intellectuelle : durant deux ans et demi, commentateurs, éditorialistes et « analystes » auront promu une explication psychologisante et dépolitisante du conflit. Il est urgent pour la gauche de l’abandonner, à l’heure où les morts continuent de s’empiler sur le front – et où les États européens évoquent un plan de militarisation à marche forcée, au détriment des systèmes sociaux du Vieux continent. Par Ingar Solty [1].
La guerre horrifique en Ukraine constitue, de plusieurs manières, une leçon en matière d’impérialismes : classique contre nouveau, formel contre informel, stupide contre stratégique. Mais elle constitue également une leçon d’ordre épistémologique, relative aux grilles analytiques à travers lesquelles nous sommes accoutumés à lire le monde. En tant que telle, elle est parlante quant aux banqueroutes intellectuelles, politiques et morales.
La folie des discours et leur implication concrète
Dès le commencement de l’invasion du pays, de nombreux commentateurs ont cherché à expliquer les objectifs du Kremlin sur la base d’un folklore ultranationaliste russe, destiné à flatter l’opinion intérieure. L’histoire récente du pays, son économie politique, sa place dans l’arène géopolitique mondiale et sa stratégie militaire concrète vis-à-vis de l’Ukraine semblaient n’avoir que peu d’importance. Ce choix – y compris à gauche -, consistant à évincer un prisme matérialiste, a laissé place à des analyses discursives superficielles, souvent alignées sur les éléments de langage libéraux des États occidentaux.
Préférant s’en tenir aux discours plutôt qu’aux faits, ces brillants analystes ont relevé que Vladimir Poutine avait qualifié l’effondrement de l’URSS de « plus grande tragédie du XXe siècle » et mis en doute l’existence de l’Ukraine comme État-nation. Ils en ont ainsi déduit que la Russie ne se contenterait pas d’envahir l’Ukraine, mais finirait par s’en prendre à l’ensemble de l’espace post-soviétique, y compris à des États non membres de l’OTAN comme la Géorgie, la Moldavie ou le Kazakhstan, voire aux pays baltes protégés par l’Alliance atlantique mais abritant d’importantes minorités russes.
Des analyses de cette nature, qui ont nourrit un alarmisme légitimant la militarisation occidentale, font pourtant abstraction du décalage flagrant entre les intentions supposées et les capacités réelles. Pire : elles se maintiennent envers et contre tout, y compris face à la contradiction évidente entre ces craintes et la stratégie militaire effective de la Russie au début du conflit – similaire à celle que l’on trouve entre les intérêts (géo)politiques russes et ses revendications officielles.
Les mêmes qui assurent que la Russie aurait les moyens d’envahir l’Union européenne sont aussi ceux qui, depuis deux ans, répètent que Moscou est sur le point de s’effondrer et que la victoire ukrainienne est à portée de main.
Personne ne se lancerait dans la conquête d’un pays de 44 millions d’habitants s’étendant sur 233.000 km² – soit presque deux fois la taille de l’Allemagne – avec seulement 190.000 soldats. À titre de comparaison, en 1939, l’Allemagne nazie a envahi une Pologne – d’une taille plus réduite et dotée d’une défense plus faible – avec 1,5 million de soldats, appuyés par près de 900 bombardiers et plus de 400 avions de chasse. Deux ans plus tard, lorsqu’elle a lancé son offensive contre l’Union soviétique, elle a mobilisé trois millions d’hommes – la plus grande force d’invasion de l’histoire –, un effort qui s’est pourtant soldé par un échec.
Ceux qui s’attachent à étudier l’histoire immédiate plutôt que l’histoire des idées immédiates (ou, pour être plus précis, la propagande) auraient pu voir, dès le départ, que la configuration des forces russes trahissait des objectifs plus limités. Trouver un exutoire à une situation intérieure marquée par l’insatisfaction de la population faisait partie des objectifs, mais ne les recouvrait pas tous – ironiquement, ce motif de guerre devrait logiquement conduire les partisans d’un changement de régime en Russie à une diplomatie de détente vis-à-vis du pays, afin de laisser les contractions s’y développer. Mais au-delà de cet aspect, Poutine les objectifs de Poutine étaient clairs : (1) élargir et annexer officiellement le Donbass, riche en minerais, et transformer Kherson et Zaporijjia en nouvelles régions russes – des cartes avaient déjà été imprimées en ce sens –, (2) établir un corridor terrestre vers la Crimée, annexée en 2014, et (3) provoquer un changement de régime à Kiev afin d’assurer que l’Ukraine, déchirée entre l’Est et l’Ouest, reste neutre et ne devienne pas un avant-poste de l’OTAN et de l’influence américaine.
Mais pourquoi s’embarrasser d’une analyse fondée sur l’histoire globale et régionale, l’économie politique internationale, les théories de l’impérialisme et les études stratégiques, lorsqu’on peut tout simplement répéter les éléments de langage des uns et des autres ?
Il est en effet plus simple de s’en tenir à une rhétorique qui banalise la mémoire de la Shoah, selon laquelle Poutine serait un nouvel Hitler, sa guerre en Ukraine une « guerre d’anéantissement » – comme l’a affirmé Berthold Kohler, rédacteur en chef de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, relativisant ainsi l’extermination menée par l’Allemagne nazie à l’Est, qui, en moins de quatre ans, a coûté la vie à vingt-sept millions de Soviétiques. Selon cette logique, la Russie s’apprêterait à « envahir l’Europe », et si d’ici 2029 le continent ne devient pas « apte à la guerre » et ne se transforme pas en État-caserne autoritaire, alors Moscou marchera sur Varsovie avant de défiler sous la porte de Brandebourg, à en croire la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts).
Les mêmes qui assurent que la Russie, malgré l’échec manifeste de son offensive en Ukraine, aurait les moyens de défier l’OTAN et de conquérir l’Union européenne, sont aussi ceux qui, depuis deux ans, répètent que Moscou est sur le point de s’effondrer et que la victoire ukrainienne est à portée de main. Il suffirait, affirment-ils, d’une dernière livraison d’armes occidentales, d’une mobilisation forcée de masse et de quelques nouvelles incitations économiques offertes aux jeunes travailleurs ukrainiens contre leur envoi au front.
Mais revenons aux grilles de lecture, ces clés de compréhension du réel. Certains continuent d’« analyser » le basculement de la politique étrangère américaine, de Joe Biden à Donald Trump, ainsi que le conflit ouvert entre l’administration Trump et Zelensky, en invoquant des facteurs aussi réducteurs que la personnalité des dirigeants, leur idéologie ou même leur supposée irrationalité, entre caprices d’enfant, narcissisme et égoïsme.
Un exemple parmi tant d’autres : Katrin Eigendorf, correspondante de guerre pour l’Europe de l’Est à la télévision publique allemande ZDF, suivie par près de 70 000 personnes, qui, comme 99 % des commentateurs libéraux, n’a sans doute pas regardé l’intégralité des quarante-neuf minutes du débat en question. Elle a pourtant affirmé que « rarement Trump et [J.D.] Vance auront montré si clairement qui était leur ami et qui était leur ennemi », ajoutant que « le président américain est l’homme de Poutine et reprend ses mensonges ». Une lecture intellectuellement indigente, digne des théories du « grand homme » de l’histoire du XIXe siècle.
Où en sommes-nous donc après cette confrontation mise en scène, vendredi dernier, dans le Bureau ovale, entre Donald Trump, son vice-président J. D. Vance et Volodymyr Zelensky ? Trump s’adressait à sa base MAGA et, plus largement, à l’électorat américain. Zelensky, lui, jouait un numéro pour son propre camp, celui-là même qui pourrait finir par le liquider, et plus encore pour les va-t-en guerres Européens qui souhaitent que s’intensifie ce recrutement de masse des travailleurs ukrainiens envoyés au carnage contre les travailleurs russes.
Autant d’évidences que certains ont refusé de voir. Les interprétations libérales les plus absurdes ont immédiatement attribué à Poutine le coup politique de Trump – autrement dit, l’exploitation coloniale de l’Ukraine à ce moment charnière de rivalité géopolitique, de reconfiguration étatique et de guerre. Pour ces commentateurs, la Russie, avec une économie de la taille de celle de l’Italie, aurait mis les États-Unis « dans sa poche ». En d’autres termes, les libéraux inversent la logique des rapports de force, tout en s’obstinant à aboyer du mauvais côté, dans une simplification binaire des plus grossières.
Aussi absurdes soient-elles, ces analyses ont envahi les réseaux sociaux. Du Facebook de Mark Zuckerberg au Twitter d’Elon Musk, les hashtags #TrumpIsARussianAsset, #TrumpIsANationalDisgrace, #PutinsPuppet et #PutinsPuppets se sont répandus avec une viralité à en faire frémir des bots russes.
De nombreux « progressistes » – y compris ceux qui se prétendent de gauche, voire marxistes –, est-il besoin de le dire, n’évoluent pas dans cette direction seulement parce qu’ils ont admis leur faillite intellectuelle (ce qu’ils ont fait, et pour quoi ils doivent être tenus responsables – car si une leçon doit être tirée de cette boucherie, c’est bien la nécessité d’un retour à une analyse historique et matérialiste, afin d’éviter que la tragédie ukrainienne ne se rejoue sous une forme encore plus grotesque dans une autre guerre par procuration.
Certes, les libéraux pensent réellement ainsi. Mais pire encore, ils persistent malgré des preuves accablantes du contraire, soit par adhésion au discours officiel de leur État, soit par soumission à son pouvoir disciplinaire, cherchant ainsi à différer le moment inéluctable de la rencontre avec la vérité. S’enfoncer dans une illusion pathologique est pour eux un moyen d’éviter d’admettre qu’ils se sont trompés – politiquement et moralement – alors même que de nouvelles vies sont jetées dans l’abattoir de la guerre. Ce refus leur permet aussi d’éviter un profond réexamen de leur formation académique – qui pourrait pourtant les conduire vers une épistémologie capable d’expliquer la réalité des conflits – et, par extension, de revoir leur grille de lecture du monde.
Au lieu de cela, de nombreux « progressistes » s’enferment dans leurs certitudes. Alors même qu’ils prônent la diversité et une pensée « complexe », ils sombrent dans une réduction binaire des plus caricaturales. Ceux qui s’indignent le plus bruyamment des attaques de Trump contre les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) sont précisément ceux qui semblent incapables de penser autrement qu’en noir et blanc.
Cette posture aboutit à une infantilisation et à une dépolitisation totale des enjeux politiques, coupés de toute réalité sociale. Elle repose sur une logique simpliste, celle du vieil adage : « L’ennemi de mon ennemi est mon ami ».
Nous sommes contre l’extrême droite, l’extrême droite est (ou semble être) contre l’UE, donc nous sommes pour l’UE.
Nous sommes contre l’extrême droite, l’extrême droite est contre Kamala Harris, donc nous sommes pour Kamala Harris.
Nous sommes contre le Hamas, le gouvernement génocidaire de Netanyahou est contre le Hamas, donc nous sommes pour Netanyahou.
Nous sommes contre Donald Trump, Trump insulte Zelensky, donc nous – #IStandWithUkraine – sommes pour Zelensky, même si ce dernier enrôle de force son peuple dans une guerre perdue d’avance.
Nous sommes contre Trump, Trump – parce qu’il sait que lui et Biden ont déjà gagné tout ce qu’il y avait à gagner sans déclencher une guerre nucléaire – veut mettre fin à cette guerre ingagnable par des négociations, donc nous sommes contre les négociations et pour la poursuite du conflit.
Et nous, qui empêchons nos enfants de jouer aux cow-boys et aux Indiens, qui leur enseignons que la masculinité est toxique et qu’il faut discuter plutôt que se bagarrer, donnons aujourd’hui aux institutions européennes le pouvoir de sacrifier les États-providence et les démocraties du continent sur l’autel des industriels de l’armement comme Rheinmetall, Thales, Raytheon, Lockheed Martin et Northrop Grumman. À ce rythme, ce « progressisme » aura pavé la voie, d’ici la fin de la décennie, non seulement à un retour de Donald Trump et à la consolidation du pouvoir de Giorgia Meloni, mais aussi à l’accession au pouvoir de Marine Le Pen, Geert Wilders, Alice Weidel et Björn Höcke.
Note :
[1] Article originellement publié par Jacobin sous le titre « Liberal Delusions Won’t Save Ukraine »