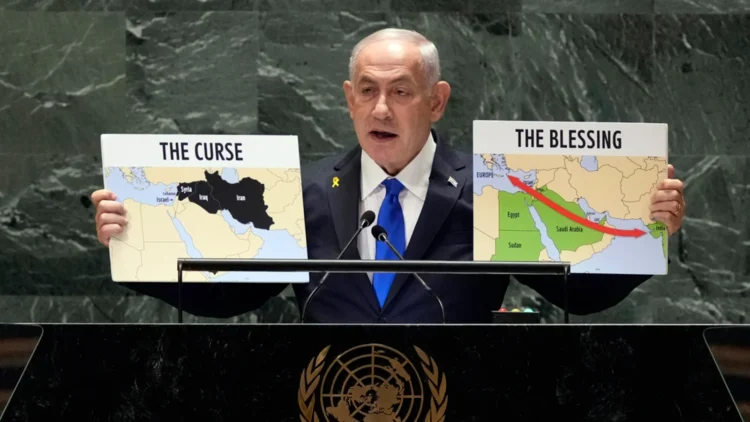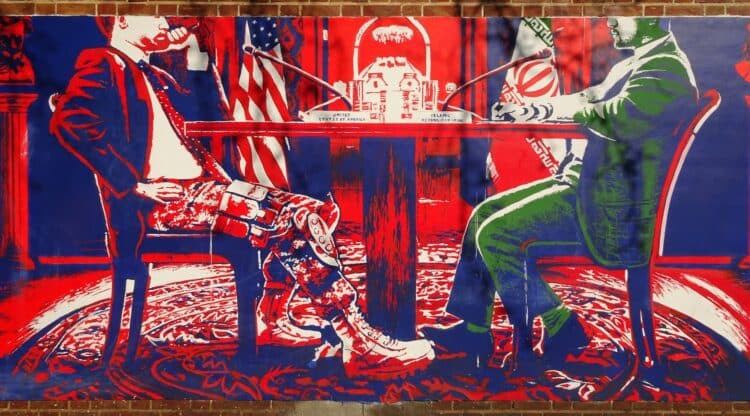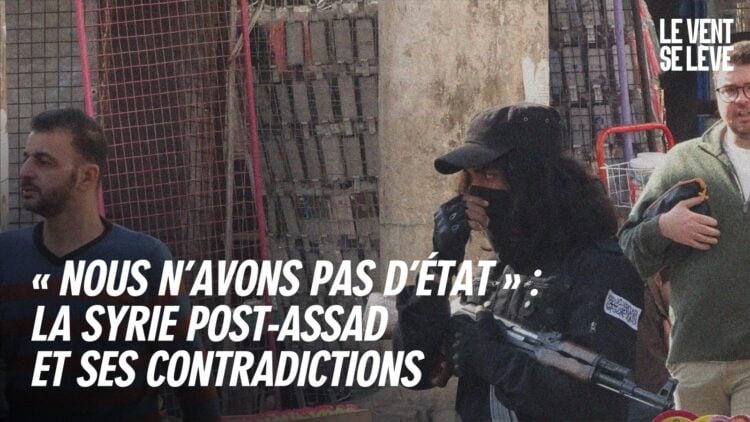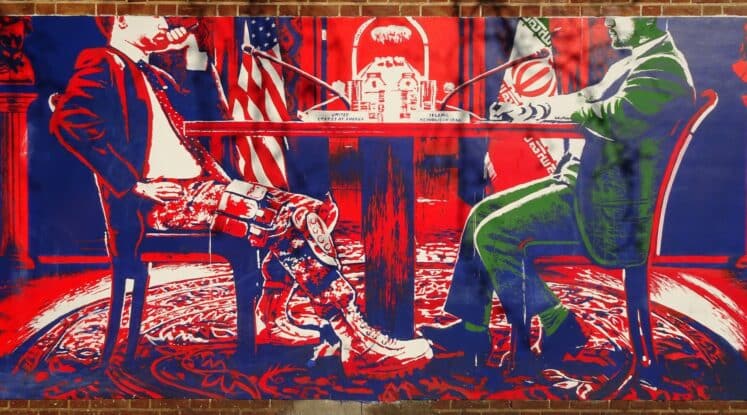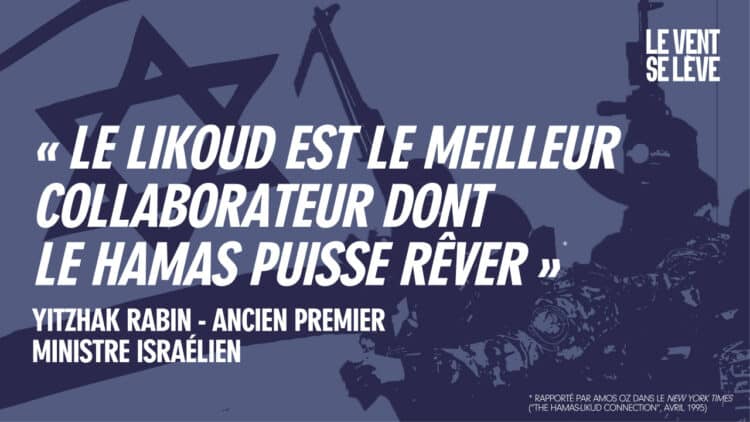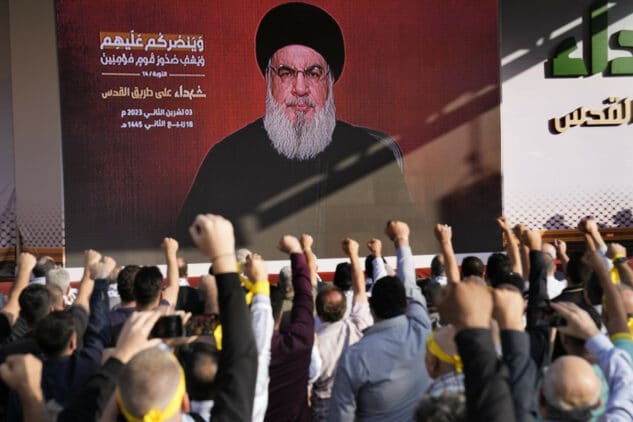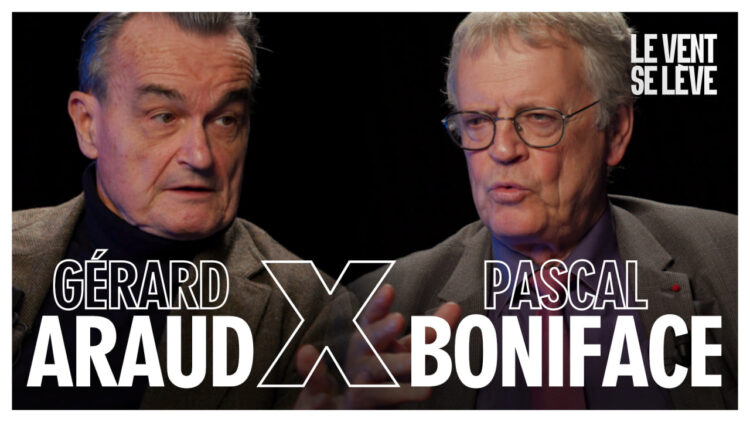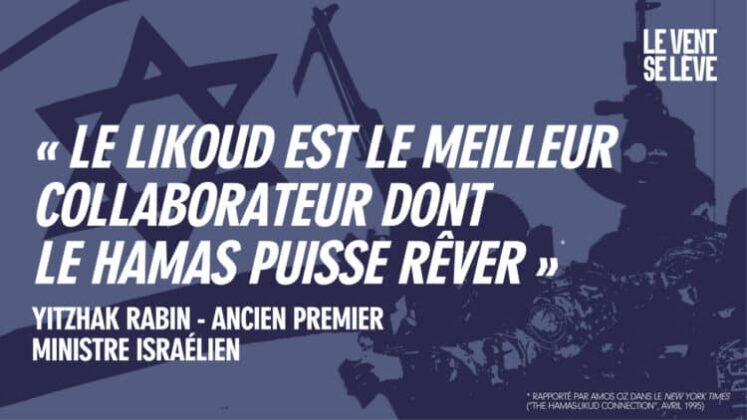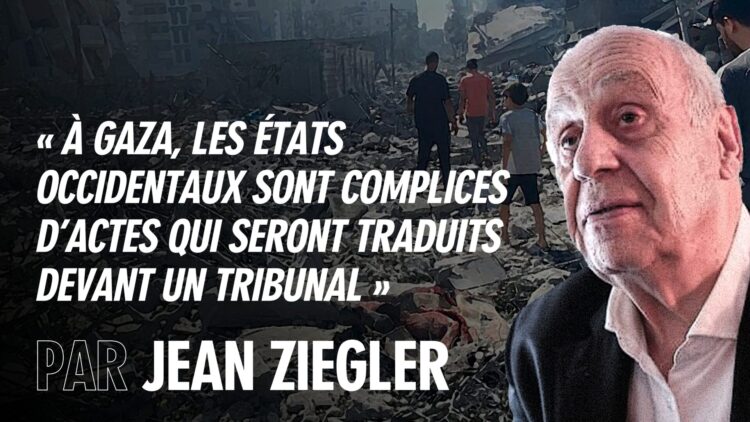Une mortalité infantile supérieure à celle de tous les conflits récents. L’équivalent « d’une classe d’enfants massacrée chaque jour depuis près de deux ans ». 70 kilotonnes de bombes larguées – six fois la bombe de Hiroshima, sur un territoire six fois plus peuplé. Un nombre record de mineurs amputés. Des tueries à un rythme inégalé depuis le génocide des Tutsis de 1994. Le carnage de Gaza aura porté le piétinement de la vie civile à de nouveaux sommets au XXIè siècle. Des crimes dont l’État israélien et son armée (« la plus morale du monde ») cherchent de moins en moins à dissimuler l’ampleur.
Deux mois après le début de la guerre, Jacobin avertissait : ce qui se déroulait à Gaza n’était « pas une guerre terrible de plus, mais une opération d’une autre nature ». La masse de faits, chiffres et témoignages horrifiques qui en émanaient autorisait à la croire. [Jacobin est un média américain partenaire de LVSL NDLR]
Dix-neuf mois ont passé, et il est désormais clair que les crimes de l’armée israélienne feront date dans l’histoire contemporaine.
D’atrocités en atrocités
Les expressions « sans précédent » et « du jamais vu » reviennent sans cesse à propos de Gaza, dans la bouche de médecins, travailleurs humanitaires, experts en droit et autres habitués des pires théâtres de guerre. Les chiffres leur donnent raison.
Trois mois seulement après le début de l’offensive, le taux moyen de mortalité infligé par l’armée israélienne – 250 morts par jour – dépassait celui des grands conflits du siècle ; Ukraine, Irak et Yémen compris. Le suivant sur la liste, la guerre civile syrienne, pourtant particulièrement sanglante, affichait un taux inférieur de moitié (96,5 morts par jour). Pour retrouver un conflit dont les cent premiers jours furent aussi meurtriers que ceux de Gaza, il faut remonter jusqu’au génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda – les autres guerres ne s’en approchent même pas.
Depuis, le rythme des morts a « ralenti », mais uniquement parce que la destruction méthodique des hôpitaux par Israël rend plus difficile le comptage des victimes. En se fondant sur le chiffre officiel du 30 juillet – plus de 60 000 morts, sans doute très en-dessous de la réalité – on obtient encore un taux de 91 Palestiniens tués par jour, supérieur à celui de tous les autres conflits récents, Syrie exceptée. Comme le relevait le journaliste Peter Beinart, c’est aussi davantage de Palestiniens tués chaque jour que lors de certains des massacres les plus célèbres de l’histoire, qui avaient pourtant bouleversé l’opinion mondiale et provoqué des virages politiques : celui de Sharpeville en Afrique du Sud (69 morts) ou le Bloody Sunday en Irlande (26 morts).
Plus encore que le nombre total de morts, c’est l’identité des victimes qui frappe. Après un an, 902 lignées familiales avaient totalement disparu du registre civil de Gaza : aucun survivant, et autant de noms effacés à jamais. Près de 3 500 familles ne comptaient plus que deux membres, 1 364 un seul. Dans certains cas de figure, trois ou quatre générations d’une même famille ont été anéanties d’un seul bombardement. Un tel phénomène est familier des conflits précédents, mais n’a jamais atteint une telle échelle au XXIè siècle.
Gaza détient le record mondial du nombre d’amputés parmi les mineurs, rapporté à la population. En raison du blocus israélien, nombre de ces opérations ont été effectuées sans anesthésie.
Israël a tué une proportion exceptionnellement élevée de civils. En septembre 2024, alors que le bilan était bien plus bas qu’aujourd’hui, plus de femmes et d’enfants avaient déjà été tués que dans la période équivalente pour tout autre conflit des vingt dernières années. Même en adoptant l’estimation la plus basse – en excluant les corps non identifiés et en acceptant l’affirmation délirante d’Israël selon laquelle 20 000 combattants du Hamas auraient péri – les femmes, enfants, personnes âgées et hommes non affiliés au Hamas représentent encore 64 % du total. Cette proportion, largement sous-évaluée, place déjà Gaza au-dessus de la plupart des conflits les plus meurtriers des soixante-dix dernières années, Vietnam, guerres yougoslaves, Syrie et Yémen compris – et bien au-dessus de la moyenne de 50 % observée en moyenne au XXe siècle.
[Que 20 000 combattants du Hamas aient péri sous les bombes israéliennes, comme l’affirme Tel-Aviv, impliquerait que la quasi-totalité des hommes tués par Tsahal appartiennent à l’organisation. De multiples preuves et indices permettent de contrecarrer cette assertion invraisemblable, mais la plus probante réside peut-être dans les programmes israéliens d’intelligence artificielle utilisés durant les premiers mois après le 7 octobre 2023 : ils permettaient aux drones de tuer 100 civils pour un combattant du Hamas, et 300 civils pour un cadre du Hamas, ainsi que le rapportait LVSL à partir d’une enquête du média indépendant israélien +972Mag NDLR].
La violence subie par les enfants dépasse l’entendement. Quatre mois après le début des hostilités, Gaza affichait le pire taux de mortalité infantile de tous les conflits récents : dix fois celui de la Syrie, quarante-cinq fois celui du Yémen. Au 30 juillet, on comptait un enfant tué chaque heure. Comme le résumait la directrice exécutive de l’UNICEF, cela équivaut à « une classe entière d’enfants tuée chaque jour depuis près de deux ans » – une classe dans laquelle on trouverait des nourrissons et des enfants de moins de deux ans. Lorsque le ministère gazaoui de la Santé a publié en juin la liste complète des victimes, classées de la plus jeune à la plus âgée, il a fallu onze pages et 486 noms avant de trouver un enfant âgé de plus de six mois.
Trois mois après le début de la guerre, plus de dix enfants par jour perdaient une ou deux jambes. Gaza détient désormais le triste record mondial du nombre d’amputés parmi les mineurs, rapporté à la population. En raison du blocus israélien, nombre de ces opérations ont été effectuées sans anesthésie. Certains de ces enfants figurent parmi les plus de 17 000 orphelins produits par la guerre. Une nouvelle expression a dû être inventée pour décrire cette réalité devenue courante : « « enfant blessé, sans famille » (Wounded Child, No Surviving Family – WCNSF). Des médecins étrangers rapportent que certains de ces enfants, mutilés à vie et sans personne pour s’occuper d’eux, demandent à mourir.
Des preuves attestent que des enfants ont été délibérément pris pour cibles. Depuis plus d’un an, de nombreux soignants témoignent avoir traité des enfants touchés volontairement à la tête, au cou, à la poitrine ou aux organes génitaux – comme si des soldats israéliens les utilisaient pour « s’entraîner au tir ». D’autres fois, de jeunes garçons ont servi de boucliers humains à Tsahal. Des centaines d’enfants de Gaza ont été arrêtés et emprisonnés en Israël, où beaucoup ont subi des actes de torture. Les adultes ne sont pas épargnés : des dizaines de détenus sont morts sous la torture, qui inclut électrocutions, attaques de chiens et violences sexuelles si extrêmes qu’elles ont nécessité des hospitalisations.
Aujourd’hui, alors que la totalité de la population gazaouie vit dans une insécurité alimentaire aiguë, le nombre de morts, notamment d’enfants, va encore s’envoler. Un expert de la famine estime que celle qui sévit désormais à Gaza est « la plus minutieusement conçue et exécutée depuis la Seconde Guerre mondiale ». Officiellement, elle a déjà causé des dizaines de victimes – mais ces chiffres représentent sans doute à peine 10 % du total.
La destruction de biens culturels par les talibans ou l’État islamique fut un argument central pour en faire des menaces mondiales. Pareille action revendiquée par Israël n’a provoqué aucune réaction en Occident.
Des milliers d’enfants ont déjà dépassé le point de non-retour : ils mourront ou resteront handicapés à vie dans les semaines et mois à venir. Le directeur des opérations d’urgence du Programme alimentaire mondial (PAM) parle d’une situation « sans équivalent au XXIe siècle », comparable seulement à des famines du siècle dernier. C’est un nouveau sommet dans l’accumulation d’actes de cruauté qui caractérise cette guerre, tandis que l’armée israélienne continue chaque jour de massacrer des Palestiniens par dizaines, à coups de bombes et de balles.
Dévastation physique sans équivalent
Ce qui distingue Gaza, ce n’est pas seulement le massacre massif de sa population, mais l’ampleur de la destruction matérielle : une campagne systématique, d’une envergure inédite, visant chaque structure et institution rendant possible la vie organisée dans l’enclave.
En février 2025, 92 % des habitations avaient été endommagées ou détruites, les deux tiers du parc immobilier anéantis. Selon l’ONU, un tel niveau de destruction, « sans précédent » depuis la Seconde Guerre mondiale, ne pourrait être réparé avant 2040 si la guerre s’arrêtait immédiatement – et cet avertissement date déjà de quatorze mois.
Dès le premier mois, le blocus israélien privant Gaza d’électricité et de carburant a conduit à l’arrêt complet des cinq stations d’épuration et de la plupart des postes de pompage des eaux usées. Les déversements non traités ont contaminé les eaux côtières, les sols et les nappes phréatiques. Après un an, 70 % des installations de traitement de l’eau et de l’assainissement étaient hors d’usage. En juin dernier, à peine 49 % des unités de production d’eau potable fonctionnaient encore.
La dévastation écologique inclut, en avril 2025, la destruction de 83 % des terres cultivées, l’abattage de 95 % du cheptel bovin et d’environ deux cinquièmes des moutons et des chèvres. Le nord de Gaza, autrefois couvert aux deux tiers de terres agricoles, est devenu un désert. À cela s’ajoutent le bombardement de l’unique moulin à blé, la fermeture de toutes les boulangeries, la destruction de 72 % de la flotte de pêche et l’arrêt total du secteur halieutique. Gaza a perdu toute capacité à se nourrir seule – aujourd’hui et pour longtemps.
Ce désastre a eu pour effet pervers de rendre la population presque entièrement dépendante de l’aide humanitaire – aide qu’Israël a transformée, selon un ancien béret vert américain, en « piège mortel », où une moyenne de vingt-quatre Palestiniens meurent chaque jour, pris pour cibles alors qu’ils attendent de recevoir de la nourriture.
Plus de la moitié des sites du patrimoine culturel et un tiers des mosquées ont été endommagés ou détruits, certaines estimations avançant des chiffres bien plus élevés. Parmi eux, les deux plus anciens bâtiments de la bande de Gaza : la Grande mosquée al-Omari, lieu sacré pluriséculaire presque entièrement rasé par un bombardement aérien, et le hammam samaritain, bâti par une communauté antique se réclamant des tribus bibliques d’Israël, démoli à coups de bombes et de bulldozers. La destruction de biens culturels par les talibans ou l’État islamique fut un argument central pour en faire des menaces mondiales, tandis que l’anéantissement de la culture juive par les nazis est reconnu comme une composante clé de leur entreprise d’extermination.
Selon les estimations les plus basses, Israël a largué depuis le début de la guerre plus de 70 000 tonnes de bombes sur Gaza – l’équivalent d’environ six bombes d’Hiroshima
L’attaque contre le secteur de la santé a été particulièrement intense : au moins 94 % des hôpitaux ont été touchés, le dernier établissement pleinement fonctionnel ayant été partiellement détruit en avril dernier. Près de la moitié ne fonctionnent plus. Ce niveau de destruction est comparable aux neuf années de guerre au Yémen (50 % d’hôpitaux hors service) et dépasse largement les chiffres de la Syrie (37 %), de l’Ukraine (37,5 %) ou de l’Irak en 2003 (7 % partiellement détruits).
Comme les écoles ou les sites religieux, les hôpitaux sont protégés en temps de guerre. Les attaques qui les visent sont considérées comme si inacceptables que, lorsqu’en 2015 l’administration Obama avait bombardé par erreur un hôpital afghan, le Pentagone a désespérément cherché une justification, trois enquêtes ont été ouvertes, le président a présenté des excuses publiques et seize personnes ont été sanctionnées. Le scandale a été mondial.
L’État d’Israël, lui, a assumé et justifié ses centaines d’attaques délibérées contre des hôpitaux, écoles et lieux de culte.
Les personnels de santé sont également protégés. Pourtant, en deux mois, Israël avait déjà tué plus de soignants à Gaza que dans l’ensemble des conflits mondiaux survenus en une année depuis 2016. Ce chiffre n’a cessé de croître. Même dans les estimations les plus basses, les 557 soignants tués entre le 7 octobre 2023 et le 30 juillet 2025 représentent un peu plus du tiers du total mondial des victimes dans ce corps de métier pendant les huit années précédant la guerre. À cela s’ajoutent des centaines de soignants enlevés par l’armée israélienne, certains torturés à mort.
À la veille du premier anniversaire de la guerre, Israël bombardait en moyenne un centre ou un entrepôt de distribution d’aide tous les quinze jours, une école ou un hôpital tous les quatre jours, un abri temporaire toutes les dix-sept heures, et une habitation toutes les quatre heures. Résultat : une série de records funestes – le plus grand nombre de soignants tués en au moins une décennie, le plus grand nombre de personnels de l’ONU tués, la guerre la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires, et la plus meurtrière pour les journalistes, avec plus de reporters tués que dans les sept dernières grandes guerres impliquant les États-Unis réunies, y compris les deux guerres mondiales et la guerre de Sécession.
Bombardements industriels
Une grande part de cette dévastation tient à une campagne de bombardements d’une intensité et d’une indiscrimination rares.
Selon les estimations les plus basses, Israël a largué depuis le début de la guerre plus de 70 000 tonnes de bombes sur Gaza – l’équivalent d’environ six bombes d’Hiroshima, sur un territoire deux fois plus petit que la ville japonaise mais six fois plus peuplé. Les trois premiers mois furent les plus destructeurs : 25 000 tonnes d’explosifs, soit l’équivalent de deux Hiroshimas, avaient déjà été larguées en février 2024.
En six semaines à peine, le nord de Gaza a subi un niveau de destruction comparable à celui des villes allemandes de Dresde, Hambourg ou Cologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Au troisième mois, Israël avait rasé 33 % des bâtiments de Gaza – un taux trois fois supérieur à celui infligé par les Alliés aux zones urbaines allemandes en trois ans. Robert Pape, historien militaire américain spécialiste de la puissance aérienne, a qualifié Gaza à ce stade de « l’une des campagnes de punition contre les civils les plus intenses de l’histoire », figurant « dans le quart supérieur des bombardements les plus dévastateurs jamais menés ».
Des chercheurs ont relevé que, dès cette période initiale, la destruction dépassait celle d’Alep, de Marioupol, de Mossoul ou de Grozny – cette dernière ayant été qualifiée par l’ONU de « ville la plus détruite au monde ». En décembre 2023, un spécialiste de la cartographie des destructions en temps de guerre soulignait que « rien n’égale ce rythme en si peu de temps ». Après dix-huit mois, Paul Rogers, professeur émérite et auteur de nombreux ouvrages sur la guerre moderne, estimait que le nivellement de Gaza était « sans précédent dans l’ère post-Seconde Guerre mondiale », comparable seulement à l’incendie de Tokyo en 1945.
Des bombes israéliennes de 900 kilogrammes, capables de tuer dans un rayon de 300 mètres, ont été larguées sur des zones dites « sûres », un marché bondé, un camp de réfugiés
Les chiffres illustrent cette intensité : en trois mois, Israël a largué bien plus de bombes que les Alliés lors de l’incendie de Hambourg (9 000 tonnes) ou du bombardement de Dresde (3 900 tonnes), que le musée américain de la Seconde Guerre mondiale qualifie d’« apocalyptique ». C’est aussi davantage que les 18 300 tonnes larguées par les nazis sur Londres pendant huit mois de Blitz.
En moins de deux mois, Israël a mené 22 000 frappes aériennes – un chiffre 60 % supérieur au n nombre de bombes de la coalition dirigée par les États-Unis contre Daech en Irak en plus de quatre ans, sur un territoire mille fois plus vaste. Ce chiffre dépassait aussi celui des frappes en Syrie durant la même période, alors que le pays est cinq cents fois plus grand que Gaza. L’opération américaine Inherent Resolve avait pourtant été décrite comme une « guerre d’anéantissement ».
En cinq jours seulement, Israël annonçait avoir largué 6 000 bombes sur Gaza. À titre de comparaison, le maximum annuel de bombes larguées par les États-Unis sur l’Afghanistan était d’un peu plus de 7 000 – un total également proche de celui de l’OTAN sur la Libye en huit mois, en 2011. Entre 2013 et 2018, jamais les États-Unis n’ont dépassé 4 400 bombes par an sur l’Afghanistan, pourtant 1 800 fois plus grand que Gaza.
Deux mois après le début de la guerre, Israël avait déjà utilisé 29 000 munitions, un chiffre « nettement supérieur à tout autre conflit des vingt dernières années », selon le directeur d’Airwars. La seule comparaison possible est la campagne de « choc et effroi » de 2003 en Irak, sur un territoire bien plus vaste. Ce total dépassait aussi celui des bombes larguées par les États-Unis dans le monde entier en 2016, et même le chiffre « inédit » atteint par Donald Trump au cours de ses six premiers mois à la Maison-Blanche.
Avec près de 500 bombes par jour, ce rythme surclasse de loin la moyenne américaine de 46 bombes quotidiennes sur tous les théâtres de guerre depuis vingt ans, et dépasse l’intensité des bombardements russes sur l’Ukraine en 2024, dont la plupart ont été interceptés par des systèmes de défense – absents à Gaza.
À cette létalité s’ajoute le recours massif aux munitions les plus destructrices et les moins précises. Entre 40 et 45 % des frappes des deux premiers mois ont utilisé des bombes non guidées, un taux « choquant » pour un expert du Pentagone.
Alors que les États-Unis privilégient généralement des bombes de 200 kilogrammes depuis le Vietnam, 90 % des munitions israéliennes durant les deux premières semaines de la guerre pesaient entre 450 et 900 kilogrammes. Ces dernières, capables de tuer ou blesser dans un rayon de 300 mètres et de creuser d’énormes cratères, ont été larguées sur des zones dites « sûres », un marché bondé, un camp de réfugiés, des immeubles résidentiels et à proximité d’hôpitaux.
Quand les mots manquent
À un certain stade, il importe peu de savoir si les responsables israéliens agissent intentionnellement (même si cela ne fait aucun doute) ou si cette guerre relève du génocide (ce qui est tout aussi incontestable). Un simple survol des faits suffit à le comprendre : quelle que soit la dénomination retenue, ce qu’Israël inflige à Gaza atteint des sommets de cruauté.
Dans l’histoire contemporaine, d’autres guerres ont fait davantage de morts ou proportionnellement plus de victimes civiles. D’autres pays ont subi un volume d’explosifs plus important. D’autres gouvernements ont tué davantage d’enfants et les ont torturés avec sadisme. D’autres nations ont été tout autant anéanties physiquement et ravagées sur le plan environnemental. Dans d’autres conflits, des travailleurs humanitaires et du personnel médical ont été tués, des hôpitaux détruits. Et il y a eu ailleurs des famines délibérément provoquées.
Ce qui distingue Gaza, ce n’est pas seulement de cumuler toutes ces caractéristiques ; c’est d’atteindre, dans chacun de ces domaines, des degrés parmi les pires observés depuis des décennies. C’est pourquoi tant de personnes qui ont passé leur vie à vivre, combattre, observer, mener des actions humanitaires ou étudier des conflits affirment avec constance n’avoir jamais rien vu d’aussi atroce que ce qui se déroule à Gaza.
Ce que nous avons vu, ce que nous continuons de voir, c’est l’effacement pur et simple d’une société de deux millions d’êtres humains. Chaque aspect de la civilisation moderne – jusqu’aux plus élémentaires – a été méthodiquement détruite par l’armée israélienne à Gaza. Et nous assistons désormais à la lente, mais de plus en plus rapide, disparition de ses habitants – par la faim, par la maladie et par le meurtre.
Cet article a été originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « Israel’s Gaza War Is One of History’s Worst Crimes Ever ».