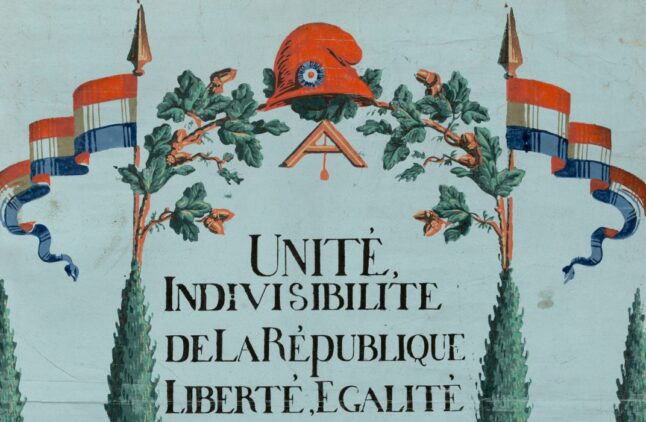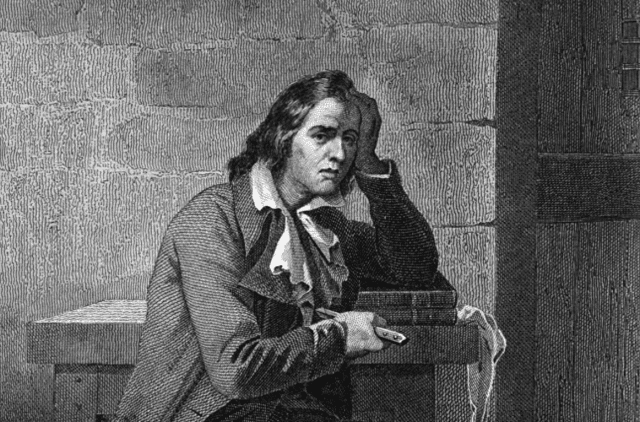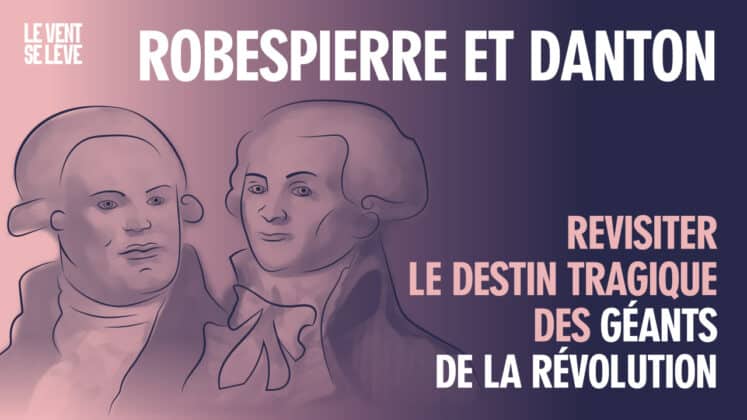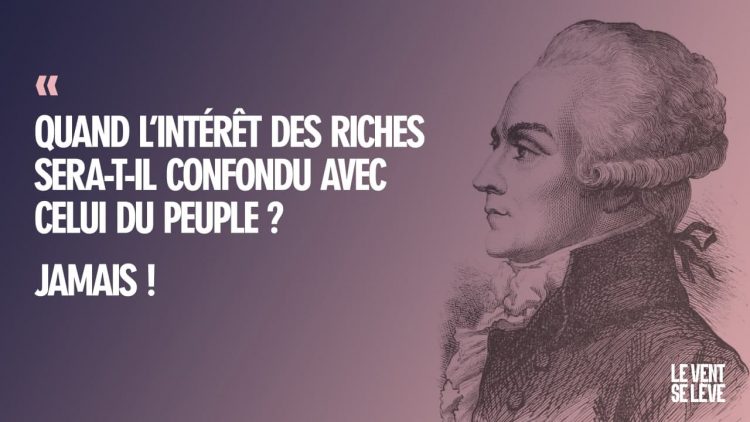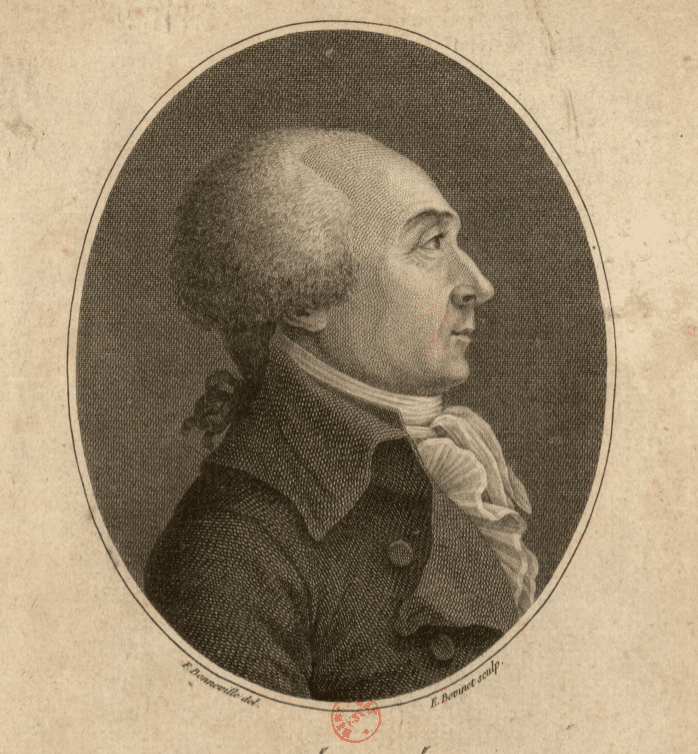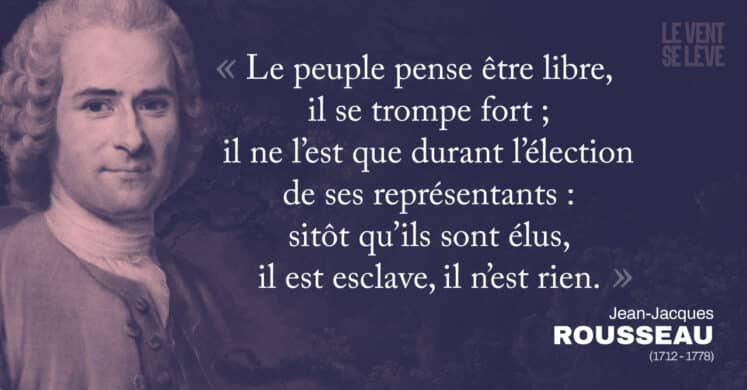« Cet air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre : ma France ». La célèbre chanson de Jean Ferrat tentait, à la fin des années 1960, de faire rimer l’amour de son pays avec la défense de la fraternité et du progrès humains. La tâche n’était pas aisée, après deux décennies de décolonisation. Le poète s’y est pourtant illustré en célébrant pêle-mêle l’écrivain Victor Hugo, le poète Paul Eluard, l’héroïsme des travailleurs ou les réformes du Front Populaire. Sur un air de défi, il ajouta dans ce Panthéon progressiste le nom de Robespierre et le souvenir des jacobins, conscient de l’odeur de soufre qui les accompagnait. De ce point de vue, la situation n’a pas beaucoup changé, ce qui explique le choix des historiens Côme Simien et Guillaume Roubaud-Quashie d’intituler leur ouvrage : Haro sur les jacobins (PUF, 2025). Les deux spécialistes se proposent ainsi d’étudier les tribulations de ce « mythe politique français » sur plus de deux siècles.
« On peut uniformiser le langage d’une grande nation de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise […] est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté ». Prononcé au sein de la Convention en juin 1794 par le député Henri Grégoire, ce discours s’inscrit dans un moment où la jeune République respire enfin.
Au prix de dizaines de milliers de morts, les « Bleus » ont difficilement repoussé les ennemis qui menaçaient d’éteindre la flamme révolutionnaire. Plus que jamais soucieux d’installer la République dans les têtes et dans les cœurs, l’abbé Grégoire ambitionnait d’universaliser l’usage de la langue française sur tout le territoire mais aussi du même coup, « d’anéantir les patois », c’est-à-dire les langues « régionales».
Ce rapport mérite d’être cité car il incarne les deux traits principalement associés aux jacobins jusqu’à nos jours : le centralisme et l’uniformisation culturelle. Déroulant ce fil, les détracteurs du jacobinisme ont assimilé ce dernier à un autoritarisme lointain, surplombant des « territoires » périphériques ignorés et des habitants méprisés. À l’origine, les jacobins étaient pourtant tout l’inverse. Fers de lance de la Révolution, ils étaient à l’avant-garde du combat démocratique, à la fois contre le despotisme d’Ancien Régime et la volonté de la grande bourgeoisie de se réserver les bénéfices politiques de la Révolution.
Comment expliquer que leur image fut à ce point transformée depuis ? Côme Simien et Guillaume Roubaud-Quashie reviennent en détail sur ce détournement. De cette façon, ils nous font toucher du doigt la promesse inédite de la République jacobine : celle de faire entrer une nation toute entière en politique1.
Les jacobins, diapason de la Révolution
Dans leur ouvrage, les deux spécialistes commencent par rappeler que, durant la période révolutionnaire, le nom de « jacobin » fut celui d’un club politique. Les auteurs insistent sur le caractère inédit de cette forme de sociabilité politique en France, et présentent les origines, à la fois britanniques et américaines de cette « histoire atlantique ». Ils nous apprennent notamment que le club s’est constitué durant l’automne 1789, en miroir à la London Revolution Society.
Les auteurs démontrent que les jacobins de l’an II tirent leur force de la diversité de ce que l’on appellerait aujourd’hui leur maillage territorial
Cette dernière, fondée en 1788 pour célébrer le centenaire de la Glorieuse Révolution et défendre une libéralisation de la monarchie britannique, attira l’attention des élites françaises « éclairées », tant pour le fond de ses combats que pour la forme de son organisation. En effet, il ne s’agissait plus seulement de débattre de grands sujets métaphysiques ou auxiliaires dans des cercles très restreints, comme ceux des premières loges maçonniques ou des clubs de lecture, mais de mettre en question l’organisation politique de la société elle-même.
Ces nouvelles sociétés se révélèrent les seules aptes à structurer l’entrée en politique de la bourgeoisie, bien décidée à disputer à l’aristocratie et au haut clergé la gestion des affaires publiques. L’ouvrage dresse ensuite la généalogie de la Société des Amis de la Constitution, le nom officiel du Club des Jacobins. Cette chronologie proposée par les auteurs présente deux atouts. Premièrement, celui de mettre le club en perspective avec les autres sociétés qui fleurirent sous la Révolution. Ensuite, celui de montrer que « jacobin » ne fut pas synonyme de « conventionnel » ou même de « montagnard ». En effet, la Convention fut inaugurée trois ans après la création du club et ses membres furent loin d’avoir tous été des sociétaires.
À l’image de la Révolution, le Club des Jacobins connut une évolution politique considérable au cours de ses cinq années d’existence. L’ouvrage y revient en détail et montre que, dès la « préhistoire » du club au printemps 1789, on y retrouva l’intransigeance qui fit son pouvoir, à la fois d’attraction et de répulsion. Dès ce moment, le club déchaîna les passions en raison de « la force de ses attaques contre la noblesse et [de] la vigueur de son rejet des privilèges ».
Clin d’œil de l’histoire, ce Club des Jacobins fut d’abord un « Club Breton ». En effet, il a été fondé par les députés du tiers-état originaires de cette province, où les nobles étaient particulièrement nombreux et réactionnaires, ce qui explique la détermination de leurs adversaires.
Démocratisation de la Révolution en 1793
Bien sûr, les jacobins furent ensuite concurrencés. D’un côté, par des sociétés plus radicales qui portèrent très tôt les revendications des sans-culottes – comme le Club des Cordeliers (fondé au printemps 1790) ; de l’autre côté, par des clubs plus modérés qui tentèrent de sauver le nouvel ordre constitutionnel de la monarchie – comme le Club des Feuillants (créé durant l’été 1791). Pour autant, les jacobins ne perdirent jamais leur attrait aux yeux des révolutionnaires de toute la France, comme le montre les très nombreuses affiliations de sociétés provinciales au club parisien.
Comment l’expliquer ? D’abord par le jusqu’au-boutisme de la noblesse et du clergé qui donna raison à l’intransigeance des jacobins. Par la suite, le déroulement des évènements, depuis la trahison du roi jusqu’aux défaites militaires des girondins (fin 1792-début 1793), convainquit la plupart des « patriotes » que le radicalisme jacobin était approprié à cette situation d’urgence inédite. Les auteurs rappellent ainsi que, durant la crise de l’été 1791 entre feuillants et jacobins, ces derniers remportèrent l’adhésion de beaucoup plus de sociétés provinciales que leurs adversaires. Les affiliations de nouvelles sociétés aux jacobins augmentèrent encore largement en 1793.
Au sujet de cette période de l’an II (fin 1793-fin 1794), l’ouvrage permet de déconstruire, non seulement les préjugés qui pèsent sur le Club des Jacobins mais aussi sur toute la période dite de « Terreur ». Certes, les auteurs reconnaissent que les lieux classiques de la sociabilité politique au siècle des Lumières – les académies et les loges maçonniques – firent alors l’objet d’une répression croissante. Néanmoins, ils montrent que l’an II fut aussi celui d’une activité politique intense avec l’éclosion d’une myriade de sociétés politiques autoproclamées « jacobines ».
L’étude fournit les données de cette poussée démocratique en soulignant qu’elle impliqua alors, des « classes moyennes inférieures » (artisans et paysans) qui étaient demeurées plutôt en retrait de l’activité publique jusque-là. Cette démocratisation s’accompagna d’une décentralisation, au sens où ces sociétés se créèrent souvent de façon spontanée, en dépassant les bastions urbains du jacobinisme pour fleurir dans des bourgs plus modestes (voire très modestes comme celui de Charroux dans l’Allier qui comptait alors 1 400 habitants et une société jacobine).
On observe néanmoins de très fortes disparités régionales. Chiffres à l’appui, les auteurs démontrent que le jacobinisme était très implanté dans le Midi provençal, le Dauphiné, le sud-ouest et dans la zone qui court du bassin parisien jusqu’à l’Artois. À l’inverse, il fut quasi-absent dans l’ouest, dans les hautes terres du Massif central et dans le nord-est. Prolongeant cette analyse, on peut remarquer une certaine continuité de cette partition territoriale sur plus de deux siècles. C’est ce que tendent à montrer par exemple, les résultats de l’élection présidentielle de 1981. Une autre carte, celle de la pratique catholique des adultes établie en 1946 par le chanoine Boulard recoupe assez largement ces tableaux et en éclaire le soubassement religieux2.
Le mythe de la centralisation jacobine
Autre idée reçue battue en brèche par l’étude : celle d’une opposition schématique entre des jacobins centralisateurs et des « girondins » – républicains eux aussi et pour beaucoup membres du club jusqu’à la fin de l’année 1792 – partisans précoces de la décentralisation. Pour Côme Simien et Guillaume Roubaud-Quashie, il n’en fut rien. Les auteurs nous défient de pouvoir identifier une pensée cohérente de l’organisation territoriale chez les uns ou chez les autres. Ils s’amusent à prendre notre mémoire à revers en insistant d’un côté, sur la volonté de Robespierre et de Saint-Just de « confier un rôle essentiel aux communes dans l’animation de la vie démocratique » ; de l’autre, sur la défense par les girondins d’une subordination stricte des agents territoriaux à l’État central.
Ce contre-pied est bienvenu car il déconstruit l’assimilation du « jacobinisme » au « parisianisme » et à la ploutocratie. Les auteurs démontrent qu’au contraire, les jacobins de l’an II tirèrent leur force de la densité et de la diversité de ce qu’on appellerait aujourd’hui leur maillage territorial. Cette réussite n’est pas fortuite. Elle s’explique par la volonté de la petite bourgeoisie jacobine d’impliquer des pans entiers du pays dans la Révolution et pour ce faire, de s’intéresser à la question de l’égalité sociale.
Le jacobinisme a été attaqué au moyen de son association avec une révolution postérieure, celle d’octobre 1917 en Russie
Cette association entre jacobinisme et « centralisation féroce » naît avec la légende noire forgée après le renversement de Robespierre et de ses partisans. De la même manière que les thermidoriens3 inventèrent l’existence d’un « système de terreur », ils créèrent de toutes pièces le mythe d’une centralisation à outrance de l’administration, qui aurait été réalisée par Robespierre pour régner en despote. Les travaux de Jean-Clément Martin ont déjà fait un sort à cette idée. Ils ont notamment démontré la grande difficulté pour la Convention de contrôler – non seulement le territoire français dont des pans entiers étaient insurgés contre elle, voire occupés par des troupes étrangères – mais aussi ses propres troupes et agents, munis de consignes floues qui les rendaient relativement autonomes sur le terrain.
Pour Simien et Roubaud-Quashie, ce mythe d’une « centralisation totale » jacobine est inauguré par le député Bertrand Barère. Cet ancien montagnard chercha alors des boucs-émissaires pour expliquer la radicalisation de la Révolution, tout en préservant les institutions dont il fut membre avec nombre de ses collègues. Tous ces thermidoriens accusèrent donc Robespierre et le club des jacobins, qui serait devenu sa créature au cours de l’an II.
Aujourd’hui, alors que l’image sombre de la Terreur commence à se modifier sous l’effet du renouvellement historiographique, la persistance de celle du centralisme jacobin interroge. D’autant que, comme les auteurs le soulignent, les régimes succédant à la Convention firent « franchir à la France un palier de centralisation autrement décisif que celui atteint en 1793-1794 ». En la matière, le Premier Empire a même été caricatural.
À partir de 1804, Napoléon Bonaparte désigna seul et sans en rendre aucun compte les ministres, les préfets, les sous-préfets, les maires des communes importantes, les sénateurs, les conseillers d’État et de manière indirecte, les membres du Tribunat et du Corps législatif. Rien de tout cela en l’an II où les comités de Salut Public et de Sûreté Générale étaient contrôlés en permanence par la Convention. À ce sujet, Albert Soboul notait que les robespierristes avaient été simplement renversés par un vote parlementaire, l’équivalent actuel d’une motion de censure4.
Au moyen d’un chapitre entier, Haro sur les Jacobins parvient donc à défaire l’idée que le jacobinisme aurait été une dictature centralisée. En revanche, l’ouvrage délaisse une autre dimension de la légende noire du jacobinisme : celle d’une volonté supposée d’uniformisation culturelle dont l’origine remonterait à la Révolution. Le rapport de l’Etat jacobin à ses périphéries est pourtant un élément d’analyse crucial. En effet, une partie importante des critiques actuellement adressées au jacobinisme visent sa volonté, largement fantasmée, d’écrasement des cultures régionales. La déconstruction de cette image pourrait être un point essentiel des prochaines études qui voudraient réactualiser la pensée et les combats jacobins.
Offensives contre le « jacobino-marxisme »
Au-delà de la question de la centralisation, les auteurs montrent comment le jacobinisme a été attaqué au moyen de son association avec une révolution postérieure – celle d’octobre 1917 en Russie – et le communisme. Si la question de l’héritage de 1793 fit largement débat chez les marxistes, on constate que la droite associa sans ambages les deux révolutions, française et russe, dans un mouvement de rejet commun.
En France, c’est Pierre Gaxotte, membre de l’Action française qui participa à établir cette filiation en prétendant donner ainsi des clefs historiques pour combattre le péril rouge dont il était contemporain. Pour Gaxotte, le communisme « donne son sens à la Terreur, en explique la marche et la durée ». Il n’y a pas qu’en France que l’hostilité à la Révolution cimente la droite la plus dure.
Côté allemand, l’historien Johann Chapoutot a démontré comment les intellectuels nazis furent hantés par la Révolution française, particulièrement son inspiration rousseauiste. En effet, l’idée d’un contrat social était insupportable à des nationalistes convaincus du caractère inéluctable du « darwinisme social », c’est-à-dire de la lutte continuelle des individus et des peuples pour leur survie. En activant un réflexe de défense patriotique, l’occupation allemande de la France entre 1940 et 1944 fit fleurir les références à 1789 et à 1793 dans la Résistance. Ainsi, de nombreux détachements de partisans se nommèrent par exemple « Valmy » ou « Saint-Just », comme le rappellent Simien et Roubaud-Quashie.
Après-guerre, c’est encore l’hostilité au communisme qui nourrit une critique du jacobinisme, venue de la gauche cette fois et inaugurée par François Furet et Denis Richet à partir de 1965. Pour Furet, le péché originel de la Révolution est clairement identifié : « Le jacobinisme, sous la fiction du Peuple, se substitue à la fois à la société civile et à l’État. À travers la volonté générale, le peuple-roi coïncide désormais mythiquement avec le pouvoir ; cette croyance est la matrice du totalitarisme5». Il est difficile de ne pas interpréter la critique du « peuple-roi » comme une mise en garde contre la démocratie. Il en va souvent de même pour les préventions actuelles contre le populisme.
L’époque était alors au triomphe des « antitotalitaires » et à leur critique d’une gauche jacobine dénoncée comme « étatique, nationaliste [et] protectionniste » (Michel Rocard6). On le voit, les jacobins ont pâti de leur association avec deux héritages de la fin du XVIIIe qui n’étaient plus dans l’air du temps : l’État-nation et la souveraineté populaire. Ces principes commençaient alors à être détricotés par une Europe supranationale. Tache aveugle de l’ouvrage : cet élément n’est pas mentionné par les auteurs, mais il est indéniable que l’acceptation de la construction européenne ait facilité la relégation du jacobinisme à gauche.
Ces critiques de gauche furent bientôt dépassées par l’offensive générale des réactionnaires contre la Révolution, prise dans sa totalité. Les flèches les plus dures restèrent néanmoins réservées à 1793. Les auteurs reviennent sur la comparaison, caricaturale mais désormais classique, qui fut alors faite entre la « Terreur » jacobine et les « totalitarismes » du XXe siècle notamment par Philippe de Villiers. Celui-ci obtint ses lettres de noblesse médiatiques en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution. Il fit alors la tournée des micros pour appeler, le premier, à déboulonner les (rares) statures et à débaptiser les rues portant les noms des pères fondateurs jacobins. Est aussi signalée l’invention, par Reynald Sécher, d’un « génocide vendéen » que la République aurait commis contre les populations des départements de l’ouest, embrasés par les soulèvements royalistes.
Ainsi, pour Raphaël Glucksmann, il faudrait « délaisser Jupiter comme Robespierre ».
Face à ce déferlement contre-révolutionnaire, la bataille historiographique s’annonçait rude. L’ouvrage rappelle que certains la menèrent. On les retrouva dans la galaxie communiste avec notamment l’historien Claude Mazauric, ou chez Jean-Pierre Chevènement et Régis Debray, les « derniers jacobins » du Parti Socialiste – qui finirent par le quitter. Dans sa majorité, la gauche resta bien timide pour défendre ses principes hérités. Il faut dire qu’une partie d’entre elle avait porté les premiers coups contre la Révolution. À ce titre, les auteurs rappellent que celui qui mettait en garde les citoyens contre la dangerosité d’une révolution – dont il convenait de « faire l’économie » – n’était autre que le premier ministre Michel Rocard en 1988.
Reprendre le flambeau ?
Malgré le tombereau de critiques dont il fit l’objet, le jacobinisme ne cessa jamais d’être un drapeau brandi par toute une série d’intellectuels, d’artistes, de femmes et d’hommes politiques. Les auteurs montrent ainsi que la référence aux jacobins est restée incontournable pour tous les républicains du XIXe siècle, un tant soit peu attentifs à la question sociale. Le rôle de Philippe Buonarotti – compagnon d’insurrection de Babeuf et théoricien de la Conjuration des Égaux – comme passeur de la mémoire jacobine au tournant des XVIIIe et XIXe siècles est souligné.
Il serait intéressant de revenir sur la lecture que les babouvistes firent de l’expérience révolutionnaire de 1793-1794. Soboul avait étudié les hésitations de Babeuf entre un mouvement populaire de masse (l’option sans-culotte) et une avant-garde révolutionnaire (l’option jacobine), une réflexion qui pourrait être actualisée7. Traversant le XIXe siècle, l’étude de Simien et Roubaud-Quashie s’arrête évidemment sur la Commune de Paris de 1871 et met en lumière l’importance du jacobinisme et du Comité de Salut Public dans la rhétorique des fédérés. Au-delà des discours, une analyse détaillée des traces de 1793 dans les politiques expérimentées par les communards permettrait une comparaison passionnante entre les deux séquences révolutionnaires.
Du côté des marxistes, les auteurs montrent que ceux-ci entretiennent d’abord une certaine défiance avec la Révolution française, même dans sa phase montagnarde. Pour eux, à la fin du XIXe siècle, il s’agissait surtout d’inaugurer une révolution d’un type nouveau qui ne devait plus se concentrer sur le tiers-état mais sur le « quart-état » : le prolétariat ouvrier. Les jacobins purent néanmoins compter sur leur récupération par Jaurès qui, dans son Histoire socialiste de la Révolution française, fit un éloge vibrant du robespierrisme tout en condamnant les girondins et les sans-culottes hébertistes.
Finalement, l’ouvrage nous montre c’est face à la pire adversité que la gauche se rassembla autour des principes de la grande révolution. En effet, la puissance de la contre-révolution fasciste des décennies 1920 et 1930 amena les frères ennemis, socialistes et communistes à faire front commun. Pour mener cette bataille, nombre d’entre eux trouvèrent dans l’expérience jacobine – à laquelle ils donnèrent « une couleur de classe » – une « source d’énergie puissante, résolue et rassembleuse », nécessaire pour contre-attaquer.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Une partie de l’historiographie récente consacrée à la Révolution se félicite que l’analyse de cette période se fasse enfin de manière dépassionnée, comme si ce cycle historique était définitivement clos. Pour autant, la reprise de plusieurs caractéristiques de la Révolution par le mouvement des gilets jaunes de 2018-2019 (l’écriture de cahiers de doléances, la méfiance vis-à-vis des représentants politiques, la révolte contre une taxation injuste) démontre au contraire, que le spectre jacobin peut ressurgir avec une vigueur insoupçonnée. Si la Révolution jacobine ne manque donc pas d’héritiers dans les mouvements sociaux, ni d’adversaires du côté de la bourgeoisie populophobe, elle peine à trouver des défenseurs à l’intérieur des forces progressistes.
Le Parti de Gauche, puis la France Insoumise ont longtemps maintenu allumée la flamme de 1793 avec toute sa galerie de symboles (bonnet phrygien, cocardes, Marseillaise à la fin des meetings) avant de paraître l’atténuer. Les raisons de ce tournant sont multiples. On peut y voir la réduction de cet héritage révolutionnaire à un folklore universaliste, vidé de son sens depuis sa récupération par les conservateurs. Mais aussi déplorer l’abandon d’un socle indispensable pour « fédérer le peuple » au profit d’approches fragmentaires, de l’acceptation de revendications autonomistes – puissantes dans certaines régions comme la Corse ou la Bretagne – à une apologie de la « créolisation » aux implications stratégiques hasardeuses.
Au sein du reste de la gauche, l’abandon du socle national est bien souvent actée. On y considère le cadre européen comme horizon indépassable, tandis que l’on vante les mérites des territoires – soit les collectivités locales – perçus comme des espaces plus propices aux consensus. Les élections départementales et régionales étant particulièrement désertées, on peut avancer que cette prédilection pour l’échelon local fait état de la frilosité démocratique d’une certaine gauche.
Cette dernière se méfie des résurgences jacobines, aussitôt qualifiées de populistes ou d’autoritaires. Ainsi, pour Raphaël Glucksmann, député européen apparenté au groupe socialiste, il faudrait « délaisser Jupiter comme Robespierre ». En 1986, François Furet écrivait que la « Révolution est terminée8». Aurait-il eu raison trop tôt ?
Tout au long de l’ouvrage, Côme Simien et Guillaume Roubaud-Quashie ont pourtant démontré la force du jacobinisme comme point d’appui historique pour toutes celles et ceux qui s’en emparèrent depuis deux siècles. Des inspirations les plus politiques aux récupérations les plus cosmétiques, tous ses héritiers comprirent le moment jacobin comme celui d’une audace politique inédite et d’une énergie inépuisable.
Dans les moments de reflux des forces progressistes comme dans ceux de la reconstruction, l’esprit jacobin est apparu comme celui d’un élan irrésistible, capable d’emporter l’ancien monde. Encore aujourd’hui, il demeure un moyen pour le peuple de « reprend[re] l’histoire » (Guillaume Mazeau)9. Mieux encore, de recréer une intensité politique indispensable pour sortir du « there is no alternative » thatchérien et de la sclérose générale.
Notes :
1 Il faut rappeler que cet universalisme resta alors strictement masculin. La non-extension des droits politiques aux femmes fut une limite majeure de la Révolution, restée infranchissable pour des hommes de la fin du XVIIIe siècle, fussent-ils républicains.
2 Le Monde du 16 novembre 1946 cité par L’Histoire, n° 529, p. 57.
3 Il s’agit du nom que l’on donne aux députés ayant renversé les robespierristes en thermidor an II (fin juillet 1794).
4 Albert Soboul, « V – Problèmes de la dictature révolutionnaire (1789-1796) ». Dictatures et légitimité, PUF, 1982. p.159-173 (Disponible sur Cairn : shs.cairn.info/dictatures-et-legitimite–9782130373445-page-159?lang=fr).
5 François Furet, Penser la Révolution française, cité par Côme Simien et Guillaume Roubaud-Quashie, p. 320.
6 Cité par Simien et Roubaud-Quashie, p. 320.
7 Albert Soboul, art. cit.
8 Cité par Simien et Roubaud-Quashie, p. 323.
9 Guillaume Mazeau, Les « gilets jaunes » et la Révolution française : quand le peuple reprend l’histoire, Agone, 2018