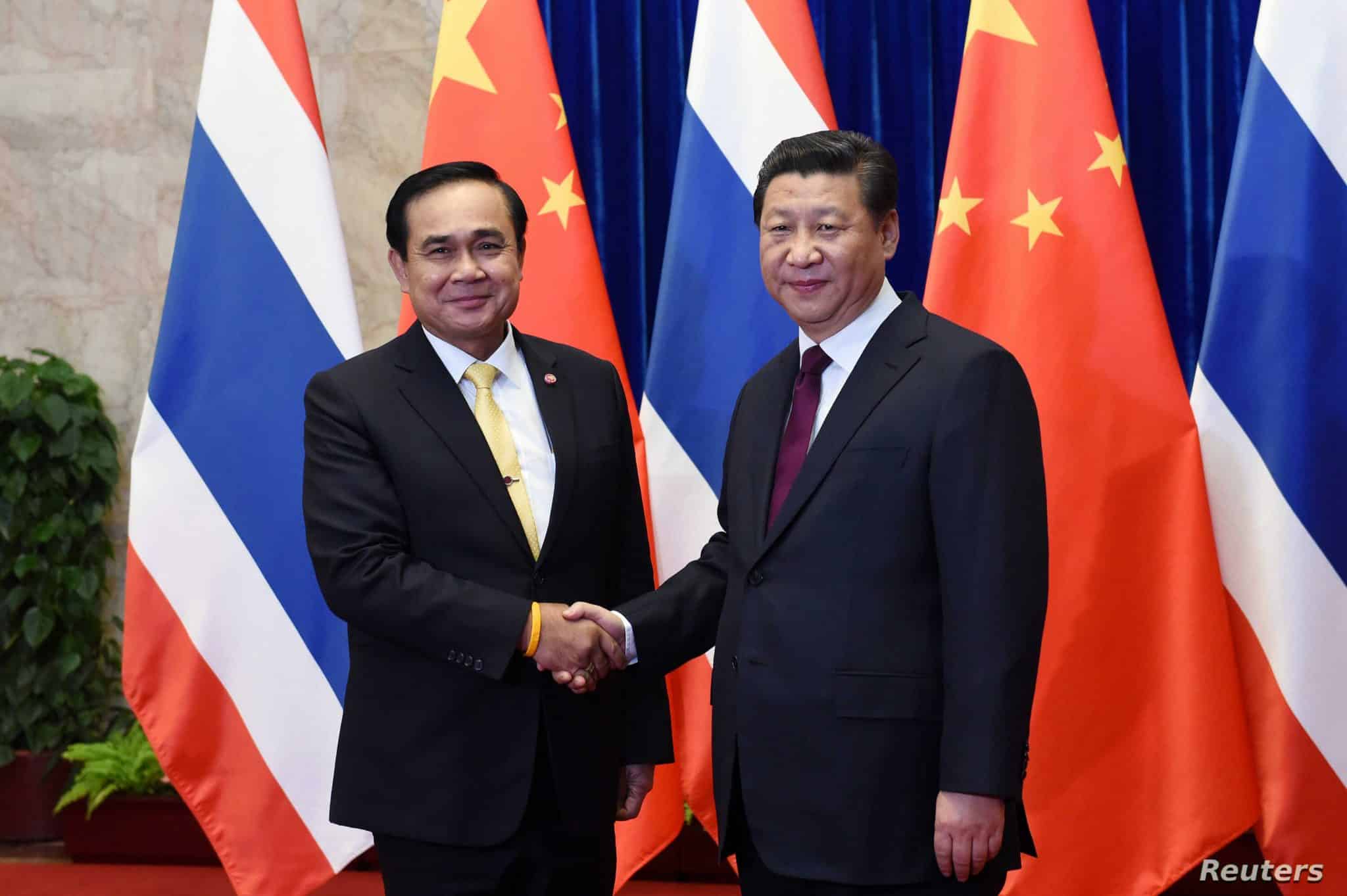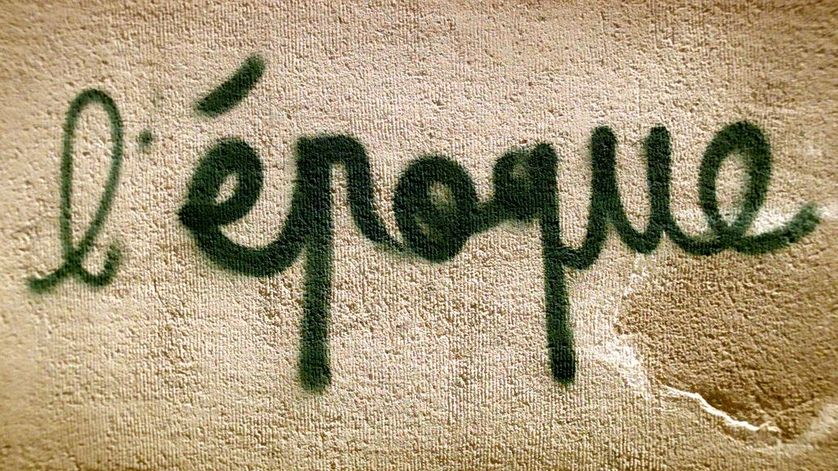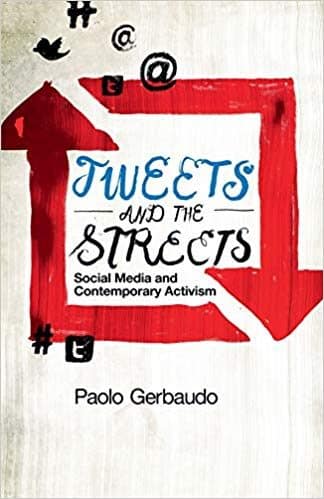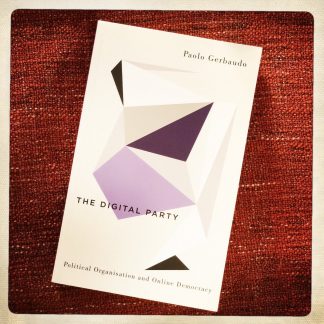Face à la réémergence au XXIe siècle d’une société d’héritiers, dans laquelle l’origine sociale accentue les inégalités de destin et la mobilité sociale se réduit, il est impératif de mettre en œuvre des mécanismes correctifs ambitieux et innovants pour favoriser l’émancipation de chacun de manière équitable. La campagne présidentielle de 2022 a d’ores-et-déjà fait émerger une idée partagée par de nombreux candidats, celle d’un « capital de départ » pour la jeunesse. Retour sur une idée pensée dans le sillage de la Révolution française, et que le prochain quinquennat pourrait enfin expérimenter.
Favoriser l’émancipation de chacun de manière équitable
Dès avant la pandémie de Covid, nous vivions dans une société où un enfant de cadre dispose de 4 à 5 fois plus de chances qu’un enfant d’ouvrier d’appartenir aux 20 % les plus aisés, et où, réciproquement, l’origine sociale est le principal facteur pour expliquer l’appartenance à un ménage pauvre1. Dans le même temps, selon l’Observatoire des inégalités2, à l’heure où la moitié des indigents en France ont moins de 30 ans, le pays souffre d’importants écarts de patrimoine, les 10% les plus fortunés possédant en 2018 près de la moitié (46%) du patrimoine en France, les 40% les moins fortunés, environ 3%. Une minorité besogneuse se tuerait au travail pour se constituer une fortune ? Depuis les années 1980, c’est en réalité l’héritage qui joue un rôle de plus en plus disproportionné dans sa constitution. 80% des milliardaires français ont hérité de leur fortune, l’Hexagone étant en tête des pays dans cette catégorie — loin, bien loin du mythe des self-made men ayant accouché de leur richesse à la sueur de leur front3.
Or, commencer avec plus de patrimoine, ce n’est pas seulement avoir la sérénité de pouvoir mener des études supérieures sans se soucier de leur financement. C’est être davantage, à la faveur de donations, susceptible de créer ou de reprendre une entreprise, ou d’acquérir, via l’héritage comme la donation, un bien immobilier4. C’est aussi avoir plus de chances de réussir son projet de vie. Désormais, sans corrections majeures, ces fractures vont s’accentuer. Le moment est donc venu d’expérimenter un capital de départ pour la jeunesse.
Des « moyens pour commencer dans la vie »
L’idée n’est pas neuve : elle remonte à Thomas Paine (1737-1809), révolutionnaire américain d’origine anglaise s’illustrant aux États-Unis par ses idées puis comme député dans la France post-révolutionnaire, et qui propose de « créer un fonds national, duquel sera payée à chaque personne, parvenue à l’âge de 21 ans, la somme de quinze livres sterling, en compensation partielle, pour la perte de son héritage naturel, par l’introduction du système de propriété foncière »5. Pour lui, chaque individu né dans une société jugée inégalitaire – certains possédant des terres, d’autres non – devait hériter « de moyens pour commencer dans la vie ».
Dans ce texte, Thomas Paine ne s’érige pas en adversaire de la propriété mais veut défendre la cause de ceux qui en ont été privés par le hasard de la naissance. Il y observe en sus que l’émergence de la civilisation a produit une grande indigence et de l’inégalité entre les plus riches et les plus pauvres, et souhaite en corriger les injustices. « Chaque propriétaire, donc, de terre cultivée, doit à la communauté une redevance foncière (car je ne connais pas de meilleur terme pour exprimer l’idée) pour la terre qu’il détient ; et c’est de cette redevance foncière que le fonds proposé dans ce plan doit venir ».
Pour le révolutionnaire, le but poursuivi est d’« indemniser » ceux qui souffrent de la spoliation originelle créée par l’émergence de la propriété privée et qui a, depuis, généré « une sorte de pauvreté et de misère qui n’existait pas auparavant ». Pour compenser cette perte, Paine propose de distribuer 15 livres à tout citoyen majeur, soit de quoi acheter une vache et du matériel pour cultiver quelques acres de terre.
Un capital de départ au XXIe siècle
Au XXIe siècle, un patrimoine universel pourrait devenir la pierre angulaire d’une société dans laquelle ce vice du contrat social – naître nanti ou indigent – est corrigé, dans l’esprit de l’œuvre de John Rawls, grand penseur de l’État-providence, qui présente l’idée de la « justice comme équité »6. Pour Rawls, chaque personne doit avoir un droit égal aux libertés de base les plus étendues possible, mais compatibles avec des libertés similaires pour les autres. Par ailleurs, les inégalités sociales et économiques peuvent être tolérées du moment qu’elles offrent des bénéfices à tous, et particulièrement aux citoyens les plus désavantagés. Enfin, la société se doit de maintenir les charges et les positions, y compris élevées ou prestigieuses, accessibles à tous, dans l’esprit de juste égalité des chances.
Comme expliqué dans un ouvrage consacré au sujet7, un système de patrimoine universel n’empêche personne d’autre de réaliser son projet pendant que j’accomplis le mien avec le patrimoine que je reçois ; en ce sens, la liberté d’autrui et la mienne ne se heurtent en aucune façon, mais celles-ci sont bel et bien augmentées grâce à ce patrimoine, qui permet alors à chacun de réaliser des projets jusque-là plus difficilement atteignables.
Un patrimoine à l’usage balisé présente des avantages pour les plus démunis sous deux formes : directement, au travers du patrimoine lui-même et, indirectement, dans la mesure où il fait naître des citoyens plus instruits (grâce à l’éducation), une économie plus riche (grâce à l’entrepreneuriat) et une propriété plus étendue (via un accès accru à l’immobilier). L’amélioration serait nette pour les plus précaires puisqu’ils auraient plus d’opportunités de réaliser leur potentiel, indépendamment de leur milieu social d’origine.
Enfin, les citoyens ainsi rendus plus autonomes auraient des chances davantage égalisées d’occuper diverses positions et fonctions d’influence : un citoyen plus intelligent, plus prospère ou qui ne craint pas de perdre son toit pourrait dédier plus de temps à la vie publique ou politique, à défendre des causes qu’il juge importantes ou à user de sa liberté d’expression.
50 000 euros à 18 ans pour un master, une entreprise ou un toit
Ainsi, une formule ambitieuse offrirait à tout citoyen atteignant 18 ans 50 000 euros sur six ans, afin de lancer une entreprise, de payer pour les frais d’un master ou d’acquérir un toit. Une agence nationale pourrait aider les adolescents à anticiper l’arrivée de ce patrimoine en les informant quant à son usage.
À titre d’exemple, en 2022, près de 830 000 personnes atteindront la majorité. La première tranche annuelle de ce patrimoine décaissé sur six ans reviendrait alors à près de 7 milliards d’euros, et grimperait au fil des ans, à mesure que d’autres cohortes en bénéficieraient. 42 milliards seraient décaissés annuellement une fois que toutes les cohortes éligibles – près de 5 millions d’individus par an – en bénéficieraient. Des mécanismes de financements existent, et il s’agirait de milliards réinvestis dans l’économie.
Pour l’heure, les tentatives françaises n’ont pas abouti, peut-être par absence d’un large débat au sein de l’opinion. En 2009, une « dotation autonomie » (d’un maximum de 4000 euros) suggérée par Martin Hirsch, qui présidait alors une commission de concertation sur la jeunesse, n’avait pas obtenu l’adhésion de l’Elysée8. Plus tard, en 2016, Etienne Grass, conseiller du président François Hollande, a exploré une possible mise en œuvre9, la « dotation initiale dans la vie active » (d’un montant de 5000 euros), le dirigeant socialiste indiquant alors qu’il pourrait en faire un élément d’un agenda de second mandat.
Les baby bonds dans les pays anglo-saxons
Les travaillistes britanniques ont testé l’idée, Gordon Brown mettant en place des fonds expérimentaux (Child Trust Funds) dans les années 2000. Si la crise de 2008 et les bouleversements politiques y ont mis un terme, plus de 5 millions de Britanniques atteignant la majorité de septembre 2020 jusqu’à janvier 2029 sont éligibles à recevoir leurs parts des 9 milliards de livres de « baby bonds » détenus dans ces comptes ouverts à leurs naissances et abondés par le gouvernement en fonction du niveau de richesse de leurs familles10.
Et si, à la fin des années 1990, le débat est porté en Amérique par l’œuvre phare de Bruce Ackerman et Anne Alstott11 dans laquelle ils proposent une dotation de 80 000 dollars à chaque jeune majeur, somme à rembourser avant le décès afin de continuer à abonder un fonds dédié, il prend un nouveau tournant dans le sillage de la révolution Black Lives Matter, à partir de 2013, et des réflexions majeures qu’elle suscite sur le discours sur les « réparations » que réclament des intellectuels afro-américains face à l’enrichissement réalisé par la société américaine au travers de la mise en place, dès les débuts de la République, de l’esclavage. L’idée gagne du terrain chez les démocrates, et le sénateur Cory Booker a ainsi réintroduit en 2021 une proposition de baby bonds offrant jusqu’à 50 000 dollars à la majorité12.
Un impératif : proposer un montant élevé
Une sémantique diverse (patrimoine universel, aide individuelle, capital de départ, dotation initiale, héritage pour tous) cache une divergence de fond parmi les défenseurs de l’idée : son montant. En résumé, certains l’imaginent plus proche de 5000 euros, d’autres, de 50 000 euros. Pour y voir plus clair, on peut convoquer la pensée de Samuel Moyn, professeur à Yale, qui a renouvelé la réflexion sur la lutte en faveur de l’égalité13. Reprenant l’histoire de cette lutte des Jacobins à nos jours, il en classe les acteurs et mouvements majeurs entre partisans de deux idéaux de justice, de deux impératifs de distribution, à savoir un minimum d’autonomie (sufficiency) ou l’égalité (equality) – entre ceux qui estiment qu’il faut simplement distribuer « assez » pour permettre de dépasser le seuil de pauvreté et ceux jugeant qu’il faut faire davantage pour atteindre l’égalité, voire peut-être établir un plafond des inégalités. Moyn est clair : assez… n’est pas assez : un monde dans lequel des besoins de base sont pris en compte n’empêche pas le maintien d’énormes hiérarchies, et peut même se scinder en deux sociétés, avec des modes de vie différents, « les riches dominant leurs inférieurs économiques »14. C’est au reste un risque qui guette un pays comme la France du XXIe siècle.
Or, de nos jours, 5000 euros ne sont pas « assez ». Que l’on songe à cinq années de master, à l’apport pour une propriété15, au démarrage d’une entreprise : que ferait-on avec un si modeste pécule pour lancer une initiative s’inscrivant dans la durée et devant pouvoir définitivement arracher les individus à leur condition d’origine ? Qui, dans la frange aisée de la population, considérerait que c’est une somme conséquente pour mener un projet majeur sur plusieurs années, et dès lors, pourquoi penser que des personnes accumulant davantage d’obstacles économiques pourraient réussir en se contentant de peu ? À l’inverse, 50 000 euros pour permettre à chaque individu de bien démarrer sa vie, serait-ce si cher payé ? Une somme revue à la hausse, vers la réalisation de l’égalité, est bel et bien un impératif.
Remédier au risque de profondes inégalités en 2030
L’idée revient aujourd’hui en force dans le contexte de l’élection présidentielle de 2022, plusieurs candidats ayant présenté des formules diverses d’un capital de départ. Ainsi, Anne Hidalgo propose une dotation en capital de 5 000 euros qui doit être attribuée à chaque jeune à ses 18 ans « pour lui permettre de financer ses projets professionnels et personnels ». Jean-Luc Mélenchon offre le montant le plus généreux puisqu’il « veut verser aux jeunes de plus de 18 ans et aux lycéens professionnels : 1063 euros par mois pour tous ». Christiane Taubira entend pour sa part « créer la dotation pour l’autonomie des jeunes qui garantira à chacun pendant cinq ans 800€ mensuels », ainsi que jusqu’à 20 000 euros pour un « capital de projet » : une « Agence des Jeunesses de France qui se sera rattachée au ministère de l’enseignement supérieur sera chargée d’étudier la nature des projets présentés ». Et si le programme du probable candidat Emmanuel Macron n’est pas connu, son parti avait esquissé une prise de position sur le sujet, Stanislas Guerini proposant « un « prêt » de 10 000 euros pour chaque jeune de 18 à 25 ans ». La presse indique aujourd’hui que l’équipe de campagne étudie une piste qui se concentrerait uniquement sur les jeunes les plus modestes, et potentiellement avec des contreparties.
Justement : la reproduction sociale risque de s’accentuer d’ici 2030, dans la mesure où les destins des uns et des autres dépendront moins de la trajectoire des revenus individuels et davantage de l’importance des héritages reçus des baby-boomers16. Avec un patrimoine universel, il existerait un outil correctif innovant, favorisant l’émancipation de chacun de manière équitable.
En ce sens, le prochain quinquennat est crucial pour prévenir la métamorphose de la France en une société du privilège et pour garantir à sa jeunesse de pouvoir bien démarrer sa vie. Il pourrait, a minima et pour à peine quelques millions d’euros, constituer un moment exceptionnel pour expérimenter cette idée grandeur nature auprès d’une centaine de jeunes et d’ores-et-déjà évaluer ce faisant l’impact de ce qui ne peut être qu’une idée d’avenir dans un contexte de hausse des inégalités.
[1] « Nés sous la même étoile ? Origine sociale et niveau de vie », France Stratégie, note d’analyse publiée en juillet 2018.
[2] Observatoire des inégalités, Rapport sur les riches en France, 2020.
[3] «The billionaire boom: how the super-rich soaked up Covid cash », The Financial Times, 13 mai 2021.
[4] « Inégalités de patrimoine entre générations : les donations aident‑elles les jeunes à s’installer ? », Luc Arrondel, Bertrand Garbinti, et André Masson, Insee, 2014. [1] Cf. Thomas Paine, Justice agraire, publié en 1797.
[5] Cf. Thomas Paine, Justice agraire, publié en 1797.
[6] John Rawls, Théorie de la justice, Points, 2009 [1971].
[7] Niels Planel, Abolir l’inégalité – 3 propositions radicales, Librio, 2019.
[8] « La dotation en capital pour les jeunes ne convainc pas l’Elysée », Les Échos, 1er juillet 2009.
[9] Etienne Grass, Génération Réenchantée, Calmann-Lévy, 2016.
[10] « £9bn bonanza begins as child trust funds come of age», The Guardian, 22 août 2020.
[11] Bruce Ackerman et Anne Alstott, The Stakeholder Society, Yale University Press, 1999.
[12] « Booker reintroduces ‘baby bonds’ bill to give all newborns a $1K savings account», Politico, 4 février 2021.
[13] Samuel Moyn, Not Enough – Human Rights in an Unequal World, Harvard Belknap Press, 2018.
[14] Ibid., p. 4
[15] Il faut de nos jours un apport de 34 439 Euros pour un bien d’un prix moyen. Cf. « En 2020, l’immobilier amorce un lent rééquilibrage des grandes villes vers les périphéries et les villes moyennes », Le Monde, 4 janvier 2021.
[16] « Peut-on éviter une société d’héritiers ? », France Stratégie, note d’analyse n° 51, janvier 2017.