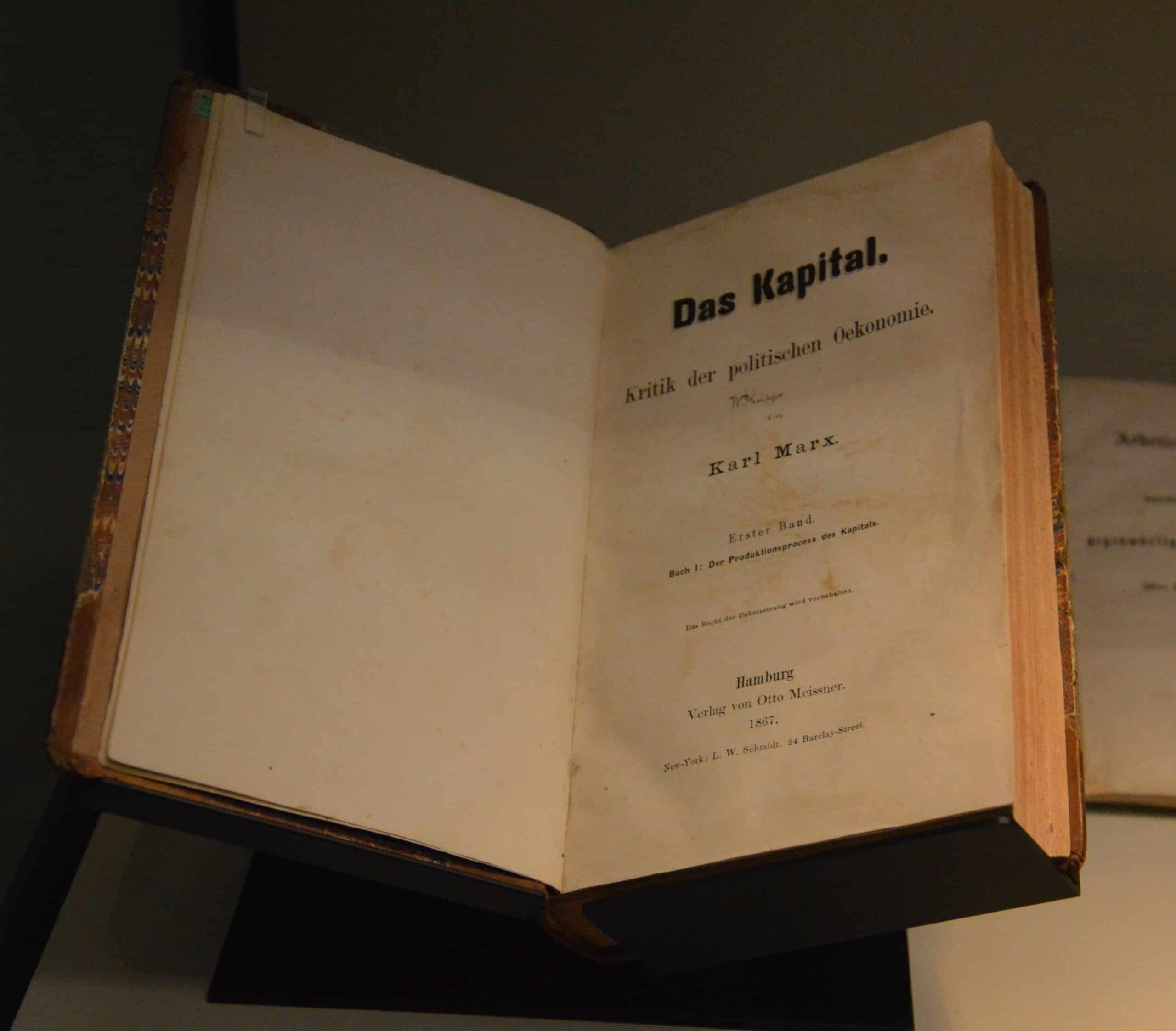L’actualité économique et sociale de la dernière semaine de 2017 s’est révélée particulièrement dense. Alors que Pimkie et PSA annonçaient leur souhait de supprimer des emplois par le recours à la rupture conventionnelle collective, dispositif phare de la nouvelle Loi travail, le Canard Enchainé dévoilait les contours potentiels de la future réforme de l’assurance chômage et le projet du gouvernement d’accentuer le contrôle des demandeurs d’emploi. Décryptage avec Camille Signoretto, maîtresse de conférences en économie à l’université d’Aix-Marseille, chercheuse au laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS) et membre du collectif d’animation des Economistes atterrés.
LVSL : L’enseigne Pimkie et le groupe PSA ont récemment annoncé vouloir recourir à la rupture conventionnelle collective afin de supprimer plusieurs centaines de postes. En quoi consiste ce nouveau dispositif du code du travail introduit par les ordonnances de septembre 2017 ?
La rupture conventionnelle collective (RCC) permet aux employeurs de supprimer des emplois en proposant à leurs salariés de partir volontairement de l’entreprise. Elle repose sur la conclusion d’un accord collectif entre organisations syndicales et employeur au sein de l’entreprise, puis d’une « validation » par l’administration du travail. C’est un nouveau moyen de réduire des effectifs pour les entreprises, mais sans user du licenciement pour motif économique qui est le dispositif juridique normalement utilisé pour cela, accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’entreprise (de 50 salariés ou plus) procède à plus de 10 licenciements en l’espace de 30 jours.
En réalité, la RCC s’inscrit dans une continuité de pratiques de réduction d’effectifs toujours plus faciles pour les employeurs et moins protectrices pour les salariés. En effet, elle reprend un certain nombre de dispositions d’une pratique qui s’est multipliée ces quinze dernières années : le plan de départs volontaires. Encadré par la jurisprudence, ce dernier permet déjà aux employeurs de réduire ses effectifs en proposant aux salariés de quitter volontairement leur emploi ; mais il doit être présenté au comité d’entreprise, et permet aux salariés de bénéficier de mesures de reclassement, comme pour un licenciement pour motif économique, et le plus souvent d’indemnités supra-conventionnelles (supérieures au minimum de la convention collective).
“En réalité, la rupture conventionnelle collective s’inscrit dans une continuité de pratiques de réduction d’effectifs toujours plus faciles pour les employeurs et moins protectrices pour les salariés.”
Cependant, la RCC apparaît moins favorable qu’un plan de départs volontaires, et encore moins qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour les salariés : le montant minimal pour les indemnités de rupture est aligné sur l’indemnité légale de licenciement (et non conventionnelle), et il n’est pas prévu dans la loi de mesures de reclassement externe. Malgré tout, les salariés gardent le droit à s’inscrire à l’assurance chômage.
Finalement, le contenu plus précis de chaque RCC dépendra de l’accord collectif conclu entre les organisations syndicales et l’employeur, autrement dit d’une négociation dans laquelle le pouvoir de force des représentants des salariés sera l’élément déterminant pour introduire plus de protection pour les salariés.
LVSL : Quels avantages la rupture conventionnelle collective présente-t-elle pour les employeurs ? Doit-on s’attendre à ce que son usage se généralise ?
Comme je l’ai déjà mentionné, la RCC facilite les suppressions d’emploi pour les employeurs et participe ainsi de la flexibilisation du marché du travail. Cette procédure permet en effet aux employeurs de se dégager de la procédure de mise en œuvre des licenciements pour motif économique. Même s’il reste des garde-fous (validation par l’administration du travail, accord du salarié au départ de l’entreprise, modalités d’accompagnement négociées dans l’accord collectif), le principal et grand avantage pour l’employeur est qu’il n’a pas à justifier ces réductions d’effectifs par des difficultés économiques ou plus largement par un motif économique. Cela rend inévitablement plus facile les suppressions d’emplois pour l’employeur. De plus, cela le « sécurise » en diminuant la contestation judiciaire et sociale des suppressions d’emplois, puisque le salarié perd la possibilité de contester le motif de la suppression de son emploi et que la RCC est le fruit d’un accord collectif et doit être validée par l’administration du travail.
Il est toutefois difficile de prévoir l’avenir de ce dispositif. S’il est plus avantageux pour l’employeur par rapport aux dispositifs en vigueur (plan de sauvegarde de l’emploi et plan de départs volontaires), il nécessite l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales et la conclusion d’un accord collectif. Selon (encore une fois) le pouvoir de négociation des organisations syndicales, cette procédure pourrait finalement allonger la durée de mise en œuvre des suppressions d’emplois, ajouter des modalités d’accompagnement pour les salariés, ainsi qu’augmenter le coût des suppressions d’emplois via la négociation des indemnités de départ. Par conséquent, pour réduire leurs effectifs, certaines entreprises pourraient continuer à utiliser les plans de départs volontaires qui restent très avantageux notamment lorsque l’ensemble des suppressions d’emplois s’effectue via des départs volontaires (s’il n’y pas de licenciement pour motif économique, l’employeur est en effet dispensé de mettre en œuvre un plan de reclassement). Les exemples de mise en œuvre de la RCC par les entreprises Pimkie et PSA en ce début d’année pourront ainsi être de bons indicateurs pour conjecturer sur le succès ou non des RCC dans les prochaines années.

LVSL : Les partisans de la réforme du code du travail engagée par Emmanuel Macron y voient une manière d’”assouplir” un marché du travail hexagonal jugé excessivement rigide. On avance notamment la peur d’embaucher manifestée par certains employeurs devant les contraintes pesant sur le licenciement, qui constituerait l’une des causes du chômage structurel. Cet argument est-il fondé ?
Depuis la loi Travail d’août 2016, il est clair que les promoteurs de la flexibilité du marché du travail ont été largement entendus. L’un de leur cheval de bataille est en effet la définition du licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, et la procédure juridique l’entourant. Leur reproche est que cette définition laisserait trop de flou aux employeurs et rendrait ainsi incertain et coûteux le licenciement car le salarié peut contester ce motif économique (autrement dit le bien-fondé de sa suppression d’emploi) et les juges condamner l’employeur à des dommages et intérêts si le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, parce qu’il serait difficile de licencier, les employeurs embaucheraient moins.
Or, les économistes qui ont tenté ou tentent encore aujourd’hui de tester empiriquement, c’est-à-dire sur des données réelles, cet argument théorique, ne sont pas parvenus à leurs fins.
D’un point de vue macroéconomique, les études sur données internationales ne montrent pas de lien entre le degré de rigidité du marché du travail et le taux de chômage. Les effets de l’assouplissement des règles juridiques encadrant le marché du travail sur le taux d’emploi sont également inexistants ou légèrement positifs à moyen/long terme, selon l’OCDE (le moyen/long terme correspondant à une longue période en économie et ne pouvant inclure que difficilement un évènement extérieur négatif – ralentissement de la conjoncture internationale, choc de productivité – qui surviendrait durant cette période). La théorie économique sous-jacente (modèles inter-temporels de demande de travail et modèles d’appariement) prédit en réalité une augmentation à la fois des créations d’emplois et des destructions d’emplois en cas de baisse du coût du licenciement permise par une flexibilité plus grande, l’effet net sur l’emploi étant indéterminé.
“En France, selon la récente étude de l’Insee (juin 2017), il apparaît que pour les employeurs le premier frein à l’embauche est l’incertitude économique (28%), suivi du manque de main-d’œuvre compétente (27%), la réglementation de l’emploi n’étant citée que par 18% des entreprises.”
D’un point de vue microéconomique, il reste difficile de tester cette « libération de l’embauche » qui serait permise par un assouplissement des règles de licenciement. Avec des techniques statistiques poussées, un certain nombre d’études tentent d’analyser les effets d’un changement de législation dans un pays ou secteur donné sur le niveau et les flux d’emploi. Les résultats de ces études sont mitigés, certaines trouvant un effet positif même si faible, d’autres aucun effet. De plus, le cadre institutionnel initial du pays étudié, et le poids et l’étendue de chacune des réformes, diffèrent tellement entre ces études qu’il reste difficile de conclure quoi que ce soit. En France, selon la récente étude de l’Insee (juin 2017), il apparaît que pour les employeurs le premier frein à l’embauche est l’incertitude économique (28%), suivi du manque de main-d’œuvre compétente (27%), la réglementation de l’emploi n’étant citée que par 18% des entreprises.
Enfin, on ne rappelle jamais assez qu’un licenciement pour motif économique est très peu contesté dans les faits par les salariés (moins de 2%) et que si trois-quarts des recours engagés par les salariés se terminent en faveur de ces derniers, le conseil des prud’hommes est un tribunal paritaire comprenant deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs.
D’ailleurs, devant ces faits empiriques contestant plutôt le bien-fondé de cet argument, la ministre du travail en a finalement convenu : cette peur d’embaucher est surtout psychologique ! Peut-être serait-il alors plus pertinent de faire appel à des théories psychologiques plutôt qu’économiques pour faire baisser le chômage…
LVSL : Le Canard Enchaîné a révélé le mercredi 27 décembre une note confidentielle confirmant le souhait du gouvernement de durcir le contrôle des demandeurs d’emploi. Un chômeur devrait ainsi remplir chaque mois un rapport d’activité afin d’indiquer les démarches effectuées dans le cadre de sa recherche d’emploi, et pourrait se voir retirer 50% de ses indemnités en cas de refus d’une formation ou de deux offres “raisonnables”. Quels sont la philosophie et les objectifs qui sous-tendent cette réforme ? Est-il efficace d’accentuer la pression sur les chômeurs pour lutter contre le chômage ?
Ce souhait du gouvernement de durcir le contrôle des demandeurs d’emploi n’est pas surprenant puisque cette proposition figurait dans le programme du candidat Macron (ainsi que celui du candidat Fillon). Sa philosophie est simple et repose sur une image du demandeur d’emploi péjorative : un « profiteur » du système qui recevrait ses allocations chômage sans fournir un effort suffisant pour retrouver un emploi. Cette image est bien évidement réductrice et surtout fausse. Faut-il rappeler en effet que 50% des demandeurs d’emploi ne sont pas indemnisés par Pôle emploi ; que les allocations chômage trouvent leur source dans le versement des cotisations sociales dont une partie est prélevée sur le salaire des travailleurs ; que ce ne sont pas les 200 000 à 330 000 emplois vacants (chiffres Pôle emploi, décembre 2017) qui permettront de résorber le chômage des 3 à 5 millions de demandeurs d’emplois ; que l’expérience du chômage est une « épreuve » ayant des effets psychologiques et sociaux néfastes pour les individus, comme l’ont montré de nombreux travaux sociologiques ; etc. D’ailleurs, selon les études statistiques de Pôle emploi, plus de 85% des demandeurs d’emploi recherchent bien activement un emploi.
Enfin, d’un point de vue économique, il n’est pas efficace de sanctionner les demandeurs d’emplois et c’est un des rares consensus qui existe entre économistes. Cela tend en effet à inciter le chômeur à accepter un emploi de mauvaise qualité, par exemple un emploi court qui le fera sortir du chômage pour quelques semaines ou mois seulement, ou un emploi pour lequel il est surqualifié. Les relations d’emplois nouées ne seront ainsi pas optimales et plutôt de courte durée.
Crédit photos :
©Julien Faure
©Anakin732













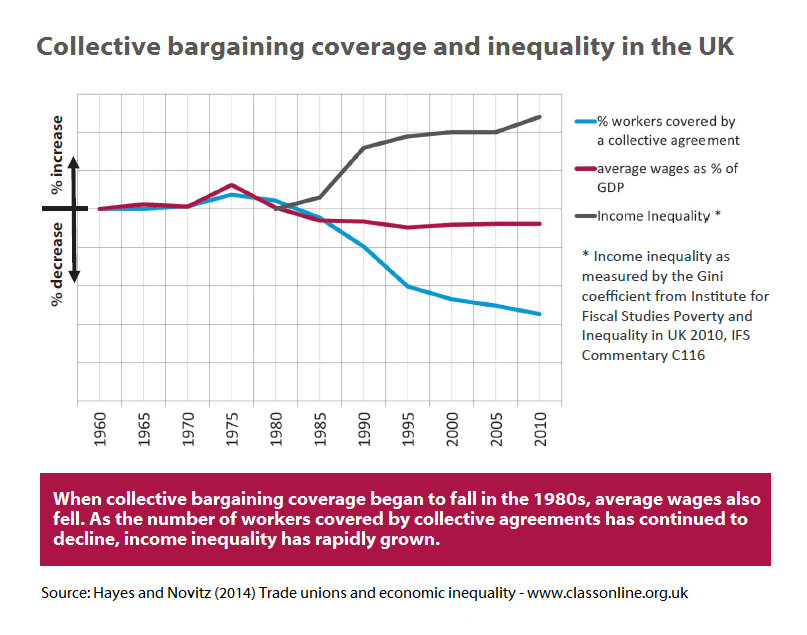
















 Muriel Pénicaud détaille le plan d’attaque du gouvernement
Muriel Pénicaud détaille le plan d’attaque du gouvernement