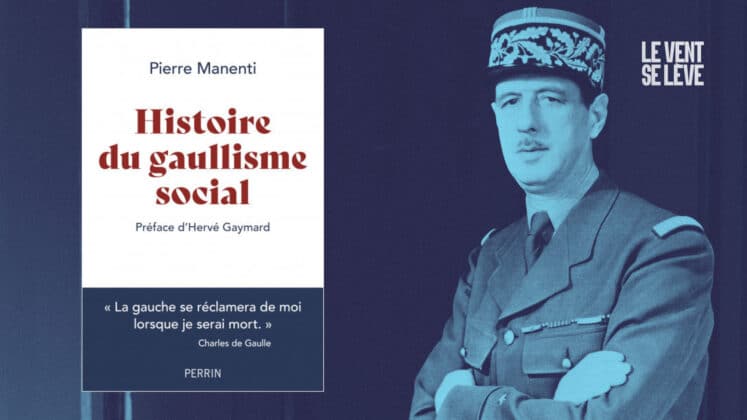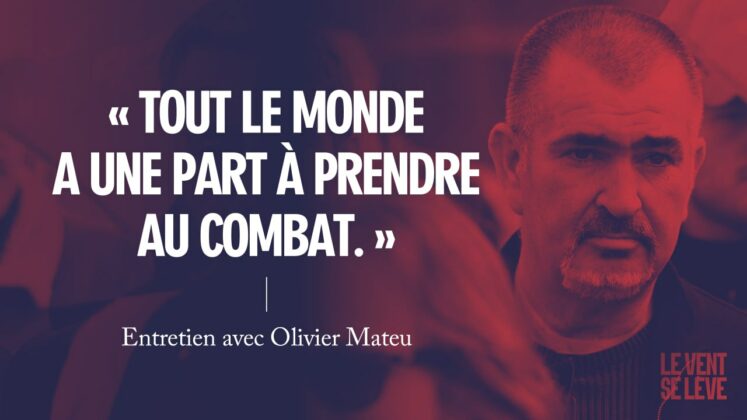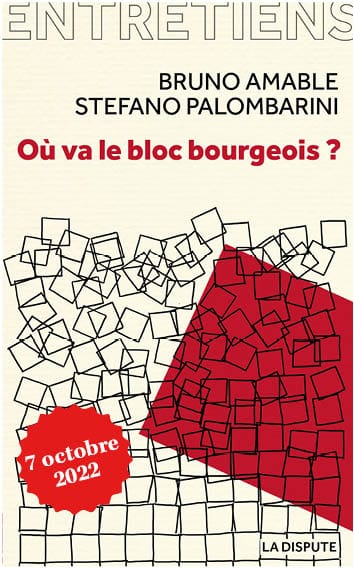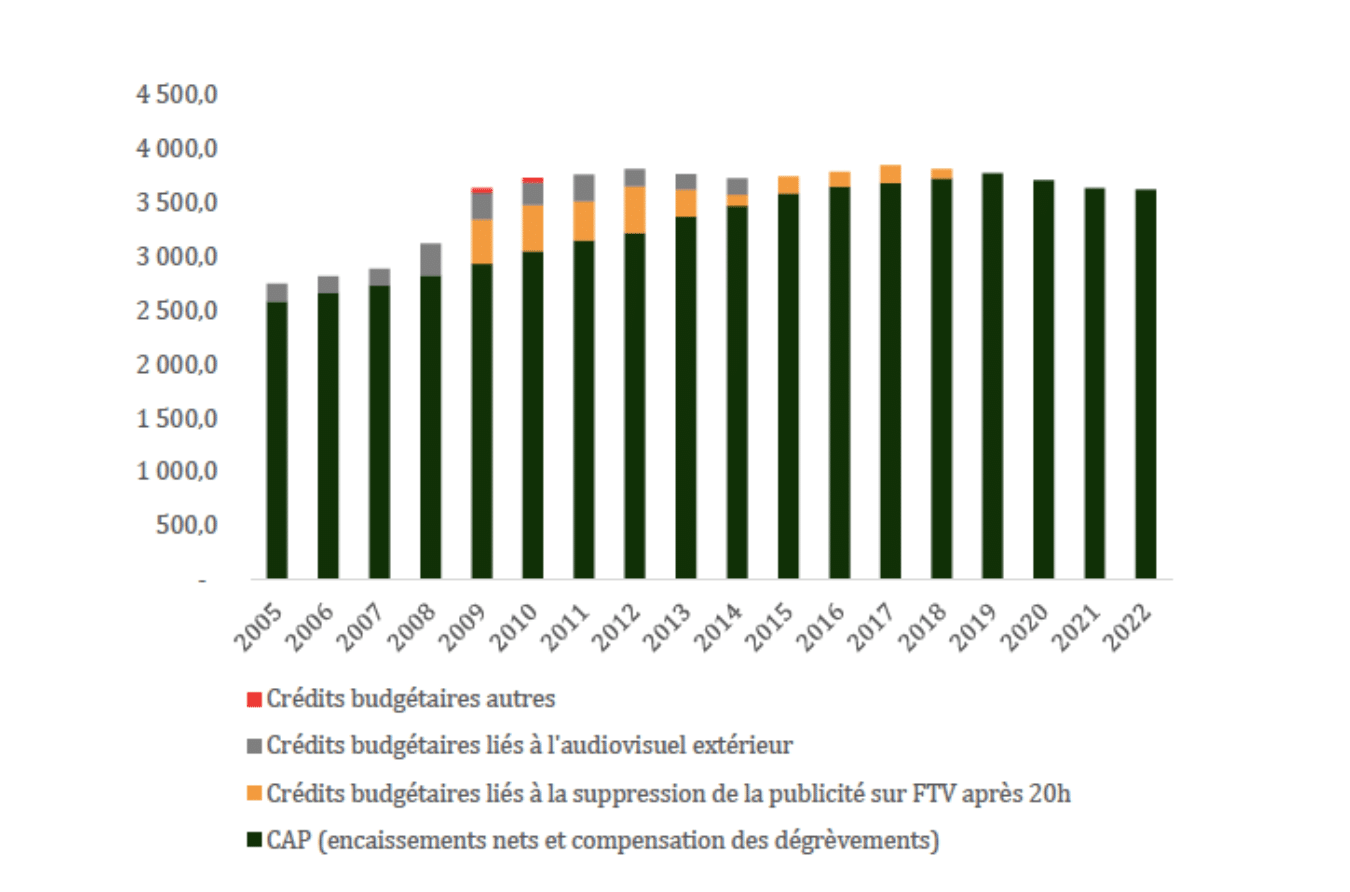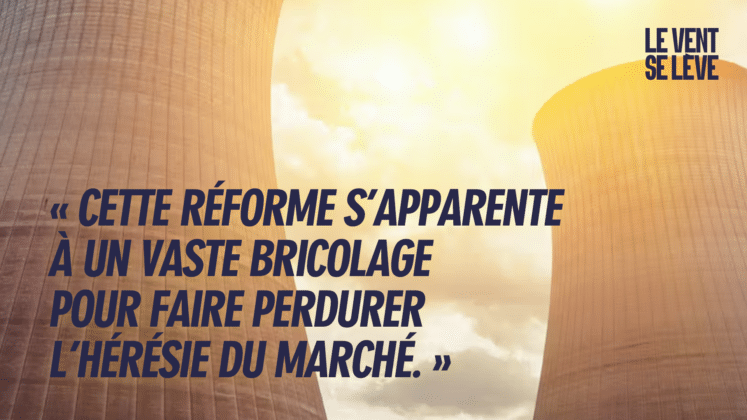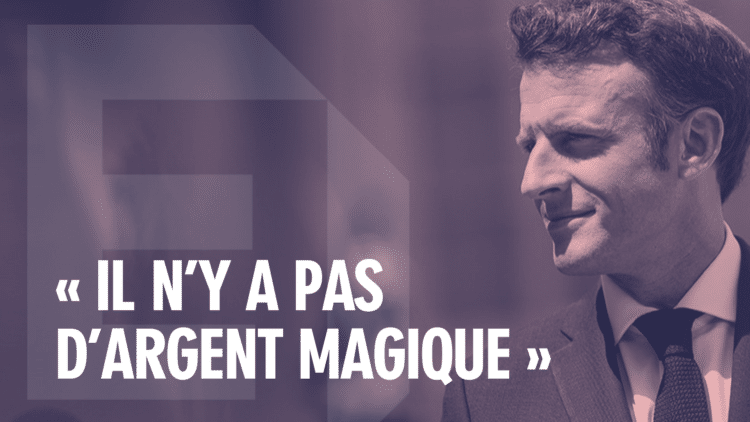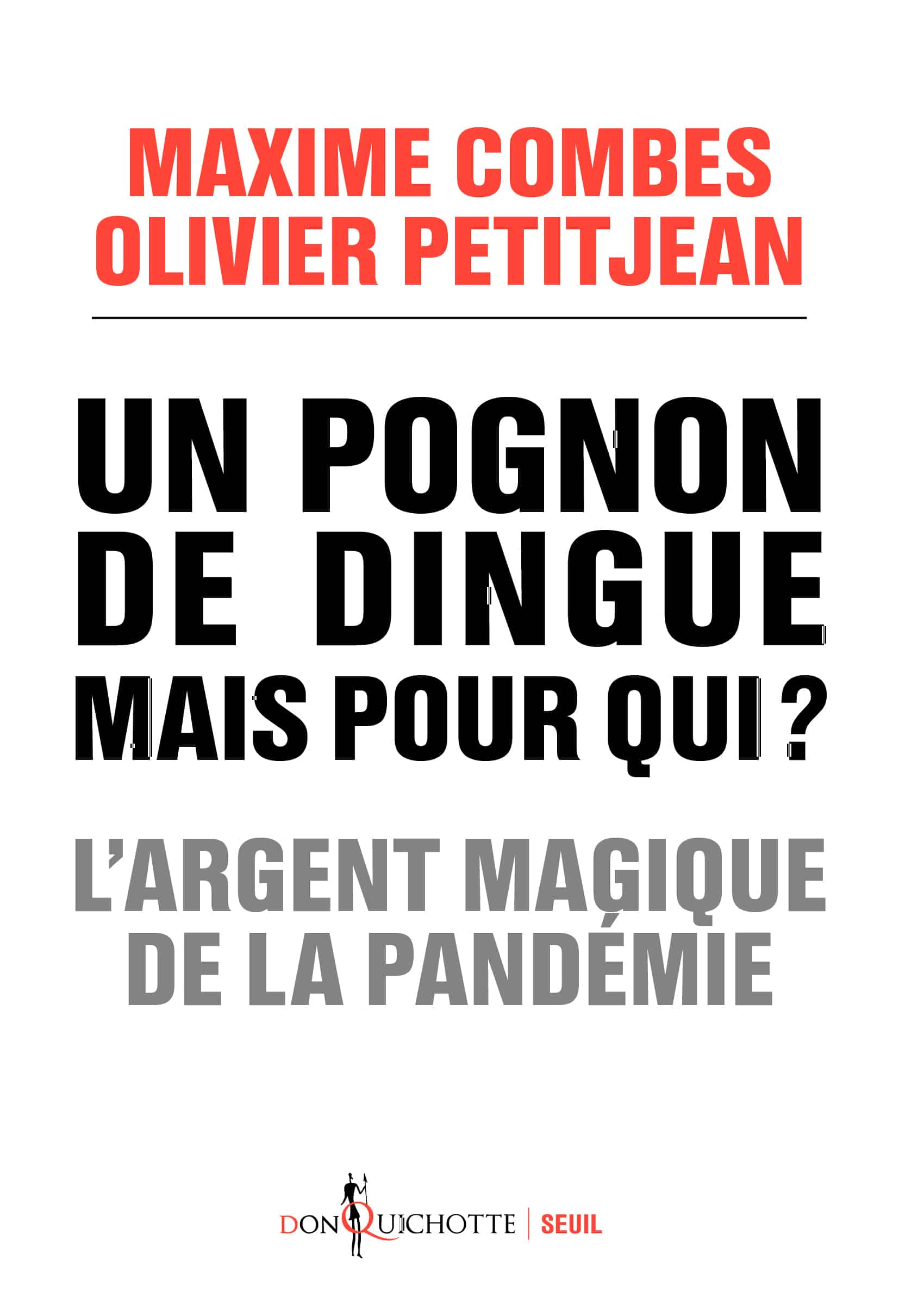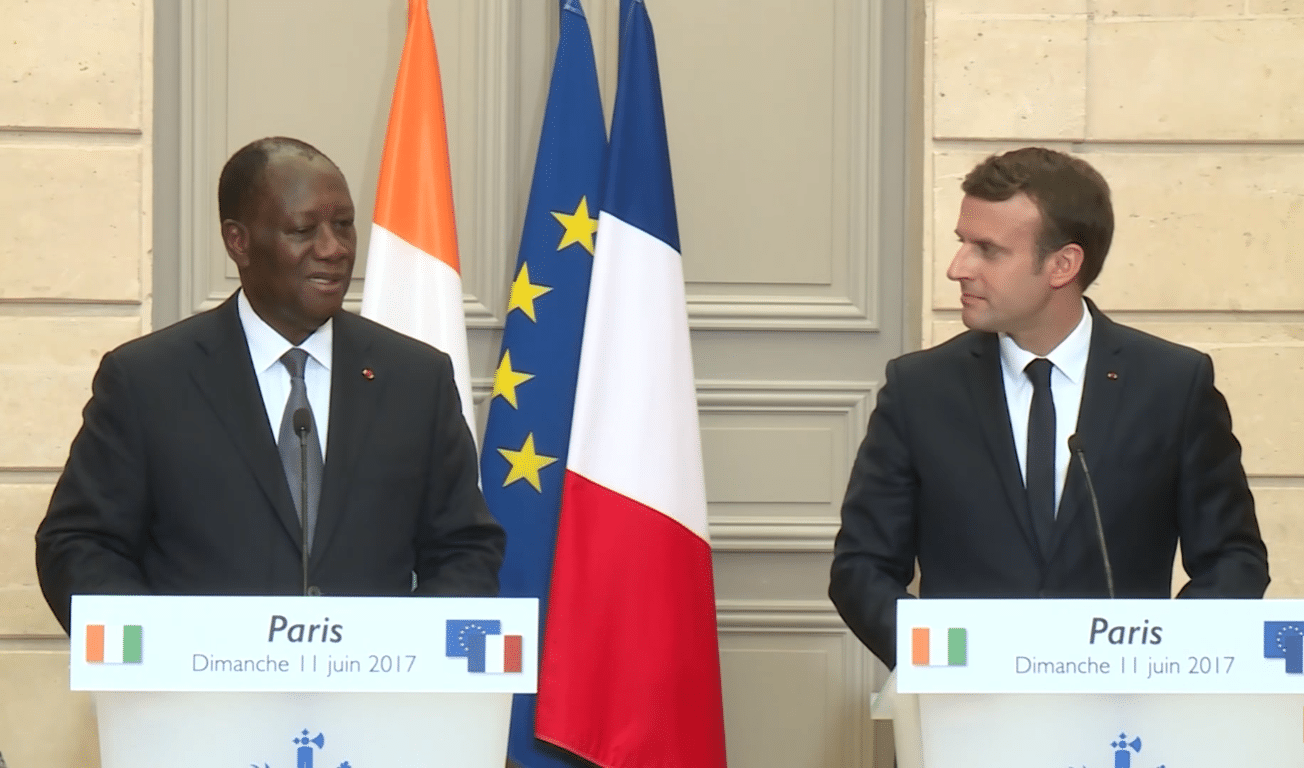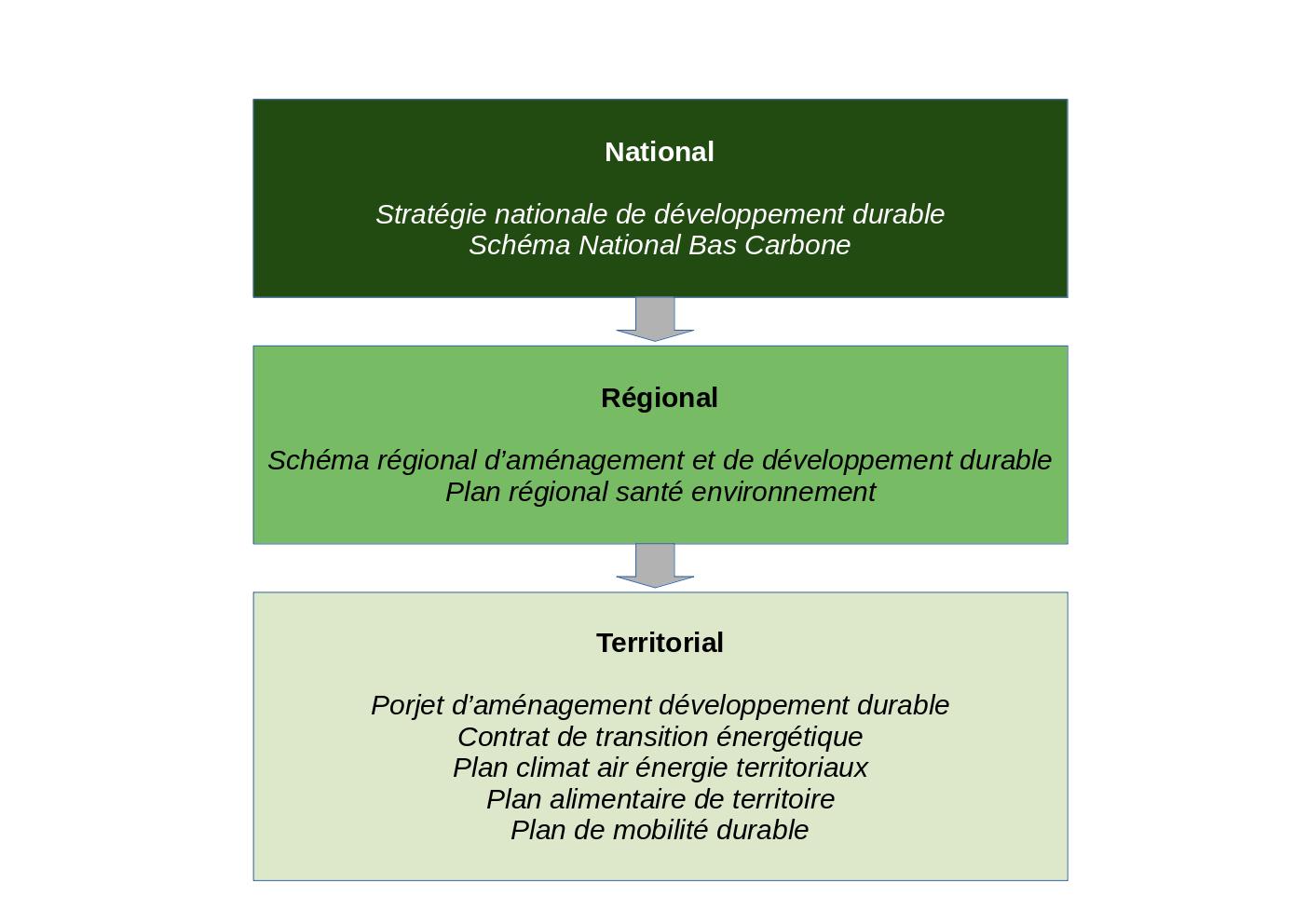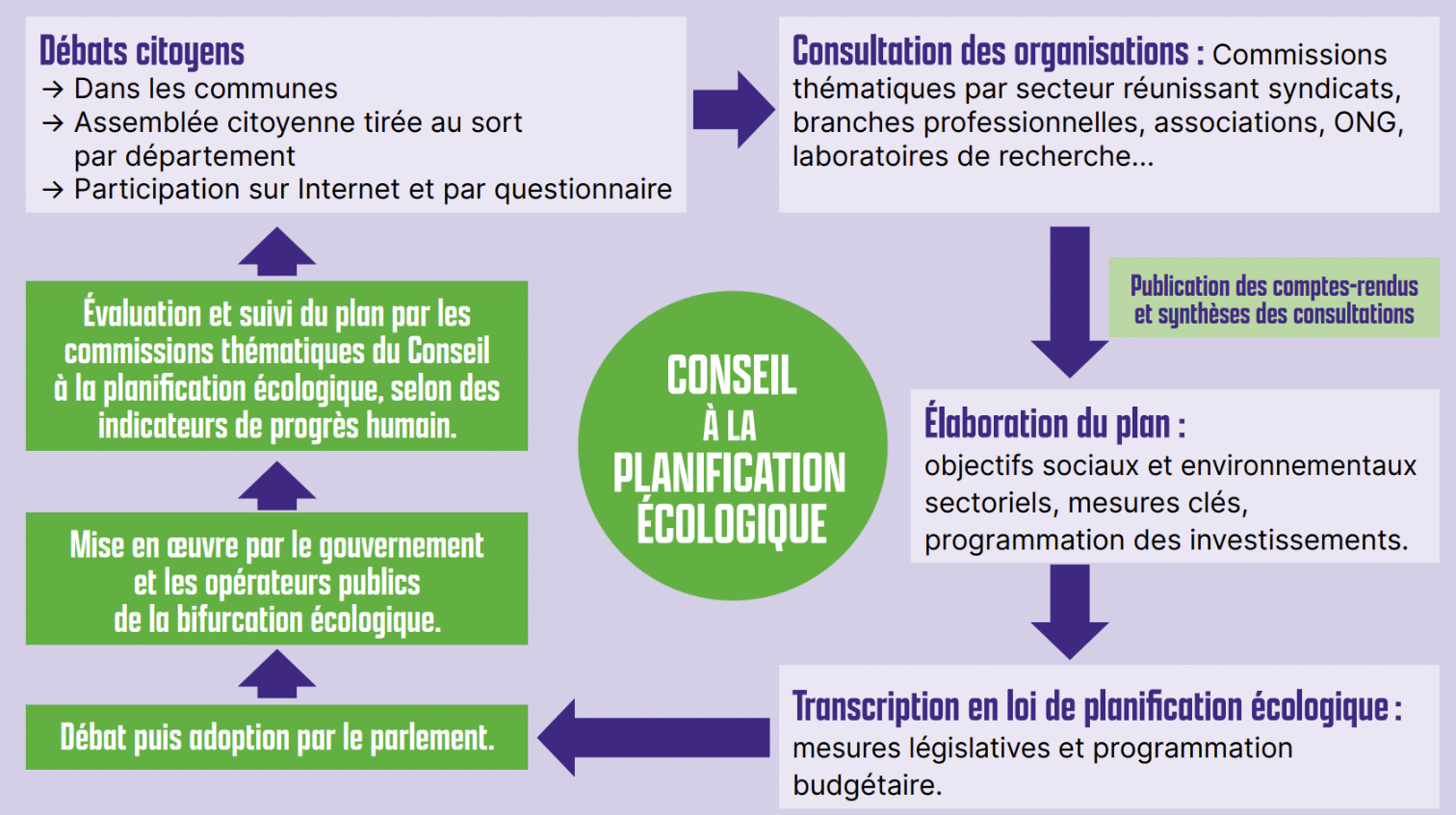Alors que la rentrée politique a été marquée par un regain d’intérêt pour la question du travail, nous nous sommes entretenus avec Bernard Friot, sociologue du travail et économiste qui milite pour « émanciper le travail ». Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, Bernard Friot est aussi à l’initiative de l’Institut européen du salariat et de Réseau salariat, qui défend l’idée d’un « salaire à la qualification personnelle ». Dans cet entretien, il revient sur le début du deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron et sur les perspectives politiques qui s’offrent à la NUPES, mais aussi sur les moyens qu’il promeut pour raviver la citoyenneté et garantir la souveraineté populaire sur le travail.
LVSL : Tout au long du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, vous avez fait partie des voix critiques qui se sont élevées contre sa politique sociale et économique. Comment avez-vous accueilli sa réélection à la présidence de la République ? Pensez-vous que celle-ci aurait pu être évitée ?
Bernard Friot : Je pense exprimer une opinion commune en disant que la réélection d’Emmanuel Macron aurait peut-être pu être évitée si la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (NUPES) s’était réalisée avant le premier tour de l’élection présidentielle et non après. Étant donnée la détestation de Macron dans notre pays, la qualification de Jean-Luc Mélenchon pour le second tour aurait peut-être enclenché une dynamique permettant son élection. Étant entendu que cette victoire électorale inattendue n’aurait eu de sens qu’accompagnée d’une mobilisation des travailleurs, comme pour le Front populaire. Sinon elle aurait été suivie d’un échec de plus pour la gauche, car on ne sort pas de l’État capitaliste par les urnes.
En tout cas, la présence de Mélenchon au second tour nous aurait préservé de la spectaculaire progression du Rassemblement national (RN) aux législatives : avoir empêché sa qualification est une faute politique majeure. Membre du Parti communiste français (PCF), je me suis formellement opposé à l’orientation du congrès de 2018 qui a décidé d’en finir avec le Front de gauche et de privilégier une stratégie identitaire, ce qui est un réflexe mortifère pour un parti en déclin. En être réduit à se saisir de la présidentielle comme d’une tribune signale une terrible perte d’audience. Comme le PCF était avec la France insoumise (LFI) au premier tour de 2017, il est évident que parmi les 800 000 voix de Fabien Roussel figurent les 400 000 qui ont manqué à Mélenchon en 2022. Pire, sa non qualification a été postulée dès le départ en donnant curieusement crédibilité aux sondages : Roussel est entré en campagne en répétant que la gauche ne serait de toute façon pas au second tour.
« Nous vivons dans une caricature de démocratie politique qui gangrène par ailleurs la vie des partis. »
Cela dit, parmi les facteurs de la réélection de Macron, il n’y a pas que l’attitude irresponsable des partis socialiste, communiste et écologiste vis-à-vis de LFI – et, symétriquement, bien des pratiques discutables de LFI en matière d’union. Sa réélection tient, plus profondément, au fonctionnement-même de l’élection présidentielle. Regardez comment les principaux médias ont méticuleusement organisé, depuis 2017 et dans la campagne du premier tour, le fait que Marine Le Pen soit la seule opposante à Emmanuel Macron, avant de s’écrier d’une seule voix, avant le second tour, qu’il fallait faire barrage au RN. Nous vivons dans une caricature de démocratie politique qui gangrène par ailleurs la vie des partis : nous voici maintenant au parti communiste avec un Fabien Roussel, bon communicant, qui entend bien occuper toute la place « au service de la notoriété du parti », évidemment, alors que c’est de plus d’horizontalité, de débat interne, d’intelligence collective effectivement à l’œuvre, dont nous avons absolument besoin.
Les signes se multiplient au contraire d’une volonté de faire du PCF le « parti de Fabien », de prolonger le funeste one man show propre à une campagne présidentielle dans une tournée régionale de « celui auquel les Français identifient le PCF » alors que l’enjeu est au contraire que le parti contribue à la suppression des chefs et des figures emblématiques dans la vie politique. Sur ce terrain démocratique décisif pour la conquête du pouvoir par en-bas fondatrice de la dynamique communiste, bien des associations sont très en avance sur le PCF comme sur tous les partis d’ailleurs, que la logique de l’élection présidentielle transforme en troupes au service de la notoriété d’un candidat. L’élection du président au suffrage universel est un cancer, elle doit impérativement être supprimée !
LVSL : En tant que militant communiste, quel regard portez-vous sur la dynamique de rassemblement autour de la NUPES, et sur sa capacité à constituer un véritable contrepoids parlementaire au pouvoir présidentiel détenu par Emmanuel Macron ?
B. F. : Tout d’abord, rappelons que Jean-Luc Mélenchon et LFI, mais aussi l’ensemble des forces de gauche qui composent la NUPES, s’inscrivent dans la logique présidentielle y compris pour réformer la Constitution. Jean-Luc Mélenchon n’a jamais non plus renié son allégeance à François Mitterrand. Et chacun sait que sa capacité à inscrire son action dans un processus de décision collective est limitée. Beaucoup de choses pourraient être discutées sur ce point.
« L’union de rupture avec le capitalisme n’a de sens que si la NUPES est l’expression politique de la multiplicité des initiatives alternatives au capitalisme et suscite le mouvement social de prise de pouvoir sur le travail, sans lequel les victoires électorales de gauche sont des illusions. Ce sont les occupations d’usines et les grèves de 1936 qui ont permis les principales réalisations du Front populaire. »
Toujours est-il que c’est à Jean-Luc Mélenchon et à LFI que nous devons la très heureuse nouveauté de la NUPES, comparée à « l’union de la gauche » des dernières décennies : l’union s’opère enfin sur une base de rupture avec le capitalisme. C’est considérable, quand on sait le désastre pour la crédibilité populaire de la gauche qu’a été le gouvernement de « gauche plurielle » de Jospin : Hollande y a certes ajouté sa touche par la suite, mais il n’a jamais fait qu’achever le travail commencé avec le tournant de la rigueur de Mitterrand, mis sur les rails avec Rocard et accompli avec Jospin. Dans le champ que j’étudie, le bilan de la gauche plurielle de Jospin est catastrophique : remplacement de la cotisation maladie par la CSG, installation des complémentaires avec la CMU, extension de la scandaleuse « insertion des jeunes » avec les emplois-jeunes, légitimité théorique de la réforme des pensions avec le Conseil d’Orientation des Retraites, exonération de cotisations patronales avec les 35 heures.
Bien sûr, l’union de rupture avec le capitalisme n’a de sens que si la NUPES est l’expression politique de la multiplicité des initiatives alternatives au capitalisme et suscite le mouvement social de prise de pouvoir sur le travail, sans lequel les victoires électorales de gauche sont des illusions. Ce sont les occupations d’usines et les grèves de 1936 qui ont permis les principales réalisations du Front populaire. Si la relative réussite électorale de la NUPES s’accompagne d’un surgissement populaire, sur les lieux de travail d’abord, et mobilise toute l’inventivité démocratique des dernières années dans le champ associatif et social, alors je crois qu’il sera possible de sortir, à terme, de la logique présidentielle, pas tant par un contrepoids parlementaire que par une affirmation de classe.
Encore faut-il que la NUPES soit réellement portée par les partis qui ont signé l’accord. Pour m’en tenir à mon parti, la direction actuelle du PCF fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle sait que, s’il n’avait pas adhéré à la NUPES, le parti n’aurait plus qu’une poignée de députés et pas de groupe parlementaire. Elle tente donc de sauver les meubles à travers cette alliance électorale qu’elle n’assume que par opportunisme tout en s’en démarquant, sur la forme à coup de petites phrases polémiques certes qui font de Roussel le bon client des médias dominants, mais surtout, sur le fond, par le refus de jouer le jeu d’une union de rupture où le parti est minoritaire. Roussel est l’élu d’un congrès qui a renoncé au Front de gauche par nostalgie de l’union de la gauche. C’est l’aile droite du parti, favorable à l’union avec le PS, qui l’a emporté en 2018, avec l’aide de la mouche du coche des quelques partisans de la faucille et du marteau, sous la houlette opportuniste d’André Chassaigne.
« J’appelle à ce que le prochain congrès du parti nous permette d’apporter une contribution communiste à l’union populaire de rupture avec le capitalisme qu’est en puissance la NUPES. »
Roussel, qui vient du cabinet d’une des ministres communistes de la gauche plurielle de Jospin, a d’ailleurs tenté de refaire le coup de l’union de la gauche en étant aux présidentielles le candidat du PCF, des radicaux de gauche, des rescapés de gauche du chevènementisme et d’anciennes personnalités du PS comme Marie-Noëlle Lienemann. Il en a obtenu le résultat mérité. Cet échec considérable est dû non pas au vote utile (est-ce le vote utile qui explique qu’il ait fait 4% dans les villes communistes alors que Mélenchon y faisait entre 40 et 70% ?) mais à l’inaudibilité populaire de sa campagne pour la « République sociale ». Le PCF ne peut faire entendre sa voix qu’en passant de l’union de la gauche à l’union populaire. Et donc en participant sincèrement et sur le fond au bouillonnement d’initiatives alternatives observable partout aujourd’hui et dont la NUPES peut devenir l’expression politique si elle se hisse à la hauteur de l’enjeu communiste. C’est pourquoi j’appelle à ce que le prochain congrès du parti nous permette d’apporter une contribution communiste à l’union populaire de rupture avec le capitalisme qu’est en puissance la NUPES.
LVSL : Vous avez signé, avec un collectif d’économistes, une tribune soutenant le programme économique de la NUPES. Qu’est-ce qui vous a motivé à le faire, et en quoi trouvez-vous ce programme plus pertinent et crédible que les autres ?
B. F. : J’ai signé cette tribune parce que cela relevait de l’évidence. D’un point de vue strictement électoral, il s’agissait de soutenir le seul mouvement qui était en capacité d’imposer éventuellement une cohabitation, du moins une opposition puissante et utile face à Emmanuel Macron. Et sur le fond, comme je viens de le dire, comment ne pas soutenir la dynamique d’une union de la rupture avec le capitalisme ?
Mais cette rupture est en puissance, et j’exprime nombre de réserves sur le programme de la NUPES, notamment parce qu’il s’inscrit toujours dans la même logique et le même imaginaire de la gauche « d’en haut », dont ni mon parti ni la NUPES ne sont sortis mais qu’il faudra bien finir par dépasser. Il s’agit encore de « prendre l’argent où il est », de lutter contre la fraude fiscale, de taxer les riches, de mieux partager les richesses, de créer un pôle public bancaire, de réaliser quelques nationalisations appuyant une politique industrielle volontariste, de relancer la demande par une hausse des salaires, des pensions et des minimas sociaux.
« La sortie du capitalisme suppose une conquête du pouvoir sur le travail dans toutes les entreprises, en actualisant et en étendant à toutes les fonctions collectives cette anticipation magnifique qu’a été la gestion du régime général par les travailleurs entre 1946 et 1967. »
Nous sommes en échec depuis quarante ans en persévérant dans cette croyance dans une bonne politique publique par en haut, alors qu’on ne va au communisme que par le communisme. La sortie du capitalisme suppose une conquête du pouvoir sur le travail dans toutes les entreprises, par en bas, et par un en haut géré par les citoyens, en actualisant et en étendant à toutes les fonctions collectives cette anticipation magnifique qu’a été la gestion du régime général par les travailleurs entre 1946 et 1967.
LVSL : Selon vous, par quels moyens pourrions-nous, aujourd’hui, renouer avec cette dynamique ?
B. F. : Une telle conquête passe par celle de l’attribution à tous les majeurs, comme droits politiques, de droits économiques nouveaux : qualification personnelle et salaire, propriété d’usage des entreprises, co-décision dans la création monétaire et toutes les institutions de coordination de la production. Or une telle conquête n’est malheureusement pas à l’agenda de la NUPES, ni d’aucun des partis qui la composent. Prenons l’exemple de la proposition de faire du contrat de travail un droit attaché à la personne qui est une proposition phare de FI et du PCF. Je m’en explique longuement dans un texte à paraître dans Salariat, la nouvelle revue de l’Institut européen du salariat dont le premier numéro [1], qui sort en octobre, porte précisément sur la question du droit au contrat ou du droit à la qualification. Car ce n’est pas du tout la même chose.
L’attribution à toute personne d’une qualification doit être bien distinguée de l’attribution à toute personne d’un contrat. L’idée de pérenniser les revenus par une continuité de contrats, que ce soit entre des contrats avec des entreprises et avec un État employeur en dernier ressort – pour ce qui est de la proposition de LFI – ou entre des contrats de travail et des contrats de formation – pour ce qui est de la sécurité emploi-formation défendue par le PCF –, cette idée de succession continue de contrats, incroyablement en dessous de la conquête du statut de la fonction publique, menace ce dernier alors qu’il est la cible principale de la classe dirigeante : c’est une proposition irresponsable. Dans la fonction publique, ce n’est pas le contrat qui est le support des droits d’une personne, mais la qualification dont elle est porteuse, en tant que personne. C’est pour cela que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement, et c’est précisément cela qu’il faut généraliser à tous les majeurs : la continuité du salaire doit reposer non pas sur la continuité des contrats mais sur l’attachement du salaire à la personne dans la généralisation, comme droit politique du citoyen, du salaire à la qualification personnelle de la fonction publique.
La bourgeoisie, quand elle était classe révolutionnaire, a eu ce coup de génie de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en août 1789. Sur la base de cette déclaration, qui pose que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, l’abstraction de la citoyenneté a pu être progressivement construite avec la conquête du suffrage universel. Elle postule que tout majeur, indépendamment de tout autre critère, est considéré en capacité et en responsabilité de la chose publique. Cette citoyenneté-là, qui était au cœur de notre tradition républicaine, est en train de s’épuiser, un épuisement qu’il faut contrarier si nous voulons éviter le pire.
Si la citoyenneté s’épuise, c’est parce que les abstentionnistes ou les votants porteurs de l’illusoire « sortons les sortants » constatent l’impuissance d’une chose publique qui exclut le travail, qui exclut la production. La politique s’arrête à la porte de l’entreprise, ou à la porte des banques lors de la création monétaire, car la bourgeoisie capitaliste tient à conserver son monopole sur le travail, et ce d’autant plus violemment qu’il n’y a plus aujourd’hui adhésion au travail tel qu’elle l’organise. Une chose publique dans laquelle est absent le cœur même de la vie sociale, c’est-à-dire le travail et la production, décourage les citoyens et leur donne d’autant moins de raisons de faire de la politique que c’est sur le travail, précisément, qu’ils sont en désaccord. Avec en fond de scène le fascisme, joker de la bourgeoisie quand la vie politique perd ses repères.
L’enrichissement de la citoyenneté, nécessaire pour la sauver, doit procéder du même geste que celui des révolutionnaires de 1789 : le salariat, classe révolutionnaire d’aujourd’hui, doit inclure le travail dans la chose publique et proclamer que tout majeur est postulé comme étant en capacité et en responsabilité de produire, de décider de la production. Sur son lieu de travail bien sûr, et aussi à l’échelle méso et macroéconomique de la création monétaire, de l’implantation des entreprises, des accords internationaux de coopération et d’échanges.
« Le salaire à la qualification reconnaît la contribution à la production de valeur économique, il pose les travailleurs comme les seuls producteurs de la valeur, et il s’agit maintenant de les poser comme ses seuls responsables. »
Cela suppose des droits correspondant à cette responsabilité, dont le salaire à la qualification personnelle, car qui osera décider réellement du travail dans son entreprise si ses droits sont liés au contrat passé avec elle ? Nos droits économiques ne doivent être liés qu’à notre personne. Le salaire est certes une ressource, et la sécurité de cette ressource qu’assurera la continuité du salaire est importante pour sortir toutes les vies de la précarité. Mais ça n’est pas la seule dimension du salaire tel que le syndicalisme de classe l’a imposé au patronat au cours du XXème siècle. Le salaire à la qualification reconnaît la contribution à la production de valeur économique, il pose les travailleurs comme les seuls producteurs de la valeur, et il s’agit maintenant de les poser comme ses seuls responsables.
Et comme la fonction publique a inauguré un mouvement d’attribution de la qualification à la personne du travailleur, et non plus à son poste de travail, généralisons-le en posant tout majeur comme titulaire d’une qualification (et donc d’un salaire), comme responsable de la production de dix-huit ans à sa mort. Toutes les vies seront sorties de la précarité en même temps que la citoyenneté sera enrichie de la maîtrise de la production. Pour cela, la qualification personnelle, condition nécessaire, n’est pas suffisante : l’expression de cette citoyenneté enrichie, de cette responsabilité dans la production de la valeur, c’est trois droits économiques nouveaux à lier à tout majeur. Le premier est la qualification, et donc le salaire comme droit politique lié à la personne et non pas au contrat. Le second est la propriété d’usage de l’outil de travail et donc la décision dans l’entreprise. Le troisième est la décision dans les institutions de coordination de la production : création monétaire, jurys de qualification, instances territoriales de définition des biens et services à produire, etc.
Dès lors, le fait que chacun, à dix-huit ans, soit titulaire de ces droits et que ce soit des droits politiques inaliénables jusqu’à sa mort ne dépendra pas du tout de contrats de travail qu’il aurait ou qu’il n’aurait pas. Toute personne majeure sera en permanence en responsabilité de la production et titulaire des droits exprimant cette responsabilité. Bien sûr, sa qualification se concrétisera dans du travail et donc dans des contrats passés avec une entreprise, avec des fournisseurs ou des usagers. Mais ces contrats ne fonderont ni le salaire ni la qualification, ni non plus les conditions générales du travail qui relèvent d’un Code du travail interprofessionnel, grand conquis de la CGT naissante et depuis 1910 en permanence contesté par la bourgeoisie capitaliste. Dans le respect du Code du travail, le contrat de travail, évidemment débarrassé de la subordination qui le constitue aujourd’hui juridiquement, définira les conditions spécifiques dans lesquelles s’exerce tel travail concret, qui diffèrent d’une branche et d’une entreprise à l’autre. Le travail étant une activité collective, il suppose des règles et un contrat dans lequel les parties s’engagent à respecter ces règles, sans quoi des sanctions sont possibles.
Il faut donc distinguer soigneusement le contrat de travail et les droits économiques et politiques de la personne majeure que sont la qualification (et donc salaire), la propriété de l’outil et la décision dans les instances de coordination de la production. Le contrat est une institution tout à fait nécessaire pour organiser le travail concret dans le respect des règles du Code du travail, mais il ne doit pas être le support des droits économiques.
Au contraire, continuer de faire dépendre les droits économiques du contrat de travail, c’est laisser le cœur du capitalisme, qui pose les individus comme titulaires d’une force de travail sur le marché du travail. Ou pire, pour les travailleurs indépendants, sur le marché des biens et services, bien moins régulé que le marché du travail, avec des hauts et des bas spéculatifs permanents. Le fait que cette force de travail serait en permanence validée par la continuité des contrats, et que l’on aurait ainsi un revenu permanent, apporterait une régulation supplémentaire bienvenue au marché du travail mais ne changerait pas cette pratique décisive du capitalisme qu’est la définition du travailleur comme titulaire d’une force de travail subordonnée sur un marché, n’ayant droit au salaire que s’il le mérite par un travail productif. Ce que nous devons combattre, c’est précisément cette figure capitaliste du travailleur méritant son salaire par son travail, ce catéchisme de la « fierté de gagner sa vie par son travail », cette disqualification en « allocs » de la si précieuse déconnexion de l’emploi et du salaire qu’est le conquis du salaire continué du chômage, toujours plus menacé.
J’insiste sur le fait que l’irresponsabilité des saillies de Roussel à ce propos ne tient pas qu’à sa légèreté de communicant à laquelle on les réduit trop facilement. Elle tient au fond même des positions de la direction du parti, et singulièrement de sa section économique, sur le salaire, le travail et l’emploi. Là encore, je renvoie aux analyses du premier numéro de Salariat. L’emploi est la situation créée par les conventions collectives : au poste de travail est attribué une qualification et donc un salaire. C’est une conquête du siècle dernier sur l’infra-emploi du travail « indépendant » dépendant du marché des biens et services et de la rémunération à la tâche des CDD de mission et autres formes du salaire capitaliste. Mais c’est une conquête qui a été dépassée dans l’au-delà de l’emploi capitaliste qu’est l’attribution de la qualification, et donc du salaire, à la personne des fonctionnaires et des retraités du régime général, et, dans une moindre mesure, à celle des chômeurs.
Sauf à donner raison à Macron qui veut supprimer le droit au salaire des chômeurs, un chômeur n’est pas un « privé d’emploi » qui doit vite en retrouver un pour retrouver un salaire, c’est le titulaire d’un salaire – certes minoré et précaire – alors qu’il n’a pas d’emploi. L’enjeu décisif de lui garantir tant la continuité de ses ressources que l’exercice souverain d’un travail n’est pas de lui assurer un emploi qui demeurera capitaliste puisqu’il restera le support de ses droits, mais de lui assurer d’une part une qualification personnelle, support d’un salaire attaché à sa personne, et d’autre part le soutien dans la recherche d’un contrat de travail libéré de tout employeur par un service public de la qualification qui remplacera Pôle-emploi et l’actuel marché scandaleux de la formation professionnelle continue.
« Il s’agit de passer de la fierté de travailler pour mériter d’acheter à la fierté de décider de la production, la fierté de la souveraineté sur le travail dans des emplois communistes. »
Il s’agit de passer de l’emploi capitaliste à l’emploi communiste, exercice concret du travail sans employeurs par des citoyens qualifiés dans le cadre d’un contrat hors de toute subordination. Il s’agit de sortir du salaire capitaliste en poursuivant la conquête du salaire communiste, droit politique de toute personne majeure jusqu’à sa mort. Il s’agit de passer de la fierté de travailler pour mériter d’acheter à la fierté de décider de la production, la fierté de la souveraineté sur le travail dans des emplois communistes.
Poser le salaire comme un préalable au travail et non pas comme son résultat, voilà un nouveau front de l’action collective, difficile à assumer, je le constate. On le voit à la CGT : depuis vingt-cinq ans elle claudique sur le pied familier de la revendication du « plein emploi », dans lequel chacun est sur un poste qualifié, et sur le pied, affirmé comme prioritaire dans chaque congrès mais jamais réellement mis en œuvre, d’un nouveau statut du travailleur qui généraliserait le conquis du salaire à la qualification personnelle dans une « sécurité sociale professionnelle » portée par le mot d’ordre « la qualification doit passer du poste à la personne ». Une sécurité sociale professionnelle qui combat donc le marché du travail mais que la CGT a souvent du mal à distinguer de la « sécurisation des parcours professionnels » de la CFDT, qui elle le régule. Et qu’elle ne parvient pas non plus à distinguer du plein emploi car pour elle le contrat de travail demeure le support des droits économiques.
LVSL : Certes, mais n’est-il pas important que chaque majeur puisse exercer effectivement sa qualification dans un emploi ? N’est-ce pas comme cela qu’il faut comprendre la réticence devant la généralisation du salaire que vous entendez comme droit politique ?
B. F. : Oui, Fabien Roussel a répété dans la campagne présidentielle qu’il préférait le travail universel au revenu universel, et nombre de camarades craignent que la proposition d’attacher un revenu à la personne soit le signal d’un abandon de toute ambition en matière d’emploi pour tous, déjà hélas visible dans la fin de tout volontarisme de l’État en matière de production. Cette position très partagée appelle plusieurs remarques.
« Le salaire à la qualification personnelle n’est pas un revenu universel, reconnaissant des besoins de la naissance à la mort. Ce n’est pas en tant qu’êtres de besoins que les personnes sont reconnues, mais en tant que citoyennes décisionnaires sur le travail et la production, et c’est pourquoi la qualification est liée à la majorité politique. »
Premièrement, je le répète, ce n’est pas un revenu qu’il s’agit d’attribuer aux personnes majeures, mais une qualification et donc un salaire. Le salaire à la qualification personnelle n’est pas un revenu universel, reconnaissant des besoins de la naissance à la mort. Ce n’est pas en tant qu’êtres de besoins – comme dans le capitalisme qui voit dans le salaire un revenu, un pouvoir d’achat – que les personnes sont reconnues, mais en tant que citoyennes décisionnaires sur le travail et la production, et c’est pourquoi la qualification est liée à la majorité politique. Le salaire capitaliste, c’est un pouvoir d’achat dépendant de la validation de telle activité par la bourgeoisie, alors que le salaire communiste pose toute personne majeure comme qualifiée, c’est-à-dire décidant de la définition de ce qui a valeur et concourant à sa production.
Deuxièmement, il faut bien sûr qu’une production de valeur corresponde à la monnaie émise pour verser les salaires, et concourir à la production suppose que la qualification soit mise en œuvre dans des contrats de travail débarrassés de leur définition capitaliste par la subordination. L’exercice d’un travail concret validé comme productif par la décision commune a grande valeur anthropologique. « Le travail universel » est, lui, un mot d’ordre réactionnaire. Ce n’est pas le travail en tant que tel qui a valeur anthropologique – sinon vive l’esclavage ! –, mais le travail exercé en toute souveraineté, dont l’objet et les méthodes relèvent de la décision commune. Et qui est donc le fait de citoyens qualifiés, pas de titulaires d’une force de travail. Des citoyens qualifiés soutenus dans la mise en œuvre effective de leur qualification, à la fois par le syndicalisme et par un service public de la qualification.
Troisièmement, mettre en œuvre la souveraineté commune sur le travail, contre son monopole par la bourgeoisie capitaliste, suppose un déplacement de la pratique militante des organisations de travailleurs, jusqu’ici peu mobilisées sur la maîtrise du travail, tant concret qu’abstrait. La naturalisation de la désignation de l’aliénation au travail par le terme médical de « souffrance au travail » signale cette acceptation collective de mener des travaux avec lesquels on est en désaccord. Tant que, collectivement, les travailleurs accepteront de produire dans « la souffrance », soit des objets qu’ils récusent, soit dans des conditions qu’ils récusent, aucun passage significatif au communisme ne sera possible. L’urgence de la rupture écologique aidera, je l’espère, à ce déplacement. La rupture écologique ne peut pas passer par une bonne politique industrielle menée d’en-haut par un bon État assurant le plein de bons emplois, illusion qui reste malheureusement l’horizon de la gauche.
La clé d’une bonne politique industrielle permettant l’exercice par chacun de sa qualification dans le respect des conditions de notre vie sur la planète, ce sont des entreprises débarrassées de la mise en valeur du capital et gérées par les citoyens, et par eux seuls, et des fonctions collectives étatiques – de création monétaire, de choix des investissements, d’aménagement du territoire, d’échanges internationaux, etc. – gérées elles aussi par les seuls citoyens. Des citoyens qualifiés et donc titulaires de leur salaire : toute rupture écologique sera impossible tant que les droits économiques seront liés à l’emploi. Si le salaire reste lié à l’emploi, ce n’est pas moi qui irai faire la morale écologique à des travailleurs défendant leurs droits, et donc leur emploi, fût-il de merde. Je me bats pour que leurs droits, et au premier rang leur salaire, ne dépendent plus de leur emploi, et donc que les suppressions, conversions et créations d’activités selon les critères écologiques soient possibles.
Ma remarque finale, inséparable des précédentes, porte sur la marginalisation de la tentation fasciste, une urgence, là aussi. Toute proposition du type « le plus important, c’est que chacun ait un emploi afin que personne n’ait de ressources sans contrepartie productive » ne peut pas vaincre le ressentiment contre « les assistés », qui est une composante de l’adhésion au fascisme. Pourquoi ? Parce que cette proposition que chacun ait un bon emploi générant un bon salaire partage avec le ressentiment qu’elle veut combattre l’adhésion aliénée à la pratique capitaliste du salaire mérité par le travail. En finir avec le préalable au salaire que serait le travail, inverser une représentation à ce point aliénée à la pratique capitaliste du travail, poser le salaire communiste comme la condition de la production contre le salaire capitaliste posé comme sa conséquence, c’est un immense champ, aujourd’hui en friche, d’une action politique victorieuse contre la montée en puissance du fascisme.
LVSL : Justement, la rentrée politique a été marquée à gauche par un regain d’intérêt vis-à-vis de la question du travail, et de la place qu’elle doit occuper dans un projet politique émancipateur et tourné vers la victoire. Que vous inspire ce débat ? Pensez-vous qu’il puisse aboutir à ce que la gauche renoue avec la volonté d’« émanciper le travail », pour reprendre le titre d’un de vos ouvrages ?
B. F. : Le parti communiste n’a pas abandonné les travailleurs au bénéfice des victimes de discrimination au cours des dernières décennies : laissons cette accusation absurde aux pourfendeurs d’un wokisme fantasmé et à ceux qui disqualifient la si décisive lutte contre les discriminations comme une diversion de la lutte de classes. La souveraineté sur le travail ne peut pas se construire sans égalité des genres, des âges et des couleurs de peau. Pour m’en tenir à ce seul exemple, l’indifférence de la très grande majorité des travailleurs de la métropole au massacre de Sétif en mai 1945 a évidemment amputé, et pour longtemps, leur puissance de classe.
« Ce qui est sûr, c’est que la désindustrialisation, les délocalisations d’activités, ont considérablement affaibli les organisations de classes et leur capacité à susciter un vote de classe, alors qu’on ne peut pas laisser sans réagir fortement toute une fraction des travailleurs se tourner vers le RN. »
Que les choses bougent sur tous ces terrains ne peut être que salué comme une montée en puissance de la classe révolutionnaire. Quant à la question du poids du discours sur le travail dans les différences géographiques des résultats électoraux entre les métropoles et les périphéries, je laisse à des collègues spécialistes de sciences politiques le soin d’intervenir. Ce qui est sûr, c’est que la désindustrialisation, les délocalisations d’activités, ont considérablement affaibli les organisations de classes et leur capacité à susciter un vote de classe, alors qu’on ne peut pas laisser sans réagir fortement toute une fraction des travailleurs se tourner vers le RN. Comment restaurer cette capacité ?
Le prétendu débat sur le travail que vous évoquez a malheureusement été parasité par un concours de petites phrases qui témoigne, là encore, d’un déficit plus profond que la manie communicante. La gauche a sur le travail un discours et surtout des pratiques d’une extrême faiblesse. Vous évoquez à juste titre la volonté d’émanciper le travail : c’est pour moi le cœur de la question. Et il ne s’agit pas pour la gauche de « renouer » avec elle, car elle ne l’a jamais eue comme volonté prioritaire, pas davantage que les syndicats. Je renvoie aux travaux de collègues comme Thomas Coutrot qui a sous-titré un de ses ouvrages consacré à la liberté du travail « pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer ».
Je suis un chercheur passionné, et admiratif, des conquis des organisations de classe en matière de droit du travail et de droits des travailleurs. Mais ces conquis en matière d’emploi, dans le privé, ou de qualification personnelle, dans la fonction publique, n’ont pas leur équivalent en matière de travail. Et quand je parle de travail, c’est l’objet du travail, son contenu, pas simplement ses « conditions », que les entreprises libérées et autres logiques managériales sont prêtes à négocier.
« Des chercheurs comme Yves Clot font le même constat : quand est-ce que le savoir des travailleurs, leur métier, leur bonheur de bien travailler, sera posé par la gauche au cœur de la culture et de la politique ? »
Je constate que la conquête de la souveraineté sur le travail concret, sur son organisation, sur son objet, n’a été que très minoritairement à l’ordre du jour des mobilisations collectives. Et que la construction du travail comme temps libre est étrangère à une gauche qui identifie ce dernier au hors travail. Des chercheurs comme Yves Clot font le même constat : quand est-ce que le savoir des travailleurs, leur métier, leur bonheur de bien travailler, sera posé par la gauche au cœur de la culture et de la politique ? Quand est-ce qu’elle parlera de travail communiste, de salaire communiste, d’emploi communiste ? Quand est-ce que l’entreprise communiste et l’État communiste seront au centre de son programme ? Construire la classe révolutionnaire comme classe des travailleurs se joue sur la maîtrise du travail.
LVSL : À quelle échelle cette citoyenneté sur la production peut-elle s’exercer et comment peut-elle être encadrée ?
B. F. : Tout l’enjeu est justement de désencadrer, de susciter l’initiative, de la rendre désirable chez des citoyens qui ont été socialisés dès l’enfance à la délégation, à l’attente qu’un autre décide. La souveraineté sur le travail ne peut se construire que dans un processus de démocratisation de toutes les décisions. Pour en revenir au non-débat sur le travail qui vient d’affliger la gauche, lorsque sont par exemple évoquées à juste titre toutes les compétences professionnelles qu’il va falloir susciter, tous les emplois qu’il va falloir créer pour assurer la rupture écologique, la question de la décision démocratique n’est pas au cœur du propos : confiance est faite dans des assemblées territoriales de délégués d’organisations représentatives, dans l’expertise scientifique, dans les institutions de formation, dans un parlement débarrassé de ses godillots.
Mais ce sont précisément autant de lieux qui existent, qui assument aujourd’hui la folle fuite en avant capitaliste. Leur démocratisation est une entreprise aussi considérable que prioritaire, qui suppose au moins deux choses à notre portée parce que vivantes dans un déjà-là communiste. D’une part la généralisation à tous les majeurs du salaire comme droit politique, distribué, sans endettement, préalablement à l’acte de production. D’autre part, le bilan et la généralisation de toutes les procédures de décision collective et de dépassement des dominations naturalisées en train de s’expérimenter partout comme autant d’éléments de construction de la classe révolutionnaire.
« La création monétaire est également un enjeu de souveraineté populaire sur la production. »
Quant à l’échelle, il y a un exercice local et un exercice national de la chose publique, qui sont articulés mais différents. La citoyenneté économique doit donc s’exercer à plusieurs niveaux, et en premier lieu dans l’entreprise, évidemment. Je ne vois pas comment on pourrait être souverain sur le travail, si l’on n’est pas souverain sur le travail concret que l’on met en place dans l’entreprise. La création monétaire est également un enjeu de souveraineté populaire sur la production. Par conséquent, il doit revenir aux citoyens de décider de la création monétaire. C’est aussi le cas des enjeux territoriaux : continue-t-on la folie de la métropolisation et des déserts qui se forment autour des métropoles, ou diffuse-t-on le tissu économique de façon plus harmonieuse sur le territoire ?
C’est à tous ces niveaux que les citoyens doivent être les décideurs. Au niveau macro-économique, de telles fonctions collectives assurées par les citoyens eux-mêmes constituent l’État communiste que nous évoquons, Frédéric Lordon et moi, dans En travail [2]. Par exemple la gestion par les travailleurs du régime général de sécurité sociale entre 1946 et 1967 constitue des prémices d’un tel État communiste, contre l’« État social » que la classe dirigeante met en œuvre avec détermination depuis la Première Guerre mondiale, comme le montre Nicolas Da Silva dans La bataille de la Sécu [3]. C’est un ouvrage très roboratif dont je recommande la lecture, car il dessille les yeux de lecteurs nourris d’une image positive de l’État social alors qu’il est une arme de la classe dirigeante contre l’autonomie des travailleurs.
LVSL : Venons-en plus précisément à cet autre enjeu démocratique qu’est celui de la Sécurité sociale. L’actualité récente a montré le désir majoritaire, y compris au sein des institutions politiques et du gouvernement, d’en finir avec les mutuelles et complémentaires au profit du modèle de la Grande Sécu. Comment percevez-vous ce contexte général ? Que nous dit-il en termes de rapports de force historique entre ces acteurs et quels pièges éviter dans le projet de “Grande Sécu” proposé par Macron ?
B. F. : En 1946-1947, le régime général s’est construit contre la Mutualité, avec une gestion à base syndicale. Ce sont les fonctionnaires qui ont hélas sauvé la Mutualité : certes ils ont rejoint le régime général en matière de santé en décembre 1946, mais la loi Morice de 1947 a confié à leurs mutuelles la gestion au premier franc de l’assurance maladie. Depuis ce moment-là, les mutuelles de la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) sont des concurrentes du régime général, auquel elles imposent en plus le coût des remises de gestion. Elles n’en ont jamais été des partenaires. C’est contre la Mutualité française d’ailleurs que la CGT, très présente dans le régime général, avait créé dans les années 1950 ses propres mutuelles, qui ont malheureusement rejoint la FNMF dans le grand bradage du patrimoine communiste opéré dans les années 1990.
Le 100% Sécu porté par la gauche suppose évidemment que les caisses et les personnels de la Mutualité, ses locaux, intègrent le régime général, tout comme, en 1946, les communistes ont intégré dans le régime général les multiples régimes qui existaient en matière de retraite, de santé et de famille. Et, par ailleurs, des mutuelles ont une pratique de centres de santé et de prévention tout à fait intéressante qu’il s’agit bien sûr de conserver. L’idée est que la Mutualité ne rembourse plus rien et que la Sécu rembourse absolument tout, sans reste à charge pour les soignés. Cela suppose bien sûr que la prétendue « convention de secteur 2 », qui permet des dépassements d’honoraires, soit supprimée et que la convention de secteur 1, redevenue unique, soit revalorisée.
« Le projet de Grande Sécu de Macron s’inscrit dans les politiques des quarante dernières années. Macron est un « bébé Rocard » : on ne comprend Macron que par Rocard. »
Chez Macron, il ne s’agit pas du tout d’en finir avec la Mutualité. Il s’agit au contraire de faire de la Mutualité le modèle du dispositif. Le projet de Grande Sécu de Macron s’inscrit dans les politiques des quarante dernières années. Macron est un « bébé Rocard » : on ne comprend Macron que par Rocard. En résumé, le démantèlement de l’assurance maladie au profit des mutuelles est une tragédie en trois actes, indissociable de ce qui s’est passé en matière de retraite avec les régimes complémentaires, posés eux aussi comme modèles à généraliser contre le régime général.
Le premier acte remonte à la révision du Code de la Mutualité en 1985 et à la loi Évin de 1989 qui crée un marché des complémentaires de santé. Avec dans la foulée l’invention de la distinction entre assurance maladie obligatoire (AMO) et assurance maladie complémentaire (AMC). Cette évolution sémantique des années 1990 n’est pas innocente. D’une part, elle est frauduleuse car dans le régime général, on cotise selon ses moyens et on est remboursé selon ses besoins alors que les mutuelles, comme les assurances capitalistes, remboursent en fonction du montant des cotisations choisi dans un menu. D’autre part, un espace légitime est ainsi ouvert face à l’assurance maladie qualifiée d’obligatoire alors qu’elle était jusqu’ici l’assurance maladie tout court : il n’y avait qu’une assurance maladie, celle du régime général, et elle était montée en puissance entre 1945 et les années 1980 à la place tant du reste à charge que des complémentaires. Conséquence du gel du taux de cotisation au régime général à partir des années 1980, c’est cette montée en puissance qu’entend stopper le gouvernement Rocard à la suite de ceux de la première cohabitation Chirac : le couple Rocard-Seguin est l’initiateur de ce que la novlangue va désigner comme « nécessaire réforme de la sécurité sociale ».
Le second acte est celui de l’extension à la santé de la Contribution sociale généralisée (CSG) avec la construction de la logique du « panier de soins ». Lorsque Lionel Jospin supprime la cotisation salariale à l’assurance maladie en 1997 pour la remplacer par la CSG, il opère un acte politique majeur contre le régime général d’assurance maladie. Le remplacement de la cotisation par la CSG accompagne une distinction née au début des années 1990 entre des « besoins universels » et des prestations spécifiques. Les besoins universels de soins sont financés par l’impôt à travers la CSG – c’est le « panier de soins » –, tandis que les prestations spécifiques doivent suivre la logique du marché : « j’ai cotisé tant, j’ai droit à tant ». Toutes ces distinctions (obligatoire/complémentaire, universel/spécifique que viennent redoubler les binômes non contributif/contributif et premier/second piliers) qui s’opèrent dans les années 1990 sont absurdes, sans aucun fondement autre que d’en finir avec l’originalité du régime général et de créer les conditions de la marchandisation capitaliste des soins.
Car, évidemment, les « prestations spécifiques » ont vocation à devenir majoritaires, le panier de soins étant en permanence rogné. Et les mutuelles en sont le cheval de Troie parce qu’elles apparaissent vertueuses, sans but lucratif. Pourtant, dans les faits, elles ont une logique financière identique à celle des gros assureurs privés comme AXA, et leurs directions viennent en général du monde de la finance. On trouve les mêmes tentacules européens dans ces mutuelles qui, parce qu’elles ont choisi d’appartenir au second pilier des institutions de prestations sociales, celui de la concurrence entre entreprises sur le « marché unique » (le premier pilier, la dite AMO, étant sorti du marché en invoquant la solidarité) n’ont plus rien de non-capitaliste dans leur fonctionnement.
« À la place de la logique du régime général de Sécurité sociale « de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins » s’imposerait alors celle du « j’ai cotisé, j’ai droit », qui est une marchandisation capitaliste du rapport aux soins. »
Enfin, le troisième acte est celui de l’obligation du financement de la complémentaire par les employeurs. Là, c’est François Hollande qui est à la manœuvre lorsqu’il instaure en 2016 cette obligation légale pour le secteur privé, dans la foulée de l’Accord national interprofessionnel (ANI) passé en 2013 entre la CFDT et le MEDEF. Le projet de la classe dirigeante, qui s’appuie sur cette obligation, est tout à fait clair. Puisque depuis 1997 seuls les patrons financent par cotisations l’assurance maladie et que, d’autre part, ils financent la mutuelle, il s’agit de faire un seul pot, qui va s’appeler la Grande Sécu, en fusionnant mutuelle et assurance maladie, mais dans la logique des mutuelles. On conservera un panier de soins de base, qui sera de plus en plus de base, financé par la CSG, tandis que la couverture d’une part croissante des soins sera assurée par une cotisation unifiant les cotisations patronales à la mutuelle et à l’assurance maladie. À la place de la logique du régime général de Sécurité sociale « de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins » s’imposerait alors celle du « j’ai cotisé, j’ai droit », qui est une marchandisation capitaliste du rapport aux soins.
Cette dérive de la branche santé de la Sécurité sociale est exactement la même que celle de sa branche vieillesse [4]. En 1947, le ministre communiste du Travail Ambroise Croizat inaugure un alignement des pensions du régime général sur celles de la fonction publique : elles sont calculées sans tenir compte des cotisations, comme remplacement d’un salaire de référence. Il le fait contre le régime des Assurances sociales qui reposait sur le « j’ai cotisé, j’ai droit », que le patronat s’empresse de réimposer dès 1947 dans le régime complémentaire de retraite des cadres, l’AGIRC, avant de l’étendre à tous les salariés du privé dans l’ARRCO. Nicolas Castel et moi avons montré dans le séminaire de la Bourse du Travail de Réseau Salariat, qui vient de paraître au Croquant sous le titre : Retraites, généraliser le droit au salaire, que toute la « nécessaire réforme » des pensions initiée par le couple Seguin-Rocard a distillé la petite musique du « j’ai cotisé, j’ai droit » contre le droit au salaire continué qui, malgré les coups de boutoir, représente encore les trois-quarts des pensions.
Tout cela aboutit à la réforme Macron de régime unique généralisant l’Arrco-Agirc. Qu’il dise aujourd’hui renoncer à l’unification, tout en mettant en extinction les régimes statutaires et le régime de la fonction publique, montre que le cap sera tenu : en finir avec la logique du salaire continué. Ce qui montre qu’une Grande Sécu de gauche doit évidemment concerner la retraite : suppression des régimes complémentaires et du « j’ai cotisé, j’ai droit », régime unifié de continuité du salaire. Et elle doit concerner aussi, bien sûr, le chômage : maintien de 100% du salaire entre deux emplois, contre la « nécessaire réforme » qui depuis plusieurs décennies met en cause le droit au salaire des chômeurs pour lui substituer un droit au différé de cotisations.
J’en profite pour souligner combien « la cotisation » n’est pas en soi une institution progressiste. Comme pour toutes les institutions du travail, il faut distinguer cotisation capitaliste et cotisation communiste. La cotisation qui fonde un différé de ressources est capitaliste, car elle vise soit à remettre le salaire dans le carcan de l’emploi (sans emploi, on n’a pas droit à du salaire mais au différé de cotisations) soit à créer un marché des prestations de soins (j’ai des droits à proportion de mes cotisations). Alors que n’est communiste que la cotisation qui dissocie le salaire de l’emploi pour l’attacher à la personne et qui dissocie la prestation du montant de la cotisation. Il faut même aller encore plus loin et s’interroger sur la nécessité d’une cotisation dans la dynamique de construction du communisme.
LVSL : En effet, vous faites allusion dans En travail à des travaux récents du groupe thématique « économie du salaire à vie » de Réseau Salariat…
B. F. : Jusqu’ici, notre réflexion à Réseau Salariat sur le financement du salaire à la qualification personnelle ne mettait pas en cause sa réalité actuelle : 45% du salaire total (qui ajoute au salaire brut les cotisations dites patronales) est constitué de prestations qui ne sont pas versées par l’entreprise mais par la caisse de sécurité sociale, grâce à une cotisation qui socialise le salaire en socialisant la valeur ajoutée. Nous proposons de poursuivre ce mouvement en changeant l’assiette des cotisations, qui ne serait plus la masse salariale mais la valeur ajoutée, et en augmentant massivement le taux de cotisation de sorte que le salaire à la qualification personnelle devienne le fait de tout majeur, 100% du salaire étant versé par la caisse de sécurité sociale.
Grâce en particulier aux contributions du groupe thématique « économie du salaire à vie » et du groupe local suisse à partir d’un ouvrage en cours d’écriture de Christian Tirefort, nous sommes en train de nous aviser que cette proposition de meilleure affectation de la valeur ajoutée reste aliénée au postulat qu’il y aurait un préalable à la distribution des salaires : la production. Il faudrait déjà produire une valeur ajoutée pour pouvoir, ensuite, distribuer des salaires. Or, ce préalable est au cœur de la marchandisation de la force de travail dans le capitalisme. Au contraire, il n’y a aucune raison que nos ressources dépendent d’une production préalable de valeur. Nos ressources sont la condition de la production, elles ne doivent pas en être le résultat. À ce titre, c’est le salaire qui est le préalable à la production, et non l’inverse.
Et cela ne vaut pas que pour les biens et services de consommation, mais aussi pour les biens de production de ces produits finaux, les machines et les consommations intermédiaires. Jusqu’ici, nous avons continué, à Réseau Salariat, à nous exprimer selon la terminologie classique d’affectation d’une partie de la valeur ajoutée au « financement de l’investissement ». Sauf qu’en nous inspirant de la large part de la création de l’outil hospitalier par subvention de l’assurance-maladie dans les années 1960, nous préconisons, en contradiction avec les pratiques dominantes, la suppression du crédit à l’investissement et sa subvention par socialisation de la valeur ajoutée. Cette fin de l’endettement des travailleurs est certes aussi importante que leur libération du marché du travail dans une dynamique de conquête de leur souveraineté sur la production, mais l’aliénation à l’inversion capitaliste demeure intacte. Qu’est-ce que j’entends par là ?
« L’acte même de travail, et les travailleurs, disparaissent sous les trois activités de prêt, d’investissement et de vente du produit final qui sont le monopole de la bourgeoisie capitaliste. Les seuls producteurs de la valeur, dépossédés de tout pouvoir sur elle, sont niés comme tels. »
L’inversion capitaliste est quelque chose qui apparaît comme tout à fait spectaculaire quand on se libère du catéchisme dont nous a biberonnés l’omniprésente religion d’État qu’est la religion capitaliste. La religion d’État nous enseigne ceci : au commencement était l’avance capitaliste par un prêt. Un prêt relevant soit de la création monétaire, soit d’une épargne « heureusement soustraite à la consommation irresponsable » et accumulée sur les marchés financiers. Cette avance à crédit, premier acte sacré, va permettre d’investir, second acte sacré, c’est-à-dire d’acheter les intrants de la production. Une fois le produit de cette production vendu – troisième acte sacré –, il faudra d’abord rembourser la dette et, avec ce qui reste, payer les travailleurs.
Le salaire arrive en dernier, et l’initiative de la production revient aux prêteurs-investisseurs-vendeurs. L’acte même de travail, et les travailleurs, disparaissent sous les trois activités de prêt, d’investissement et de vente du produit final qui sont le monopole de la bourgeoisie capitaliste. Les seuls producteurs de la valeur, dépossédés de tout pouvoir sur elle, sont niés comme tels. À l’inversion des choses – c’est du capital qui est avancé, et non pas des salaires – s’ajoute une inversion spectaculaire des mots : le travail est une dépense.
Il faut en finir avec cette religion d’État et son rituel sacré, mettre fin à l’avance à crédit et à l’investissement, dans les choses comme dans les mots. L’avance à crédit et l’investissement sont inutiles dès lors que, décidée par les citoyens-travailleurs, la création monétaire opère, sans aucun endettement, la distribution des salaires, seule avance nécessaire à toute la production, de l’extraction des matières premières à la fabrication des outils et à la production des biens et services finaux. Dans tout cela, il n’y a besoin que de salaires, des salaires préalables et non pas résultats.
« Il faut évidemment se préparer à mener une bataille à l’échelle européenne contre la dépolitisation de la Banque centrale, pour poser la création monétaire comme un des éléments au cœur de la citoyenneté. Mais sans attendre cette bataille frontale, nous devons retrouver à l’échelle nationale une capacité de création monétaire. »
Notre réflexion n’est pas totalement arrivée à maturité, mais en tout cas nous sommes en train de sortir d’une proposition de cotisation sur une valeur ajoutée préalable pour une proposition de création monétaire par distribution des salaires préalable à la production de valeur. Nous préconisons cette inversion complète de la logique capitaliste. De même que je mettais en cause la proposition chère à la gauche de prendre l’argent là où il est par la fiscalité, je pense maintenant que ce n’est pas la bonne cotisation qui va faire les choses, mais qu’il faut conquérir la souveraineté populaire sur la création monétaire, une création sans crédit. Qu’il soit public ou privé, il n’y a pas, en matière de production, de bon crédit : poser les travailleurs comme endettés avant même qu’ils travaillent relève de la même aliénation capitaliste que de les payer après qu’ils aient travaillé.
De ce point de vue, il faut évidemment se préparer à mener une bataille à l’échelle européenne contre la dépolitisation de la Banque centrale, pour poser la création monétaire comme un des éléments au cœur de la citoyenneté. Mais sans attendre cette bataille frontale, nous devons retrouver à l’échelle nationale une capacité de création monétaire. Des travaux comme ceux de Bruno Théret montrent que c’est possible, y compris dans le cadre des traités européens.
LVSL : Comment repenser la gouvernance de la « grande sécurité sociale » telle que vous la concevez avec ses fonctions élargies de socialisation de la valeur et de démocratie économique ? Faut-il par exemple ajouter des acteurs de la société civile, comme les associations de défense du climat, de la biodiversité, les représentants des organisations paysannes, et les chercheurs en santé environnementale pour prendre en compte l’impact systémique de l’alimentation sur la nature et la santé ?
B. F. : La fin de votre question ouvre fort justement le champ de la Grande Sécu très au-delà des branches actuelles, vieillesse, santé, famille. Ce sont toutes les productions qui peuvent être mises en sécurité sociale en reprenant les principes de la mise en sécurité sociale de la production de soins dans les années 1960 : part croissante des salaires en monnaie marquée solvabilisant les consommateurs et usagers auprès des seuls producteurs conventionnés, extension du salaire à la qualification personnelle à tous les professionnels conventionnés, que la caisse de sécurité sociale paie en même temps qu’elle subventionne leur investissement.
« Sortir de l’agro-business par une sécurité sociale de l’alimentation nous libérera de la malbouffe et aura des effets positifs sur notre santé, sur celle des sols et sur la biodiversité. »
Avec d’autres organisations, nous avons engagé à Réseau salariat une réflexion [5] sur une Sécurité sociale de l’alimentation, de la culture, du transport de proximité, du logement, des services funéraires, et bien d’autres fonctions collectives feront l’objet d’un même travail. Le séminaire de la Bourse du travail organisé par le groupe Grand Paris de Réseau Salariat va porter cette année sur la sécurité sociale de la culture [6]. Toutes ces sécurités sociales sont évidemment articulées les unes aux autres. Le lien que vous établissez entre alimentation et santé est très important. Sortir de l’agro-business par une sécurité sociale de l’alimentation nous libérera de la malbouffe et aura des effets positifs sur notre santé, sur celle des sols et sur la biodiversité.
Pour ce qui est de la gouvernance de cette « grande sécurité sociale », il en va de même que pour la totalité de nos institutions, de la gouvernance des entreprises, du service public, du lieu de création monétaire. Se pose d’abord la question d’une compétence territoriale ajustée, avec des assemblées qui soient au bon niveau territorial, parce que toute décision n’est pas nationale et toute décision n’est pas locale : une entreprise en réseau doit plutôt être gérée au niveau national, tandis qu’une boulangerie devrait évidemment l’être au niveau du quartier.
À ces compétences territoriales extrêmement diverses s’ajoute la diversité des codécidants, dont vous évoquez pour l’alimentation une liste avec laquelle je suis tout à fait d’accord. Les mises en sécurité sociale poseront des questions démocratiques très vives sur les critères de conventionnement, sur les biens et services à produire, tout comme les jurys de qualification devront établir des modes de fonctionnement laissant toujours ouvert le caractère politique de leurs décisions. Bien sûr les travailleurs concernés font partie des codécideurs : j’ai insisté sur le trésor de savoir-faire et de que-faire, aujourd’hui laissé à l’abandon, quand il n’est pas combattu par un management imbécile, et dont sont porteurs les métiers. Mais il serait mauvais de laisser seuls ces travailleurs. Par exemple on a très bien vu, pour le soin, combien le sida avait été l’occasion de poser les patients comme acteurs des décisions en matière de santé. Il s’agit de partir de ce type d’expériences, et de nombreuses initiatives qui ont eu cours pendant le confinement, de mise en lien d’acteurs associatifs, de la « société civile » et de chercheurs qui, jusqu’ici, communiquaient peu ensemble.
En tout cas, la démocratisation du travail, cœur du communisme, ne peut pas s’opérer par l’en-haut d’une postulée bonne politique d’État. Comme le montrent des travaux comme ceux de Barbara Stiegler, l’absurde gestion de la pandémie par Macron ne tient pas qu’au caractère autoritaire du personnage, c’est tout l’appareil de l’État capitaliste qu’il faut mettre en cause. Et là encore on ne s’appuie pas sur rien car, je le répète, toutes les initiatives prises aujourd’hui dans des champs et des institutions très divers pour organiser l’horizontalité dans la prise de décision font partie de la lutte de classes. La nécessaire dimension macrosociale du communisme passe par une radicale démocratisation de l’exercice des fonctions collectives qui va mettre en musique tout le foisonnement observé aujourd’hui en la matière : l’État communiste est à l’ordre du jour.
LVSL : Le secteur privé semble se positionner pour empêcher l’émergence d’une vraie sécurité sociale de l’alimentation, en confinant le débat public au « chèque alimentaire » prôné par le gouvernement et déjà récupéré et amendé par les intérêts privés. Comment distinguez-vous la logique du gouvernement et des industriels de votre modèle ?
B. F. : La sécurité sociale de l’alimentation suscite beaucoup d’intérêt. Je m’en réjouis et je ne me fais évidemment aucune illusion sur la tentative de récupération capitaliste dont elle va être l’objet. Le chèque alimentaire de Macron est aussi éloigné de notre proposition que l’est son pass’culture de la sécurité sociale de la culture à laquelle nous réfléchissons.
D’une part, le chèque alimentation cible « les pauvres ». Nous sommes là à l’opposé du régime général de Sécurité sociale de 1946, que nous voulons actualiser et généraliser à l’alimentation : il est universel précisément par refus d’une simple « solidarité avec les pauvres », cette pose répugnante de mépris de classe.
D’autre part, notre proposition d’abondement universel de la carte vitale pour accéder à une alimentation de qualité repose sur un conventionnement dont le but est de changer la production alimentaire, en ne conventionnant que des productions et des distributions alternatives à la grande distribution et à l’agro-business. Emmanuel Macron, au contraire, crée avec son chèque un marché captif pour l’agro-business et la grande distribution. On pourra le dépenser chez Carrefour, alors que Carrefour ne serait évidemment pas conventionné, comme toute l’alimentation industrielle (y compris le faux « bio » de la grande distribution), dans notre proposition. Le cœur de la sécurité sociale de l’alimentation est de sortir de l’agro-business et d’impulser une véritable démocratie de la production et de la consommation. Je vous renvoie aux travaux de Réseau Salariat et de partenaires comme Dominique Paturel, par exemple, qui ont produit un travail remarquable sur ces questions de démocratie alimentaire, du point de vue tant des mangeurs que des producteurs.
La nature du financement de ces sécurités sociales sectorielles est l’objet de discussions en cours à Réseau Salariat, comme je l’ai évoqué tout à l’heure. Dans l’ouvrage que nous avons co-écrit récemment avec Frédéric Lordon, En travail, conversations sur le communisme, j’expose une proposition reposant sur la nécessité d’augmenter d’urgence les salaires. Pour faire simple, une hausse des salaires, et en particulier du SMIC de 500€, pourrait ne pas être versée sur un compte en banque, mais prendre la forme d’une monnaie marquée : ces 500€ de hausse du SMIC seraient versés à des caisses de sécurité sociale de l’alimentation, du transport, de l’habitat ou de la culture, qui sont autant de besoins quotidiens et immédiats.
Mais il est hors de question qu’un tel dispositif ne concerne que les bas salaires. Si l’on décide de n’augmenter par exemple que les salaires inférieurs à 3 500 euros net, pour un salaire de 3 500€, l’alimentation de ces caisses sectorielles pourrait prendre la forme d’une conversion de 500 de ces 3 500€ en monnaie marquée. C’est-à-dire que l’intéressé disposerait de 3 000€ sur son compte et de 500€ sur sa carte. Avec, pour les situations intermédiaires entre les 1700 euros du nouveau SMIC et les 3 500 euros du plafond de la hausse, 500 euros de monnaie marquée correspondant à un mixte de hausse du salaire et de sa conversion partielle.
Si tous les salaires comportent 500€ de monnaie marquée supplémentaire – soit par une hausse des salaires, soit par une conversion d’une partie du salaire en monnaie marquée, soit par un mixte des deux – les nouvelles caisses de sécurité sociale disposeraient de plus de la moitié de ce dont dispose l’actuelle sécurité sociale. Parmi ces sommes, 80 milliards suffiraient à affecter 100€ par personne et par mois à une alimentation alternative, ce qui couvrirait le tiers du marché de l’alimentation.
LVSL : Face à cet enjeu de la répartition des alternatives sur l’ensemble du territoire, croyez-vous que l’on puisse se passer d’une impulsion de l’État pour créer une offre suffisante et également accessible ?
B. F. : Il faut d’abord qu’il y ait une impulsion monétaire : le capitalisme s’accommode parfaitement d’alternatives confinées dans la marge. Si l’on crée en matière d’alimentation un marché de 80 milliards d’euros réservé aux producteurs, distributeurs et restaurateurs alternatifs, cela va évidemment sortir de la marge toutes les alternatives actuelles en matière d’alimentation, et en encourager de nouvelles. Il faut également qu’une partie des sommes collectées par la caisse de sécurité sociale de l’alimentation aille non pas immédiatement à la consommation de biens alimentaires, mais à l’installation de nouveaux paysans (c’est très urgent si nous voulons éviter l’agriculture sans paysans que sont en train de nous concocter la FNSEA et ses alliés de la recherche et de l’enseignement agricoles) et à la conversion de producteurs et de distributeurs de l’agro-business vers une fourniture alternative d’alimentation.
En ôtant le tiers de son marché à la grande distribution capitaliste de l’alimentation, nous la mettrons heureusement en péril et nous aurons à soutenir ses salariés pour qu’ils convertissent leur entreprise en entreprise conventionnable, et donc, entre autres, sans actionnaires ni prêteurs capitalistes : occasion soutenue macro-économiquement d’une prise de pouvoir des travailleurs sur leur travail, ce lieu décisif du passage au communisme.
Cela vaut pour l’alimentation mais, à partir du moment où l’on parle de 500€ par salarié et par mois, il faut évidemment étendre la réflexion à d’autres champs, comme les transports de proximité et en particulier la mise en place du dernier kilomètre autrement que par la voiture individuelle. Le problème n’est pas de passer à la voiture électrique, une aberration écologique qui offre un incroyable débouché pour les entreprises capitalistes de l’automobile. Mais cette imposture ne peut être dénoncée que si on crée l’inutilité de la voiture individuelle. Cela suppose une gestion correcte du dernier kilomètre, parce que, de fait, aujourd’hui, la voiture individuelle est nécessaire notamment dans les territoires très peu reliés à des transports en commun commodes et à forte périodicité.
« C’est une affaire d’impulsion étatique, oui, mais à condition que les fonctions collectives d’État soient gérées par les intéressés eux-mêmes. Tant qu’il est capitaliste, l’État est un adversaire. Raison de plus pour continuer à construire un État communiste, comme nous avions commencé à le faire avec le régime général en 1946. »
Cela suppose encore une fois d’en finir avec le processus de métropolisation, et cela vaut d’ailleurs aussi pour tous les services publics : pour l’école, pour la poste, pour l’hôpital ou pour les maternités. Il faut renouer avec la dynamique de maillage territorial qu’avait su mettre en place la sécurité sociale du soin, quand elle n’était pas attaquée comme elle l’est depuis quarante ans. C’est une affaire d’impulsion étatique, oui, mais à condition que les fonctions collectives d’État soient gérées par les intéressés eux-mêmes. Tant qu’il est capitaliste, l’État est un adversaire. Raison de plus pour continuer à construire un État communiste, comme nous avions commencé à le faire avec le régime général en 1946 et comme, je le répète, l’actuel foisonnement des initiatives de délibération collective de la chose publique nous y invite.
LVSL : Vous avez évoqué votre dernier ouvrage, En travail, écrit avec Frédéric Lordon avec la volonté de remettre en avant l’idée de communisme. Pensez-vous que la conjoncture actuelle, qui met au centre des préoccupations le pouvoir d’achat et la question sociale, peut mener à une revalorisation positive de l’idée communiste ?
B. F. : Pour cela, il faudrait que le communisme soit à l’ordre du jour des mobilisations organisées par les syndicats et les partis de l’Union populaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui mais peut advenir, en tout cas je l’espère !
Le climat de cette rentrée ne déroge pas avec un constat très ancien : lorsqu’il y a proposition à gauche, c’est « l’écosocialisme », la « république sociale », la « démocratie avancée », le ou les « communs », en tout cas pas le communisme. Cette absence ne s’explique pas d’abord, comme on le dit trop souvent, par la disqualification du mot « communisme » assimilé à la dictature stalinienne. Mettre le communisme au cœur d’une proposition pour aujourd’hui (et non pas l’y « remettre » car précisément ça n’a jamais été le cas, et c’est bien le problème !), ça n’est pas simplement lever l’autocensure sur un mot. C’est se libérer de tout une culture militante séculaire qui se réclame volontiers de Marx mais ne pratique pas sa lecture dialectique du capitalisme.
Cette culture militante a construit ce que Bernard Vasseur [7] désigne à juste titre comme un « étapisme » : d’abord la prise du pouvoir d’État, puis le socialisme, enfin le communisme. Le communisme est un horizon éloigné, la présence ici et maintenant d’un déjà-là communiste est niée au nom du dogme : « pas d’îlot de socialisme, et évidemment de communisme, dans le capitalisme ». Le capitalisme est analysé comme un système où la reproduction l’emporte sur la contradiction, où la classe révolutionnaire est incapable d’imposer des institutions alternatives à celles du capital, car le préalable à une telle imposition est la prise du pouvoir d’État pour instaurer le purgatoire du socialisme avant le paradis du communisme, société de l’abondance sans travail et sans violence : le ciel non pas là-haut, mais plus tard, avec la fonction de tout ciel, consolation demain, renonciation aujourd’hui.
Lucien Sève a remarquablement montré que ce « marxisme-léninisme » construit par Staline n’a rien à voir avec Marx ni avec Lénine [8], mais le problème est que si les crimes du stalinisme sont depuis longtemps déjà condamnés par les organisations de classe des travailleurs, son imposture intellectuelle n’y a pas, jusqu’ici, été récusée, tellement le marxisme-léninisme a informé la pratique militante autour du préalable de la prise du pouvoir d’État. Dans le cas français, cela s’est traduit par l’emphase sur un programme gouvernemental de « démocratie avancée ». Toutes les anciennes et anciens de mon parti ont encore dans les yeux cette campagne d’affiches des années 1970 présentant dans un beau ciel bleu le slogan : « la France a un programme commun de gouvernement ».
Pourquoi est-ce que, cela dit, je suis confiant dans la venue du communisme à l’ordre du jour des mobilisations ? D’abord parce que je constate l’enthousiasme avec lequel les dissidents, aujourd’hui de plus en plus nombreux en particulier chez les jeunes, décidés à ne pas produire de merde pour le capital, accueillent les analyses du « déjà-là communiste » et contribuent à la proposition – et aux réalisations locales – de sa généralisation à laquelle travaille avec d’autres Réseau Salariat. Je l’ai déjà dit mais je le redis : je suis aussi ému qu’émerveillé de l’intelligence collective qui se déploie aujourd’hui autour du communisme.
Ensuite, parce que je pense que nos organisations de classe sont mûres pour un abandon de l’étapisme. Quarante ans d’échec, c’est long même pour des militants qui croient au communisme dans un futur radieux ! Qui parmi nous peut prendre pour autre chose qu’une pose de rentrée la proposition de financer la relance des services publics par une taxation des Gafam ? Alors que toutes les propositions de bonne fiscalité sont en échec depuis des décennies et qu’aucune campagne politique n’est lancée pour un statut communiste du citoyen. Dans lequel toute propriété lucrative est interdite. Dans lequel les seules ressources légitimes sont celles du salaire à la qualification, laquelle pourrait par exemple s’inscrire dans une fourchette de 1 à 3, avec donc un salaire maximum de 5 000 euros par mois si le salaire minimum est de 1 700 euros nets.
Qui peut adhérer à une dénonciation de l’enrichissement scandaleux des plus riches qui ne s’appuie pas sur le scandale qu’il suscite pour interdire les fondations, le mécénat, la propriété capitaliste des entreprises, et travailler à la popularisation d’une citoyenneté de la décision économique entre majeurs gagnants entre 1 700 et 5 000 euros par mois ?
À quel militant fera-t-on croire qu’un fonds européen pour le climat alimentera autre chose que du greenwashing (des voitures électriques, de la 5G « propre » et autres miroirs aux alouettes) dès lors que n’auront pas été conquis les droits de propriété d’usage des entreprises par des citoyens qualifiés ?
Tous les militants sont aujourd’hui saisis par le doute sur la légitimité de l’étapisme. Entre bien d’autres exemples je peux témoigner de l’intérêt croissant pour une mobilisation explicitement communiste, s’appuyant sur le déjà-là communiste du statut de la fonction publique et de la sécurité sociale du soin des années 1960, chez des militants en train de prendre conscience de ceci : le silence politique et syndical sur l’atteinte au statut de la fonction publique qu’est la suspension du traitement des fonctionnaires soignants suspendus pour non vaccination trouve son origine dans le refus des organisations de classe de voir le caractère communiste du statut et leur absence de volonté de le généraliser à tous les majeurs.
« Il n’y a plus adhésion au travail tel que la bourgeoisie capitaliste le définit et l’organise. Même les cadres n’y croient plus. Une partie croissante de la population souhaite sortir le travail de la folie, tant anthropologique qu’écologique, qu’il y a à produire pour le profit dans l’indifférence à l’utilité sociale. »
Enfin, la mise du communisme à l’ordre du jour de nos mobilisations immédiates est probable du fait de ce que j’ai remarqué dès le début de notre entretien : il n’y a plus adhésion au travail tel que la bourgeoisie capitaliste le définit et l’organise. Même les cadres n’y croient plus. Une partie croissante de la population souhaite sortir le travail de la folie, tant anthropologique qu’écologique, qu’il y a à produire pour le profit dans l’indifférence à l’utilité sociale de ce qui est produit. Que cela prenne la forme d’une « politique de la dissidence » [9] (avec quoi j’ai des divergences mais débattons-en !) ou d’une généralisation des débuts de politisation du travail qu’observent dans des entreprises Coralie Pérez et Thomas Coutrot [10], c’est tout un déplacement de la mobilisation collective qui est en train de s’opérer.
Quand une classe dirigeante ne suscite plus l’adhésion à ce qui fonde le fait qu’elle est classe dirigeante, à savoir la direction de la production, il y a évidemment péril démocratique car elle sort son joker fasciste, mais raison de plus pour que la lutte de classes s’inscrive clairement dans le passage au communisme, dans le changement du mode de production. Toute autre attitude serait irresponsable. L’aspiration à bien travailler et la prise en compte de notre devenir sur la planète ne peuvent trouver réponse que dans une dynamique communiste de souveraineté populaire sur le travail. Et pour ce faire, inutile d’inventer l’eau chaude, nous disposons, grâce aux conquis du siècle dernier et aux effervescences contemporaines, d’un déjà-là communiste à actualiser et à généraliser, dès maintenant.
Notes :
[1] Salariat, revue de Sciences sociales, n° 1 (octobre 2022) : « Droit à l’emploi, droit au salaire ? », Le Croquant.
[2] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, conversations sur le communisme, La Dispute, 2021.
[3] Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, La Fabrique, 2022.
[4] Nicolas Castel et Bernard Friot (dir.), Retraites : généraliser le droit au salaire, Le Croquant, 2022.
[5] Voir par exemple, chez Riot Editions, Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique d’Aurélien Catin (2020) et Régime général, pour une sécurité sociale de l’alimentation de Kévin Certenais et Laura Petersell (2021).
[6] Voir le calendrier sur le site de Réseau Salariat
[7] Bernard Vasseur, Sortir du capitalisme, actualité et urgence du communisme, Éditions de l’Humanité, 2022.
[8] Voir en particulier Lucien Sève, « Le communisme » ? Penser avec Marx aujourd’hui, tome 4, première partie, La Dispute, 2019.
[9] Bertrand Louart, Réappropriation, jalons pour sortir de l’impasse industrielle, Éditions La Lenteur, 2022.
[10] Thomas Coutrot et Coralie Pérez, Redonner sens au travail, une aspiration révolutionnaire, Seuil, La République des idées, 2022.