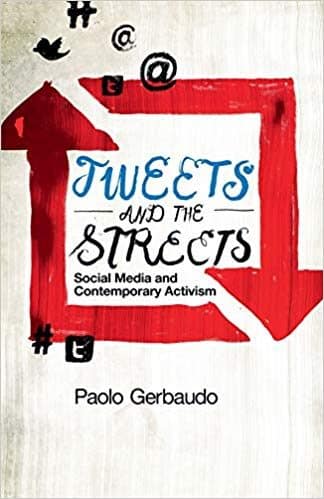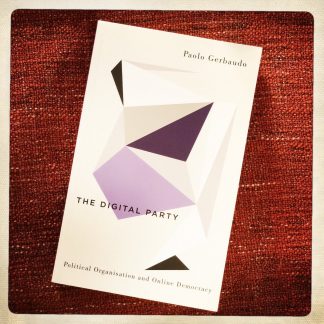La démission surprise de Luigi Di Maio de la direction du Mouvement 5 Etoiles a de nouveau démontré l’imprévisibilité du jeu politique italien. La probable victoire de la Lega aux élections d’Emilie-Romagne ce week-end devrait en effet affaiblir la surprenante alliance entre le M5S et le Partito Democratico, qui avait permis d’éviter des élections nationales suite au départ de Salvini à la fin de l’été 2019. Si Salvini est le favori des sondages, Matteo Renzi demeure toujours en embuscade, tandis que les néo-fascistes “frères d’Italie” (Fratelli d’Italia) progressent dans les intentions de vote. Pour décrypter le jeu politique transalpin, nous avons interrogé le politologue Pierre Martin, ingénieur de recherche au CNRS, enseignant à l’IEP de Grenoble et spécialiste de l’étude des élections. Retranscription par Dany Meyniel, interview par William Bouchardon.
LVSL – La coalition qui a émergée en Italie après les élections de mars 2018 a surpris tout le monde. Pourquoi le mouvement 5 étoiles a-t-il formé un gouvernement avec la Lega ?
Pierre Martin – Deux choix ont été déterminants dans cette affaire : celui du M5S de gouverner et celui de la Ligue de rejoindre ce gouvernement. Au départ, le Mouvement 5 Étoiles est un mouvement protestataire, centré sur le social, la réforme politique, la démocratisation, la lutte contre la corruption et les enjeux environnementaux. Or, on constatait déjà dans la campagne de 2018 du M5S un changement de ton par rapport à la campagne précédente, beaucoup plus contestataire, menée par Beppe Grillo. Le choix de leaders comme Luigi Di Maio et d’un discours qui insistait sur la volonté d’être une composante importante du gouvernement, notamment à travers une critique beaucoup moins forte de l’Union européenne, le traduit. Pour les électeurs du M5S, dont beaucoup sont des personnes en situation sociale difficile et en particulier dans le Sud de l’Italie, il était nécessaire d’obtenir du concret, donc il faut gouverner, et le M5S s’est donc modéré. Mais dans le même temps, ce programme social et environnemental est en opposition par rapport aux politiques néolibérales menées par le Parti Démocrate et la droite dirigée par Berlusconi et promues par l’Union européenne. On mesure donc la difficulté du M5S à pouvoir gouverner pour répondre aux attentes de ses électeurs alors que l’essentiel des forces politiques qui avaient gouverné précédemment étaient des adversaires, dont le M5S avait dénoncé les politiques et le degré considérable de corruption. Voilà donc une première explication.
« Si le M5S n’avait pas pu former un gouvernement, il y aurait eu un gouvernement technocratique qui aurait mené une politique néolibérale dure. C’était le scénario prévu par les élites politiques italiennes, qui était sur le point d’avoir lieu s’il n’y avait pas eu l’accord surprise entre le M5S et la Ligue. »
Cette volonté de résultats pour ses électeurs, nous l’avons vu à travers la loi sur le revenu de dignité [fixé à 780€/mois/personne, soit moins que le seuil de pauvreté, et avec quasi-obligation d’accepter le premier emploi venu, ndlr], une des priorités de Luigi Di Maio, la volonté de revenir sur la réforme des retraites et sur le Job Act de Renzi, etc. De toute façon, quand vous avez obtenu plus de 30% des suffrages, vous ne pouvez pas vous dérober. Qu’aurait-on dit ? Si le M5S n’avait pas pu former un gouvernement, il y aurait eu un gouvernement technocratique qui aurait mené une politique néolibérale dure. En fait, c’était le scénario prévu par les élites politiques italiennes, qui était sur le point d’avoir lieu s’il n’y avait pas eu l’accord surprise entre le M5S et la Ligue. Or, pour le M5S, une force opposée aux politiques économiques néolibérales et que je qualifierai de force de gauche contestataire, seule la droite radicale peut fournir l’allié nécessaire à la formation d’un gouvernement dans une situation de ce genre. Cette situation n’est pas sans précédent : en 2015, en Grèce, Syriza n’a pu former un gouvernement qu’en s’alliant avec une force de droite radicale, les Grecs Indépendants. Ce chemin-là est symétrique parce que la droite classique néolibérale et le centre-gauche refusent de soutenir des politiques en contradiction avec l’Union européenne et les politiques économiques qu’ils ont menées.
La deuxième question est donc : pourquoi la Ligue a-t-elle accepté ce gouvernement sous l’égide de Giuseppe Conte, qui est très proche du M5S ? D’abord, les sondages permettaient d’avoir une idée assez précise du fait probable qu’il n’y aurait pas de majorité claire, et Salvini a sans doute eu des contacts avec le M5S, ce qui est normal en campagne électorale. L’alliance de droite, entre la Ligue, Fratelli d’Italia (FdI) et Forza Italia, n’a en effet pas eu de majorité. Par contre l’événement à droite en 2018, c’est que, pour la première fois, la Ligue arrive devant Berlusconi et cette première percée a donné une responsabilité à Matteo Salvini. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il y a d’abord eu une tentative exploratoire de la part du bloc de droite, qui avait fait 37% au total et a le plus de députés, de gouverner avec un allié qui serait minoritaire dans le gouvernement, soit le M5S, soit le Parti Démocrate. Chacun des deux a dit non. Le Président de la Chambre (un M5S) a alors été chargé de tester l’hypothèse d’un gouvernement avec le Parti Démocrate. Sans surprise, celui-ci a dit non, et le Président Sergio Mattarella a alors envisagé l’option du gouvernement technique, l’option favorite de la plupart des principales élites italiennes, afin de continuer la politique précédente. Or, ni le M5S, ni Matteo Salvini n’avaient intérêt à cette solution.
En passant devant Berlusconi, Matteo Salvini a compris que la lutte contre l’immigration était un thème populaire et a voulu être en position de l’incarner pleinement. Au vu de la politique déjà très restrictive sur l’immigration du précédent gouvernement du Parti Démocrate, il est probable que ce gouvernement technique aurait mené une politique encore plus dure sur l’immigration afin de prendre à Salvini une bonne part de son électorat. Evidemment, ce gouvernement ne pouvait avoir comme cible électorale les électeurs anti-austérité du M5S, donc il n’avait pas le choix. Je pense que c’est cela qui a motivé le choix de Matteo Salvini d’aller avec le M5S, en passant un accord minimum sur les politiques économiques en échange d’une politique restrictive en matière d’immigration qu’il incarnerait en tant que Ministre de l’Intérieur.
« Après 2008, une partie des élites économiques italiennes a rompu avec le néolibéralisme habituel, notamment au niveau du libre-échange tel que défendu par l’Union européenne, en estimant que cet aspect-là n’était pas dans leur intérêt. »
C’était possible parce qu’il y avait un point de convergence économique entre la Ligue et le M5S : après 2008, une partie des élites économiques italiennes a rompu avec le néolibéralisme habituel, notamment au niveau du libre-échange tel que défendu par l’Union européenne, en estimant que cet aspect-là n’était pas dans leur intérêt. S’est donc constituée une fraction qu’on pourrait appeler “néolibérale nationaliste” dans certains milieux économiques, qui a influé sur le programme économique de la Ligue. Le point commun de la Ligue et du M5S, l’hostilité aux politiques économiques de l’UE et une volonté de relance justement de l’économie s’est bien vu dans le premier gouvernement Conte. Cette relance s’est faite à la fois par une baisse d’impôts qui favorise les électeurs de la Ligue, qui n’a certes pas obtenu autant que ce qu’elle voulait, et par une relance de la consommation via la fin de l’austérité en faveur des milieux les plus populaires, ce que voulait le M5S. Tout cela nécessitait l’affrontement avec l’Union européenne sur le premier budget, il ne faut pas l’oublier. Et l’UE a été obligée de transiger…
De plus, Matteo Salvini a su, avec beaucoup de brio je dois dire, incarner la politique anti-immigration en tant que Ministre de l’Intérieur. La presse libérale et de gauche italienne mais aussi étrangère, l’a beaucoup aidé dans ce sens puisqu’elle en a fait l’emblème du « méchant ». Or, en Italie comme ailleurs, beaucoup d’électeurs rejettent les médias et leurs discours que l’on peut qualifier de bien-pensants, et soutiennent une restriction de l’immigration. Cet effet médiatique a été magnifique pour la Ligue, qui a très vite eu une énorme progression dans les sondages, pour arriver à plus de 30% en seulement deux, trois mois. Les élections européennes n’ont fait qu’enregistrer un phénomène prévu depuis plusieurs mois. Plus intéressant, cette dynamique a démarré avant même que le gouvernement ne soit définitivement fixé, mais dès l’officialisation d’une discussion entre la Ligue et le M5S. L’alliance avec le M5S a donc fourni une caution contestataire à la Ligue, ce qui en dit long sur le rejet des électeurs italiens des élites en place. Tout cela a été très positif pour Matteo Salvini, mais ce choix était aussi très risqué, car il mettait gravement en danger l’alliance électorale de droite. Comme la stratégie gouvernementale de la Ligue était dénoncée à la fois par Berlusconi et par les Fratelli en raison de la position minoritaire de la Lega vis-à-vis du M5S, il y avait un risque de pertes électorales sur les questions économiques. Or, c’est l’inverse qui s’est produit, en particulier concernant Forza Italia, ce qui montre une nouvelle fois à quel point les politiques néolibérales classiques et les élites qui les incarnent étaient rejetées en Italie. Cette double image contestataire de Matteo Salvini, à la fois contre les élites européennes au sujet de l’immigration mais aussi au fait d’être allié avec le M5S, répondait à la demande des électeurs. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement populiste avec le M5S a été soutenu par une majorité jusqu’au bout.
LVSL – Pourquoi Matteo Salvini a-t-il rompu la coalition à la fin de l’été ? Et pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouvelles élections ?
P.M. – Parce qu’il avait obtenu une situation dominante exceptionnelle pour la Ligue. Or, la Lega, ce n’est pas « le perdreau de l’année » : elle existe comme formation importante depuis 1990 et comme formation de gouvernement, avec des hauts et des bas électoraux, depuis 1994, elle a participé à de nombreux gouvernements, a beaucoup d’élus, dirige des régions… Donc la Ligue est une force très implantée, capable de concrétiser un potentiel électoral. Pendant le gouvernement M5S-Lega, la dynamique sondagière de Salvini, vérifiée dans des élections locales, lui a permis d’attirer beaucoup d’élus locaux de droite. A mon avis, si Matteo Salvini a rompu avec le M5S, c’est qu’il s’est dit que la situation ne pouvait que se dégrader pour lui. Il espérait obtenir des élections, qu’il avait toutes les chances de gagner avec l’alliance électorale de droite traditionnelle et avec un système électoral qui n’aurait pas changé, et c’est précisément pour ça qu’il fallait rompre avant la réforme institutionnelle prévue pour le mois de septembre 2019. Cette réforme, qui comprend la réduction du nombre de parlementaires, est très populaire, donc il fallait rompre avant et trouver un prétexte pour ne pas paraître s’y opposer…
D’autre part, du fait de la position minoritaire de la Ligue dans la coalition et dans les deux chambres, Matteo Salvini savait qu’il ne pouvait pas obtenir les baisses d’impôts que voulaient ses électeurs. Il était en effet hors de question pour le M5S d’avoir un budget trop en déséquilibre, qui aurait débouché sur l’augmentation de la TVA, où le M5S aurait eu le soutien de la population contre la Ligue. Si la Lega était restée au gouvernement, elle aurait dû affronter le M5S au moment du budget et d’autre part et se heurter à ses dirigeants des régions du Nord, qui aussi réclamaient des baisses d’impôts et une diminution des transferts du Nord vers le Sud. La popularité de Salvini aurait donc décru. Avec le prétexte du désaccord sur le Lyon-Turin, sur lequel le M5S s’oppose à toutes les autres forces politiques, Matteo Salvini a pu se séparer des 5 Étoiles, même s’il était déjà en campagne, parcourait les plages, etc. depuis des mois.
Par ailleurs, Salvini était persuadé qu’il allait y avoir des élections parce que c’était la position du Parti Démocrate. Or, la surprise pour Matteo Salvini, et pour la majorité des observateurs, a été que le Parti Démocrate change son fusil d’épaule et s’oppose finalement aux élections. Le rôle de Matteo Renzi est ici fondamental: c’est ce dernier qui avait la direction du Parti Démocrate jusqu’aux élections en mars 2018, fonction qu’il a cédé au Président de la région Latium, Nicola Zingaretti, qui a gagné les primaires internes du parti. Or, Matteo Renzi et ses partisans sont majoritaires au sein du Parti Démocrate dans les deux groupes à la Chambre. Pourquoi ? Parce que c’est la direction du Parti qui fait les listes pour les élections ! Donc au moment de la rupture de Matteo Salvini du gouvernement, les renzistes au sein du Parti Démocrate savent que, s’il y a des élections, ils seraient éliminés ou très fortement diminués. Ils n’avaient donc aucun intérêt à ces élections, d’autant plus que Matteo Renzi et bon nombre de ses partisans avaient compris qu’ils n’avaient aucune chance de reconquérir le Parti Démocrate et avaient donc comme objectif de former un autre parti, hypothèse déjà envisagée publiquement et testée par les instituts de sondage italiens avant les élections européennes. La scission opérée par Matteo Renzi n’était donc nullement une surprise mais pour qu’elle soit possible, il fallait évidemment qu’il n’y ait pas d’élections. Faute de quoi les renzistes n’auraient pas eu le temps de bâtir leur parti et auraient été éliminés des listes démocrates, ce qui aurait réduit leur poids parlementaire.
« Pour le Parti Démocrate qui se présente en permanence comme le rempart anti-Salvini, après avoir fait de l’anti-berlusconisme pendant des années, comment peut-on soutenir des élections que Salvini a toutes les chances de gagner ? »
Matteo Renzi, dans la grande intelligence politique qu’on lui connaît, a donc coincé Nicola Zingaretti en seulement quelques jours après la crise provoquée par Salvini. D’une part, il semble que Romano Prodi a menacé Nicola Zingaretti en lui téléphonant avant un vote décisif au Sénat en lui laissant entendre que si le Parti Démocrate votait avec la Ligue pour des élections, Prodi le dénoncerait publiquement. D’autre part, Matteo Renzi, un peu plus tard, a publiquement déclaré qu’il était impossible de se présenter aux électeurs comme le rempart contre Matteo Salvini si on avait voté avec ce dernier pour qu’il y ait des élections. Il mettait le doigt sur la contradiction forte de la direction du Parti Démocrate : pour un parti qui se présente en permanence comme le rempart anti-Salvini, après avoir fait de l’anti-berlusconisme pendant des années, comment peut-on soutenir des élections que Salvini a toutes les chances de gagner ?
D’autant plus que Giuseppe Conte, lui, ne s’est pas incliné et a décidé de se battre devant le Parlement pour rester Premier Ministre, ce qui a mis la Ligue et une partie des démocrates au pied du mur. Les démocrates n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter un gouvernement dirigé par Conte et dominé par le M5S. Une fois la réforme constitutionnelle du vote enclenchée, il ne peut plus y avoir d’élections avant un certain temps puisque précisément ça nécessite une modification de la loi électorale… Je vous passe les détails techniques mais entre les délais de vote de la nouvelle loi électorale, d’autre part les délais de la possibilité d’organisation d’un référendum pour ceux qui sont contre, il me semble impossible qu’il y ait des élections avant mars-avril. Cela laisse tout le temps à Renzi de former son nouveau parti. Il l’a fait tout de suite, en disant que ce nouveau parti n’était pas contre le gouvernement, tout ne s’y engageant pas afin de garder ses distances. Enfin, en empêchant les élections, Renzi permet aussi à des parlementaires berlusconistes de réfléchir, son but étant de les détacher de Forza Italia et de les attirer vers son nouveau parti. Quant à la loi électorale, il est probable que la réduction du nombre de parlementaires poussera à une plus forte proportionnelle, qui serait un élément défavorable à la tentative centriste de Matteo Renzi, qui a donc besoin de nouvelles troupes.
LVSL – Jusqu’en 2018, les 5 Etoiles étaient porteurs de beaucoup d’espoirs chez les Italiens en déclassement ou menacés de l’être. Comment le M5S a-t-il évolué depuis qu’il dirige le gouvernement ?
P.M. – En fait, pour une force contestataire, on a systématiquement observé que la première expérience du pouvoir est toujours dramatique. Daniel-Louis Seiler, dans son ouvrage « Les Partis Politiques » paru en 2000, explique que, dans ce cas, deux phénomènes sont à l’oeuvre : d’une part un très fort espoir de la part des électeurs pour ce parti et de l’autre une situation difficile qui permet l’arrivée au pouvoir d’un nouveau parti contestataire. Le M5S est dans cette situation et, mis à part les municipalités de Rome et de Turin, il n’a aucune expérience de gouvernement local, aucune majorité dans aucune région… Bien sûr, il a des élus dans les régions mais ne dirige, ni ne participe à aucun gouvernement régional. Donc il y a un fossé pour ce nouveau parti entre l’ampleur des résultats électoraux, 32% des voix, auprès d’un électorat très récent qui n’a pas d’habitude de vote et ne correspond pas à des implantations locales fortes, excepté Rome et Turin, et les espoirs suscités. Tous ces éléments permettaient de prévoir des difficultés électorales et la déception qui ont eu lieu.

Par ailleurs, il faut rester prudent sur ce qui pourrait se passer lors de prochaines élections. Bien sûr, beaucoup de choses dépendront de la volonté du Parti Démocrate et de sa direction de rester dans l’alliance jusqu’à la fin du mandat de la Chambre ou de la rompre avant. Mais on ne peut pas simplement projeter le faible niveau des 5 Étoiles dans les sondages et aux élections européennes du M5S pour de futurs scrutins. La figure de Giuseppe Conte comme rempart contre Matteo Salvini peut jouer, même si on ne sait pas quel sera le lien entre ce dernier et le M5S. L’avenir du M5S se jouera aussi dans le renouvellement du personnel politique via ses règles et décisions de non-professionnalisation des élus. Il est normal qu’il y ait eu une forte déception des électeurs du M5S, mais il peut y avoir une remontée. Tout dépendra de la teneur des débats politiques.
« Pour l’instant, aucune force n’est capable de se substituer au M5S quant à la mobilisation sur l’hostilité aux politiques d’austérité. »
Les électeurs de M5S qui sont attirés dans les sondages par Matteo Salvini le sont plus par rapport à l’immigration, mais ils peuvent être remobilisés si le M5S a un bilan suffisant au point de vue économique et social via un discours du type « l’alliance de droite est une menace pour nos réformes sociales ». Jusque-là, les résultats du M5S étaient liés à la mobilisation contestataire. Beppe Grillo incarnait cela en 2013 sans être lui-même candidat. Or, même si certains électeurs ont été déçus par ces résultats qu’ils perçoivent insuffisants, il y a quand même une inflexion économique significative sur les retraites et un certain nombre de choses ont été faites comme le revenu minimum, par exemple.
Pour l’instant, aucune force n’est capable de se substituer au M5S quant à la mobilisation sur l’hostilité aux politiques d’austérité. Aucune force de gauche contestataire n’est capable de rivaliser avec le M5S et n’a profité des espoirs déçus. Le M5S est toujours perçu comme la force qui est la plus proche des préoccupations sociales. Par contre, ce n’est pas obligatoirement une bonne image dans le Nord de l’Italie où beaucoup d’électeurs sont défavorables à des transferts financiers en faveur du Sud. L’électorat du PD est un bloc très proche de celui de Macron en France, quant à la Lega, il suffit de se souvenir de son histoire…
LVSL – En face, l’alliance électorale des droites va-t-elle pouvoir se maintenir ?
P.M. – S’il y avait eu des élections précipitées, Silvio Berlusconi était prisonnier de cette alliance. Dans le système électoral actuel au scrutin uninominal, Forza Italia aurait été marginalisée, dans le Nord de l’Italie voire dans tout le pays, par la dynamique Salvini, donc il ne pouvait pas rompre. Aujourd’hui, la donne est très différente avec la très vraisemblable modification du mode de scrutin par la réforme institutionnelle. Cela dépendra aussi de la capacité qu’aura Matteo Renzi à réussir un rapprochement avec des élus de Forza Italia. Il y a aussi des dynamiques européennes, puisque Renzi joue sur le fait d’avoir voté avec Forza Italia (et le M5S) pour l’investiture de la nouvelle présidente de la Commission Européenne et parle d’une « majorité européenne ».
Avec le discours de plus en plus hostile à l’Union européenne de Matteo Salvini alors que Forza Italia demeure le représentant du PPE (dans la majorité au Parlement Européen) en Italie, une rupture peut advenir. Si la dimension majoritaire du mode de scrutin est supprimée, les élus de Forza Italia savent qu’ils risquent d’avoir leur portion congrue s’ils restent alliés à Matteo Salvini. Ils peuvent donc être incités à tenter une autre aventure, celle que leur propose Matteo Renzi en formant un parti distinct du PD, un peu comme Emmanuel Macron. Si la proportionnelle domine le nouveau mode de scrutin, l’alliance des droites est en danger.
LVSL – Et en ce qui concerne Fratelli d’Italia, quelle est la nature de ce parti et pourquoi constate-t-il une certaine dynamique ? En quoi se différencie-t-il de la Lega de Salvini ?
P.M. – L’origine de Fratelli d’Italia renvoie à la première crise politique italienne majeure, autour de 1993-1994 avec l’effondrement de la démocratie chrétienne et des socialistes (après celui des communistes un peu plus tôt). Cela avait été l’occasion pour les néo-fascistes du MSI, jusque là confinés dans l’opposition, de participer à des majorités gouvernementales, en se transformant en Alliance Nationale (Alleanza Nazionale), en renonçant à une bonne part de leur programme économique étatiste. En gros, ils se sont convertis au libéralisme et se sont ensuite directement avec Silvio Berlusconi, alliance dont la dynamique électorale leur a profité. Après la fusion de l’Alliance nationale et de Forza Italia au sein du Popolo Della Liberta, toujours dominé par Berlusconi, une minorité d’anciens de l’Alliance nationale a estimé qu’il fallait recréer un parti alors que le berlusconisme entrait en déclin. Cela a donné les Fratelli d’Italia, qui restaient dans une alliance avec Silvio Berlusconi et qui conservaient le nationalisme, d’ailleurs quand on regarde le nom, “Frères d’Italie”, c’est explicite !
« D’une certaine manière, le fait que Matteo Salvini ait rompu avec le M5S a donné raison aux Fratelli qui soutenaient sa politique migratoire mais dénonçaient son alliance avec le M5S. »
Ce parti est resté en dehors du gouvernement et a critiqué l’alliance Matteo Salvini avec le M5S, mais pas sa position hostile à l’immigration, qu’il partage. Il y a donc deux forces de droite radicale, la Ligue et les Fratelli. D’abord, la Ligue a eu une dynamique électorale spectaculaire, mais maintenant on a le sentiment que la Ligue piétine et ce sont les Fratelli qui en profitent. Ils sont aujourd’hui devant Forza Italia dans les sondages. D’une certaine manière, le fait que Matteo Salvini ait rompu avec le M5S a donné raison aux Fratelli qui soutenaient sa politique migratoire mais dénonçaient son alliance avec le M5S. Si Giorgia Meloni est moins connue que Matteo Salvini, elle commence à l’être, et son parti incarne le nationalisme depuis déjà un certain nombre d’années et auprès d’une part importante des électeurs. Malgré toutes les tentatives de Matteo Salvini, la Ligue reste très fortement marquée par ses origines autonomistes du Nord et l’héritage néo-fasciste italien a toujours été différent. Il s’agit d’accepter le jeu démocratique, tout en restant un parti très centraliste, qui défend l’unité italienne comme le faisait Mussolini. C’est d’ailleurs pour ça d’ailleurs que l’Alliance nationale était très hostile à la Ligue au début des années 1990 : Quand Silvio Berlusconi avait négocié en 1994 son alliance avec la Lega et Alleanza Nazionale, il a été obligé de faire deux alliances séparées, une dans le Nord de l’Italie avec la Ligue et sans les néofascistes de l’Alliance nationale et une dans le Sud et le centre de l’Italie avec l’Alliance nationale où la Ligue n’existait pas… Puisque la Lega reste marquée par les intérêts économiques et spécifiques qu’elle défend du Nord de l’Italie, il y aura toujours un espace politique pour les Fratelli.
LVSL – Et en ce qui concerne le positionnement des forces politiques italiennes sur l’Union européenne ?
P.M. – Au niveau des rapports avec l’Union européenne, l’abandon du discours anti-européen du M5S pendant la campagne électorale de 2018 a été confirmé. Mais entre la crise grecque, le Brexit et les difficultés allemandes, l’UE n’est plus en situation d’avoir un affrontement avec un gouvernement italien qui ne veut pas mener une politique austéritaire trop forte. Elle a elle-même été obligée d’évoluer. C’est ce contexte qui a permis la transaction entre l’UE et le premier gouvernement Conte sur le budget et qui facilite aussi la situation actuelle. De fait, les élites européennes n’ont pas intérêt à provoquer un conflit avec l’Italie, c’est la différence avec la Grèce. Le M5S n’a pas été obligé de « manger son chapeau » contrairement à ce qui s’était passé pour Syriza. Au fond, le M5S soutient désormais la Commission européenne et les politiques européennes rapprochent les composantes du gouvernement. Cela s’est concrétisé par la nomination du commissaire Paolo Gentiloni, qui a été une concession du M5S au PD, mais permet aussi à l’Italie d’avoir un poids dans la Commission européenne. Il n’y a pas du tout eu de conflit entre le gouvernement italien et la Commission européenne comme il y en a un entre le gouvernement français et le Parlement européen et cela renforce le gouvernement actuel.
« Les forces de droite radicale s’opposent entre elles : les conservateurs en Pologne et en Hongrie ne veulent pas entendre parler de répartition de migrants alors que l’Italie, qui est en première ligne, a besoin de cette solidarité. »
C’est aussi un élément qu’il faudra prendre en compte aux prochaines élections : la droite dominée par Matteo Salvini est en conflit avec les élites européennes, ce qui n’est pas obligatoirement une position de force pour lui parce que cela peut inquiéter les électeurs. De ce point de vue, il n’y a plus que les forces radicales de droite, la Ligue et les Fratelli, qui tiennent un discours d’hostilité qui peut les mettre en difficulté dans la mesure où une partie des élites italiennes hésitera. Ces rapports tendus à l’UE peuvent pousser la composante Forza Italia à rompre avec ses alliés de droite. On voit bien le calcul de Renzi, dont il est trop tôt pour évaluer les résultats. Mais tout cela dépendra aussi des évolutions au niveau européen, la rapport de Salvini à l’UE est aussi lié au fait qu’elle ne soit pas capable d’imposer une solidarité sur les migrants vis à vis de l’Italie. C’est paradoxal, mais les forces de droite radicale s’opposent entre elles : les conservateurs et la majorité des électeurs en Pologne et en Hongrie ne veulent pas entendre parler de répartition de migrants alors que l’Italie, qui est un des pays en première ligne, a besoin de cette solidarité. D’un autre côté, ça facilite par contre l’écho au niveau national l’écho des discours anti-UE des droites radicales.
Ne perdons pas non plus de vue également que l’attitude du M5S est mouvante : s’il y avait une nouvelle crise économique et financière, les rapports peuvent se durcir considérablement et cela dépendra des capacités de réaction de l’Union européenne. N’oublions pas que ce sont avec les politiques économiques austéritaires imposées par l’Union européenne, en particulier au moment du gouvernement de Mario Monti, que se situe l’origine de l’hostilité du M5S à l’UE. C’est à ce moment que le M5S a surgi comme force politique majeure. Son discours anti-européen était bien lié à une réalité d’une pression très forte de l’UE, d’Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy qui ont obligé Silvio Berlusconi à démissionner. Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans une telle situation et le M5S n’a pas pas d’opposition de caractère idéologico-nationaliste ou identitaire vis-à-vis de l’UE. Mais en cas de nouvelle crispation, tout cela peut ressurgir très rapidement.