Diplomate de carrière, ancien coordonnateur national du renseignement auprès du président de la République, et membre du Conseil d’administration d’Action contre la Faim, Didier Le Bret est aussi secrétaire général de la mobilisation citoyenne Rendez les doléances !. L’association demande au gouvernement de tenir son engagement de transparence et de rendre disponibles en ligne l’ensemble des doléances citoyennes exprimées pendant la mobilisation des gilets jaunes. Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur le contenu des cahiers citoyens et sur l’importance de rouvrir leurs pages afin de ne pas oublier les raisons profondes qui ont déclenché les mobilisations de novembre 2018, et leur caractère toujours actuel. Entretien réalisé par Lou Plaza et retranscrit par Dany Meyniel.
LVSL – Qu’est-ce qui a motivé la création de l’association « Rendez les doléances ! » ? Qui sont les membres de l’association et comment menez-vous cette mobilisation citoyenne ?
Didier Le Bret – Le point de départ est la crise que nous avons traversée avec la mobilisation des gilets jaunes. Même si ma formation et mon parcours professionnel m’ont conduit à observer le monde plus que la France, j’ai été amené à approfondir les questions sociales dans notre pays depuis plusieurs années – notamment depuis mon engagement politique comme candidat aux législatives pour le Parti socialiste. Il me semble que depuis quelques années, le thème de la précarisation s’est invité en profondeur dans notre société. Ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs membres de notre association sont aussi membres d’associations caritatives, humanitaires ou d’aides au développement. Dorian Dreuil, qui est au bureau de Rendez les doléances !, est l’ancien secrétaire général d’Action contre la Faim, le président de notre association Thomas Ribémont est également l’ancien président d’ACF et je suis membre du Conseil d’administration de cette même association.
Le moment où le président Emmanuel Macron décide de donner la parole aux gens en organisant le grand débat national a ouvert un cycle assez inédit. Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons assisté à une mobilisation citoyenne de très grande ampleur. Chacun a pu exprimer ce qu’il avait sur le cœur, ses projets, ses rêves selon différentes modalités. L’une d’entre elles a été les discussions organisées en mairie, avec la possibilité de déposer des doléances sur des cahiers ouverts par les maires.
Nous avons été nombreux à nous dire que le président avait eu du flair en redonnant la parole aux gens. C’était une bonne façon d’interrompre un cycle de violence et de se mettre à l’écoute. Il a néanmoins privilégié un positionnement très central. Il est allé lui-même dans les débats et a essayé de convaincre les gens. On a eu l’impression qu’il refaisait campagne, alors que l’attitude qui s’imposait dans ces circonstances aurait été l’écoute. De plus, le président avait annoncé que ces doléances seraient rendues publiques et qu’elles constitueraient un corpus à partir duquel les chercheurs pourraient travailler et approfondir nos connaissances sur ce qui se passe en profondeur dans notre pays.
Nous nous sommes privés d’une source importante pour comprendre une partie de notre pays.
Ni l’un ni l’autre n’a été fait : les doléances n’ont pas été mises en ligne, contrairement à l’engagement pris par le gouvernement, et elles n’ont pas pu être exploitées par les chercheurs. C’est doublement dommage. Politiquement, parce qu’il n’est jamais bon de refermer une porte quand on l’a entrouverte, et parce qu’on nous a privés d’une matière extrêmement intéressante pour comprendre la situation des classes moyennes françaises concernées par ces phénomènes de précarisation. Elles avaient des choses à dire sur toute une série de sujets : la fiscalité, le sentiment d’injustice, le type de société que l’on a développé, la ruralité, les déplacements, la santé ou encore l’éducation.
Nous nous sommes privés d’une source importante pour comprendre une partie de notre pays – je ne dis pas que c’est tout le pays –, des gens que nous n’avions pas l’habitude d’entendre, qui estimaient qu’ils avaient fait leur part de travail, qu’ils avaient joué le rôle du contrat social, ce qu’on attendait d’eux. Ils travaillent, essaient d’être actifs et de participer à la vie de notre société et finalement, ils s’aperçoivent que le contrat est rompu. Ils ont quitté les grandes villes et ont fait le choix de la campagne et des petites communes, sauf que les services publics ferment les uns après les autres : l’hôpital, les services administratifs mais aussi les commerces de proximité.
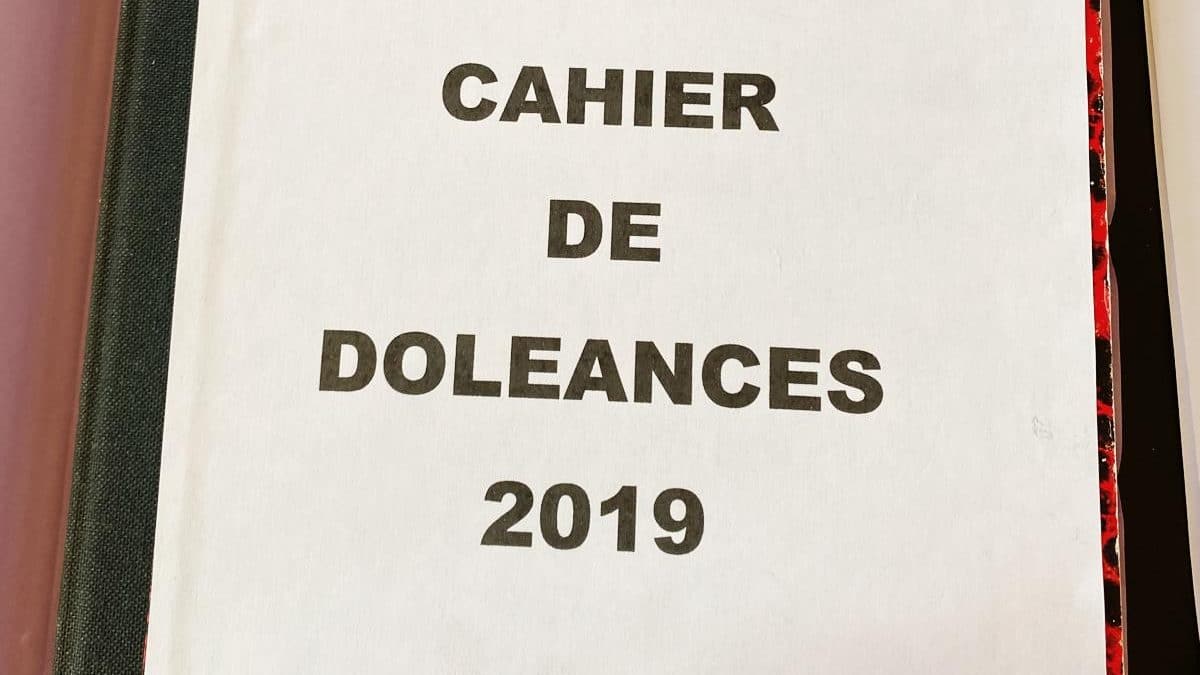
Nous avons eu une expression très forte qui venait des citoyens eux-mêmes et c’est cela qui nous intéresse. Nous avons envie de comprendre ce qu’il s’est passé et de restituer cette parole à leurs auteurs, sous une forme d’hommage. Nous nous sommes fixés un objectif à moyen terme : pour le troisième anniversaire du grand débat national en janvier 2022, nous publierons une anthologie de ces textes avec des équipes de chercheurs que nous sommes en train de structurer un peu partout en France et qui récupèrent actuellement ces doléances. Cette anthologie sera ensuite commentée. L’objectif n’est pas d’en faire une exégèse rigide et définitive mais de nous intéresser à des points de vue : de chercheurs et d’universitaires, bien sûr, mais aussi d’artistes, de collectifs citoyens comme « Démocratie Ouverte », un de nos partenaires, de revues comme Germinal, également partenaire de l’opération, ou encore d’acteurs de la vie publique. En faisant en sorte que ces textes se répondent dans un jeu de miroirs, nous souhaitons rendre compte d’une réalité que l’on a du mal à saisir.
Il s’agit de prolonger les deux débouchés politiques du grand débat national.
Cette anthologie, nous l’espérons, pourrait aussi inspirer celles et ceux qui souhaitent présider aux destinées des Français en se portant candidats. Les thématiques sont nombreuses. Je pense notamment à un thème souvent négligé : l’écologie rurale, mais aussi les transports en dehors des grandes métropoles et les interconnexions. Il s’agit de prolonger les deux débouchés politiques du grand débat national : l’agenda rural, qui n’a pas encore donné de résultats tangibles, et la Convention citoyenne pour le climat qui est une façon d’articuler l’ambition écologique aux contraintes sociales. Les gens sont prêts à manger bio mais encore faut-il que ce soit accessible. Tout le monde serait ravi de se débarrasser de sa vieille voiture diesel mais encore faut-il que les voitures électriques soient abordables. Tout le monde rêve de rénover son appartement et de faire des économies d’énergie mais encore faut-il que des dispositifs soient en place. Cette démarche me paraît vraiment centrale pour arriver à comprendre ce qui se passe dans notre pays mais aussi pour pouvoir y répondre.
LVSL – Au-delà de la synthèse produite par des cabinets privés pour le gouvernement, que contiennent ces cahiers de doléances ? À partir des premières analyses que vous avez menées de ces cahiers citoyens, quelles sont les thématiques récurrentes ?
D. L. B. – Les bilans réalisés par les cabinets privés ont concerné essentiellement le bloc des quatre thématiques proposées dans la lettre de cadrage d’Emmanuel Macron, dans laquelle d’entrée de jeux étaient exclues certaines questions. Il était clair par exemple qu’étaient hors champ le retour de l’ISF, une hausse du SMIC et que la CSG ne serait pas non plus revue.
Il y a des sujets qui reviennent massivement, notamment la question de l’ISF. Cette question ne revient pas tellement parce-que les Français pensent que ça va remplir à nouveau les caisses de l’État […] mais parce que c’est une question de justice sociale.
Que voit-on quand on regarde les doléances ? Il y a des sujets qui reviennent massivement, notamment la question de l’ISF. Cette question ne revient pas tellement parce-que les Français pensent que ça va remplir à nouveau les caisses de l’État – ils ne se font pas d’illusion sur le fait que ce n’est pas une source fiscale majeure pour le budget de l’État – mais parce que c’est une question de justice sociale. Ils considèrent qu’à un moment où les inégalités se creusent, avoir décrété une flat tax sur l’impôt sur les sociétés et avoir privilégié une fois de plus la fiscalité financière des dividendes au détriment du patrimoine – puisque la réforme de l’ISF visait à réduire l’assiette et à prendre en compte uniquement les actifs immobiliers – disait de manière très claire où se trouvait le curseur idéologique de la politique de Macron. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que la question de l’ISF soit omniprésente !
Les gens ont le sentiment de ne pas être représentés au point d’être invisibles, de se sentir muets, voire méprisés.
On trouve aussi beaucoup de doléances qui sont liées aux problèmes de représentation : politique, bien sûr, mais aussi symbolique. Les gens ont le sentiment de ne pas être représentés au point d’être invisibles, de se sentir muets, voire méprisés. Dans les deux sens du terme, leur voix ne porte pas. Cela se retrouve dans la problématique lancinante de l’éloignement. C’est d’ailleurs pour cela que la crise des gilets jaunes a démarré avec les questions de transport et de hausse du prix du diesel. Au fond, le véhicule est le seul lien qui reste pour les gens éloignés des métropoles, à la fois centres d’emplois, centres administratifs, mais aussi centres culturels et épicentres de la vie sociale. Cet éloignement leur donne le sentiment qu’ils sont dans un espace qui n’est plus tout à fait l’espace commun, partagé par l’ensemble des Français.
Ensuite il y a bien sûr beaucoup de doléances qui portent sur le pouvoir d’achat et la difficulté à joindre les deux bouts. Il est intéressant de constater que ce n’est pas lié au fait, contrairement à ce que l’on l’entend parfois, que les Français de milieu modeste seraient de mauvais gestionnaires. C’est simplement que leurs marges de manœuvre sont singulièrement réduites. Lorsque vous avez payé le loyer, les abonnements d’eau, de gaz, de téléphone, les assurances et les frais de scolarité, ils sont nombreux à dire qu’il ne leur reste plus grand-chose pour vivre. Ces témoignages sont souvent plus parlants que des statistiques froides et globales. Corollaire de cette paupérisation des classes moyennes, la mondialisation est fortement contestée : les gens ne croient pas à la théorie du ruissellement, ils ne voient pas les effets positifs de la mondialisation. Bref, ils se décrivent un peu comme les oubliés de la fête.
Le gouvernement a tiré les conclusions qui l’arrangeaient.
LVSL – Techniquement, comment les chercheurs font-ils pour analyser ces cahiers citoyens regroupant plus de 600 000 pages ? Comment est-il possible de saisir l’ensemble des contributions et d’en tirer un bilan plus exhaustif que celui réalisé par le gouvernement ?
D. L. B. – Pour l’instant, c’est difficile, nous n’avons pas de vision globale. Dans tel département nous pouvons étudier les doléances en profondeur mais cela ne donne pas une image à l’échelle du pays. Il faudra continuer de faire remonter les données. En revanche, en pratiquant des « coups de sonde », nous pouvons saisir des éléments qualitatifs, apprécier et entendre telle ou telle tendance. Faire du traitement de données, à partir de mots clés, c’est indispensable. Mais mettre en relief des données qualitatives, s’attacher à faire des analyses fines, voir la façon-même dont les gens expriment ces doléances, est aussi riche d’enseignements.
D’ailleurs, beaucoup de chercheurs étaient assez remontés contre la méthodologie retenue par les cabinets de conseil pour le compte du gouvernement. Leur approche ne rendait pas compte de la réalité, d’autant plus dans les délais impartis par le gouvernement. Les conclusions ont été restituées seulement deux mois après la fin du grand débat. La plupart des chercheurs ont doucement rigolé, cela n’avait pour eux aucune valeur scientifique et au fond, le gouvernement a tiré les conclusions qui l’arrangeaient.
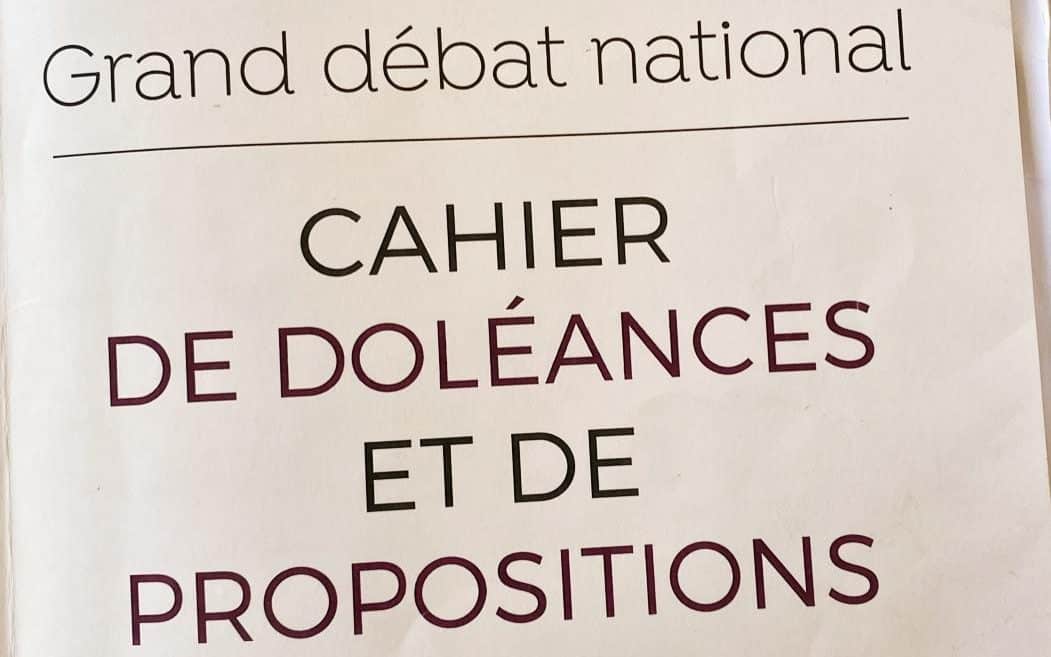
LVSL – Comment expliquer que le gouvernement n’a toujours pas rendu accessibles à tous en ligne les doléances des citoyens ? Sébastien Lecornu, alors ministre en charge de l’animation du grand débat national, disait : « Tout doit pouvoir être consulté par tout le monde. Tout en transparence ». Comment explique-t-on ce revirement ?
D. L. B. – Il me semble que c’est un mélange de plusieurs éléments. Premièrement, il y a eu la volonté d’en finir, de ne pas relancer le débat et de partir du principe que tout ce qu’on pouvait dire sur le sujet avait été dit, c’était une façon de passer à autre chose. Entretemps il y a eu le Covid, et nous sommes effectivement passés à autre chose. Il y a aussi eu des maladresses techniques. Les départements ont numérisé et remonté les archives au ministère de la Culture qui les a remises à la BNF et/ou aux archives de France. Un microfilmage de l’ensemble des archives a donc été fait département par département et serait en théorie tout à fait disponible.
Mais les départements ont ensuite reversé physiquement les archives recueillies par les communes dans les centres d’archives départementales. Les archivistes ont donc mis en œuvre les règles qui s’appliquent. Donc, si vous voulez les consulter, vous prenez rendez-vous et vous le faites sur place. Pour la partie des doléances nominatives, comportant des noms, des adresses, vous devrez patienter…. cinquante ans ! Ce qui est un peu dommage pour des études contemporaines. Et si vous voulez une dérogation, il faut la demander au département qui saisira le ministère de la Culture, donc dans dix ans nous y sommes encore.
Vous ne pouvez pas à la fois solliciter l’intelligence collective des Français et, quand cela ne vous arrange pas, ou plus, passer à autre chose.
Tout a été fait pour que, consciemment ou non, l’affaire soit enterrée. Notre ambition est donc de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. La parole politique, à force d’être reniée et à force de se dédire, finit par perdre de sa crédibilité. Vous ne pouvez pas à la fois solliciter l’intelligence collective des Français et, quand cela ne vous arrange pas, ou plus, passer à autre chose. La démocratie participative n’est pas un gadget. Nous avons plus que jamais besoin de faire vivre notre démocratie entre deux élections. Ce moment d’expression des doléances était une occasion en or. Il est dommage que le gouvernement s’en soit privé.
LVSL – Sur cette question de faire vivre la démocratie entre les moments électoraux, vous dites justement que ces doléances permettraient d’« imaginer le “monde d’après” et (de) contribuer à refaire des citoyens des acteurs de leur destin ». Pensez-vous que les citoyens auraient la volonté de se saisir de ces doléances si elles étaient rendues accessibles ? Quelle utilité peuvent avoir les doléances dans ce « monde d’après » ?
D. L. B. – Je ne sais pas si c’est aux citoyens de s’en emparer, mais c’est aux citoyens de décider eux-mêmes de ce qu’ils veulent en faire. Il s’agit donc d’avoir au moins la possibilité d’en disposer. Ensuite c’est l’affaire de ceux qui, dans le cadre de la compétition électorale politique, ont envie de s’emparer de cette masse d’informations pour en faire quelque chose. Ces doléances aident par exemple à comprendre l’urgence d’avancer dans l’agenda rural. Quand vous analysez les scores du Rassemblement national dans certaines régions, vous êtes frappés de voir la concomitance entre l’éloignement physique des gens de la première gare et ces scores. Il y a donc des éléments très concrets, pas seulement dans l’imaginaire des gens, mais dans leurs vies. Des formes d’éloignement, de coupures qui isolent les personnes. Des choix ont été faits, comme la privatisation d’un ensemble de services publics et le fait de vouloir rentabiliser à tout prix les services publics.
Vous avez des friches industrielles partout. Ce sont des pans entiers de vie détruits petit à petit. Il est important d’entendre ces messages au travers des doléances.
On peut prendre pour exemple la privatisation du rail, au motif que les petites lignes ne servaient plus à rien. Quand vous regardez la diagonale qui traverse tout le pays d’Ouest en Est, vous vous rendez bien compte qu’elle suit exactement la trajectoire de la désertification de nos territoires en hôpitaux, en services publics, en commerces de proximité, ou encore en dessertes ferroviaires. Tout est lié. Ces doléances donnent un socle et une légitimité à ceux qui disent que les TGV n’épuisent pas le besoin qu’on a de pouvoir desservir aussi de plus petites communes. Quand vous quittez Paris pour aller à Nevers, vous traversez des villes qui ont perdu en moyenne près de 10% de leur population au cours des dix dernières années. C’est terrible. Vous avez des friches industrielles partout. Ce sont des pans entiers de vie détruits petit à petit. Il est important d’entendre ces messages à travers les doléances.
LVSL – Au-delà du travail d’analyse des doléances et du constat que vous portez, y a-t-il une volonté de votre part de donner une suite politique à ces expressions citoyennes ? Dans le cadre des élections de 2022, comment ces cahiers de doléance pourraient-ils intervenir dans les programmes des candidats ?
D. L. B. – Il est important d’abord de poursuivre le dialogue qui a été interrompu. Tout n’a pas été dit, donc il s’agit de partir de ce qui a été dit pour prolonger cette première expression, et envisager quels peuvent être les débouchés programmatiques, tout en continuant d’approfondir le sujet avec les Français. Ensuite sur la base des doléances et du dialogue qui pourrait être établi, il est effectivement possible d’intégrer tout, ou partie, de ces revendications dans un programme tourné vers celles et ceux qu’on a tendance à oublier. Il me semble qu’il existe un vrai potentiel – pas seulement électoral dans le mauvais sens du terme – pour restaurer une écoute là où elle est déficiente. C’est un outil qui peut être au service d’une campagne et d’un programme.
LVSL – Quels sont les prochains événements que vous menez dans le cadre de la mobilisation ? Vous avez évoqué une anthologie de textes dans le cadre du troisième anniversaire du grand débat national…
D. L. B. – La publication de cet ouvrage en janvier 2022 est un point d’arrivée médian. Notre souhait entretemps est de continuer à structurer des regroupements de chercheurs dans toutes les régions, en fonction des thématiques qui les intéressent, afin de nourrir cette réflexion. Nous souhaitons également organiser des rencontres en région dans le but de prolonger ces discussions. Nous pouvons aussi imaginer de retourner voir les Français qui ont pris la peine de passer deux ou trois jours, pour certains d’entre eux, à aller dans les mairies où ils ont discuté de thématiques très sérieuses. Il serait intéressant, deux ans plus tard, de leur demander ce qu’il s’est passé depuis, ce qui a changé dans leurs vies. Ce serait une façon de montrer qu’il existe des structures citoyennes qui essaient d’aller à leur rencontre et de faire vivre le débat.

































