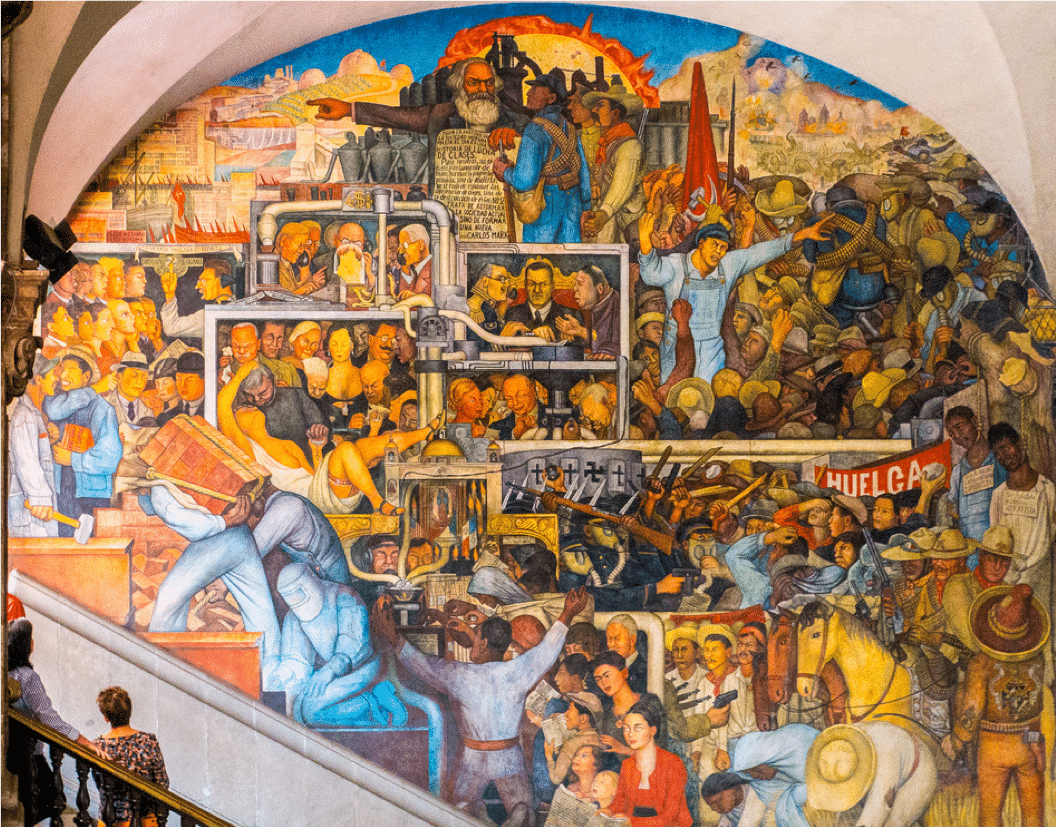Après bientôt cinq ans au pouvoir, quel bilan peut-on tirer de l’action d’AMLO au Mexique ? Si des critiques peuvent être faites sur plusieurs questions majeures, comme l’égalité homme-femme, la gestion des frontières ou l’impact écologique des grands projets, l’action du président est globalement perçue favorablement par près de deux tiers des Mexicains. Sa lutte acharnée contre la corruption, la reconstruction progressive de l’État et des services publics en écartant le secteur privé parasite et les nombreuses mesures sociales redonnent confiance aux électeurs, qui espèrent un avenir meilleur. Si le régime néolibéral mexicain n’est pas encore mort, la détermination d’AMLO pour construire un État au service du peuple semble en passe de réussir. Article du sociologue Edwin Ackerman pour la New Left Review, traduit par Piera Simon-Chaix.
Le 1er juillet 2018, le paysage politique mexicain a connu un véritable bouleversement avec la victoire électorale éclatante du candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sous les couleurs de son nouveau parti MORENA, avec 53 % des votes, soit une avance de trente points sur le plus proche de ses trois concurrents. Une telle marge est, de loin, la plus importante observée dans le pays depuis la « transition démocratique » du tournant des années 2000. Les partis qui avaient dominé le champ politique au cours de la période néolibérale se sont littéralement effondrés. Cinq ans plus tard, les sondages sont toujours favorables à 60 % au président, en dépit de l’hostilité constante de la presse et d’une pandémie ayant débouché sur une crise économique et une hausse de l’inflation. Les partis d’opposition ont mis de côté leurs anciennes rivalités et le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), le Parti d’Action Nationale (PAN) et le Parti de la Révolution Démocratique (PRD) n’ont eu d’autre choix que de s’allier au risque de voir disparaître tout espoir de victoire électorale.
Si le conflit d’AMLO avec la droite néolibérale n’a rien de surprenant, le rejet dont il fait l’objet de la part de l’intelligentsia cosmopolite et « progressiste » ou des autonomistes néozapatistes (mouvement social mexicain pour l’autonomie des peuples indigènes, qui contrôle en partie la région du Chiapas depuis 1994, ndlr) a davantage surpris. Cette réaction est pourtant intéressante, car directement liée aux particularités du populisme de gauche qui a marqué le mandat d’AMLO. Peu originale, la droite l’a accusé de « transformer le pays en un autre Venezuela ». Mais pourquoi ces autres groupes, supposés appartenir également à la gauche, lui reprochent-ils de colporter le « conservatisme » ou d’agir en « suppôt du capital » ? Alors que la fin du mandat présidentiel se profile, le bilan d’AMLO est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Son projet global consistait à rompre avec le néolibéralisme et à embrasser un modèle de capitalisme développementaliste, c’est-à-dire dans lequel l’État serait bien plus présent. Dans quelle mesure ce projet a-t-il fonctionné, et quelles leçons la gauche peut-elle en tirer ?
Le projet global d’AMLO consistait à rompre avec le néolibéralisme et à embrasser un modèle de capitalisme développementaliste, c’est-à-dire dans lequel l’État serait bien plus présent.
Tout d’abord, il faut rappeler que la transition vers un autre régime d’économie politique s’opère au sein d’un paysage structuré par le néolibéralisme lui-même. Ce paysage se caractérise par l’érosion de la classe ouvrière comme acteur politique et par le démantèlement de la puissance étatique. La tâche historique fondamentale de la gauche contemporaine consiste donc à relégitimer la lutte des classes et l’État en tant qu’acteur social. En partant de ce postulat, nous pouvons évaluer l’administration AMLO à l’aune de trois critères fondamentaux : la réhabilitation du clivage entre les classes sociales comme organisation de base du champ politique ; les efforts déployés pour recentraliser la puissance de l’appareil étatique phagocytée par des décennies de gouvernance néolibérale et la rupture avec un paradigme économique fondé sur la corruption institutionnalisée. Penchons-nous successivement sur chacun de ces critères.
Une politique sociale vigoureuse
En mai 2020, alors que la droite lançait sa première vague de protestation contre le gouvernement AMLO, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montrait une foule de manifestants issus des classes supérieures en train de défiler en voitures sur la plus grande avenue de Monterrey, dans l’État de Nouveau León. Par la fenêtre d’un bus public, un passager anonyme harangue les conducteurs protestataires : « Voilà ce qui fait avancer le Mexique ! », lance-t-il. « Les travailleurs font avancer le Mexique ! » Nombreux sont ceux qui ont vu dans cette vidéo un renouveau de la lutte des classes, après une longue absence.
À peine quelques mois après son investiture, AMLO annonçait la mort du néolibéralisme mexicain. Il s’agissait d’une déclaration audacieuse, relevant davantage du vœu pieux que d’un fait accompli. Les premiers sursauts étaient donc rhétoriques. Jusqu’alors, les discours politiques tournaient autour de la division entre l’État et une « société civile » vaguement définie. Les autorités publiques prenaient note de la nécessité croissante d’améliorer le « contrôle citoyen » de la « gouvernance ». La lutte des classes avait quasiment disparu des discours dominants. Elle a pourtant ressurgi sous AMLO, qui, s’inspirant des théories populistes d’Ernesto Laclau, a organisé son discours autour d’une confrontation entre « le peuple » et « les élites » (moqueusement surnommés fifis et machuchones), ces dernières se définissant par leur richesse, l’autopersuasion de leur méritocratie et leur dédain pour la culture populaire.
Cette évolution rhétorique s’accompagne d’une vaste reconfiguration du paysage politique. Lors des élections de 2018 (où les Mexicains élisaient à la fois leur président, leurs députés, leurs maires et leurs élus provinciaux, ndlr), les votes de la classe ouvrière se sont éparpillés entre plusieurs partis, y compris ceux du bloc néolibéral, tandis qu’AMLO a bénéficié d’un fort soutien des professionnels des classes moyennes. 48 % des électeurs détenteurs d’un diplôme universitaire ont alors soutenu les candidats à la députation de MORENA. À la mi-mandat, en 2021, ce chiffre est tombé à 33 %. L’inverse s’est produit à l’autre extrémité de la fourchette des diplômes : 55% des personnes ayant achevé une scolarisation primaire ont voté pour MORENA en 2021, contre 42 % trois ans plus tôt. Un récent sondage a montré que les plus fervents partisans d’AMLO sont des travailleurs ordinaires, le secteur informel et la paysannerie, tandis que ses plus virulents opposants sont les entrepreneurs et les professionnels diplômés. Ainsi, le phénomène de la « gauche brahmane », une expression de Thomas Piketty désignant une gauche repliée sur les électeurs éduqués de classe moyenne, observé aux États-Unis ou en Europe, n’a pas court au Mexique.
Le phénomène de la « gauche brahmane », c’est-à-dire repliée sur les électeurs éduqués de classe moyenne, n’a pas court au Mexique.
Comment expliquer un tel renversement de situation ? Les quatre dernières années ont vu passer une avalanche de réformes en faveur des employés. Les droits formels des employés domestiques ont été reconnus pour la première fois et les pratiques d’embauche irrégulières ont été abolies. En conséquence, 2022 a connu une augmentation de 109% des reparto de utilidades, ces intéressements auxquels tous les employés ont formellement droit, mais que leurs employeurs pouvaient jusqu’alors contourner en les « sous-traitant ». Sous AMLO, la procédure de formation de nouveaux syndicats a été considérablement simplifiée, le nombre de jours de congés payés a doublé et le législateur se penche actuellement sur la semaine de quarante heures (contre quarante-huit heures actuellement). L’administration AMLO a mis en œuvre la plus importante augmentation des salaires de ces quarante dernières années. Avant la crise économique causée par le confinement, la section la plus pauvre de la population a connu une augmentation de ses revenus de 24%.
Par ailleurs, cette situation s’est accompagnée d’une tentative de résurgence de la classe ouvrière comme acteur politique. L’exemple le plus patent en est peut-être le soulèvement des ouvriers de la maquiladora (manufacture américaine délocalisée au Mexique, généralement vers la frontière avec les USA, ndlr) de Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, où des dizaines de milliers d’employés ont lancé la grève sauvage la plus importante de l’histoire de ce secteur. Enhardis par l’augmentation du salaire minimum, les ouvriers ont réclamé des augmentations des autres intéressements. Leurs employeurs refusaient en effet que les primes n’augmentent à la même proportion que les salaires. Le mouvement permit d’augmenter le nombre de syndiqués et d’envoyer au Congrès l’une des meneuses de la grève, Susana Terrazas, sous l’étiquette MORENA.
La centralité des programmes sociaux dans l’approche d’AMLO est venue renforcer cette nouvelle politique de classe. Les allocations touchent à présent 65 % de personnes de plus que sous le gouvernement précédent. En 2021, malgré la crise économique, les dépenses sociales ont atteint une proportion record des dépenses totales de l’État depuis des dizaines d’années. Ce modèle d’aide sociale fonctionne selon une logique entièrement différente de l’ancienne logique néolibérale : il ne s’agit plus de faire du microciblage et de prendre en compte des critères de revenus, mais d’embrasser une approche plus universelle. Même si les transferts d’espèces sont toujours réservés à d’importants sous-groupes (personnes de plus de soixante-cinq ans, étudiants, personnes handicapées, etc.), les conditions pour y avoir accès sont minimales. De plus, les programmes d’aide sociale ont été inscrits dans la Constitution, afin de garantir qu’il s’agit bien d’un droit et non d’actes de charité.
À l’autre bout du spectre politique, les partis supplantés par MORENA ont formé une coalition qui a ouvertement proclamé sa fidélité aux grandes entreprises. Des magnats comme Claudio X Gonzalez et Gustavo de Hoyos, anciens dirigeants de la confédération patronale, ont joué un rôle crucial dans le financement de l’opposition et pour orienter les sujets mis en avant. Le secteur entrepreneurial, en plus de dénoncer les lois pro-travailleurs d’AMLO, s’est farouchement opposé à sa nouvelle approche fiscale. Même si le gouvernement a plutôt suivi une ligne orthodoxe sur les questions macroéconomiques, il a malgré tout engagé un vaste effort afin d’augmenter la capacité étatique de recouvrement de l’impôt, c’est-à-dire de lutte contre la fraude fiscale, sujet sur lequel le Mexique se classait historiquement sous les moyennes de l’OCDE et de l’ALC (Amérique latine et Caraïbes). Sans toucher à la structure actuelle de taxation, ces mesures ont eu des conséquences significatives en matière de redistribution. Selon les chiffres officiels, le gouvernement a augmenté le recouvrement de l’impôt des plus riches contribuables du pays de plus de 200 %. Raquel Buenrostro, l’ancienne secrétaire de l’Administration fiscale et actuelle secrétaire à l’Économie d’AMLO, a ainsi été décrite par le Financial Times comme une « dame de fer » faisant claquer son fouet sur les impôts des multinationales.
Parallèlement, le désaveu de certaines sections des classes moyennes diplômées vis-à-vis d’AMLO est un reflet de leur rejet de la grande narration nationale que le président a érigée au fil de ses conférences de presse quotidiennes. Alors que sous les gouvernements précédents, les personnalités du monde universitaire étaient garantes de la respectabilité et de l’autorité, les appels à l’« expertise » sont à présent considérés comme des stratagèmes de marketing politique vides de sens. Les ministres sont salués pour leur « proximité avec le peuple » et non pour leurs titres et leurs distinctions.
AMLO s’est exposé aux critiques des cercles progressistes, composés en majorité des classes diplômées, pour son désintérêt sur la question du mariage homosexuel ou de l’avortement. Le président a refusé de prendre position sur ces questions, proposant plutôt de les soumettre à un référendum populaire. Ces reproches sont néanmoins discutables car des avancées significatives ont eu lieu sur ces questions à l’échelle des provinces, en particulier celles contrôlées par le parti MORENA.
Le président s’est également aliéné le mouvement féministe combatif qui a émergé en 2019 en réaction à la persistance des féminicides au Mexique. D’emblée, AMLO a paru davantage impliqué dans la dénonciation d’une campagne soi-disant orchestrée par la droite (qui a effectivement tenté de phagocyter le mouvement) plutôt que dans la recherche de réponses aux problèmes soulevés. Il a critiqué les tactiques d’action directe des mobilisations récentes et salué le travail des soignantes d’une manière que beaucoup ont interprété comme de la condescendance masculine. Même si le président s’est attaché à une politique de stricte parité lors de la sélection des membres de son gouvernement, ses détracteurs féministes considèrent, de manière compréhensible, que son action ne s’attaque pas suffisamment aux hiérarchies genrées du pays.
Reconstruire l’État mexicain
En parallèle de ces réformes en matière de répartition des richesses, l’une des priorités de l’administration AMLO a consisté à inverser la tendance à l’affaiblissement de l’État. Ce processus a pris différentes formes. Tout d’abord, les fonctions gouvernementales jusqu’alors sous-traitées à des entreprises privées ou semi-privées ont été réintégrées au sein de l’État. La sous-traitance des services publics a été abolie dans le but de les réintégrer au sein des institutions étatiques centralisées. Le gouvernement s’est également débarrassé des établissements financiers qui géraient les fonds publics de manière très opaque et discrétionnaire, rapatriant ces fonds dans le giron des ministères.
Ce renforcement de l’État s’est accompagné d’une série de méga-projets d’infrastructure, pilotés par l’État, de l’annulation de projets privés comme l’aéroport de Texcoco et de l’expropriation des compagnies privées sur certains tronçons ferroviaires. Les projets de construction les plus importants d’AMLO sont l’aéroport de Felipe Angels, le train maya autour de la péninsule du Yucatán, un corridor de transport pour relier le golfe du Mexique à l’océan Pacifique, l’amélioration des routes rurales et un plan de reforestation de grande ampleur. Ces plans sont mis en avant pour leur capacité à générer des emplois grâce aux chantiers publics et comme une manière de remédier à l’échec de la doctrine du laissez-faire.
La souveraineté énergétique a pour sa part reçu une attention spéciale du gouvernement AMLO, qui a tenté de réorganiser l’entreprise pétrolière étatique PEMEX et l’a transformée en un moteur de croissance. Le gouvernement s’est également employé à limiter, quoique modestement, le pouvoir des entreprises minières étrangères. Une nouvelle législation sur les hydrocarbures permet à présent de révoquer les permis des entreprises privées qui commettent certaines violations, tandis qu’une loi relative à l’industrie de l’électricité vise à augmenter l’énergie générée par la CFE, l’entreprise d’électricité contrôlée par l’État, en limitant les exigences d’approvisionnement en électricité auprès du secteur privé. Ces deux mesures cherchent à renforcer la position relative du secteur public et à inverser l’effet des réformes néolibérales. Le gouvernement a récemment réaffirmé son engagement par l’acquisition de treize centrales électriques jusqu’ici détenues par l’entreprise énergétique Iberdrola.
Malgré le volontarisme d’AMLO, l’atrophie de l’État avant sa prise de fonction était si forte que certaines de ses politiques les plus ambitieuses ont été difficiles à mettre en œuvre.
Malgré ce volontarisme, l’atrophie de l’État avant la prise de fonction d’AMLO était si forte que certaines de ses politiques les plus ambitieuses ont été difficiles à mettre en œuvre. Le Mexique n’a ainsi pas encore surmonté sa dépendance aux partenariats publics-privés. Il a été contraint de recourir à l’infrastructure administrative de la Banco Azteca, détenue par le magnat des médias Ricardo Salinas Pliego, pour mettre en œuvre ses programmes de transfert d’espèces. Il existe bien un plan pour que les banques publiques prennent à leur charge cette responsabilité, mais la transition est lente. Le projet d’infrastructure qui porte la signature d’AMLO, le train du Yucatán, est détenu par l’État, mais il repose en partie sur des partenariats publics-privés. Des services qui étaient auparavant sous-traités par le gouvernement, comme la garde d’enfants, ont été fermés dans la perspective d’en reprendre la gestion, mais ils n’ont pas tous été remplacés, ce qui signifie que les bénéficiaires doivent utiliser des coupons de l’État pour payer ces services essentiels sur le marché privé. À cause du manque de personnel dans les administrations, AMLO est devenu de plus en plus dépendant de l’armée pour élaborer et gérer un bon nombre de ses projets d’infrastructures.
L’autre point sur lequel l’État mexicain peine à retrouver sa pleine puissance concerne l’endiguement de la violence liée aux cartels de la drogue. Pour contourner les corps de police corrompus, AMLO a créé une nouvelle Garde nationale, composée de membres de l’armée et de nouvelles recrues. Certains y voient une militarisation de la vie publique et ont également souligné qu’AMLO autorisait le recours à des mesures répressives le long de la frontière Sud, où les caravanes de migrants d’Amérique centrale sont souvent interceptées par la force. Il s’agit là d’une capitulation face à l’incessante demande des États-Unis – de la part de Trump, mais aussi d’Obama et de Biden – que le Mexique arrête les flux de demandeurs d’asile avant qu’ils n’atteignent le sol américain.
Comme ses prédécesseurs, AMLO a accepté ces restrictions à la souveraineté nationale, sans doute pour pouvoir l’utiliser comme levier dans ses négociations avec son voisin septentrional. Le président a dépensé une énergie considérable pour empêcher les caravanes d’atteindre les États-Unis : en offrant des visas de travail mexicains, en réclamant un « plan Marshall pour l’Amérique centrale » et en fermant les yeux lorsque la police s’engageait dans de brutales reconduites à la frontière. Dans ce domaine, son bilan global est désastreux, à l’exception notable de son refus d’approuver la tentative de Trump de faire entrer le Mexique sur la liste des « pays tiers sûrs », ce qui aurait quasiment empêché tous les réfugiés d’Amérique centrale de demander l’asile aux États-Unis.
« Austeridad republicana »
Mais la reconstruction de l’État ne pourra se faire sans lutte acharnée contre la corruption qui ronge le Mexique. Dans son discours d’investiture en décembre 2018, AMLO présentait celle-ci comme la caractéristique distinctive du néolibéralisme. Selon le président, le néolibéralisme n’est pas simplement une contraction de l’État, mais plutôt son instrumentalisation au service du marché. Le Mexique a ainsi été transformé en une sorte d’économie rentière inversée où tout un réseau d’entreprises privées siphonne l’argent des coffres publics en recourant à des mécanismes légaux et illégaux : privatisation, sous-traitance, surfacturation de services et création d’entreprises fantômes pour bénéficier de contrats étatiques et pratiquer l’évasion fiscale.
Cette conception du néolibéralisme comme une économie politique de la corruption a servi de boussole aux objectifs de dépenses publiques d’AMLO. Le concept principal sur lequel repose son gouvernement est contre-intuitif : il s’agit de l’austeridad republicana, ou « austérité républicaine », c’est-à-dire une réorganisation et une recentralisation des dépenses publiques, avec pour objectif de mettre un terme aux abus venus d’en haut. Dans la mesure où le néolibéralisme mexicain s’enracine dans les liens étroits entre l’État et les entreprises privées, l’austérité est vue comme une manière de briser ces liens, de se défaire du joug des entreprises parasites dont les profits dépendent des largesses gouvernementales.
Sur le long terme, une adhésion stricte à l’austeridad republicana peut rendre difficile, sinon impossible, la création d’un système d’aide sociale robuste. Mais pour l’instant, cette stratégie est parvenue à rendre sa légitimité à l’État après des décennies de copinage et de clientélisme. La peur de voir cette stratégie entraîner des licenciements de masse s’est dissipée. En plus des dépenses à grande échelle pour les travaux publics et les transferts d’argent, des secteurs comme les sciences, l’éducation et la santé ont vu leurs budgets augmenter, quoique de manière restreinte. Néanmoins, le problème le plus urgent que posent les restrictions fiscales imposées par AMLO est qu’elles rendent toute réforme de l’imposition à grande échelle plus difficile, puisque la gauche n’a d’autre choix, pour atteindre ses objectifs, que de rendre ses dépenses plus efficaces : rééquilibrer le budget plutôt que redistribuer la richesse.
Quel bilan peut-on tirer de son action au bout de cinq années ? Les détracteurs de gauche d’AMLO reconnaissent de nombreuses avancées, mais critiquent la faiblesse de sa politique d’égalité femme-homme, sa gestion des frontières et ses programmes d’austérité. Néanmoins, ils ne sont pas parvenus à construire une alternative sérieuse à MORENA. Jusqu’à présent, les critiques de gauche à l’encontre d’AMLO sont l’apanage de l’intelligentsia « progressiste », qui a été absorbée à son tour par le bloc d’opposition dominé par les élites. Le mouvement autonomiste zapatiste se désintéresse, lui, de toute tentative de prendre le pouvoir étatique. Ayant abandonné ce terrain il y a bien longtemps, il se concentre davantage sur l’opposition à certains projets, sans résultats probants.
Si les critiques formulées à l’encontre d’AMLO sont légitimes, toute analyse sérieuse de son bilan doit prendre en considération les difficultés inhérentes à la relance d’un État providence doté d’un appareil administratif décrépit et la nécessité de rebâtir la classe ouvrière en tant qu’acteur collectif. L’administration actuelle souffre, bien sûr, de nombreuses incertitudes et contradictions. À quel point le néo-développementalisme et les grands projets d’infrastructures sont-ils viables dans le contexte de la crise climatique ? Est-ce qu’une imposition progressive peut fonctionner alors que la croissance stagne ? Avec quelle rapidité le pays peut-il se sevrer des investissements étrangers ? De telles questions se posent d’ailleurs à la gauche dans le monde entier. Quels que soient les défauts des réponses apportées par AMLO, sa tentative de rompre avec le néolibéralisme est en tout cas déterminée.